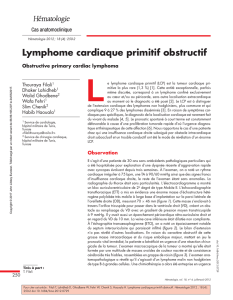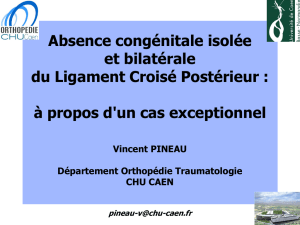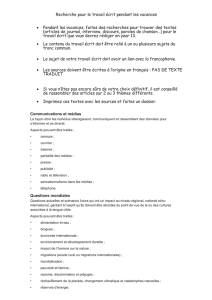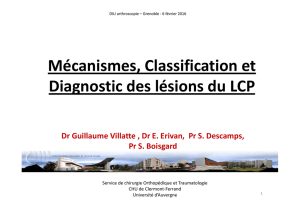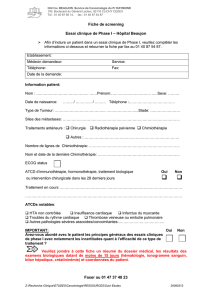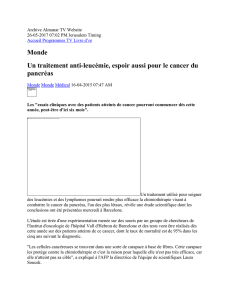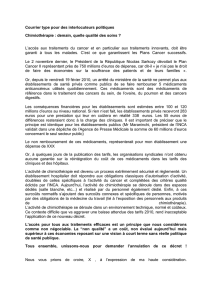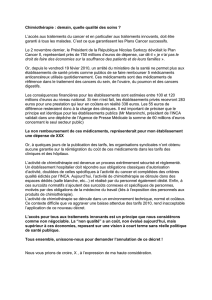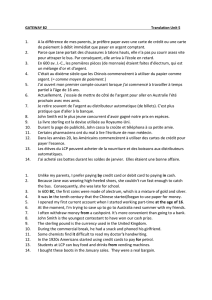Lire l'article complet

Correspondances en Onco-hématologie - Vol. IV - n° 2 - avril-mai-juin 2009
66
66
dossier thématique
Coordinateur : S. Choquet
Les lymphomes cérébraux
primitifs chez le sujet
immunocompétent
Primary central nervous system lymphoma in immuno-
competent patients
C. Soussain*, K. Hoang-Xuan**
* Centre René-Huguenin,
hématologie clinique, Saint-Cloud.
** Fédération de neurologie Mazarin,
hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris.
R
ÉSUMÉ
Les lymphomes primitifs cérébraux
♦
(LCP) bénéfi cient actuellement d’un
intérêt croissant, dont témoigne
l’abondante littérature couvrant le champ
de la clinique et de la biologie, en raison
de l’augmentation de leur incidence
chez les patients immunocompétents
et de l’amélioration des résultats
thérapeutiques. Ils se différencient
des lymphomes malins non hodgkiniens
systémiques par leur évolution quasi
confi née au système oculo-cérébro-
méningé et par leur pronostic péjoratif en
partie lié à la mauvaise biodisponibilité
des chimiothérapies à travers la barrière
hémato-encéphalique.
Les traitements standard actuels
combinant une chimiothérapie
comportant du méthotrexate à haute
dose et une radiothérapie encéphalique
permettent d’obtenir des taux de réponse
de l’ordre de 90 %, entravés par un risque
de rechute d’environ 50 %, aboutissant à
une survie médiane entre 24 et 55 mois
(20 à 40 % de survivants au-delà de
5 ans). Ces traitements exposent les
patients à un risque – vraisemblablement
sous-estimé car encore trop mal étudié
– de toxicité neurologique retardée et
pouvant être fatale dans les cas les plus
sévères. Ainsi, dans la population âgée
(> 60 ans), particulièrement exposée, un
consensus se forme pour surseoir à la
radiothérapie ou la différer en cas de
réponse à une chimiothérapie première.
De nombreux progrès thérapeutiques
restent à faire, tant pour améliorer les
résultats thérapeutiques en diminuant
le risque de rechute que pour diminuer
la toxicité cérébrale des traitements.
La place des anticorps monoclonaux,
de la chimiothérapie intrathécale, de
la radiothérapie encéphalique et de
la chimiothérapie intensive n’est pas
totalement défi nie.
De nombreuses études biologiques,
limitées par la rareté des prélèvements
provenant généralement de biopsies
stéréotaxiques, sont en cours pour tenter
de mieux comprendre la physiopathogénie
des LCP, en particulier la question de
l’origine de la cellule lymphomateuse en
cause et celle de sa transformation.
Mots-clés : Lymphome – Système nerveux
central.
Keywords: Lymphoma – Central nervous
system.
L
es lymphomes primitifs cérébraux (LCP) sont
des lymphomes malins extranodaux locali-
sés dans le cerveau, la moelle épinière, les
méninges ou l’œil, à l’exclusion de toute localisa-
tion systémique. L’incidence des LCP est estimée
aux États-Unis à 5/10
6
cas par an. Ils représentent
en France environ 3 % des tumeurs primitives du
système nerveux central (SNC), selon un recense-
ment prospectif du registre de l’Association des
neuro-oncologues d’expression française (Anocef)
[1], et environ 1 à 2 % des lymphomes malins non
hodgkiniens (LNH). L’incidence est estimée en

6767
Correspondances en Onco-hématologie - Vol. IV - n° 2 - avril-mai-juin 2009
Les lymphomes cérébraux primitifs chez le sujet immunocompétent
France à 300 nouveaux cas par an. Elle diminue
dans la population des patients immunodéprimés,
mais continue d’augmenter dans la population
immunocompétente. Les LCP sont actuellement
individualisés au sein des LNH dans la nouvelle
classifi cation de l’OMS (2).
DIAGNOSTIC ET BILAN D’EXTENSION
Présentation clinique ✔
Les LCP se manifestent le plus souvent par
des signes neurologiques focaux, mais des
troubles du comportement sont relativement
fréquents. Les crises d’épilepsie sont plus
rares que lors des autres tumeurs cérébrales
en raison de la moindre fréquence des loca-
lisations corticales (tableau I). Une atteinte
oculaire est présente au diagnostic dans 10
à 20 % des cas, parfois asymptomatique.
L’atteinte de la moelle épinière ou méningée
primitive isolée est beaucoup plus rare.
Présentation radiologique ✔(fi gure)
L’imagerie cérébrale par TDM ou IRM montre
typiquement des lésions uniques ou multiples
profondes périventriculaires, prenant le contraste
de manière homogène. Cependant, des présen-
tations atypiques peuvent simuler des maladies
infl ammatoires telles que la sarcoïdose ou la
sclérose en plaque, l’encéphalomyélite aiguë
démyélinisante (ADEM) ou d’autres tumeurs
cérébrales (méningiomes, gliomes malins, métas-
tases cérébrales). Le diagnostic radiologique
est particulièrement diffi cile en cas de lésions
infi ltrantes non rehaussées par le produit de
contraste qui existent dans 10 % des cas. Dans les
présentations atypiques, la spectroscopie-IRM
et les séquences de perfusion peuvent appor-
ter des arguments en faveur d’une localisation
cérébrale d’un LNH.
Diagnostic pathologique ✔
L’examen anatomopathologique reste indispen-
sable, le plus souvent sur un prélèvement tumoral
obtenu par biopsie stéréotaxique. La biopsie
cérébrale peut être évitée lorsque des cellules
lymphomateuses sont retrouvées dans le liquide
céphalorachidien(LCR) [10 à 30 % des cas] ou dans
un prélèvement de vitré. Les examens nécessai-
res au diagnostic et au bilan d’extension sont
résumés dans le tableau II, p. 68.
La quasi-totalité des LCP sont des LNH diffus
à grandes cellules B, avec un angiotropisme
Tableau I. Présentations cliniques au diagnostic.
Signes cliniques Fréquences (%)
Défi cits focaux 50
Troubles cognitifs et psychiatriques 25-50
Hypertension intracrânienne 20
Crise d’épilepsie 10
Atteinte oculaire (uvéite) 10-20
Figure. Présentations radiologiques.
A. IRM axiale. Séquences T1 avec gadolinium : masse temporale gauche rehaussée
par le gadolinium.
B. IRM axiale. Séquences T1 avec gadolinium : aspect de ventriculite.
C. IRM axiale. Séquence FLAIR (C1) et séquence T1 avec gadolinium (C2) : forme infi ltrante
avec multiples lésions hyperintenses sur la séquence FLAIR, sans rehaussement sur la
séquence T1-gadolinium.
A
C1
B
C2

Correspondances en Onco-hématologie - Vol. IV - n° 2 - avril-mai-juin 2009
68
68
dossier thématique
Coordinateur : S. Choquet
caractéristique. Exceptionnellement sont retrouvés
des LCP à cellules T, voire des LNH de bas grade
à cellules B. Dans le LCR et le vitré, le diagnostic
cytologique peut être diffi cile en raison de la pau-
cité cellulaire. L’immunomarquage et la recher-
che de clonalité peuvent aider au diagnostic. Le
dosage de l’IL-10 est intéressant dans le vitré, et
son taux élevé bien corrélé à l’origine lymphoma-
teuse de l’uvéite.
L’infi ltration tumorale n’est pas limitée aux lésions
prenant le contraste visibles en IRM : celles-ci
correspondent à une zone tumorale où la barrière
hématoméningée (BHE) est rompue, mais qui ne
refl ète pas la dissémination largement étendue
à tout le parenchyme cérébral, bien démontrée
par des études autopsiques.
CARACTÉRISTIQUES BIOLOGIQUES
ET PATHOGÉNIE
Le virus d'Epstein-Barr (EBV) n’est impliqué que
dans les LCP des patients immunodéficients.
Les LCP, majoritairement des lymphomes diffus à
grandes cellules B, se distinguent de leurs équiva-
lents anatomopathologiques systémiques par leur
tropisme cérébral et leur pronostic péjoratif. Le
SNC, considéré comme un organe immunoprivilégié
car dépourvu de cellules dendritiques et d’un
système lymphatique conventionnel, est toutefois
le siège d’un trafi c de lymphocytes B et T entre le
SNC et la circulation systémique (3). Cependant,
l’origine de la cellule lymphomateuse et le lieu de
la transformation maligne du lymphocyte B (dans
le SNC, ou en dehors du SNC ?) restent inconnus.
Pour tenter d’expliquer le confi nement des LCP
au SNC, quelques études suggèrent un rôle des
chémokines et de leurs récepteurs exprimés par
les cellules tumorales, l’endothélium vasculaire
cérébral et les cellules du micro-environnement
cérébral (4).
Le mauvais pronostic des LCP s’explique en
partie par la mauvaise biodisponibilité des
chimiothérapies dans le SNC, et peut-être par
des caractéristiques biologiques de la cellule
lymphomateuse elle-même. La petite taille des
prélèvements tumoraux et leur “contamination”
par du tissu cérébral sain compliquent les étu-
des biologiques des LCP. Les études d’expres-
sion génomiques divergent dans leur défi nition
de la “signature des LCP”, mais s’accordent
pour montrer que les LCP expriment des carac-
téristiques à la fois des centres germinatifs
(CG) et des cellules B activées, se traduisant par
un phénotype de type CD19+, CD20+, CD10–, bcl6+,
CD138–, IgM/D+ et MUM+ (5). La cellule tumorale
semble dériver d’une cellule B postcentre germina-
tif (4). Une étude du profi l d’expression des miRNA
(6) a montré une augmentation signifi cative de
l’expression du MiR-17-5p dans les LCP par rapport
aux LNH nodaux et testiculaires, indépendamment
du caractère CG ou non CG, suggérant une spéci-
fi cité de la cellule lymphomateuse des LCP.
Les délétions du 6q, plus souvent observées dans
les LCP que dans les lymphomes systé miques,
pourraient impliquer le gène suppresseur de
tumeur PTPRK dans leur pathogénie (7). La perte
du chromosome 6q serait associée à un pronostic
défavorable (7). Une étude d’hybridation géno-
mique comparative (8) a montré une association
entre les LCP, une perte du 6p21.32-p25.3 et un
gain du 12q15, impliqués respectivement dans
la réponse immunitaire antitumorale (pertes
de l’HLA-DQ, HLA-DR) et les voies d’apoptose
(MDM2 et YEATS4, gènes candidats associés à
p53). L’activation de proto-oncogènes secon-
daires aux mutations hypersomatiques plus fré-
quentes dans les LCP et l’activation du système
NF-κb sont potentiellement impliquées dans
la physiopathologie des LCP (4). Les cellules
du micro-environnement, et en particulier les
astrocytes, pourraient aussi jouer un rôle dans
la survie des cellules malignes par expression de
BAFF (B-cell activating factor of the TNF family)
[4]. Les données biologiques restent toutefois
très fragmentaires.
Tableau II. Bilan diagnostique et d’extension.
Bilan SNC
IRM cérébrale sans et avec injection (± séquence de perfusion/spectro-IRM)
Ponction lombaire
(cytologie, immunomarquage, recherche de clonalité par PCR)
Examen ophtalmologique avec examen à la lampe à fente
Vitrectomie en cas d’uvéite
(cytologie, dosage IL-10, immunomarquage, recherche de clonalité par PCR)
Biopsie stéréotaxique
Bilan systémique
Sérologie VIH
LDH
TDM thoraco-abdomino-pelvien
Échographie testiculaire chez l’homme
± PET scan (pour détecter des atteintes systémiques occultes
Biopsie ostéomédullaire
>>>

Correspondances en Onco-hématologie - Vol. IV - n° 2 - avril-mai-juin 2009
70
70
dossier thématique
Coordinateur : S. Choquet
PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE
La chirurgie n’a qu’un rôle diagnostique dans cette
pathologie très infi ltrante, chimio- et radiosen-
sible. Les problèmes thérapeutiques des LCP sont
multiples. Outre les caractéristiques biologiques
propres à la tumeur (voir ci-dessus), qui semblent
conférer un pronostic péjoratif aux LCP au sein
des LNH à grandes cellules B, la biodisponibilité
des chimiothérapies dans le SNC est entravée par
la BHE caractérisée par des jonctions intercel-
lulaires serrées, une forte expression de la Pgp
et de nombreux mécanismes d’effl ux cellulaires
(9). Enfi n, la toxicité sur le SNC induite par les
traitements est un facteur limitant essentiel à
considérer dans les choix thérapeutiques en rai-
son de sa gravité potentielle, en particulier chez
les personnes âgées (> 60 ans), qui représentent
la moitié de la population de patients.
Nous faisons ici une synthèse de la prise en charge
thérapeutique actuelle des lymphomes cérébraux
primitifs (pour revue générale détaillée [10]).
Facteurs pronostiques ✔
L’âge et l’indice de performance status (PS) sont les
facteurs pronostiques les plus souvent identifi és,
bien que le PS soit parfois diffi cile à coter en raison
des troubles neurologiques liés à la tumeur. D’autres
facteurs ont été proposés, tels que les LDH, la pro-
téinorachie et l’atteinte des structures cérébrales
profondes, mais nécessitent d’être confi rmés.
Traitements de première ligne ✔
Traitement standard combiné
Le traitement de référence actuel est un traite-
ment associant une chimiothérapie à base de
méthotrexate (MTX) à haute dose (≥ 3 g/m2) suivie
d’une radiothérapie cérébrale (10). La médiane de
survie avec ce type de traitement se situe entre 2
et 4 ans, avec une survie à 5 ans comprise entre
20 et 40 %. La radiothérapie seule ne permet
d’obtenir qu’une médiane de survie courte de
10 à 12 mois et une survie à 5 ans inférieure à
50 %. L’adjonction d’une chimiothérapie classique
de type CHOP n’a pas amélioré ces résultats.
Questions thérapeutiques
Aucune étude de phase III n’ayant pu être conduite
à ce jour pour cette pathologie rare, de nombreuses
questions restent sans réponse.
Les rares phases II évaluant le MTX i.v. à haute
•
dose (3-5 g/m2) en monothérapie donnent des
résultats plutôt décevants plaidant en faveur
d’une polychimiothérapie. De nombreuses études
de phases II publiées, utilisant des combinaisons
différentes de chimiothérapies associées au MTX
i.v. à haute dose, rapportent des résultats relati-
vement similaires, mais diffi ciles à comparer en
l’absence d’essais contrôlés. Ainsi existe-t-il de
nombreux protocoles basés sur l’expérience de
centres ou de groupes experts en France (Anocef,
Gela, Goelams) et à travers le monde (MSKCC de
New York, MGH de Boston, etc.).
La place de la chimiothérapie intrathécale
•
prophylactique demeure très controversée. Une
étude allemande a montré de façon intrigante une
diminution du taux de réponses et une augmen-
tation des rechutes parenchymateuses lorsque
la prophylaxie neuroméningée a été supprimée
du protocole (11). D’autres études rétrospectives
n’ont pas montré d’impact sur la survie globale
de la chimiothérapie intrathécale quand elle était
associée à une chimiothérapie i.v. à base de MTX
à haute dose (12).
Les modalités et la place de la radiothérapie
•
cérébrale (délivrée après la chimiothérapie à base
de MTX pour des raisons de tolérance) restent dis-
cutées. Les doses sont habituellement comprises
entre 20 et 55 Gy sur l’encéphale in toto avec ou
sans surdosage sur le lit tumoral. Le protocole
le plus souvent utilisé en pratique est une RT de
l’encéphale in toto à 40 Gy sans surdosage. La
diminution de la dose ou la suppression de la
radiothérapie cérébrale dans le but de diminuer
la neurotoxicité restent un sujet très controversé
car elles semblent exposer à une plus grande
incidence de rechute, avec un impact variable,
selon les études, sur la survie globale (10).
Traitement du sujet âgé (> 60 ans)
Contrairement au sujet jeune, la suppression de
la RT systématique dans le traitement de première
ligne des LCP du sujet âgé fait aujourd’hui l’objet
d’un large consensus en raison de la gravité et
de la fréquence de la toxicité neurologique des
traitements combinés dans cette population.
De nombreuses études rapportent une effi ca-
cité similaire à celle du traitement combiné en
termes de survie, avec une nette réduction de la
neurotoxicité (10). La chimiothérapie optimale, qui
doit comporter au moins du MTX à haute dose,
reste toutefois à défi nir.
Alternatives thérapeutiques
Chimiothérapies conventionnelles seules
Une étude allemande a rapporté des résultats
encourageants avec un protocole de chimio-

7171
Correspondances en Onco-hématologie - Vol. IV - n° 2 - avril-mai-juin 2009
Les lymphomes cérébraux primitifs chez le sujet immunocompétent
thérapie seule (13) par voie systémique. Une étude
de l’Anocef dédiée aux sujets jeunes (< 60 ans)
suggère une diminution de l’intervalle libre de
progression par rapport à ce qui est rapporté avec
les traitements combinés, mais avec une survie
globale comparable, ce qui suggère une effi cacité
des traitements de rattrapage, et en particulier de
la chimiothérapie intensive, fréquemment utilisée
lors de la rechute (14).
D’autres équipes pratiquent des chimiothéra-
pies intra-artérielles avec ouverture de la BHE par
injection intra-artérielle de mannitol et obtiennent
des résultats qui semblent comparables à ceux
des traitements combinés. Cette technique néces-
site néanmoins des équipes spécialisées.
Rituximab
Par analogie avec les LNH systémiques à cellules B,
le rituximab est en cours d’essai dans les LNH
encéphaliques. La taille (145 kD) de cet anticorps
monoclonal est un obstacle théorique à son pas-
sage à travers la BHE, peut-être contourné par sa
longue demi-vie. L’injection intraveineuse de rituxi-
mab s’est montrée effi cace dans un modèle de LNH
encéphalique murin (15). Une étude américaine
de phase II associant du rituximab à une chimio-
thérapie comportant du MTX à haute dose rap-
porte des résultats thérapeutiques à court terme
encourageants, mais l’adjonction de rituximab,
utilisé à la dose de 500 mg/m2, semble augmenter
l’incidence et la profondeur des neutropénies (16).
Les injections intrathécales de rituximab (10-40 mg)
sont faisables et bien tolérées en cas d’atteinte
méningée, avec un taux de réponse objective
encourageant sur de très petites séries (17).
Chimiothérapie intensive avec support
hématopoïétique
Plusieurs études ont évalué la chimiothérapie
intensive (CI) avec support hématopoïétique dans
les LCP en première ligne, en utilisant soit une CI
de type BEAM (BCNU, étoposide, cytarabine, mel-
phalan), soit du thiotépa associé à du busulfan
ou à du BCNU. Il semble que les CI comportant
du thiotépa soient supérieures au BEAM (10, 18).
Cependant, le rôle propre de la CI reste diffi cile à
évaluer car, dans la quasi-totalité de ces études
de phase II, la CI était suivie d’une irradiation
encéphalique.
Traitement de deuxième ligne ✔
Environ un tiers des patients restent réfractaires au
traitement de première ligne, et environ la moitié
des patients en rémission complète ont un risque
de rechute. Des résultats encourageants en situa-
tion d’échec primaire ou de rechute ont été obtenus
avec une chimiothérapie intensive avec support
hématopoïétique (19), avec une survie sans pro-
gression et une survie globale respectivement
de 41 et 58 mois après la CI. Les chimiothérapies
conventionnelles avec témozolomide, topotécan,
carboplatine intra-artériel, cytarabine à haute dose
et ifosfamide (10) sont potentiellement actives
dans les LCP en rechute, avec un taux de réponse
objective allant de 26 à 37 %, et une survie sans
progression à un an comprise entre 13 et 22 %.
Chez les patients non antérieurement irradiés,
la radiothérapie de l’encéphale au moment de la
rechute permet d’obtenir un taux de réponse de
70 %, mais avec une médiane de survie entre 11
et 16 mois (10). L’effi cacité de la radio-immuno-
thérapie, avec un anti-CD20 couplé à l’indium-111
ou à l’yttrium-90, est très limitée.
Évolution
L’évolution des LCP est principalement loco-
régionale, avec des rechutes confi nées dans le
parenchyme cérébral, les méninges et l’œil. Des
rechutes systémiques sont observées dans 7 à
10 % des séries.
Le problème de la toxicité neurologique
des traitements des LCP
La complication la plus redoutée du traitement
des LCP est la neurotoxicité centrale retardée. Elle
peut se manifester dès le troisième mois après
la fi n des traitements. Elle se caractérise par des
troubles de l’attention, de la mémoire, une ataxie
et des troubles urinaires, et peut évoluer dans ses
formes graves vers une démence pouvant être
fatale. Cette démence se différencie des démences
de type Alzheimer par son atteinte de type sous-
cortical, identifiée par une batterie de tests
neuropsychologiques adaptés et plus complets
que le MiniMental Status Examination (MMSE),
pratique mais très insuffi sant, car sous-évaluant
les troubles sous-corticaux. Le risque de neu-
rotoxicité retardée augmente signifi cativement
avec l’âge des patients, atteignant, dans l’ex-
périence du MSKCC après un suivi médian de
115 mois, 75 % des patients de plus de 60 ans
et 26 % des patients plus jeunes (20). En réalité,
ces chiffres ne représentent que les atteintes les
plus graves, sous-estimant, en l’absence d’études
neuro psychologiques prospectives, les troubles
cognitifs moins sévères mais pouvant gêner l’acti-
vité quotidienne et la qualité de vie des patients.
Il semble que les domaines risquant le plus d’être
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%