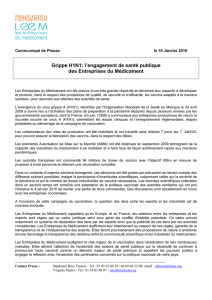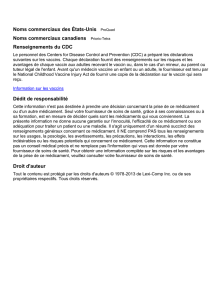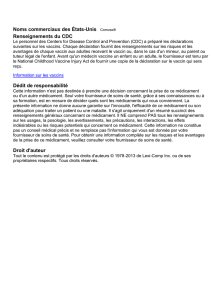Thérapeutique

Quand apparaît le médicament “moderne” ?
Pour mieux comprendre les enjeux, nous devons
nous situer par rapport au point de départ : 1937.
La médecine moderne selon M. Jean Bernard, date
de cette année-là. C’est à partir de 1937 en effet
que la découverte de médicaments nouveaux effi-
caces a permis de passer d’une médecine de dia-
gnostic et d’accompagnement à une médecine
scientifique. L’arsenal thérapeutique s’est davan-
tage enrichi de médicaments, dont certains sont
de véritables “bistouris thérapeutiques”, au cours
de ces soixante dernières années que depuis l’ap-
parition de l’homme sur la terre.
Quels sont les différents aspects
du médicament ?
Chacun des participants à la vie du médicament
le vit différemment. Dans l’âme de celui qui
souffre, le médicament est aux confins de la vie
et de la mort. C’est d’abord, pour lui, l’espoir de
la guérison ; c’est une parcelle de vie ou, plus
simplement, un facteur de la qualité de la vie.
Pour le prescripteur, c’est le complément logique
de son diagnostic et le moyen de répondre à
l’attente du malade.
Pour le dispensateur, c’est mettre le médica-
ment à la disposition du malade, parfois dans
l’urgence, dans les meilleures conditions de
sécurité.
Pour le producteur, c’est élaborer un médica-
ment efficace de très haute qualité.
Pour le chercheur, c’est la quête inlassable du
médicament nouveau qui, peut-être, anéantira
ses découvertes antérieures.
Pour l’économiste, c’est un objet de statistique,
de budget, un bien industriel comme les autres,
dont nous ne retiendrons malheureusement que
ce qu’il coûte et non ce qu’il apporte.
Définir l’avenir est un exercice à la fois difficile
et risqué. Mais le médicament de demain devra
répondre à des besoins exprimés, s’adapter à
l’évolution de la science, accepter ou influencer
son environnement.
15
●●●
Thérapeutique
Médicament : l’actualité,
c’est pour demain
Quels sont les médicaments de demain ?
Ceux qui seront commercialisés dans 10 ans sont déjà
dans les laboratoires, mais les médicaments de demain
sont aussi le devenir de ceux d’aujourd’hui. De très
grandes découvertes thérapeutiques ont jalonné
l’histoire au cours des siècles précédents (alcaloïdes,
glucosides, divers sérums et vaccins), mais c’est
en 1937 que les progrès qui ont conduit à l’arsenal
thérapeutique d’aujourd’hui ont été annoncés.
©Garo/Phanie
Sommaire
Molécules :
quelques approches
thérapeutiques
Génétique :
qu’est-ce que
la thérapie génique ?
Vaccination :
la révolution
du XXesiècle
Rôle infirmier :
plus que jamais
le lien entre le médecin
et le patient
Douleur et nouveau-né :
une prise de conscience
récente
Psychiatrie :
une évolution globale
Pharmacie :
quelques définitions
Dossier réalisé par
Andrée L. Pissondes

16
Thérapeutique
Quelle évolution pour la science ?
Il serait inconcevable de parler du médicament
de demain sans parler du génie génétique, véri-
table révolution scientifique. Étant donné l’im-
portance des moyens mis en jeu dans le monde
(plus de 20 milliards de francs), on peut prévoir
que, vers 2005, le génome humain devrait être
connu dans sa totalité, tout en sachant qu’il n’est
pas immuable. Il restera à identifier les rôles
exacts de chacun de ses composants, ce qui sauf
acquisition de techniques nouvelles, demandera
bien vingt nouvelles années de recherche. On
sait qu’un grand nombre de maladies ont pour
origine des défauts génétiques, sans que l’on
sache toujours s’il s’agit d’un ou de plusieurs
gènes. Des premiers essais sur l’homme permet-
tent de prévoir des résultats contre certains can-
cers et contre les maladies cardiovasculaires. On
peut attendre aussi la préparation de vaccins, en
particulier contre la grippe, le sida, le palu-
disme. Un des domaines qui doit également sus-
citer beaucoup d’espoirs correspond aux mala-
dies du système nerveux dont on connaît la
vulnérabilité, que l’on ne sait pas reconstituer
aujourd’hui, et dont les désordres s’appellent :
Parkinson, Alzheimer, sclérose latérale amyotro-
phique, maladie de Huntington...
Les biotechnologies sont également connues
depuis longtemps comme un moyen important
de production de médicaments (antibiotiques,
acides aminés). Elles sont précieuses quand
elles permettent la production de principes ac-
tifs naturels sans les effets secondaires ; parfois
dangereuses quand ces mêmes principes actifs
naturels sont obtenus par extraction (hormones
de croissance, vaccins, insuline, érythropoïé-
tine...), et parfois en quantité trop infinitési-
male. Dans les cinq ans qui viennent, plus de
200 produits nouveaux issus des biotechnolo-
gies entreront dans leur phase d’expérimenta-
tion clinique, avec des promesses de résultat,
en particulier dans les domaines du cancer et
des vaccins.
Où en est la thérapie cellulaire ?
Elle a déjà montré le bénéfice que l’on peut en
attendre en matière de transfusion et de trans-
plantation. Il ne s’agit pas de médicaments selon
les définitions officielles, mais il faut les traiter
comme tels, ne serait-ce qu’au plan de la sécu-
rité d’emploi. La transplantation de cellules vé-
gétales chez le rat montre que les cellules conti-
nuent à sécréter leur principe actif, puis
s’organisent et se différencient dans l’organisme
animal. Ces transplantations permettent de faire
progresser la connaissance des xénogreffes,
voire l’inoculation directe de médicaments dans
l’organisme. Mais on ne voit pas cependant,
dans l’état actuel de nos connaissances, com-
ment ce type de thérapeutique pourrait être mis
à la disposition de l’officine.
Qu’en est-il de la chimie combinatoire ?
On suppose que la nature, à partir de quelques
éléments chimiques, a su les combiner pour
produire une gamme considérable de protéines.
Il était donc tentant pour l’homme de l’imiter
une nouvelle fois en réalisant à partir d’éléments
organiques simples, comme des acides aminés,
des cétones, etc., des ensembles complexes dont
on peut attendre une activité pharmacologique.
C’est la chimie combinatoire, qui suscite elle
aussi des espoirs importants. Déjà, des sub-
stances actives ont été identifiées dans le do-
maine de la coagulation sanguine, par exemple.
Quant à la piste des enzymes, elle est promet-
teuse. D’après les travaux de Bernard Roques,
certains inhibiteurs d’enzymes spécifiques lais-
sent de grands espoirs dans le domaine de
l’analgésie, dans le traitement de la maladie de
Hurler, etc.
Que deviennent les méthodes
traditionnelles ?
Elles n’ont pas dit leur dernier mot. La cohabita-
tion des méthodes aléatoires et des recherches
plus ciblées en fera encore longtemps des
concurrentes à vrai dire complémentaires tant
nous sommes encore loin de maîtriser tous les
paramètres des maladies, de leur étiologie, et
tous les facteurs qui permettraient de les vaincre
définitivement. La connaissance croissante de
sites récepteurs permettra également une re-
cherche plus ciblée, donc plus rapide, que celle
que nous avons connue jusqu’alors. Pour identi-
fier les cibles, l’informatique, comme dans la chi-
●●●
©Voisin/Phanie

mie combinatoire, rejoint la physique et la biolo-
gie moléculaire pour identifier le site récepteur le
plus souvent protéinique. Cette pratique est at-
trayante et pleine de promesses, en particulier
pour guérir des maladies d’étiologie plurifacto-
rielles. Mais si l’objectif est simple, la solution est
rendue difficile par les contraintes qui viennent
des nombreuses agressions sur les ligands* et
par la conception nécessairement tridimension-
nelle de ce dernier. Le ligand doit de surcroît
pouvoir se positionner correctement sur le site et
être stable. Il reste aujourd’hui à identifier
quelques milliers de cibles.
L’immunologie continuera aussi à participer
de façon très significative aux médicaments de
demain. Elle intervient dans de nombreux do-
maines comme dans la thérapie cellulaire. La
chimie reste, sous sa forme classique, un moyen
de recherche essentiel : par la reproduction de
substances naturelles végétales ou biologiques
que la nature ne peut fournir en quantité suffi-
sante ; par la modification de ces substances
naturelles pour en isoler les parties les plus ac-
tives ou pour en accroître les propriétés, soit
d’activité soit de tolérance ; enfin, par la création
de molécules totalement originales.
Quant à l’isolement de principes actifs naturels
du monde qui nous entoure, il n’est pas ter-
miné. Comme l’a montré Pierre Potier, le monde
naturel n’a pas fini de nous apporter des médi-
caments nouveaux issus des plantes, des micro-
organismes, des animaux terrestres et marins
dont sont issus chaque jour des médicaments
importants (le Taxoène®, la Pervincanine®, la
ciclosporine, les dolastatines). Nous pourrons
demander aux mondes végétal et animal de pro-
duire, voire d’introduire dans l’organisme hu-
main, les médicaments dont le malade a besoin.
D’autres voies de recherches se font jour comme
l’épidémiologie qui, si ce n’est pas une science
nouvelle, prend une autre dimension qui per-
mettra d’élucider des phénomènes pathogé-
niques complexes par l’analyse des paramètres
biologiques et chimiques d’un grand nombre
d’individus sains ou malades.
Mais, pour aller plus loin, on sait depuis tou-
jours que l’esprit influe sur l’état de santé. Ainsi
s’ouvre une dimension encore nouvelle et plus
large de la recherche qui ne se fierait pas qu’aux
relations directes, au médicament et à l’organe
malade, mais qui impliquerait tout le réseau des
composants biologiques du cerveau. Le cerveau
ne pourrait-il pas être à l’origine de production
de “médicaments endogènes” ? La frontière
entre le corps et l’esprit semble bien ténue. Il y a
là certainement de nouvelles voies de recherche
à explorer... après-demain ? ■
* Molécules ou ions unis à l’atome central d’un complexe par
une liaison de coordination.
Extraits de la déclaration de
Pierre Joly,
président de la Fondation pour la recherche médicale
lors de la XIeJournée de l’Ordre des pharmaciens.
17
La recherche devient accessible au public
La Fondation pour la Recherche Médicale présidée par
M. Pierre Joly, a pour mission de soutenir la recherche
afin de faire progresser les connaissances scientifiques
et médicales dans tous les domaines de la santé. Elle
se donne aussi une mission d’information visant à rap-
procher le public du monde de la recherche, notam-
ment en communiquant ses avancées dans différents
supports et à travers diverses manifestations. En ce
moment, la Fondation initie un cycle d’expositions iti-
nérantes sur le fonctionnement du corps humain.
Cette action pédagogique a pour objectif de mettre
en place une dynamique dans le domaine de la santé
entre le public et les chercheurs, et de favoriser le
débat scientifique au sein de la société.
©Alix/Phanie

18
Thérapeutique
Les nouvelles techniques de recherche don-
nent aujourd’hui des premiers résultats.
Cependant, à part la thérapie génique, les der-
nières découvertes vraiment innovantes ne sont
pas toutes très récentes. La plupart des médica-
ments d’aujourd’hui ont un rôle palliatif, d’ac-
compagnement des malades, plutôt qu’un rôle
curatif définitif. Les avancées les plus notables
s’exercent dans la biologie moléculaire ou cellu-
laire, l’immunologie, la virologie, ainsi que la
technologie, et notamment les biotechnologies.
Le développement de médicaments demande des
investissements lourds, supportés par l’industrie
pharmaceutique, et entre la découverte de la mo-
lécule et la mise en circulation du médicament
après vérification de son efficacité, et surtout de
son inocuité, il s’écoule plusieurs années.
Le XXesiècle a vu l’essor de la chimiothérapie,
mais aussi des antibiotiques, avec la pénicilline
et les sulfamides.
Ces vingt dernières années ont vu la mise sur le
marché d’une soixantaine de principes actifs
concernant aussi bien la distribution à l’hôpital
qu’à l’officine. Plusieurs d’entre eux ont été sa-
lués comme des avancées importantes. On peut
signaler, en infectiologie, l’arrivée de la classe des
inhibiteurs non nucléosidiques de la transcrip-
tase inverse dans le domaine des antirétroviraux
indiqués dans l’infection à VIH. Les patients
asthmatiques peuvent désormais bénéficier des
antagonistes des leucotriènes. Les troubles de
l’érection sont traités pour la première fois par
voie orale avec le sildénafil (Viagra®). Le xénical
(Orlistat®) est encore le seul médicament de fac-
ture originale contre la surcharge pondérale. En
cancérologie, l’innovation consiste notamment
dans une approche immunologique, associant
un élément radioactif à un ligand sélectif des mé-
tastases osseuses pour une action antalgique. La
douleur migraineuse, quant à elle, se soigne dé-
sormais par voie orale.
Nutrition
•Le xénical (Orlistat®) représente une appro-
che innovante de la lutte contre l’obésité. Il agit en
inhibant les lipases intestinales et leur activité sur
les triglycérides alimentaires. Ce médicament, qui
répond à des règles très précises, ne peut être ad-
ministré en dehors d’un traitement contre l’obé-
sité. Il ne sera prescrit que si un régime instauré
un mois avant a permis une perte pondérale d’au
moins 2,5 kg en quatre semaines. Les effets indé-
sirables se limitent à des troubles gastro-intesti-
naux réversibles, dont le plus gênant est l’inconti-
nence fécale. Mais, avec la commercialisation du
xénical, recommandé pour certains diabétiques
obèses, il n’y a plus de raison de recourir à la pres-
cription d’anorexigènes centraux.
Diabète
•Nouvel antidiabétique oral, le miglitol (Dias-
tabol®)s’inscrit dans une approche spécifique du
diabète de type 2, fondée sur le principe de ges-
tion de la charge glucidique afin de contrôler
l’équilibre glycémique. Le miglitol est une mo-
lécule inhibiteur réversible des alpha-glucosi-
Molécules
Quelques approches
thérapeutiques
Le siècle finissant, avec son cortège de découvertes, uniques
depuis le début de la médecine, laisse augurer, malgré quelques
déconvenues comme l’arrivée d’une épidémie comme le sida,
de fantastiques progrès. Mais n’est-ce pas l’enthousiasme
inhérent à un début de siècle tout proche qui veut que
demain sera meilleur ? Pas tout à fait, car le discours se fait plus
réaliste. A cela une raison toute simple : l’homme ne finissant
pas de vieillir, il faut bien que l’usure advienne.

19
dases de la bordure en brosse intestinale. L’action
du médicament est de retarder l’absorption intes-
tinale des hydrates de carbone en la répartissant le
long du tractus intestinal.
Cholestérol
•Une nouvelle molécule, la cérivastatine, (Stal-
tor®, Cholstat®) première statine microdosée de
synthèse à très haute sélectivité hépatique a une
très forte affinité pour l’HMG-CoA réductase,
enzyme régulant la synthèse du cholestérol. La
cérivastatine est efficace dans les hypercholesté-
rolémies pures et les hypercholestérolémies
mixtes de type IIb. Dans celles de type IIa, la cé-
rivastatine induit une baisse de 30 à 35 % du
taux de LDL-cholestérol. Ce nouveau médica-
ment se distingue par une absence d’interaction
médicamenteuse avec les autres produits habi-
tuellement prescrits.
•L’ atorvastatine (Tahor®) exerce une activité
complémentaire sur les tryglycérides, intéres-
sante pour la prise en charge des hypercholesté-
rolémies mixtes.
Neurologie
•Le topiramate (Epitomax®) est un antiépilep-
tique associant trois propriétés pharmacolo-
giques : il bloque les canaux sodiques des neu-
rones, il augmente l’activité GABAergique mais
n’a pas d’action sur l’activité du N-méthyl-D-as-
parate sur son récepteur et il antagonise l’activité
excitatrice du glutamate. C’est un anticonvulsi-
vant efficace indiqué dans le traitement des épi-
lepsies partielles en association avec d’autres an-
tiépileptiques lorsque ceux-ci sont peu efficaces.
•Le zolmitriptan (Zomig®) est un agoniste sé-
lectif des récepteurs sérotoninergiques de
type 5-HT1B et 5-HT1D ayant une action pharma-
cologique à la fois périphérique et centrale. L’as-
sociation au propranolol est déconseillée et il y
arisque de survenue d’un syndrome sérotoni-
nergique lors de l’association à des antidépres-
seurs IRS.
•Le naratriptan (Naramig®) est de la famille des
triptans. Il peut être prescrit en association avec
les bêtabloquants et les antidépresseurs inhibi-
teurs de la recapture de la sérotonine, mais ne
doit pas être associé à l’ergotamine et aux autres
dérivés de l’ergot de seigle ou à un agoniste des
récepteurs 5-HT1. Le naratriptan, comme le zol-
mitriptan, appartient à la classe des antimigrai-
neux inaugurée par le sumatriptan.
•Le donepezil (Aricept®) inhibe l’acétylcholi-
nestérase intracérébrale car il se distribue à des
taux importants dans le cerveau. Il est indiqué
dans le traitement symptomatique de la maladie
d’Alzheimer dans ses formes légères à modérées.
•La rivastigmine (Exelon®) est aussi un inhibi-
teur des acétylcholinestérases. Il se distingue
de la tacrine et du donepezil par son action
pseudo-irréversible.
Rhumatologie
•Le nimésulide (Nexen®) est un anti-inflamma-
toire non stéroïdien (AINS) qui fait partie d’une
nouvelle famille, celle des sulfonanilides. Il par-
tage toutes les actions pharmacologiques des
AINS mais également les contre-indications
classiques. Il est préférentiellement indiqué
dans le traitement des arthroses douloureuses
invalidantes.
•Le raloxifène (Evista®) est une molécule inau-
gurant une nouvelle génération dans la classe
pharmacologique des modulateurs sélectifs des
récepteurs aux estrogènes (MoSARE) qui com-
prend déjà le tamoxifène. Il est indiqué dans la
prévention des fractures vertébrales non trau-
matiques chez les femmes ménauposées à risque
prouvé d’ostéoporose ou d’ostéopénie. Des acci-
dents thromboemboliques ont cependant été
décrits.
Allergologie
•La fexofénadine (Telfast®) est un antihistami-
nique H1métabolite de la terfénadine indiqué
dans la rhinite allergique et le prurit de l’urti-
caire chronique. Son intérêt est de ne pas avoir
d’effets indésirables sédatifs et anticholiner-
giques. Le médicament n’induit pas d’arythmie
ventriculaire.
Cancer
•Le rituximab (Mabthera®) est le premier anti-
corps développé en thérapeutique hématolo-
gique. Il est indiqué en monothérapie dans le
traitement des lymphomes folliculaires de
stades III/IV à partir de la deuxième rechute après
une chimiothérapie ou, lorsque celle-ci reste inef-
ficace, avec un taux de réponse objective de
50 %. Effets secondaires : syndrome pseudo-grip-
pal au décours de la perfusion, manifestations cli-
niques allergiques, nausées, hypotension.
•Le bicalutamide (Casodex®) complète la classe
médicamenteuse des antiandrogènes non sté-
roïdiens pour traiter le cancer de la prostate. Il
permet de neutraliser les hormones androgènes
d’origine extratesticulaire par inhibition compé-
titive de l’hormone au niveau de ses récep-
teurs exprimés à la surface des cellules tumo-
rales prostatiques. Ses effets indésirables ●●●
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
1
/
18
100%