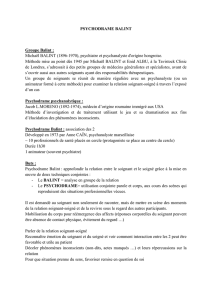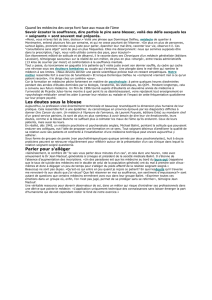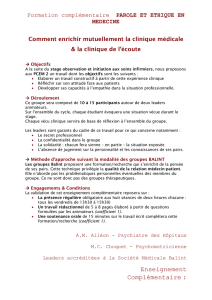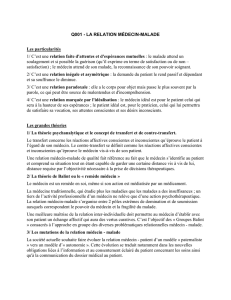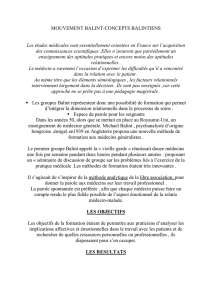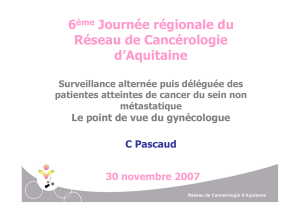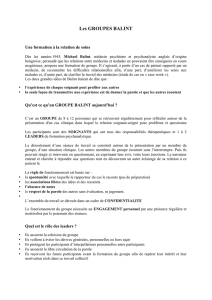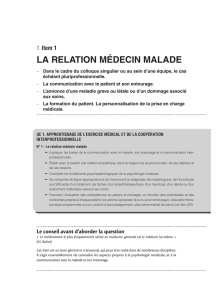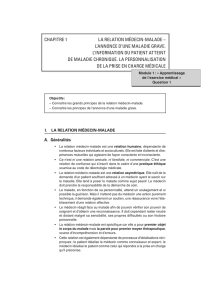GYNÉCOLOGIE ET SOCIÉTÉ
21
La Lettre du Gynécologue - n° 247 - décembre 1999
n peut se demander ce qui est le plus difficile, être
le médecin ou être le malade... Certes, le médecin
a, en général, choisi son camp, mais pour quelles
raisons ? Le malade, lui, n’a en principe pas choisi ou, du moins,
il ne le sait sans doute pas, même si, selon la phrase de Kafka,
“la maladie parle pour moi parce que je le lui demande”.
La médecine, et en particulier notre spécialité, a, ces dernières
années, progressé à pas de géant en s’appuyant de plus en plus
sur la science et sur les sciences. Nous pouvons presque tout voir
et tout explorer, presque tout doser et interpréter, presque tout
identifier, même si ce fabuleux butin ne nous donne pas encore
le vrai pouvoir, celui de guérir, ou plutôt le vrai savoir, celui qui
éviterait la maladie. Mais il est un domaine où la médecine reste
encore un art, l’art de l’échange et de la communication, de cette
forme d’intimité qu’est la consultation, l’art que Georges Duha-
mel, écrivain et médecin, nommait le “colloque singulier”, et
qu’à la suite de Michael Balint nous nommons relation méde-
cin-malade, ou soignant-soigné.
En parle-t-on jamais vraiment au cours des études médicales ?
Il serait cependant bien dommage, et dommageable pour le soi-
gnant comme pour le soigné, que ce moment particulier reste
“une énigme doublée d’un mystère”, selon l’une de ces formules
lapidaires chères à Churchill.
Moment particulier, certes, mais qui s’inscrit dans l’interaction
qu’est toute relation entre êtres humains, ce qu’à la suite des
publicitaires, hérauts de notre temps, on nomme aujourd’hui la
communication, objet semble-t-il de toutes les convoitises.
Mais est-ce seulement de cela qu’il s’agit ici ?
Oui, si l’on évoque le schéma de base où verbal et non-verbal
doivent permettre une reconnaissance de l’offre et de la demande.
Non, si l’on estime devoir dépasser cette objectivité, éventuel-
lement cette neutralité bienveillante, qui seraient ce que doit le
médecin à son patient, à l’exclusion de tout autre sentiment. Sen-
timent, et pourquoi pas émotion, cette dimension fondamentale
de toute relation, que le médecin plus qu’un autre doit apprendre
à reconnaître d’abord, à canaliser ensuite.
Faudrait-il alors opposer sur un mode irréductible le praticien
imperturbable, ne “s’en laissant pas conter”, efficace parce
qu’objectif, à celui plus subjectif, moins “ne varietur”, qui
s’attache autant au sujet malade qu’à l’objet maladie ? Non, bien
sûr, pas plus que ne sont souhaitables les partis pris manichéens,
du style technique reine et rationalisation étroite versus psycho-
logisation outrancière, pas plus que ne serait souhaitable une
vision monolithique d’un bout à l’autre de sa pratique d’un méde-
cin que ne troublerait jamais la moindre parcelle d’émotion et,
surtout, de doute. En fait, l’idéal serait sans doute une balance
entre deux pôles, celui du “savoir” médical et celui d’une “igno-
rance” qui ménagerait sa place au savoir de l’autre.
Point n’est besoin de le souligner, une consultation est un échange
d’une extrême complexité. Elle évolue dans cette unité de temps
et de lieu chère à la tragédie classique et, comme celle-ci, en plu-
sieurs actes.
À la rencontre, ce prologue qui met en place les rôles et la place
de chacun, va succéder “le corps à corps” [1] de l’examen, puis
la parole va reprendre ce que les gestes ont mis au jour et, don-
nant un nom au problème, permettre la transition vers la dernière
scène, celle qui ouvre sur l’avenir, immédiat ou lointain, avec ou
sans suite au prochain numéro. Tout cela se joue en version ori-
ginale, à chaque fois différente, parfois muette mais le plus sou-
vent parlante.
“Le langage anesthésie la bouche aussi bien qu’un produit phar-
maceutique” (2). Est-ce cette anesthésie qui nous rend souvent
insensibles – au sens propre du terme – aux bizarreries de nos
échanges avec ceux et surtout celles qui viennent nous consulter ?
“Comment allez-vous ?” marque dans la plupart des langues et
des cultures l’ouverture de la rencontre et, en principe, l’amorce
du dialogue. Mais cette apparente marque d’intérêt pour l’autre
n’est souvent qu’une banale habitude et, vidée de tout contenu
affectif, n’appelle pas plus de réponse sincère que d’écoute vraie.
La poignée de main était autrefois un garant de non-inimitié et
parfois de loyauté, elle tend aujourd’hui à s’effacer au profit d’une
gestuelle à type de salut où les mains s’agitent en l’air sans se
toucher. Les mots aussi peuvent se chercher sans se rencontrer,
même si, selon la sagesse populaire, un mot en appelle un autre.
Alors, que disons-nous à nos patientes pour inaugurer la relation,
celle du moment présent, qu’elle soit nouvelle ou déjà ancienne ?
Non pas “que voulez-vous ?” ou “qui êtes-vous ?” ni même
“qu’avez-vous ?”, mais plutôt “en quel état êtes-vous ?”, en quel
état de santé donc.
La relation médecin-malade en gynécologie :
étude et approche
!M. Lachowsky*
* Attachée consultant, service de gynécologie-obstétrique, Pr P. Madelenat,
hôpital Bichat, 46, rue Henri-Huchard, 75018 Paris.
[1] Michel Sapir.
[2] Michel Serres.
O

Cet état de bien-être physique et mental, social aussi, qui ne
consiste pas seulement en l’absence de maladie ou d’infirmité – la
santé selon la définition de l’OMS –, c’est la vie dans sa qualité
au moins autant que dans sa quantité. Votre santé nous intéresse,
disons-nous ès qualités à ces interlocuteurs spécifiques, vous
n’avez pas l’obligation d’être malade pour venir nous consulter.
Mais comment l’entendent-ils, comment l’entendons-nous, dans
cette relation de soins où l’interaction repose sur une double
assise, presque un paradoxe ? En effet, elle est, d’une part, une
relation que l’on pourrait qualifier d’inégalitaire, fondée sur la
dominance et le pouvoir de l’expert, seul à même de prendre les
décisions thérapeutiques sans se permettre d’être troublé par les
inquiétudes de son malade. Mais, d’autre part, elle doit aussi être
une relation de coopération, où d’autres savoirs seront pris en
compte, d’autres réalités, et aussi ce que d’aucuns appellent
empathie ou encore, au sens large du terme, “compassion” [3],
c’est-à-dire une certaine gestion des émotions. Peut-être faudrait-
il dire une gestion certaine, mais nous n’allons pas tarder à y
revenir, car c’est bien cela que la Faculté non seulement ne nous
enseigne pas mais nous demande d’éviter, et que seule une for-
mation personnelle à la psychosomatique peut nous aider à per-
cevoir et à intégrer. Encore faut-il en comprendre la nécessité et
en éprouver le désir.
Cette relation médecin-malade, comme toute relation humaine,
est faite de dit et de non-dit, de mots et d’attitudes, d’échanges
donc. Échange tout de même particulier puisqu’il commence sou-
vent par un interrogatoire. Notons ici le vocabulaire policier, alors
que pour soigner c’est le vocabulaire militaire qui prend la relève,
avec notamment “ordonnance” et “arsenal thérapeutique”.
“Si le médecin pose des questions selon sa technique habituel-
lement apprise, il obtiendra sans doute des réponses, mais rien
d’autre. Avant de pouvoir arriver à ce que nous avons appelé un
diagnostic approfondi, il doit apprendre à écouter. Écouter est
une technique beaucoup plus difficile et subtile que celle qui doit
nécessairement la précéder : mettre le patient à l’aise pour lui
permettre de parler. La capacité d’écouter est une aptitude nou-
velle, qui exige un changement considérable bien que limité dans
la personnalité du médecin. À mesure qu’il découvrira en lui la
capacité d’écouter ce qui chez son patient est à peine formulé,
car le patient n’en est qu’obscurément conscient [...] il décou-
vrira qu’il n’est pas de questions nettes et directes qui puissent
mettre à jour le type d’informations qu’il cherche [...] ces pro-
cessus ne peuvent apparaître que par une collaboration de ces
deux personnes” [4].
Après l’interrogatoire, l’examen, après les mots, les regards et
les gestes. C’est son intimité, celle que l’éducation et la société
lui ont appris à cacher et à préserver, celle liée à tous les mys-
tères donc à tous les dangers, son “origine” [5], que nous
allons demander à notre patiente de dévoiler. La voilà ici
encore cette inégalité dans la relation, car ces regards et ces
gestes sur le corps de l’autre sont nôtres et nôtres exclusive-
ment, aussi devons-nous ne jamais oublier que rien, là, n’est
banal pour la patiente, étendue demi-nue et jambes écartées sur
une table qui n’est pas un lit, livrée à ses fantasmes et fantas-
mant peut-être ceux du gynécologue.
Le toucher vaginal peut, aussi étonnant que cela puisse
paraître, être un moment privilégié de ce couple particulier
gynécologue/patiente. Le silence notamment permet souvent
l’émergence d’événements anciens, violences, attouchements
ou abus sexuels, traumatismes refoulés qui ne se parleront
peut-être nulle part ailleurs.
Enfin, rituel final de ce duo joué tantôt à l’unisson, tantôt en
canon, parfois avec des dissonances, vient la prescription, ce
papier qui va objectiver qu’il s’est passé quelque chose entre
les deux protagonistes, chacun à sa place et dans son rôle.
“La prescription, c’est l’ensemble de l’atmosphère dans
laquelle le médicament est donné et pris” [6]. Et pris, me
direz-vous... Et Balint d’ajouter : “Le médicament de loin le
plus utilisé en médecine est le médecin lui-même”.
Mais aucun manuel ne nous guide quant à la drogue-médecin,
aucun Vidal®n’en indique posologie ou effets secondaires,
même si, comme pour tout médicament, trop pour l’un est trop
peu pour l’autre, allergie ou accoutumance pouvant toujours
survenir.
“Ma gynécologue, elle est formidable, elle me prescrit toujours
d’importants traitements, avec tous les médicaments nouveaux
qui viennent de sortir...”
“Ma gynécologue, elle est formidable, elle ne prescrit jamais
de longues ordonnances, elle ne me donne jamais beaucoup de
drogues...”
Notons l’emploi de termes chargés de sens : les médicaments
sont de bons objets, les drogues au contraire de mauvais
objets.
Gardons aussi présents à l’esprit (et avec quelle humilité !) le
sort de nos ordonnances : perdues, oubliées au fond d’un sac,
certaines ne verront jamais le jour. Quant aux autres, elles
iront se faire étudier et contrôler par voisins et pharmaciens.
En effet, taraudées par l’inquiétude ou persuadées de n’y rien
comprendre, les patientes souvent n’entendent rien à nos expli-
cations et attendent d’être à l’extérieur pour enfin apprendre ce
qui les attend.
On l’aura compris, pour être de qualité, une relation ne peut
être que de sujet à sujet et non de sujet à objet. La maladie ou
sa souffrance sont l’objet de notre travail, l’être humain
malade ou souffrant est notre partenaire. On a pu parler de
l’inévitable duplicité du soignant, ce Janus Bifrons qui doit
vous faire mal pour votre bien ou tenter d’adoucir votre sort
s’il ne peut rien contre le mal. Cependant, il ne faudrait pas
tomber dans le travers actuel qui croit tout résoudre ou tout
expliquer en opposant la médecine technique à la médecine
relationnelle. Il est bien entendu plus facile ou plus tentant
pour le médecin de se cacher derrière ses écrans ou ses outils
sophistiqués plutôt que d’ajouter à ses propres angoisses et à
ses propres doutes ceux de sa patiente.
Mais, bien entendu, ne devrait mériter “appellation contrôlée”
de médecine psychosomatique que celle qui réunit la patiente au
lieu de la réduire à la tranche défectueuse, externe ou interne,
visible ou non, de son sein ou son utérus.
GYNÉCOLOGIE ET SOCIÉTÉ
22
La Lettre du Gynécologue - n° 247 - décembre 1999
[3] Emmanuel Levinas.
[4] Michael Balint.
[5] Gustave Courbet, “l’Origine du monde”, musée d’Orsay, Paris.
[6] Michael Balint.

Nous avons été formés à l’université pour affronter la maladie et
même la mort, notre suprême échec, mais pas pour affronter le
malade. Et pourtant, celui-ci est partie prenante dans sa maladie
comme dans l’effet thérapeutique de ce que nous lui prescrivons,
à condition aussi qu’il veuille bien de cette place que nous lui
laissons. Il ne doit pas s’agir là d’un faux humanisme médical,
d’une “gentillesse” de façade où ne passerait rien de vrai, une
forme de rituel compensatoire du style de la tête à peine passée
dans l’entrebâillement de la porte de cette chambre où l’on n’ose
plus entrer faute de savoir faire face à la douleur physique ou
morale.
Faire face ou garder la face... mais devons-nous toujours porter
un masque pour cacher nos émotions ?
Certes non, mais l’autre écueil serait de nous laisser trop enva-
hir par elles, de nous laisser déborder, dans toutes les acceptions
du mot. La bonne distance thérapeutique n’est pas toujours facile
à repérer, elle peut d’ailleurs varier d’une consultation à l’autre
avec le même patient. Trop loin n’est pas plus bénéfique, mais
peut-être plus économique pour le médecin qui, s’investissant
moins, reçoit moins en retour. Trop près peut grossir les traits et
diminuer la perspicacité, comme en témoigne la difficulté à soi-
gner les siens, ceux justement qui vous sont – trop ? – proches.
On voit que garder un certain degré de neutralité est assurément
difficile mais est indéniablement une garantie de qualité.
Il n’empêche que garder la tête froide ne signifie pas se montrer
de glace, et l’on sait, depuis Hippocrate au moins, que se réchauf-
fer les mains avant de palper un ventre ou des seins ne peut
qu’améliorer la qualité de l’examen et la qualité de la relation.
Et que dire de tout ce qui rend sa dignité à la malade hospitali-
sée, horizontale quand nous sommes verticaux, infantilisée par
le lit et parfois par la nudité-spectacle qui lui est imposée. Les
salutations les plus banales “dehors” deviennent capitales
“dedans”, frapper à la porte et se présenter nommément sont des
attitudes aussi banales qu’évidentes mais propres à situer
d’emblée la relation médecin-malade dans une plus juste pers-
pective.
On aura beau jeu de brandir ici l’épouvantail de la relation de
séduction face à la relation de pouvoir, ou le risque de voir l’une
menaçant l’autre. Certes, les deux éléments existent, malade et
médecin en usent tous les deux selon leur temps et leurs moyens.
L’important pour le médecin est de reconnaître ces mouvements,
d’essayer de n’être ni trop manipulateur ni trop manipulé. Séduc-
tion du pouvoir ou pouvoir de la séduction, n’est-ce pas là le
moteur de toute action et de toute relation des humains entre eux ?
De toute action... mais le médecin se doit-il d’être toujours dans
l’action, ne doit-il pas aussi aller à la rencontre de l’autre, sa
patiente, aussi bien dans le silence de la technicité que dans
l’absence de prescription, ou même dans certains cas jusqu’à la
reconnaissance du placebo ? Ne résistons pas au plaisir de lire
ce qu’en dit Ambroise Paré dans son Discours sur l’inefficacité
de la poudre de licorne (!) : “Vous me direz, puisque les méde-
cins savent bien et publient entre eux-mêmes que ce n’est qu’un
abus, cette Poudre de Licorne, pourquoi en prescrivent-ils ? C’est
que le monde veut être trompé et sont contraints, les dits méde-
cins, d’en ordonner ou pour mieux dire, permettre aux patients
d’en user parce qu’ils en veulent. Que s’il advenait que les
patients qui en demandaient mourassent sans en avoir pris, les
parents donneraient tous la chasse aux susdits médecins et les
décrieraient comme vile monnaie.”
Et si Hippocrate insiste pour que ne soit pas oubliée la formule
magique conjuratoire après l’application d’une médication
d’herbes très précisément nommées et dosées, c’est autant pour
relier entre eux tous les paramètres de la thérapeutique que les
patients semblent en droit d’exiger que pour maintenir le lien
entre toutes les approches possibles de la médecine.
Écouter l’autre, accepter l’ennui de consultations répétitives ou
l’agressivité ambiante, savoir attendre et attendre ce temps de
l’autre qui n’est pas toujours le nôtre, tenter d’entendre sa
demande pour mieux le comprendre, c’est rechercher la dose
d’empathie qui permettra cette “rencontre de deux imaginaires”
qu’est une relation digne de ce nom. Cela n’est pas enseigné ex
cathedra car il n’y a sans doute pas de recette miracle, si ce n’est
un travail sur soi-même et surtout un travail en groupe, comme
l’a littéralement inventé Michael Balint.
La parole est à celui qui l’écoute, a écrit ce grand curieux de lui-
même qu’était Montaigne.
L’objet de ces groupes était – et est toujours – l’étude exclusive
de la relation médecin-malade dans sa pratique quotidienne, c’est-
à-dire un essai de compréhension de ce fonctionnement particu-
lier de chaque praticien, non pas tellement face à chaque malade
mais bien face à une malade donnée. Toute histoire est unique
et particulière et chaque relation est un cas particulier, comme
chacun d’entre nous d’ailleurs. Le travail en groupe éclaire et
rassure tout à la fois, montrant similitudes et divergences parmi
les participants, tout aussi enrichissantes les unes que les autres,
sans oublier le plaisir de se retrouver régulièrement dans la cha-
leur d’un groupe de collègues prêts à entendre et à comprendre,
à partager et à soutenir. C’est sans doute en partie ce réconfort
qui rend tolérable l’inconfort de certaines histoires rapportées au
cours de sessions plus houleuses que d’autres. Il est d’ailleurs
d’observation courante que la consultation rapportée se traduit
souvent dans l’attitude du groupe qui s’ennuie comme le pré-
sentateur dit s’être ennuyé, ou se sent pris de colère avant même
que celui-ci ne le raconte.
Si les mêmes situations ne provoquent pas les mêmes réactions
chez tous, ces réactions existent bel et bien et méritent que l’on
s’y attarde, car elles sont des révélateurs et des repères qui vont
servir ensuite de repères ou de balises dans le parcours de cha-
cun. Exposé par le médecin qui a envie ou besoin de présenter
son cas, celui-ci devient le cas de tous qui s’y retrouvent ou, à
l’inverse, s’en étonnent. Ne sont pas là argumentés le type ou le
protocole d’examens ou de traitements, mais bien ce qui a été
vécu et comment, pour en arriver parfois au pourquoi et même,
plus rarement, au plus jamais ça. Il ne s’agit pas non plus d’arri-
ver avec un dossier écrit, mais bien d’utiliser “l’arbitraire des
souvenirs persistants et des oublis incontrôlables” [7].
On n’insistera jamais assez sur l’objectif professionnel, et uni-
quement professionnel, de cette formation en forme de recherche,
qui n’est pas une introspection psychanalytique personnelle.
23
La Lettre du Gynécologue - n° 247 - décembre 1999
(7) André Brincourt.

C’est bien du moi-médecin dont il est question ici et non du moi-
personne privée, et c’est au leader (l’appellation anglaise d’ori-
gine a été conservée, même si elle tend parfois à être remplacée
par celle d’animateur) d’y veiller, car il est vrai que ces deux
sous-ensembles ont une évidente tendance à se surimprimer. Cela
est capital tant pour le but recherché que pour l’équilibre et la
sécurité de chaque participant, comme du groupe et de sa dyna-
mique d’ailleurs. “Thérapie professionnelle” [8]certes, mais avec
une évolution propre au groupe et propre à chacun. On ne vient
pas là non plus pour faire l’économie d’une analyse personnelle,
mais bien pour partager entre pairs et apprendre les uns des autres,
apprendre à parler et à se taire, à dire et à entendre, à mettre en
commun un peu de l’intime médical, sans fausse honte ni peur
du ridicule. Le leader doit éviter d’être pris comme modèle ou
comme référence, il lui faut gérer transfert et contre-transfert, car
c’est bien de cela qu’il est question, il lui faut parler peu mais
juste afin de n’être ni trop directif ni trop dirigiste. Là encore il
lui faut savoir écouter.
Est-il bien utile d’ajouter que participer à ce style de travail signi-
fie que le médecin accepte de se remettre en question, qu’il a fait
le deuil de sa toute-puissance au profit d’un intérêt plus grand
pour l’échange et le partage des savoirs ?
Il est frappant de constater que les gynécologues ont toujours été
très présents dans ces groupes où sont mis au jour les problèmes
inhérents au métier de médecin, à ce face-à-face soignant-soigné
où l’offre et la demande ne sont pas toujours là où on les attend.
Métier de médecin certes, mais pas n’importe quel métier. En
effet, c’est plus sur leurs fonctions que sur leurs techniques, plus
sur les ressorts que sur les ficelles que s’interrogent ces méde-
cins. Ce n’est donc pas n’importe quel médecin non plus, et sou-
vent ce n’est pas la maladie qui occupe le devant de la scène,
même si elle fait de la figuration pas toujours intelligible, à tra-
vers des consultations pour contraception, infertilité, grossesse
ou même un banal frottis de dépistage ; pas n’importe quelle
maladie non plus puisque nous parlons de gynécologie, c’est-à-
dire autant de physiologie que de pathologie, mais surtout de ce
qui nous fonde tous : le ventre et les seins des femmes. Le corps
sexué a ici la vedette, il a son mot à dire et sa scène à jouer. La
vie intime est toujours en filigrane, sexe et sexualité se mettent
toujours en scène, dans les coulisses ou côté jardin.
Sans doute est-ce aussi parce que, gynécologues ou obstétriciens,
nous travaillons dans la filiation, la possible comme l’impossible,
et dans une ambivalence du désir toujours tellement présente que,
tout en étant de plus en plus hautement spécialisés, nous essayons
de toujours considérer notre patiente comme un tout, un être
humain dans sa globalité et non limité aux organes et aux symp-
tômes qui nous concernent ou qu’elle nous apporte.
Nous en arrivons donc, à nouveau, à un essai de compréhension,
sinon de définition, de la médecine psychosomatique dont la
gynécologie paraît être un terrain d’élection. Telle la double
hélice indispensable à la vie, celle de l’entrelacs psyché et soma
est la clé de voûte de la médecine comme de notre fonction de
soignants. Oserons-nous qualifier la relation médecin-malade
d’ARN messager, reconnu par toutes les cellules en cause, celles
du soignant et celles du soigné ?
“On ne guérit jamais du désir de guérir”, a écrit Canguilhem,
mais arriver avant que ne s’installe ce que Balint appelle “la mala-
die organisée”, pour être apparemment moins glorieux, n’en est
pas moins digne de nos efforts.
Psyché et soma, hommes et femmes, médecins et patientes, ne
s’agit-il pas toujours de ce lien, de ce liant indispensable, qu’est
la relation ? C’est sans doute aux maladies de la relation que pen-
sait Lucien Israël en écrivant : “À nous de faire entendre à nos
patientes qu’elles ont quelque chose à dire que nous nous devons
d’écouter.” "
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
#Balint M. Le médecin, son malade et la maladie. Petite Bibliothèque Payot,
Paris, 1980.
#Balint M. Techniques psychothérapiques en médecine. Payot, Paris.
#Cosnier J., Grosjean M. et Lacoste M. (Ed.) Soins et communications.
Approches interactionnistes des relations de soins. Presses universitaires de
Lyon, 1983.
#Caïn A. Quinze années d’expérience du psychodrame Balint avec Charles
Brisset. In Psychiatrie française, n° 2, 1990.
#Caïn A. Le psychodrame Balint. Méthode, théorie et applications. Collec-
tion Corps et Psychisme. La Pensée sauvage, Grenoble, 1994.
#Sapir M. Soignant-soigné : le corps-à-corps. Payot, Paris, 1980.
#Rey-Wicki H., Vanotti M. L’empathie dans la relation de soins, de quoi
parle-t-on ? In Médecine psychosomatique, organe de la Société de médecine
psychosomatique suisse, 1994 ; n° 3, vol. 23 : 7-11.
#Lachowsky M. La relation médecin-malade, une technique parmi d’autres?
Le Quotidien du médecin, 1997 ; n° 6054 : 14.
#Winaver D., Lachowsky M. Entre pouvoir et séduction au fil du temps. In
La femme dans tous ses états (actes des 1res Journées francophones de gynéco-
logie-obstétrique psychosomatiques), Paris, 1994 ; 103-7.
#Lachowsky M., Laveissière M.N., Waldman A. Corps et chuchotements. Le
psychodrame Balint animé par des gynécologues. Actes du 1er Congrès inter-
national de l’AIPB, Marseille, 1992.
GYNÉCOLOGIE ET SOCIÉTÉ
24
La Lettre du Gynécologue - n° 247 - décembre 1999
(8) Charles Brisset, psychiatre, coauteur d’un livre blanc sur la psychiatrie
française.
Les articles publiés dans “La Lettre du Gynécologue” le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.
©janvier 1984 ÉDIMARK S.A.
Imprimé en France - DIFFERDANGE - 95100 Sannois - Dépôt légal 4etrimestre 1999
1
/
4
100%