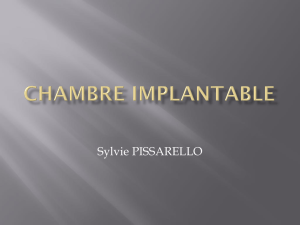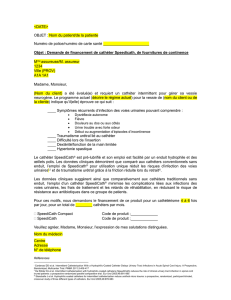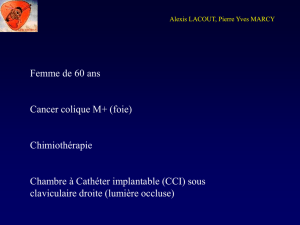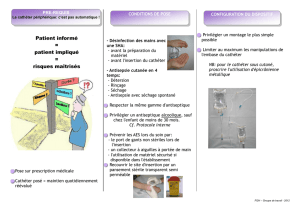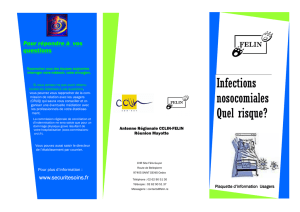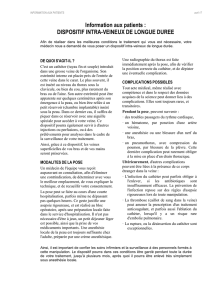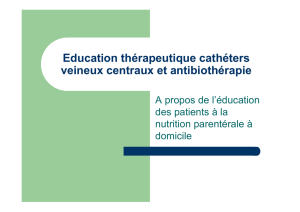A n g i o l o g i e ... Types de cathéters

Angiologie et cancer (III)
Act. Méd. Int. - Angiologie (15) n° 7, septembre 1999 118
Types de cathéters
Globalement, deux types de matériels
sont utilisés :
– soit des cathéters de type Hickman ou
Broviac. Ces cathéters sont constitués
de silastique (gomme siliconée impré-
gnée de baryum). Ils existent en diffé-
rentes tailles : pédiatriques ou adultes et
peuvent être à simple ou double lumière ;
– soit des chambres implantables utilisées
maintenant depuis une vingtaine d’an-
nées. Les chambres sont généralement
construites en titane ou en plastique et
comprennent un diaphragme en silicone
accessible à des ponctions répétées au
moyen d’aiguilles de Huber.
Sélection du site et du cathéter
Le choix entre cathéter externe et
chambre implantable dépend bien enten-
du avant tout des habitudes des équipes,
mais aussi du type de traitement à réali-
ser. Une chimiothérapie conventionnelle
prolongée sera aisément réalisable à l’aide
d’une chambre implantable. Un traite-
ment plus intensif impliquant une nutri-
tion parentérale, la transfusion fréquente
de produits sanguins ou des prélèvements
sanguins répétés lui feront préférer un
cathéter externe.
De même, le risque éventuel de déplace-
ment d’une aiguille de Huber avec fuite
de l’agent cytotoxique hors de la loge du
boîtier de perfusion peut faire préférer la
pose d’un cathéter externe pour des per-
fusions prolongées de substances poten-
tiellement toxiques. De toute façon, en
cas de perfusion prolongée, les aiguilles
de Huber doivent être utilisées de façon
adéquate, en bonne position et contrôlées
à intervalles réguliers.
La pose de ces accès vasculaires est par-
fois effectuée chez des patients pour
lequel le traitement a déjà débuté. Un
grand nombre d’agents cytotoxiques
entraîne une baisse transitoire mais par-
fois profonde (proche de l’aplasie médul-
laire) des éléments figurés du sang, dont
la conséquence est un risque infectieux et
hématologique, le plus souvent de courte
durée. La période de chute des chiffres
globulaires (nadir) doit donc être prise en
compte lors du choix de la date de mise
en place. Un retour à un compte de neu-
trophiles supérieur à 1 500/ml, significa-
tif d’une immunocompétence correcte,
autorise la pose d’un cathéter dans de
bonnes conditions. La thrombopénie, fré-
quente chez ces patients, n’est pas une
contre-indication absolue à la pose de ce
type d’appareil, à condition qu’un chiffre
supérieur à 50 000/ml soit maintenu pen-
dant la période péri-opératoire.
Le choix du site d’insertion doit prendre
en compte les antécédents du patient.
L’implantation doit être réalisée dans la
mesure du possible en peau saine, non
irradiée, n’ayant pas fait l’objet d’une chi-
rurgie avec volet.
L’ intégrité de l’anatomie vasculaire doit
être évaluée en cas de tumeur envahissant
ou comprimant le médiastin ou les creux
susclaviculaires, ou en cas de radiothéra-
pies antérieures. Une imagerie thoracique
peut être réalisée par doppler, voire par
angiographie.
Technique d’insertion
La pose de ces cathéters et chambres
implantables se fait au bloc opératoire
dans des conditions optimales d’aseptie.
Ils sont posés dans la majorité des cas
sous anesthésie locale.
Une incision est réalisée au niveau du
sillon deltopectoral et on dissèque la
veine céphalique pour introduire un
cathéter qui va être poussé jusqu’au
niveau de la veine cave supérieure sous
contrôle radiologique. Si la veine cépha-
lique est de faible calibre, le cathéter est
mis dans la veine jugulaire externe ou
interne. Les cathéters de Broviac et
Accès veineux en
oncologie
V. Andriambolona, S. Piperno-Neumann,
J.F. Morère*
Une grande partie des
agents cytotoxiques utilisés
en chimiothérapie anticancé-
reuse nécessite une administra-
tion parentérale. Certains tels
que les alcaloïdes de la per-
venche ou les anthracyclines
sont vésicants et nécessitent une
administration intraveineuse
stricte. De plus, la chimiothérapie
anticancéreuse est administrée
en règle sur une période de plu-
sieurs mois. Un abord veineux
facilement accessible et fiable
est donc une des conditions
essentielles à la réalisation
d’une chimiothérapie antican-
céreuse optimale.
* Service d’oncologie médicale, CHU
Avicenne, Bobigny.

119
Hickman sont tunnélisés sous la peau et
l’extrémité externe est suturée à la peau
entre le sternum et le mamelon.
On procède de la même façon pour les
boîtiers de perfusion et les chambres
implantables sont, en revanche, placées
dans une logette cutanée à proximité du
site d’insertion veineuse.
Entretien du cathéter
L’entretien régulier de ces cathéters est
nécessaire pour leur assurer une longue
durée de vie. La fréquence de l’hépari-
nisation et la quantité d’héparine utili-
sée diffèrent selon les équipes.
Habituellement, les cathéters externes
sont héparinés tous les jours quand ils
ne sont plus utilisés, tandis que pour les
chambres implantables une héparinisa-
tion mensuelle suffit.
Dans le service, nous utilisons de l’hé-
parine à la dose de 500 UI/5 ml et tous
les mois.
Complications
Plusieurs complications peuvent être
observées chez les patients porteurs de
cathéters. Les plus importantes sont :
Obstruction du cathéter
Elles sont dues à une malposition du
cathéter, soit à une obstruction de la
lumière par des précipitations médica-
menteuses et/ou par des produits san-
guins. On les reconnaît facilement par
l’impossibilité de perfuser. Une radio-
graphie thoracique permet de voir une
malposition du cathéter. Si le cathéter
est en place, il s’agit d’une observation
de la lumière nécessitant des agents
thrombolytique pour la désobstruction.
L’administration de 250 000 UI d’uro-
kinase dans 150 ml de soluté glucosé
pendant 90 min permet de lever l’oc-
clusion dans 90 % des cas selon
Tschirhart J.M. et coll. (1).Deux milli-
litres d’urokinase à la concentration de
2500 à 5 000 UI/ml, administrés dans la
lumière du cathéter puis laissés pendant
30 min à 2 heures est aussi efficace
selon Gillius H. et coll. (2).
L’activateur tissulaire du plasminogène
(t-PA) a aussi été utilisé avec succès
pour la désobstruction des cathéters (3).
Dans le service, nous utilisons un milli-
litre d’urokinase à la concentration de
5000 UI/ml.
Thromboses veineuses
La présence d’un cathéter dans la veine
sous-clavière est un facteur prédispo-
sant au développement d’une thrombose.
Il s’agit souvent d’une thrombose de la
veine sous-clavière ou axillaire.
L’incidence de thrombose veineuse est
plus élevée chez les patients dont le
taux d’hémoglobine est supérieur à
12,7 g/dl et chez les patients porteurs
d’adénocarcinome bronchique que chez
les patients porteurs de carcinome épi-
dermoïde bronchique, de l’œsophage
ou ORL (5, 6).La fréquence des embo-
lies pulmonaires est d’environ 12 %
dans ce cas de thrombose (4).
Dans une étude réalisée dans le service,
sur 185 malades recevant une chimio-
thérapie par l’intermédiaire d’une
chambre implantable, 16 (8,6 %) ont
développé une thrombose veineuse
jugulaire ou sous-clavière (7).
La plupart de ces thromboses sont
asymptomatiques. Le tableau clinique
complet associe des douleurs, une cir-
culation veineuse collatérale et un
œdème inflammatoire du bras homola-
téral au cathéter. Un échodoppler vei-
neux confirme le diagnostic. Le cathé-
ter doit être enlevé si on ne l’utilise
plus. Certains auteurs chez les patients
asymptomatiques préconisent unique-
ment l’ablation du cathéter et sur-
veillance simple (8).D’autres auteurs
mettent en garde contre le risque d’une
embolie pulmonaire (9). Une héparino-
thérapie par voie systémique est néces-
saire d’emblée. L’échodoppler confir-
mera si l’extrémité du cathéter est
thrombosée. Dans ce cas et/ou si les
signes cliniques ne s’amendent pas
sous héparinothérapie, l’ablation du
cathéter peut alors être discutée et
recommandée.
Du fait de la fréquence des thromboses
veineuses associées au cancer, les
patients “à risque”, tels ceux qui reçoi-
vent de l’hormonothérapie, peuvent
recevoir un traitement anticoagulant
préventif ou antiagrégant (7).
Infections du cathéter
Elles sont plus fréquentes chez les
patients porteurs de cathéter externe
que chez ceux porteurs de chambre
implantable. Elles surviennent souvent
au moment du nadir des globules
blancs. Il existe trois types d’infection :
– infection locale qui se manifeste par
un érythème et une induration cutanée
sans syndrome infectieux. Elle est sou-
vent due au Staphylococcus epidermidis
(10, 11).Un traitement local et une
antibiothérapie systémique suffisent
pour enrayer cette infection (12-14) ;
– infection du cathéter ou de la
chambre implantable. Elle se manifeste
par une suppuration voire une cellulite
au niveau de la chambre ou au niveau
du point de suture du cathéter externe.
Cette symptomatologie s’accompagne
d’un syndrome infectieux. Le germe
responsable est souvent le Pseudomonas.
Une antibiothérapie systémique est ins-
tituée et on procède à l’ablation du
cathéter et de la chambre (15) ;
– septicémie dont le point de départ est
le cathéter.Elle se manifeste par un
syndrome infectieux sans point d’appel
clinique. Les hémocultures prélevées
sur les veines périphériques et sur le
cathéter confirment le diagnostic. Dans
une étude réalisée dans le service, sur
1496 malades ayant reçu une chimio-
thérapie par l’intermédiaire d’un boîtier

Act. Méd. Int. - Angiologie (15) n° 7, septembre 1999 120
de perfusion implanté, 94 patients
(6 %) ont eu de la fièvre associée à des
hémocultures positives (16).
Parmi eux, 18 (19 %) ont eu une infec-
tion liée à la chambre.
Les caractéristiques de ces sepsis reliés
au cathéter ont pu être mieux précisés
dans une étude prospective multicen-
trique de cohorte réalisée dans douze
hôpitaux de l’Assistance publique hôpi-
taux de Paris. Dans cette étude, l’inci-
dence et les facteurs de risque ont été
évalués chez les patients atteints de
cancer et comparés à ceux de patients
immunodéprimés (VIH). Deux cent
cinquante-huit cathéters veineux, reliés
ou non à des chambres implantables,
ont été disposés chez 250 patients
atteints de cancer et 209 mis en place
chez 201 patients immunodéprimés. Un
suivi de la maintenance de ces cathéters
et de leurs complications a été réalisé
dans les six mois suivant leur pose. Les
patients étaient atteints de tumeur du
sein (35 %), des bronches (16 %), du
côlon (16 %), ORL (6 %) et avaient, en
majorité (94 %), une maladie très évo-
luée. Une neutropénie d’une durée
médiane de quinze jours a été observée
chez 24 % d’entre eux. Un sepsis relié
au cathéter, défini sur des critères cli-
niques et microbiologiques a été observé
chez 5 % de patients atteints de cancer
contre 31,6 % des patients immunodé-
primés. Les principaux germes isolés
consistaient en staphylocoques coagu-
lase négative (n = 45), Staphylococcus
aureus (n = 14), bacille gram négatif
(n = 22). Cette incidence de sepsis pour
1000 jours d’implantation était huit
fois moins fréquente chez les patients
atteints de cancer que chez les patients
immunodéprimés. Chez les patients
atteints de cancer, le risque infectieux
était plus élevé chez les patients ayant
un indice de Karnofsky bas (p = 0,001)
et chez les patients ayant eu une infec-
tion bactérienne dans le mois précédant
l’implantation du cathéter. Enfin, le
risque de complications est identique
dans les cathéters et les chambres
implantables (p = 0,63) (18). Dans ces
cas, en plus de l’antibiothérapie systé-
mique, l’ablation du cathéter est bien
entendu indiquée.
D’autres complications ont pu être
rapportées dans quelques cas, heureu-
sement rares
L’arythmie cardiaque est en général
consécutive à une malposition du cathéter
descendu trop bas au niveau de
l’oreillette.
Le déplacement du cathéter peut se
faire soit spontanément lors des mouve-
ments, soit dans le cadre d’un syndro-
me de Twidler ; le cathéter est alors
déplacé lors de palpations et de mas-
sages répétés de la zone du boîtier
implantable et du cathéter à la suite de
la gêne créée par ce corps étranger. En
cas de rupture du cathéter, une migra-
tion de celui-ci peut nécessiter son
extraction par des équipes de radiolo-
gistes interventionnels, voire par une
intervention chirurgicale. Une malposition
initiale peut être source de pneumothorax
et hémothorax, voire d’extravasation de
produit plus ou moins vésicant dans la
plèvre ou le médiastin lorsqu’elle passe
inaperçue avant l’utilisation de l’abord
veineux. Les complications cependant
sont relativement rares, eu égard à l’uti-
lisation de plus en plus répandue. Le
taux de complications des chambres
implantables est ainsi évalué dans une
étude récente à 0,23 pour 1 000 jours
d’utilisation. Ces accès périphériques
par chambres implantables semblent
diminuer l’anxiété et la douleur reliées
à l’accès veineux même si elles ne per-
mettent pas d’enregistrer une améliora-
tion significative de la qualité de vie
évaluée par le questionnaire du
Functional Living index Cancer (19).
Conclusion
La mise en place de procédés de perfu-
sion de longue durée apporte un
meilleur confort au patient sous chimio-
thérapie pour un cancer avancé. Une
vigilance constante de l’équipe soi-
gnante est cependant nécessaire pour
éviter la “banalisation” de l’abord vei-
neux afin de minimiser le risque de
complication.
Références bibliographiques
1. Tschirhart J.M., Rao M.K. : Mechanism
and management of persistent withdrawal
occlusion. Am. Surg., 1988, 54 : 326.
2. Gillius H., Rogers H.J., Johnson J. et coll. :
Is repeated flushing of Hickman catheter
necessary ? Br. Med. J., 1985, 290 : 1708.
3. Atkinson J.B., Bagnall H.A., Gomperts E. :
Investigational use of tissue plasminogen
activator (t-PA) for occluded central venous
catheters. J. Parenteral Enteral Nutr., 1990,
14 : 310.
4. Horattas M.C., Wright D.J., Fenton A.M. et
coll. : Changing concepts of deep venous
thrombosis of the upper extremity. Report of
series and review of litterature. Surgery,
1988, 104 : 561.
5. Anderson A.J., Krasnow S.H., Boyer M.W.
et coll. : Thrombosis : the major Hickman
catheter complication in patients with solid
tumor. Chest, 1989, 95 : 71.
6. Brismer B., Hardstetd C., Jacobson S. et
coll. : Reduction of catheter associated
thrombosis in parenteral nutritional by intra-
venous heparin therapy. Arch. Surg., 1982,
117 : 1196.
7. Morère J.F., Boaziz C., Israël L. :
Implantable infusion system and thoracic
venous thrombosis. Eur. J. Cancer Clin.
Oncol., 1987, 16, 31 : 1543.
8. Lokich J.J., Becker B. : Subclavian throm-
bosis in patients treated with infusion chemo-
therapy for advanced malignancy. Cancer,
1983, 52 : 1586.
Angiologie et cancer (III)

ABONNEZ-VOUS
ABONNEZ-VOUS
121
9. Brismar B., Hardstedt C., Jacobson S. :
Diagnosis of thrombosis by catheter phlebo-
graphy after prolonged central venous cathe-
terization. Ann. Surg., 1981, 194 : 779.
10. Press O.W., Ramsey P.G., Larson E.B. et
coll. : Hickman catheter infections in patients
with malignancies. Medicine, 1984, 63 : 189.
11. Schuman E.S., Winters V., Gross G.F.,
Haves J.F. : Management of Hickman catheter
sepsis. Ann. J. Surg., 1985, 149 : 627.
12. Harvey M.P., Frent R.J., Joshue D.E. et
coll. : Complications associed with indwel-
ling venous Hickman catheters in patients
with hematological disorders. Aust. Nzj.
Med., 1986, 16 : 211.
13. Raaf J.H. : Results from use of 826 vascu-
lar access devices in cancer patients. Cancer,
1985, 55 : 1312.
14. Benezra D., Kiehn T.E., Gold J.W.M. et coll. :
Prospective study of infections in indewelling
central venous catheters using quantitative
blood cultures. Am. J. Med., 1988, 85 : 495.
15. Flynn P.M., Van Hooser B., Gigliotti E. :
Atypical mycobacterial infections Hickman
catheter exit site. Pediatr. Infect. Dis. J., 1991,
10 : 510.
16. Dugdale D.C., Ransey P.G. : Staphylo-
coccus Aureus. Bacteremia in patients with
Hickman catheters. Am. J. Med., 1990, 89 :
137.
17. Morère J.F., Nahon S., Boaziz C. et coll. :
Implantable port related sepsis in cancer
patients. Recent advances in chemotherapy
american society for microbiology, 1993 :
542-3.
18. Morère J.F., Astagneau P., Maugat S. et
coll. : Catheter-related sepsis (CRS) in can-
cer and HIV infected patients : a multicentric
cohort study. Proceeding Am. Soc. Clin. Oncol.
17, 1998, 65a, abst 251.
19. Bow E.J., Kilpatrick M.G., Clinch J. :
Totally implantable venous access port sys-
tems for patients receiving chemotherapy for
solid tissue malignancies : a randomized
controlled clinical trial examining the safety
costs and impact on quality of life. J. Clin.
Oncol., 1999, 17 : 1267-73.
Tarif 1999
POUR RECEVOIR LA RELIURE
❐70 F avec un abonnement ou un réabonnement (10,67 €, 13 $)
❐140 F par reliure supplémentaire
(franco de port et d’emballage)
(21,34 €, 26 $)
MODE DE PAIEMENT
❐
par carte Visa
N°
ou
Eurocard Mastercard
Signature : Date d’expiration
❐
par virement bancaire à réception de facture
❐
par chèque
(à établir à l'ordre de Angiologie)
MEDICA-PRESS INTERNATIONAL - 62-64, rue Jean-Jaurès - 92800 Puteaux
Tél. : 01 41 45 80 00 - Fax : 01 41 45 80 30 - E-mail : [email protected]
Votre abonnement prendra effet dans un délai de 3 à 6 semaines à réception de votre ordre.
Un justificatif de votre règlement vous sera adressé quelques semaines après son enregistre
ment.
Merci d’écrire nom et adresse en lettres majuscules
❏Collectivité .................................................................................
à l’attention de ..............................................................................
❏Particulier ou étudiant
Dr, M., Mme, Mlle ...........................................................................
Prénom ..........................................................................................
Pratique : ❏hospitalière ❏libérale ❏autre..........................
Adresse..........................................................................................
......................................................................................................
Code postal ...................................................................................
Ville ................................................................................................
Pays................................................................................................
Tél..................................................................................................
Avez-vous une adresse E-mail : oui ❏non ❏
Sinon, êtes-vous intéressé(e) par une adresse E-mail : oui ❏non ❏
Merci de joindre votre dernière étiquette-adresse en cas de réabonnement,
changement d’adresse ou demande de renseignements.
Recevez régulièrement toutes nos parutions et bénéficiez de nos services gracieux
ÉTRANGER (autre que CEE)
FRANCE / DOM-TOM / CEE
❐
700 F collectivités (127 $)
❐
580 F particuliers (105 $)
❐
410 F étudiants (75 $)
❐
580 F collectivités (88,42 €)
❐
460 F particuliers (70,12 €)
❐
290 F étudiants (44,21 €)
joindre la photocopie de la carte
ANGIO 7
1
/
4
100%