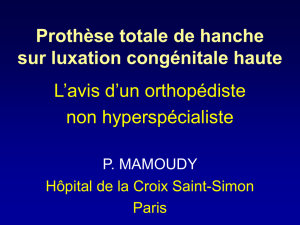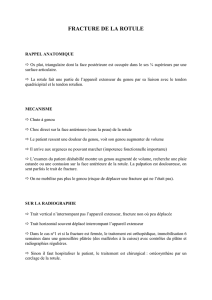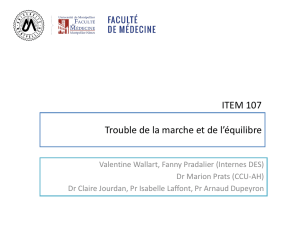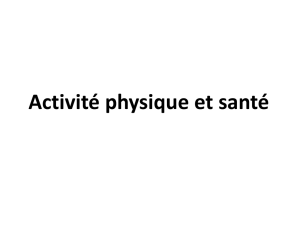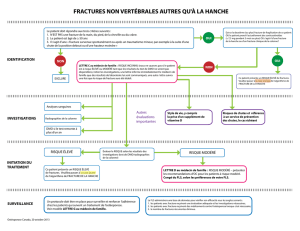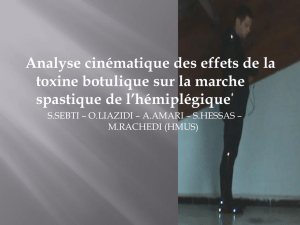APPAREIL LOCOMOTEUR – Sémiologie du membre inférieur

APPAREIL LOCOMOTEUR – Sémiologie du membre inférieur – Partie 2
24/11/2014
PAUL Mathilde L3
CR : BAUMIER Vincent
Appareil locomoteur
Pr. ROCHWERGER
12 pages
Sémiologie du membre inférieur – Partie 2
Sur le membre inférieur, nous retrouvons les articulations portantes : la hanche, le genou, la cheville.
Il s'agit d'un membre d'appui. Il existe une notion de stabilité (rester debout) et de dynamique (course, marche).
L'instabilité d'une articulation est source de traumatismes. Le membre inférieur est particulier dans le sens où il
est portant, à la différence du membre supérieur qui est pronateur. Il sera donc indispensable de restaurer la
fonction d'appui et de dynamisme lors de traumatismes.
A. Sémiologie analytique commune
I) L'interrogatoire
L'interrogatoire est indispensable. Il faut recueillir l'histoire du patient (anamnèse) et l'histoire de la maladie.
On va ensuite étudier les signes fonctionnels physiques :
•Douleur : localisation, irradiation, type,
•Impotence fonctionnelle totale ou partielle (fracture du fémur -> totale, entorse -> partielle...)
•Raideur, blocage
•Instabilité : le patient se plaint de dérobement, chute.
•Boiterie : spécifique du membre inférieur, on peut avoir une boiterie d'esquive (le patient raccourcit le
temps où le membre douloureux est appuyer sur le sol) ou boiterie par insuffisance musculaire
( exemple par anomalie du moyen fessier. La boiterie va entraîner l'utilisation d'une canne.
•Périmètre de marche : distance que le patient peut parcourir sans s’arrêter. Il est souvent donner en
1/12
Plan
A. Sémiologie analytique commune
I) L'interrogatoire
II) L'examen clinique
B. La hanche
I) Sémiologie de la hanche
II) La hanche traumatique
III) Hanche pathologique
C. Le genou
I) Sémiologie du genou
II) Le genou traumatique
III) Genou pathologique
D. Fracture de jambe
E. La cheville
I) Sémiologie de la cheville
II) Cheville traumatique

APPAREIL LOCOMOTEUR – Sémiologie du membre inférieur – Partie 2
minute car la distance en mètre est trop subjective.
II) Examen clinique
Le patient doit être examiné couché, debout puis à la marche car on ne voit pas les mêmes choses.
Inspection : On recherche des déformations. Exemple d'une dé formation liée à l'usure : gonarthrose où la
déformation est accentuée en position debout et peut être invisible couché. Recherche de rougeur, de plaies ou
d'ecchymoses.
Palpation On palpe les points douloureux .
Test de mobilisation des articulations qui peut être active (par le patient lui-même) ou passive (par le praticien).
On recherche des insuffisances d'amplitude, en particulier la notion de flexum : amplitude articulaire
incomplète vers l'extension (le patient maintient la flexion). On le recherche systématiquement pour le genou et
la hanche.
Paraclinique : On fait souvent une radio.
B. La hanche
C'est une articulation profonde, peu accessible. Ses repères osseux palpables sont l'EIAS et le massif du grand
trochanter. Ses rapports anatomiques se font avec les vaisseaux iliaques qui accompagnent le nerf fémoral à la
partie antéro-interne de la hanche. Les branches de l'artère fémorale profonde dont l'artère circonflexe
antérieure donnent une vascularisation terminale de la tête fémorale ; si elle est rompue, il y aura risque de
nécrose de la tête fémorale.
I) Sémiologie analytique de la hanche
a. La douleur.
La hanche est douloureuse dans la région inguinale avec irradiation en région fessière ou douleur
trochantérienne. Elle irradie dans le genou. Lors de douleur chronique de la hanche, la douleur est parfois située
seulement au niveau du genou. Il faut faire préciser au patient le type d'antalgie : médicaments, canne, ou
technique d’évitement.
2/12

APPAREIL LOCOMOTEUR – Sémiologie du membre inférieur – Partie 2
b. Examen physique
•Inspection :
On recherche une inégalité de longueur des membres inférieures ; chez tous les individus, il y a une
différence de longueur de quelques mm à 20mm.
Lorsqu’elle est supérieure à 20mm, elle est parlante et peut donner une boiterie, des douleurs....
Sur un patient couché, on palpe les épines iliaques et on regarde si elles sont sur la même ligne horizontale.
On refait l'examen sur le patient debout, placé dans l'axe. Cette fois ci, on place une cale sous le membre le plus
court, jusqu'à trouver la bonne hauteur pour ramener le bassin en position horizontale. Cette manœuvre permet
de mesurer la différence de longueur.
L'attitude vicieuse : le patient a une position anormale du bassin qui a des
conséquence sur le rachis et ses courbures. Elle peut être en rapport avec une
inégalité de longueur des membres inférieures ou un enraidissement de la
hanche qui oblige le patient à fléchir son genou pour avoir les deux pieds au sol
d'où une boiterie.
Boiterie de Trendelenbourg (à retenir). Pour pouvoir marcher, il faut lever
le pied l'envoyer en avant pendant que l'autre est au sol. On utilise le muscle
moyen fessier pour garder le bassin horizontal lors de la marche.
Si le moyen fessier est anormal, lorsque le pied se lève il va y avoir
distension et chute du bassin du coté où il a lever le pied ; pour ne pas perdre
l’équilibre, le patient va balancer les épaules.
3/12

APPAREIL LOCOMOTEUR – Sémiologie du membre inférieur – Partie 2
•Mobilisation de la hanche :
C'est un examen comparatif droite et gauche. Il existe une pathologie si diminution de l'amplitude.
Flexion de la hanche 140°.
Pour détecter une flexum, il faut mesurer l'extension qui doit être de 30° normalement. Dans le cas de flexum,
on ne peut pas dépasser 5-10°.
Abduction : 40° (éloigner la cheville de l'autre)
Adduction : 40° (faire passer une cheville sur l'autre)
La rotation se mesure sur hanche fléchie à 90° ; elle est de 40° pour une rotation externe et de 20° pour la
rotation interne.
En cas de perte d'extension de la hanche (= du pas postérieur) et le patient ne peut compenser avec sa colonne,
il va y avoir une dissociation de hanche lors de la marche avec une alternance pas court / pas long.
c. Examen paraclinique: la radiologie
On vérifie la continuité osseuse ( les trochanters, la diaphyse, le col fémoral, l'interligne cartilagineux, les
surfaces articulaires, le cintre cervico-obturateur +++, l'axe du col et de la diaphyse (130°).
Il faut également vérifier les signes de la trophicité osseuse avec les travées osseuses.
Il faut vérifier l'orientation de la hanche ( angulation) avec l'axe du col et de la diaphyse (130°) ainsi que
l'angle de couverture de l'acétabulum : c'est l'angle entre la verticale qui passe par le centre de la tête et la ligne
qui passe par l'extrémité médiane de l'acétabulum ; il ne doit pas être inférieur à 20° sinon on parle
d'insuffisance de couverture du cotyle. Dans ce cas, la tête est découverte.
On le diagnostique souvent en pédiatrie. C'est une source d’arthrose précoce chez les jeunes adultes due à une
hyperpression.
4/12

APPAREIL LOCOMOTEUR – Sémiologie du membre inférieur – Partie 2
II) La hanche traumatique
a. Fracture du bassin
La fracture du bassin ou du cotyle sont souvent dues à un accident de la voie publique, ce sont des traumatismes
à haute énergie et souvent polytraumatiques qui touchent le jeune adulte.
La douleur est importante, l'impotence totale.
- la fracture du cadre obturateur ( bassin) : entraîne une ouverture de l'anneau pelvien ; elle peut s'étendre vers
l'arrière et toucher des organes profonds ( digestifs, urinaires avec une section de l'urêtre - > rétention urinaire).
Cette fracture est classique chez le motard.
- la fracture du cotyle articulaire : le pronostique fonctionnel est réservé, il y a une douleur de la région
inguinale. Si elle n'est pas réduite, elle va générer des coxarthroses précoces.
b. Fracture de l'extrémité proximale du fémur
•Fracture du col du fémur.
C'est la plus fréquente.
Elle a lieu lors d'une chute de sa hauteur, chez des patients âgés sur des os pathologiques comme l’ostéoporose.
La douleur est ressentie dans la région inguinale, l'impotence fonctionnelle est totale dans presque tous les cas
(exception pour la fracture en coxa valga).
Le plus souvent, la fracture est déplacée avec déformation visible.
Le tableau clinique est: membre inférieur racourci, il est en rotation externe avec tendance à l'abduction.
Le déplacement est dû aux tractions musculaires du moyen fessier et du psoas qui tirent vers le haut et par les
muscles abducteurs.
L'épiphyse proximale du fémur est parcourue par un certain nombre de travées osseuses qui sont les lignes de
force de l'os. Les fractures se font sur les points de faiblesses, surtout présent dans le col.
On classifie les fractures du col du fémur grâce a la classification de Garden :
I : Fracture en coxa valga, les travées sont en valgus
permettant de faire le diagnostic.
II : Axe de la travée préservé .
III : fracture en coxa vara, les travées sont en varus.
La fracture sépare le col et la tête,
IV : plus de contact osseux entre la tête et le col.
5/12
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
1
/
12
100%