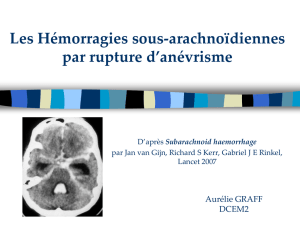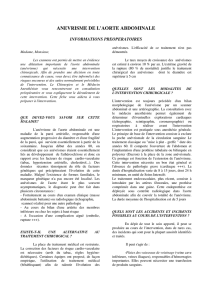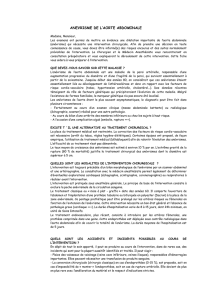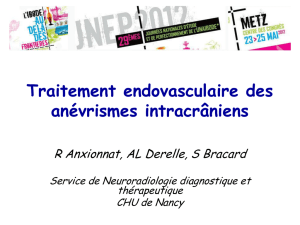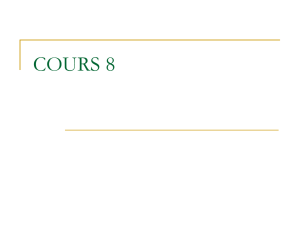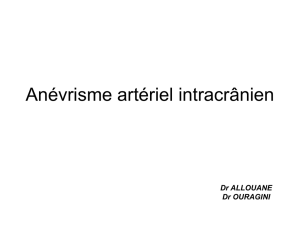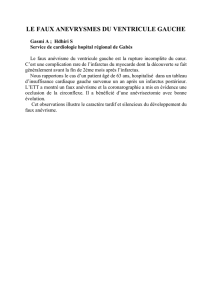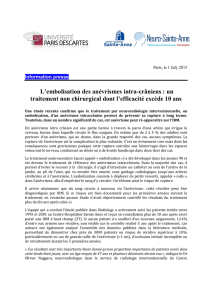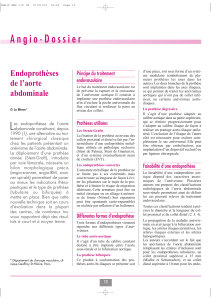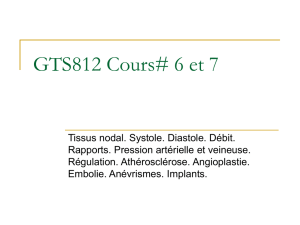Traitement endovasculaire des anévrismes intracrâniens M

MISE AU POINT
225
La lettre du neurologue - n° 5 - vol. V - mai 2001
Traitement endovasculaire des anévrismes intracrâniens
●
F. Turjman*
es techniques endovasculaires de traitement des ané-
vrismes intracrâniens ont évolué dans les dix der-
nières années. Les spires métalliques détachables
(Guglielmi Detachable Coils [GDC]), utilisées en Europe
depuis 1992 et en Amérique du Nord depuis 1991, représentent
une avancée technique capitale. Elles ont supplanté le traite-
ment sélectif des anévrismes par ballon et le traitement par
spires non détachables.
Nous allons décrire la technique endovasculaire, les principes
de son évaluation et sa place par rapport à la chirurgie.
Selon les centres, les techniques endovasculaires sont propo-
sées en première intention ou, à l’inverse, c’est le traitement
neurochirurgical qui est privilégié, les indications d’embolisa-
tion étant limitées.
La France est le pays dans lequel le traitement endovasculaire des
anévrismes est le plus avancé et le plus répandu, puisque environ
50 % des anévrismes intracrâniens sont traités par cette voie.
TECHNIQUE ENDOVASCULAIRE
Trois techniques sont utilisées : le traitement standard, la
reconstruction de l’artère au collet (ou remodeling) et l’occlu-
sion du vaisseau porteur.
Le traitement standard
(1)
Le traitement est réalisé sous anesthésie générale et décoagula-
tion à l’héparine (même après hémorragie méningée). En géné-
ral, on utilise un abord artériel fémoral ; d’autres voies sont
possibles (carotide, humérale).
Le traitement endovasculaire consiste en une occlusion pro-
gressive, totale et dense du sac anévrismal, en préservant le
vaisseau porteur.
II commence par la mise en place d’un cathéter “porteur” d’en-
viron 2 mm de diamètre dans la portion cervicale de l’artère
carotide interne ou vertébrale porteuse de l’anévrisme. Un
microcathéter de 0,6 à 1 mm est ensuite introduit dans le sac
anévrismal. Les boucles vasculaires sont négociées par le
microcathéter grâce à un guide souple.
L’outil de traitement est une spire métallique détachable et
repositionnable appelée coil : c’est un filament métallique avec
une mémoire de forme (figure 1). Il est constitué d’un guide en
acier et d’une partie en platine : le coil lui-même. La spire
GDC est la plus couramment utilisée : les deux pièces sont
solidarisées par une soudure ; la partie en platine est la partie
implantable. Elle est caractérisée par sa longueur et son dia-
mètre. Ce coil en platine est très souple, ce qui permet de le
positionner avec une bonne sécurité, même dans un anévrisme
fraîchement rompu. Le coil est choisi en fonction de la taille du
sac anévrismal et de la zone d’attache de l’anévrisme sur l’artè-
re (le “collet”). Pour un anévrisme rond de 5 mm de diamètre,
on pourra choisir un coil de 5 mm de tour de spire sur 15 cm de
longueur. Plusieurs spires sont en général nécessaires pour trai-
ter un anévrisme. L’occlusion de l’anévrisme peut ne pas être
* Service de radiologie, hôpital neurologique et neurochirurgical
Pierre-Wertheimer, Lyon.
■En France, environ 50 % des anévrismes intracrâniens
sont traités par les techniques endovasculaires.
■Le traitement actuel utilise une spire en platine déta-
chable et repositionnable.
■L’indication idéale du traitement endovasculaire est un
anévrisme de 5 à 10 mm de diamètre arrondi à petit collet
(base d’implantation).
■Certaines localisations anévrismales (système vertébro-
basilaire, carotido-ophtalmique, sinus caverneux) et la gra-
vité du tableau clinique initial orientent vers une prise en
charge endovasculaire.
■La disponibilité, l’expérience et les convictions des
équipes endovasculaires et chirurgicales jouent un rôle
déterminant dans le choix entre les deux techniques théra-
peutiques.
■Les développements actuels portent sur l’amélioration
du pourcentage et de la permanence de l’occlusion, points
faibles de la technique actuelle.
■La connaissance du taux de resaignement à long terme et
l’évolution clinique selon le grade initial sont nécessaires
pour compléter l’évaluation des méthodes endovasculaires.
POINTS FORTS
POINTS FORTS
L

226
MISE AU POINT
La lettre du neurologue - n° 5 - vol. V - mai 2001
complète à l’issue du traitement. Après la souplesse, le deuxiè-
me avantage fondamental du GDC est d’être repositionnable.
Lorsque sa position n’est pas satisfaisante, le coil peut être reti-
ré de façon à tenter un placement plus convenable. Lorsque la
position est correcte, le largage est réalisé par application d’un
courant électrique continu positif au guide en acier, qui sort du
patient par la voie d’abord fémorale. Ce courant entraîne une
électrolyse progressive de la soudure et, en quelques minutes,
on obtient le détachement de la partie en platine sans déplace-
ment mécanique du coil.
Plus récemment, des coils de forme complexe ont été commer-
cialisés (premier tour et demi de diamètre réduit ou déploie-
ment successif de la spire dans toutes les directions de
l’espace). Le prix d’un coil GDC est de l’ordre de 4 200 FF TTC.
Reconstruction de l’artère ou
remodeling (2)
La technique standard ne permet pas de traiter des anévrismes
dont la zone d’attache est large.
J. Moret a proposé une technique utilisant, en plus du microca-
théter porteur des coils, un ballonnet fixé à l’extrémité d’un
autre microcathéter introduit par l’artère fémorale controlaté-
rale et gonflé temporairement au collet de l’anévrisme pendant
la mise en place des coils. Cette méthode permet de maintenir
les coils à l’intérieur de l’anévrisme malgré une zone d’attache
assez large de l’anévrisme sur l’artère.
Occlusion du vaisseau porteur
La plupart des anévrismes géants et fusiformes ne peuvent pas
être traités par les techniques endovasculaires ou chirurgicales
habituelles. On peut proposer l’occlusion de l’artère porteuse
de l’anévrisme à condition que les vaisseaux intracérébraux
soient pris en charge par les anastomoses ou par le cercle de
Willis et que l’occlusion entraîne une diminution importante du
flux dans l’anévrisme. Nous ne privilégions pas cette
technique ; il n’est pas anodin d’occlure une artère majeure du
cerveau chez un patient porteur d’une lésion vasculaire, et donc
potentiellement porteur d’autres anomalies de la paroi vasculai-
re. Cependant, c’est parfois la seule solution thérapeutique.
L’occlusion des vaisseaux porteurs est réalisée après un test de
tolérance. En cas de non-tolérance, on peut programmer une
anastomose chirurgicale entre la carotide externe et la carotide
interne (voire entre la carotide externe et le segment P2 de l’ar-
tère cérébrale postérieure), qui permet une prise en charge
complémentaire de l’axe occlus. Pour favoriser la thrombose de
l’anévrisme géant, on associe volontiers la mise en place d’un
maillage lâche de coils dans le sac avant l’occlusion anévrismale.
RÉSULTATS
Le but du traitement des anévrismes intracrâniens est de préve-
nir de façon permanente le (re)saignement en préservant la cir-
culation cérébrale. Le traitement des anévrismes rompus est
réalisé dans un système cérébrovasculaire en crise.
L’évaluation des résultats du traitement endovasculaire est
encore très incomplète. Les résultats à long terme sur de
grandes séries de patients embolisés ne sont pas encore dispo-
nibles. Nous nous proposons de décrire ici les principes de
l’évaluation des résultats. Le taux de (re)saignement, les résul-
tats morphologiques, le pourcentage d’échecs et de patients
récusés, le taux de complications techniques conduisant à des
complications cliniques ainsi que l’évolution selon l’état cli-
nique initial et selon les grades de Fisher sont autant de critères
utiles à analyser.
Taux de saignement ou de resaignement
Il est sans doute trop tôt pour estimer le taux de saignement des
anévrismes non rompus traités, car c’est un événement peu fré-
quent : la démonstration de l’efficacité de cette prévention
nécessitera un suivi prolongé.
La fréquence du resaignement dans les études de référence est
de 1 à 2 % des patients sur des périodes moyennes de 12 mois
(3, 4) ; dans certaines séries, jusqu’à 30 % de patients sont per-
dus de vue.
Résultats morphologiques
Ils font état de 70 à 80 % de traitements complets, d’environ
20 % de traitements subtotaux, c’est-à-dire laissant persister
une opacification au collet, et de 2 à 4 % de traitements par-
tiels, c’est-à-dire dans lesquels on observe une opacification
résiduelle du sac anévrismal.
Le suivi à plus de trois ans ferait état d’environ 10 % de reca-
nalisation des anévrismes (inférieurs à 15 mm de diamètre)
dont le traitement initial était jugé satisfaisant.
L’occlusion secondaire spontanée d’anévrismes incomplète-
ment traités est possible.
Ce résultat morphologique exprimé en pourcentage d’occlusion
de l’anévrisme est une donnée immédiatement disponible et
peut être corrélé au risque de resaignement. Cette dernière
hypothèse comporte plusieurs incertitudes.
Figure 1. Coil
GDC : on distingue
la partie droite en
acier et la partie
souple en platine
rattachées par la
soudure.

227
La lettre du neurologue - n° 5 - vol. V - mai 2001
●La relation entre pourcentage d’occlusion de l’anévrisme et
risque hémorragique n’est pas claire :
—
en effet, il n’est pas certain qu’un anévrisme angiographi-
quement exclu de la circulation comporte un risque hémorra-
gique nul, et il n’est pas démontré qu’un anévrisme partielle-
ment traité (du fait de modifications hémodynamiques à
l’intérieur du sac anévrismal) soit associé à un risque hémorra-
gique significatif ;
– il semble que le traitement d’un anévrisme à la phase aiguë
de l’hémorragie prévienne le resaignement précoce ; classique-
ment, après six mois d’évolution, l’anévrisme rompu retrouve
un risque hémorragique équivalent de celui d’un anévrisme non
rompu. Une occlusion satisfaisante à la phase initiale pourrait
garantir un risque de resaignement très faible.
●Le développement de l’anévrisme et sa rupture éventuelle
résultent d’un facteur pariétal et de facteurs hémodynamiques :
—
il est difficile de généraliser les données concernant les ané-
vrismes, car il existe des entités différentes : certains ané-
vrismes se rompent au fond du sac et seront plus facilement
protégés par le traitement endovasculaire, même incomplet,
que ceux qui se rompent au collet ; d’autres anévrismes ont
tendance à la recroissance après traitement endovasculaire ou
chirurgical : ce pourrait être la traduction d’une paroi vasculai-
re pathologique ;
– les facteurs hémodynamiques : les anévrismes directement
dans l’axe du vaisseau porteur (terminaison du tronc basilaire
ou de l’artère carotide interne) sont plus difficiles à occlure que
les autres (5).
Pourcentage d’échecs et de patients récusés
L’analyse des résultats devrait tenir compte des patients récusés
par la technique endovasculaire.
Les échecs du traitement dépendent de nombreux facteurs, dont
le recrutement du centre endovasculaire. Ce taux d’échec du trai-
tement endovasculaire lié à l’incapacité de positionner le micro-
cathéter dans le sac anévrismal ou à l’impossibilité de mettre en
place un coil dans l’anévrisme est de l’ordre de 5 %.
Taux de complications techniques et cliniques
Les complications en relation avec la procédure sont la perfora-
tion d’anévrisme, la migration d’emboles dans les artères dis-
tales, l’occlusion artérielle, la migration du coil dans le vais-
seau porteur et enfin le vasospasme mécanique.
Nous retiendrons les chiffres des complications cliniques per-
manentes en relation avec une complication technique : la mor-
talité est aux alentours de 2 % et la morbidité entre 4 et 8 %
selon les séries.
Évolution selon l’état clinique initial et selon les grades de
Fisher (tableau I)
En plus de l’occlusion de l’anévrisme, qui est le geste central
de l’intervention, le traitement de l’anévrisme (endovasculaire
ou chirurgical) implique des événements potentiellement néga-
tifs (rétraction du cerveau, perte de sang, ralentissement circu-
latoire...) ou potentiellement positifs (lavage des citernes, réta-
blissement du calibre artériel...). Ces facteurs sont trop nom-
breux et intriqués pour que l’on puisse en faire la part. L’éva-
luation du résultat clinique doit donc se faire en fonction de
l’état clinique initial du patient mais aussi en fonction du
potentiel évolutif (grades de Fisher : quantité de sang au scan-
ner initial corrélée avec la survenue d’un vasospasme).
PROTOCOLE DE SURVEILLANCE
La surveillance des anévrismes traités par voie endovasculaire
doit être clinique et morphologique, précoce et tardive : plu-
sieurs protocoles sont possibles.
Les patients avec un anévrisme rompu quitteront l’institution
hospitalière en fonction de l’évolution de l’hémorragie sous-
arachnoïdienne. Les patients traités pour un anévrisme non
rompu quitteront l’hôpital après 3 ou 4 jours. Dans notre proto-
cole, l’évaluation est clinique et angiographique. Nous convo-
quons le patient en consultation à un mois. Une angiographie
est pratiquée à deux mois puis à un an. Une angiographie par
résonance magnétique (ARM) est pratiquée entre deux et trois
ans après le traitement. En cas de résidu anévrismal, un traite-
ment complémentaire endovasculaire ou chirurgical est envisa-
gé. Si ce traitement n’est pas faisable, une ARM est réalisée en
même temps que l’angiographie à un an. Si les résultats sont
concordants, c’est l’ARM annuelle qui permettra la surveillan-
ce ; sinon, c’est l’angiographie qui en sera la base. Une simple
radiographie du crâne pourrait fournir des renseignements pré-
cieux pour la surveillance. Le protocole de surveillance est
adapté selon l’état clinique et l’âge du patient.
INDICATIONS
Décision thérapeutique
●Anévrismes rompus
Les anévrismes rompus doivent être traités. Juvela (6) a rappor-
té un taux de resaignement de 27,7 % à 14 jours dans un
groupe d’anévrismes non traités. Le taux de mortalité en rela-
tion avec ce resaignement était de 74 %. Nous ne mettons pas
de limite d’âge à cette prise en charge (le patient le plus âgé
avait 82 ans). Dans notre stratégie actuelle, tout patient trans-
portable en salle d’angiographie sera traité par voie endovascu-
laire, même en cas d’état clinique très sévère.
●Grade 1 : pas d’hémorragie sous-arachnoïdienne
●Grade 2 : hémorragie méningée diffuse dont l’épaisseur est
inférieure à 1 mm
●Grade 3 : caillots ou hémorragie dont l’épaisseur est supérieure
à 1 mm
●Grade 4 : hémorragie intracérébrale ou intraventriculaire
Tableau I. L’intensité de l’hémorragie au scanner initial est corrélée à
la survenue d’un vasospasme : grades de Fisher.

MISE AU POINT
228 La lettre du neurologue - n° 5 - vol. V - mai 2001
●Anévrismes non rompus
Le risque de rupture des anévrismes non rompus est l’objet
d’une controverse. Les données classiques (7) avançaient un
risque hémorragique cumulatif de 2 à 3 % par an (8). Les don-
nées de l’étude internationale sur les anévrismes intracrâniens
non rompus (8) font état d’un risque hémorragique très faible,
en particulier des anévrismes non associés à un anévrisme pré-
cédemment rompu et de taille inférieure à 10 mm. Cette étude
peut être sujette à critiques, en particulier du fait de l’impor-
tante représentation (16,9 %) des anévrismes intracaverneux,
dont l’hémorragie est rarissime. Par ailleurs, elle est en contra-
diction avec l’expérience quotidienne, pour laquelle les ané-
vrismes les plus fréquemment rompus mesurent entre 2 et
10 mm.
Cependant, cette étude suggère que le risque hémorragique des
anévrismes non rompus est sans doute plus faible que ce qui est
habituellement admis.
Dans notre pratique, nous ne conseillons pas le traitement pré-
ventif des anévrismes non rompus après 65 ans. Avant 65 ans,
le patient est informé des risques du traitement et des incerti-
tudes de l’histoire naturelle : c’est lui qui prend la décision. La
réputation très défavorable de la rupture d’anévrisme dans la
population pousse la plupart des patients à demander un traite-
ment malgré l’absence de statistiques démontrant formellement
le bénéfice de l’intervention.
●Anévrismes de taille supérieure à 15 ou 20 mm
Ils posent des problèmes de prise en charge pour les deux
techniques.
Indications particulières : anévrismes satellites d’un
anévrisme rompu
Vingt à 25 % des patients porteurs le sont d’anévrismes mul-
tiples. Dans la série de Wiebers (8), les anévrismes non rompus
associés à un anévrisme rompu représentent un groupe particu-
lier associé à un risque hémorragique largement supérieur à
celui des anévrismes isolés. Il faut souligner que la détermina-
tion précise de l’anévrisme responsable de l’hémorragie peut
être difficile.
D’autre part, la prise en charge médicale du vasospasme, une
des principales complications de l’hémorragie méningée,
consiste principalement dans le maintien d’une tension artériel-
le haute et d’une hypervolémie. Ces facteurs sont susceptibles
de favoriser la rupture d’un anévrisme associé, même en dehors
d’une rupture préalable. Dans la mesure du possible, nous pra-
tiquons le traitement simultané des anévrismes associés à un
anévrisme rompu en cas d’anévrismes multiples.
Indications respectives de la chirurgie et du traitement
endovasculaire
La comparaison des deux méthodes se heurte à des évaluations
différentes et à des biais de recrutement. L’étude de Vinuela (3),
par exemple, rapporte le traitement d’anévrismes considérés
comme des contre-indications chirurgicales. Dans les séries
endovasculaires, on constate un fort pourcentage d’anévrismes
de la circulation postérieure, dont la chirurgie est difficile.
●Traitement chirurgical des anévrismes intracrâniens
La publication de l’étude coopérative internationale sur la prise
en charge chirurgicale des anévrismes intracrâniens en 1992 (9)
a fourni les données les plus complètes sur le traitement chirur-
gical moderne des anévrismes dans des centres expérimentés.
Plus de 3 000 patients ont été inclus dans une étude prospective
multicentrique entre 1980 et 1983. Cette étude a montré que la
mortalité globale des patients opérés était de 20 à 28 % selon la
date de la chirurgie et le grade clinique du patient. Les patients
en grade 4 de Hunt et Hess (stuporeux ou comateux) ont un
taux de mortalité compris entre 39 et 79 % (tableau II).
Dans une étude récente (8), un groupe de 1 172 patients por-
teurs d’anévrismes, non rompus isolés ou satellites d’ané-
vrismes rompus déjà traités, ont été opérés dans des centres de
référence. Six à 17 % des patients ont été récusés pour la chi-
rurgie. La morbidité et la mortalité globales étaient comprises
entre 13,1 et 15,7 %. Dans une autre étude, le résultat morpho-
logique du traitement chirurgical fait état d’une occlusion ané-
vrismale incomplète dans 5,9 % des cas (10).
Plusieurs auteurs ont rapporté des séries monocentriques avec
des résultats chirurgicaux nettement plus favorables.
●Facteurs décisionnels
L’indication idéale du traitement endovasculaire est un ané-
vrisme de 5 à 10 mm de diamètre arrondi à petit collet.
– Date du traitement : dans les anévrismes rompus, la stratégie
chirurgicale doit faire la part entre le traitement précoce évitant
le resaignement mais majorant l’ischémie cérébrale retardée et
le traitement tardif (14 % de resaignement chez les patients
programmés pour une chirurgie tardive entre le 11eet le 14e
jour). Le traitement endovasculaire n’est pas influencé par ce
facteur.
– Localisation anévrismale : certaines localisations anévris-
males sont réputées difficiles pour la chirurgie ; c’est le cas des
anévrismes de la circulation postérieure et des anévrismes
●Grade 1 : céphalée minime
●Grade 2 : syndrome méningé avec céphalée modérée à
sévère ± paralysie oculomotrice
●Grade 3 : somnolence, confusion ou déficit neurologique modéré
●Grade 4 : stupeur, hémiparésie
●Grade 5 : coma profond, décérébration
Tableau II. La classification de Hunt et Hess permet l’évaluation de la
gravité des hémorragies sous-arachnoïdiennes.

229
La lettre du neurologue - n° 5 - vol. V - mai 2001
carotido-ophtalmiques (figures 2, 3, 4). Ce sont de bonnes
indications du traitement endovasculaire. Le traitement chirur-
gical des anévrismes du complexe communicant antérieur doit
préserver les artères perforantes de l’artère communicante anté-
rieure. Les anévrismes localisés dans la bifurcation de l’artère
cérébrale moyenne sont très accessibles à la dissection chirur-
gicale. Leur réputation de relative bénignité chirurgicale n’est
pas retrouvée dans la littérature.
– La présence d’un hématome mal toléré associé à l’anévrisme
doit faire pratiquer une exérèse chirurgicale de l’hématome et
le clippage de l’anévrisme.
– La morphologie de l’anévrisme : la constatation d’un ané-
vrisme sans véritable collet fait préférer le traitement chirurgi-
cal, même si le traitement endovasculaire avec technique de
reconstruction est possible.
– L’état clinique : certains patients ont des antécédents sévères
défavorables à la chirurgie.
Pour les patients en grades cliniques élevés (4 et 5 de Hunt et
Hess), un geste endovasculaire est probablement moins agressif
et donc mieux toléré qu’une craniotomie chez des patients avec
une circulation cérébrale perturbée et des chiffres de pression
intracrânienne habituellement élevés.
En définitive, la décision de traitement endovasculaire ou chi-
rurgical tient compte de facteurs concernant le patient et les
caractéristiques de l’anévrisme. Ces paramètres permettent,
dans bon nombre de cas, de choisir l’orientation thérapeutique.
La disponibilité, l’expérience et les convictions des équipes
endovasculaires et chirurgicales jouent un rôle déterminant.
La performance de la prise en charge endovasculaire des ané-
vrismes dans des conditions difficiles a permis l’extension des
indications à des présentations plus favorables.
Une étude multicentrique randomisée des anévrismes traitables
par les deux techniques (étude ISAT coordonnée par A. Moly-
neux et R. Kerr d’Oxford, Royaume-Uni) est en cours. Elle
pourrait apporter des éléments plus objectifs à cette discussion.
PERSPECTIVES
Le traitement endovasculaire des anévrismes est toujours en
évolution.
●L’imagerie actuelle des anévrismes bénéficie de l’apport de
l’angiographie 3D. Cette angiographie permet de mieux
démontrer, avant et après la procédure, les relations entre l’ané-
vrisme et sa branche porteuse, sa zone d’attache et les branches
adjacentes.
●Le matériel d’embolisation : on a déjà mentionné la com-
mercialisation récente de coils à forme complexe. De nouveaux
systèmes de détachement de coils sont disponibles. Des travaux
actuels portent sur le remplissage des anévrismes par un liquide
polymérisant ou précipitant. Des équipes japonaises ont déjà
rapporté une expérience clinique intéressante avec cette tech-
Figure 2.
Artériographie
carotidienne
de profil avec
soustraction
osseuse
montrant
un anévrisme
carotido-
ophtalmique.
Figure 3.
Artériographie
carotidienne
de profil après
traitement :
image
en soustraction
montrant
la disparition
du remplissage
anévrismal.
Figure 4.
Artériographie
de profil sans
soustraction
après traitement
montrant
l’aspect dense
des spires
métalliques
dans l’anévrisme.
 6
6
1
/
6
100%