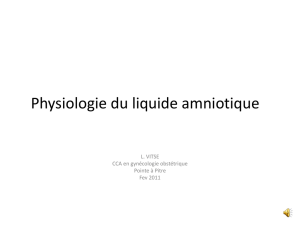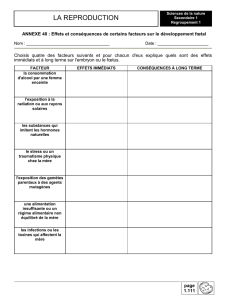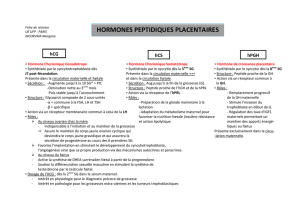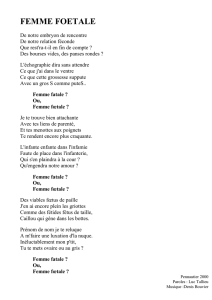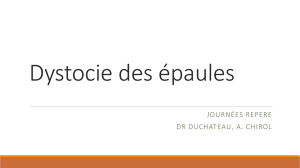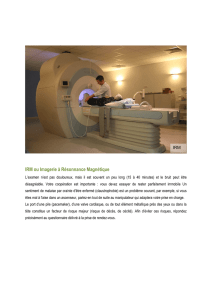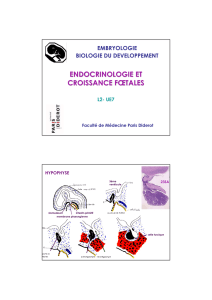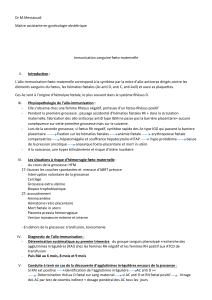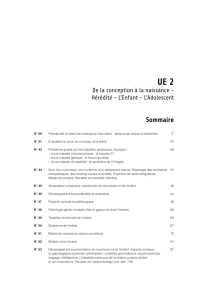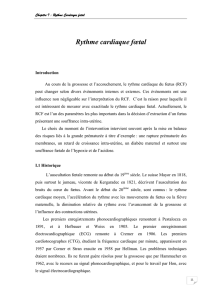Générer un fichier PDF

JFR 2010 - Neuro-imagerie anté- et post-natale
Mis à jour le 22/06/2011 par
SFR
F Brunelle .
Hôpital Necker, Paris
Article issu des JFR 2010
- Mardi 25 Octobre
Les premières IRM fœ
tales ont été réalisées il y a un peu moins de vingt
-
cinq ans. Les tout
premiers scanners du f
œ
tus réalisés il y a moins de dix ans ont fortement ému la communauté
radiologique.
Que de chemin parcouru !
Les toutes premières images d
’
IRM ont été réalisées après
curarisation fœtale par ponction du cordon sous contrôle
échographique pour obtenir une immobilité fœtale liée à la
longueur des séquences utilisées alors.
Puis la prémédication maternelle par Rohypnol a été utilisée.
Aujourd
’
hui, la rapidité des séquences utilisées, en particulier les
séquences en
«
single shot
»
, permet une analyse complète de
l
’
anatomie fœtale, sans aucune prémédication.
531 articles ont été publiés lors des douze derniers mois sur
l
’
imagerie fœtale. C
’
est dire le dynamisme de ce domaine !
Ce développement a été rendu possible par une collaboration
intégrée entre les différents acteurs de la médecine fœtale :
obstétriciens, généticiens, radiologues…
Les corrélations entre l
’
imagerie anténatale et post
-
natale et les
données chirurgicales, l
’
établissement de facteurs pronostiques
permettant une meilleure approche thérapeutique post
-
natale ont
été autant d
’
avancées scientifiques.
Le domaine de la hernie diaphragmatique est à ce titre
exemplaire.
La mesure du volume pulmonaire fœtal en IRM, puis en échographie, a permis d
’
établir un pronostic
relativement fiable permettant d
’
adapter la prise en charge thérapeutique post
-
natale.
En effet, en comparant les volumes pulmonaires d
’
un fœtus porteur d
’
une hernie diaphragmatique aux
abaques normaux, il a été possible d
’
établir une valeur seuil (
«
cut off
»
)
en deçà de laquelle le
pronostic est péjoratif.
La collaboration entre les équipes anténatales et post
-
natales a permis de développer le concept de
«
mortalité cachée
»
(
hidden mortality).
En effet, certains nouveau
-
nés porteurs de hernies diaphragmatiques mouraient dès la naissance et
n
’
atteignaient pas les centres chirurgicaux qui prennent en charge ces hernies diaphragmatiques.
Ce biais épidémiologique a été rapidement identifié.
Les avancées techniques actuelles concernent essentiellement l
’
IRM cardiaque fœtale qui permet de
réaliser, comme en post
-
natal, des images statiques et dynamiques du cœ
ur f
œtal en IRM.
Le
«
gating
»
cardiaque fœtal reste cependant encore un obstacle technique non surmonté. Il est en
effet difficile de saisir le signal électrocardiographique fœtal.
Dans le domaine cardio
-
vasculaire, il est à prévoir que l
’
utilisation
de produit de contraste, qui est aujourd
’
hui relativement contre
-
indiqué, permettra l
’
analyse précise des pathologies placentaires,
mais aussi des pathologies vasculaires anténatales. En cas de
nécessité, l
’
injection de produit de contraste permet une
identification précise des implantations anormales du placenta
(placenta accreta).
L
’
application des séquences de diffusion et de spectroscopie sur
le cerveau fœtal va permettre de réaliser des études de
développement cérébral normal et pathologique chez l
’
enfant.
Des publications récentes montrent l
’
intérêt de ces séquences
pour évaluer les souffrances cérébrales fœtales.
Des séquences dynamiques (fiesta) permettent une analyse de la
déglutition et le diagnostic d
’
atrésie de l
’
œsophage. L
’
imagerie
fœtale en scopie IRM n
’
est pas très loin !
Des algorithmes de reconstruction spécifiques utilisant des
séquences traditionnelles permettent déjà des reconstructions
tridimensionnelles du cerveau fœtal qui laissent imaginer
l
’
établissement d
’
atlas tridimensionnels de la croissance du
cerveau fœtal.

Dès aujourd
’
hui, l
’
échographie et l
’
IRM permettent une analyse
assez précise de la biométrie fœtale et du poids fœtal.
L
’
IRM est aussi aujourd
’
hui utilisée comme outil d
’
autopsie
virtuelle permettant une analyse post
-
mortem fœtale non
invasive.
Il ne faut pas oublier le développement du scanner fœtal qui, grâce aux techniques de réduction de
doses, a permis l
’
explosion du diagnostic des malformations osseuses anténatales. Les tout premiers
scanners furent réalisés en 30 secondes au cours d
’
une apnée maternelle. Aujourd
’
hui, les scanners
multibarettes permettent une acquisition en quelques secondes avec une dose inférieure aux anciens
«
contenus utérins
»
, qui font partie du passé.
Ainsi le fœtus devient
-
il un patient
«
comme les autres
»
, et les tabous liés à cette période de la vie
sont en train de tomber.
Les différentes techniques d
’
imagerie utilisées chez l
’
enfant et l
’
adulte vont s
’
appliquer chez le fœtus.
L
’
ensemble de ces techniques va éclairer d
’
un jour nouveau les mécanismes du développement fœtal, en
particulier du développement cérébral du fœtus.
D
’
ores et déjà, ces techniques ont modifié la prise en charge d
’
un certain nombre de pathologies
malformatives.
C
’
est la collaboration entre les différentes spécialités prenant en charge la médecine fœtale, la
collaboration entre les différentes techniques et leurs justes prescriptions (échographie, IRM, scanner),
qui ont permis ces progrès.
Mais la porte est juste entrouverte : il est à parier que la révolution est à venir. Le fœtus est en train
d
’
acquérir un véritable statut. La naissance n
’
est plus le début de la vie : c
’
est un passage dans une vie
qui commence bien avant.
1
/
2
100%