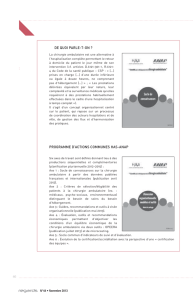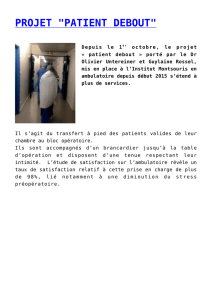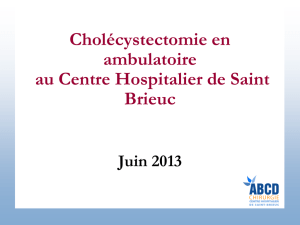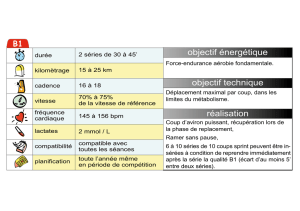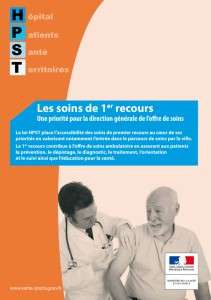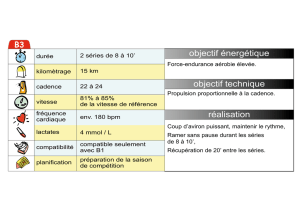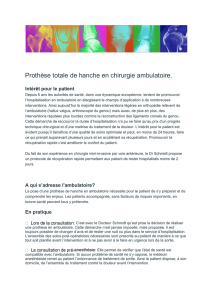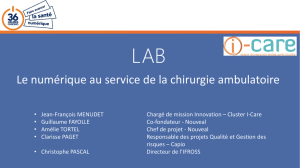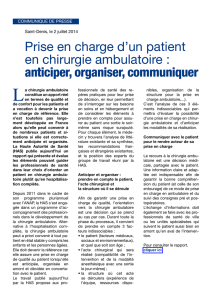Thyroïdectomie en ambulatoire : déjà 20 ans d’expérience

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XVII - n°10 - décembre 2013
326326
Mise au point
Thyroïdectomie en ambulatoire :
déjà 20 ans d’expérience
Thyroid surgery in outpatients: a 20 years story
C. Vons*, F. Sista*
Points forts
Highlights
»
Depuis 20 ans, une importante et croissante littérature a rapporté
les résultats de thyroïdectomies réalisées en ambulatoire, venant
principalement des États-Unis et parfois réalisées dans des
établissements où seuls des patients ambulatoires étaient pris en
charge. Au total, 14 séries originales ont rapporté les résultats des
interventions réalisées chez 4 166 patients et 2 études de cohortes
réalisées dans 2 États américains, les résultats de 17 936 patients.
»
En moyenne, les thyroïdectomies en ambulatoire représentaient
26 % (1-76 %) des thyroïdectomies réalisées pendant la même
période dans les séries originales, et 16 % dans les études de
cohortes.
»
Les pathologies opérées étaient le plus souvent des goitres
multinodulaires (41 %), moins souvent des cancers (28 %) et des
nodules isolés (26 %) et rarement des hyperthyroïdies (5 %). Un
peu plus de lobectomies (54 %) que de thyroïdectomies totales
(46 %) ont été réalisées en ambulatoire.
»
Les bons résultats de ces séries et cohortes confi rment que
l’ambulatoire pour les thyroïdectomies est fi able et sans danger à
condition que la sélection des patients se fonde essentiellement
sur le volume de leur thyroïde et que la technique et la prise
en charge chirurgicale et anesthésique gèrent les risques
postopératoires d’hémorragie et d’hypocalcémie.
»
Aucune durée de surveillance postopératoire supplémentaire
en milieu hospitalier ne semble devoir être imposée.
Mots-clés : Thyroïdectomie – Chirurgie thyroïdienne – Chirurgie
ambulatoire.
In the last 20 years a wide and growing evidence in literature
has reported the results of outpatient thyroidectomy (without
an overnight hospital stay). These works are most from the
United States. Surgery was performed in a structure devoted to
ambulatory surgery in one report of more than 1000 patients.
Fourteen original series reported the results of a total of 4166
ambulatory thyroidectomies and two cohort studies, from
two of the United States, of a total of 17936 ambulatory
thyroidectomy.
An average of 26% (1-76%) of the thyroidectomies realized
in the same period in the original series were performed in
outpatient setting, while outpatient thyroidectomies reached
16% in the 2 cohort studies.
Pathologies were multinodular goitre (41%), followed by
cancer (28%), isolated nodules (26%), and less frequently
hyperthyroidism (5%). Finally, lobectomies (54%) were realized
most frequently than total thyroidectomies (46%).
The good results of these series and cohorts confi rm that
ambulatory thyroidectomy is feasible without risks, after
an appropriate selection of patients, based on thyroid
volume, and including appropriate surgical and anaesthetic
techniques, in order to manage the risks of post-operative
bleeding and hypocalcaemia.
It seems that no postoperative surveillance time in hospital
setting is to be imposed for these patients.
Keywords: Thyroidectomy – Thyroid surgery – Ambulatory
surgery.
* Service de chirurgie
digestive et métabolique,
hôpitaux universitaires
Paris Seine-Saint-Denis,
hôpital Jean-Verdier,
Bondy.
T
raditionnellement, la chirurgie thyroïdienne est
réalisée avec un séjour hospitalier postopératoire
d’au moins 1 ou 2 nuits. Ces dernières années,
plusieurs séries de thyroïdectomies réalisées en ambu-
latoire ont été publiées (1-16). La chirurgie ambulatoire
est de plus en plus populaire, surtout aux États-Unis
où il existe des établissements dédiés à la chirurgie
ambulatoire, centres indépendants ou “freestanding
surgery centers” (10, 12). Mais les thyroïdectomies “sans
nuit passée à l’hôpital” restent relativement rares en
Europe, et notamment en France où une seule série a
été publiée (6). Les résultats rapportés par les Américains
sont soupçonnés d’être peu transposables à l’Europe,
car les patients resteraient hospitalisés 23 heures et/
ou dormiraient la première nuit à l’hôtel alors qu’en
France, la durée de séjour doit être inférieure à 12 heures

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XVII - n° 10 - décembre 2013
327327
Thyroïdectomie en ambulatoire : déjà 20 ans d’expérience
(17). Mais l’argument principal de beaucoup d’auteurs
pour s’opposer aux thyroïdectomies en ambulatoire
demeure surtout la crainte, après la sortie du patient,
d’une hémorragie et d’un hématome cervical pouvant
être compressif et asphyxiant (17, 18).
Dans cet article, nous avons colligé et analysé les résul-
tats de séries de thyroïdectomies réalisées en ambula-
toire au cours de ces 20 dernières années. Le but de ce
travail était de tenter de déterminer si la thyroïdectomie
en ambulatoire pouvait être recommandée, et dans
quelles conditions.
Matériels et méthodes
Revue de la littérature
Une revue de la littérature a été réalisée à partir de séries
de patients opérés d’une thyroïdectomie en ambulatoire
dans un seul établissement, et de données de codage
de séjours hospitaliers provenant de cohortes de sujets
opérés d’une thyroïdectomie en ambulatoire dans un
État ou une région des États-Unis, publiées et référen-
cées sur le site de The National Center for Biotechnology
Information (http://www.ncbi.nlm.nih.gov), entre janvier
1993 et janvier 2013, soit sur une période de 20 ans. Les
mots-clés utilisés pour la recherche étaient : “thyroïdec-
tomy” ; “thyroid surgery” ; “ambulatory surgery” ; “day
surgery” ; “outpatient setting”. Seuls les articles rédigés
en langue anglaise ont été retenus ainsi que les séries
dans lesquelles le séjour durait moins de 12 heures.
Ont ainsi été exclus les “day case”, “short stay” et les
séjours de 23 heures qui ne correspondent pas à la
défi nition internationale de la chirurgie ambulatoire
arrêtée le 23 octobre 1999, lors de la réunion du comité
exécutif de l’Association internationale de chirurgie
ambulatoire (IAAS). Les auteurs des séries ont aussi été
interrogés par courrier électronique pour confi rmer
que leurs patients n’avaient pas séjourné la première
nuit à l’hôtel. Le nombre de chirurgiens opérateurs et
leur spécialité ont été recherchés dans chaque série.
Sélection des pathologies thyroïdiennes
et des patients
Les critères d’éligibilité à la chirurgie thyroïdienne en
ambulatoire ont été recherchés, qu’ils soient liés à la
pathologie thyroïdienne et à l’exérèse qu’elle requérait, et/
ou aux comorbidités du patient ou à ses conditions de vie.
Caractéristiques des patients, des pathologies
thyroïdiennes et des thyroïdectomies
Le nombre de patients éligibles à la chirurgie ambula-
toire pendant la période étudiée, leurs caractéristiques
(âge), le type de la pathologie thyroïdienne traitée et
le type de la résection thyroïdienne réalisée (thyroï-
dectomie unilatérale ou thyroïdectomie totale) ont
été retenus.
Les pathologies thyroïdiennes concernées ont été répar-
ties en 4 groupes : groupe 1, nodules isolés nécessitant
une thyroïdectomie unilatérale (nodules kystiques et
adénomes bénins) ; groupe 2, goitres multinodulaires
(GMN) nécessitant une thyroïdectomie totale ; groupe 3,
hyperthyroïdies nécessitant une thyroïdectomie totale
(thyroïdites, maladie de Basedow) ; groupe 4, cancers
nécessitant une thyroïdectomie totale avec ou sans
curage (tumeurs papillaires, folliculaires, médullaires).
Dans chaque série et cohorte tirée du codage, le taux
de patients éligibles à une chirurgie thyroïdienne en
ambulatoire, par rapport au nombre total de thyroïdec-
tomies réalisées pendant la même période, a été calculé.
Protocoles anesthésiques et chirurgicaux,
opératoires et postopératoires
Le type d’anesthésie réalisée (générale ou locale,
hypnose) et l’existence de protocoles spécifi ques ont
été relevés. La technique chirurgicale employée (voie
d’abord par cervicoscopie ou cervicotomie, procédés
d’hémostase, drainage) a été évaluée ainsi que la durée
de l’intervention.
La durée de surveillance postopératoire (de la fi n de
l’intervention à la sortie) a été notée.
Avant la sortie, la réalisation d’examens particuliers a été
recherchée : dosage de la calcémie, de la parathormone
(PTH). Les critères de sortie, s’ils étaient spécifi ques à
la chirurgie thyroïdienne, ont été relevés. Enfi n, avant
la sortie, la prescription de traitements spécifi ques
(type d’antalgiques, calcium, vitamine D) et/ou d’exa-
mens biologiques postopératoires a été colligée. Le
suivi postopératoire des patients par les acteurs de
l’unité de chirurgie ambulatoire ou d’un autre relais, et
notamment la réalisation d’un “appel du lendemain”, a
également été noté.
Admissions non programmées et causes
Le nombre et le pourcentage de patients n’ayant pas
pu sortir le soir même, comme prévu, ont été relevés.
Les causes des admissions non programmées ont été
recherchées.
Morbidité, réhospitalisations dans les 30 jours
suivant la sortie, mortalité
Ont été colligées les complications survenues dans
les 30 jours suivant la sortie, la nécessité ou non d’une
réhospitalisation et d’une réintervention, et la mortalité
associée.

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XVII - n°10 - décembre 2013
328328
Mise au point
Les complications ont été classées en 4 groupes : groupe 1,
hémorragies et/ou hématomes (nécessitant ou non une
réintervention) ; groupe 2, hypocalcémie transitoire ou
défi nitive ; groupe 3, lésion du nerf récurrent temporaire ou
défi nitive ; groupe 5, autres causes (médicales générales).
Résultats
Séries rapportées de thyroïdectomies
en ambulatoire
De 1993 à 2013, 14 séries de thyroïdectomies en ambu-
latoire ont été publiées. Certaines, réalisées avec un
séjour hospitalier proche de 23 heures, ont été exclues
(19-22). Leur nombre a progressivement augmenté avec,
avant 2005, seulement 2 séries de thyroïdectomies en
ambulatoire (1, 2), puis de 2005 à 2009, 5 séries publiées
(3, 8) et enfi n de 2009 à 2013, 8 séries (tableau I) [9-15,
19-22]. Une série comportait plus de 1 000 patients (10),
2 séries plus de 800 (2, 3), 5 séries plus de 200 (8, 9, 11,
14, 15) et 7 séries comportaient entre 50 et 100 patients
(1, 4-7, 10, 13). Les études s’étalaient en moyenne sur
une période de 5,5 ans (1 à 16 ans). Dans l’une des
séries, toutes les thyroïdectomies ont été réalisées en
ambulatoire dans un centre ambulatoire indépendant,
“free standing center” (10).
Plus récemment, 2 cohortes de patients ayant eu une
thyroïdectomie en ambulatoire, obtenues à partir des
données du codage des séjours dans les États de New
York (12) et des hôpitaux universitaires de l’Arkansas (16),
et incluant respectivement 1 168 et 13 734 patients, ont
Tableau I. Caractéristiques (nombre de patients, type de résection [pourcentage par rapport au nombre total de thyroïdectomies réalisées pendant la même période] et
indication opératoire) des thyroïdectomies réalisées en ambulatoire dans un établissement hospitalier entre 1993 et 2013.
Auteurs/année Nb de patients
(% ambulatoire) Type de résection
Nb de patients (%) Pathologie thyroïdienne
Nb de patients (%)
Lobectomie Thyroïdectomie
totale Nodule isolé GMN Hyperthyroïdie Cancer
Mowschenson PM
et al. 1995 (1)
61 (61 %) 22 (36 %) 39 (64 %) 32 (52 %) 14 (23 %) 4 (7 %) 11 (18 %)
Samson PS et al.
1997 (2)
809 (69 %) 642 (79 %) 167 (21 %) ns ns ns ns
Spanknebel K et al.
2005 (3)
820 (44 %) 231 (28 %) 589 (72 %) ns ns ns ns
Chin CW et al.
2007 (4)
50 (48 %) 0 50 (100 %) 5 (10 %) 41 (82 %) 1 (2 %) 3 (6 %)
Terris DJ et al.
2007 (5)
52 (36 %) 35 (67 %) 17 (33 %) 13 (25 %) 19 (36 %) 9 (17 %) 11 (22 %)
Champault A et al.
2009 (6)
95 (18 %) 95 (100 %) 0 31 (33 %) 60 (63 %) 1 (1 %) 3 (3 %)
Teoh AY et al.
2008 (7)
50 (ns) 50 (100 %) 0 14 (28 %) 32 (64 %) 1 (2 %) 3 (6 %)
Trottier DC et al.
2009 (8)
232 (ns) 171 (74 %) 61 (26 %) 79 (34 %) 83 (36 %) 10 (4 %) 60 (26 %)
Seybt M et al.
2010 (9)
208 (50 %) 129 (62 %) 79 (38 %) ns ns ns ns
Snyder SK et al.
2010 (10)
1 136* (ns) 523 (46 %) 613 (54 %) ns ns ns ns
Hessman C et al.
2011 (11)
148 (ns) 74 (50 %) 74 (50%) 35 (23 %) 80 (55 %) 12 (8 %) 21 (14 %)
Sklar M et al.
2011 (13)
94 (38 %) 94 (100 %) 0 ns ns ns ns
Sahmkow S et al.
2012 (14)
200 (ns) 134 (67 %) 66 (33 %) 19 (9, 5 %) 36 (18 %) 7 (3,5 %) 138 (69 %)
Mazeh H et al.
2012 (15)
211 (76 %) 124 (59 %) 87 (41 %) ns ns ns ns
Total 2 400 (26 %) 2 085 (54 %) 1 762 ( 46 %) 228 (26 %) 365 (41 %) 45 (5 %) 250 (28 %)
* Centre de chirurgie ambulatoire indépendant. GMN: goitre multinodulaire; ns: non spécifi é.
>>>

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XVII - n°10 - décembre 2013
330330
Mise au point
été publiées (tableau II). Les 24 628 thyroïdectomies
avec un séjour de 23 heures réalisées dans l’Arkansas ont
été exclues (16). Le nombre de thyroïdectomies réalisées
en ambulatoire a, dans cette publication, augmenté
de 60 % en 10 ans (16). Dans l’État de New York, il est
spécifi é que des thyroïdectomies ont été réalisées en
ambulatoire dans des “freestanding surgical centers”.
Ces études et cohortes de patients provenaient à hau-
teur de : 64 % des États-Unis (1, 3, 5, 9, 10-12, 14-16), 12 %
du Canada (8-13), 6 % de France (6), et 18 % de l’Asie
(Chine et Philippines) [2, 4, 7]. Le nombre de chirurgiens
opérateurs était spécifi é dans 10 séries. Il y avait 1 seul
opérateur dans 8 séries (80 %) [2-6, 9-11] et 2 ou 3 dans
les 2 autres (20 %) [7, 14]. Les chirurgiens étaient à 41 %
des chirurgiens ORL et à 59 % des chirurgiens digestifs
et endocriniens. Dans l’étude de cohorte réalisée dans
l’État de New York, il est spécifi é que les chirurgiens
qui réalisaient des thyroïdectomies en ambulatoire
réalisaient un volume de thyroïdectomies par année
signifi cativement plus important que ceux qui ne fai-
saient pas d’ambulatoire (12).
Sélection des pathologies thyroïdiennes
et des patients
Les critères d’éligibilité à la chirurgie ambulatoire des
pathologies thyroïdiennes n’étaient pas toujours pré-
cisément notifi és, sauf dans 9 séries (1-9). Le principal
critère d’éligibilité était l’absence de chirurgie du cou
préalable et le volume de la thyroïde : ainsi le goitre
intrathoracique et la déviation de la trachée étaient
des facteurs d’exclusion (1-9). Plus précisément, selon
C.W. Chin et al., la taille du principal nodule (moins de
4 cm) était un facteur limitant (4). Si dans 4 séries (27 %)
l’absence de signes de malignité à la cytoponction était
un critère d’éligibilité (3, 6, 7, 9), pour toutes les autres
séries (73 %), l’existence ou la suspicion d’un cancer thy-
roïdien n’était pas une contre-indication à une chirurgie
ambulatoire (1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 14, 15).
Les autres critères de sélection étaient liés aux patients,
et principalement à leurs comorbidités. Dans 9 séries
(60 %), il est spécifié que seuls les patients ASA
(American Society of Anaesthesiology) I et II étaient
opérés en ambulatoire (1-9). Dans 6 séries (40 %), des
pathologies cardiovasculaires ou respiratoires ont
constitué des contre-indications à l’ambulatoire (1, 3-6,
8, 9). Dans 3 séries (20 %), un indice de masse corporelle
(IMC) supérieur à 30 a contre-indiqué la chirurgie en
ambulatoire (4, 5, 9) et dans 3 séries (20 %), un traite-
ment anticoagulant (3, 5, 6). Enfi n, des facteurs non
médicaux ont aussi déterminé le choix de l’ambulatoire.
Ainsi, dans 27 % des séries, il est précisé qu’un domi-
cile à moins de 50 km de l’hôpital et la présence d’un
accompagnant à la maison la première nuit étaient des
critères importants de sélection (3, 4, 6, 8, 9).
Caractéristiques des patients, des pathologies
et des résections thyroïdiennes
Au total, les cas de 4 166 patients ayant eu une thy-
roïdectomie en ambulatoire ont été rapportés dans
les 15 séries, soit en moyenne 26 % des thyroïdecto-
mies réalisées pendant la même période, avec des
extrêmes allant de 17 à 76 %. Dans les 2 cohortes,
14 902 patients ont été opérés en ambulatoire “with-
out overnight stay” et représentaient respectivement
17 et 15 % des patients ayant eu une thyroïdectomie
pendant la même période dans la même région. Dans
les séries, par ordre croissant, 365 patients avaient un
GMN (41 %), 250 un cancer (28 %), 228 (26 %) un nodule
thyroïdien isolé et 45 une hyperthyroïdie (5 %). Sur les
4 166 patients ayant eu les 2 types de thyroïdectomies
et sortis le jour même, 2 085 ont eu une lobectomie
(54 %) et 1 762 une thyroïdectomie totale (46 %). Dans
4 séries, ont été uniquement réalisées en ambulatoire
soit des thyroïdectomies partielles (6, 7, 14), soit des
thyroïdectomies totales (4). Dans la série de S.K. Snyder
et al (10), la totalité des 1 136 patients ont été opérés
dans un centre de chirurgie ambulatoire indépendant.
L’âge moyen des patients était de 40 ans (± 13 ans ; 13
à 89 ans). Dans 5 séries (30 %), le patient le plus âgé
avait plus de 80 ans (3, 8, 10, 11, 13) [tableaux I et II].
Protocoles anesthésiques et chirurgicaux,
opératoires et postopératoires
Protocoles d’anesthésie
Toutes les thyroïdectomies en ambulatoire ont été réali-
sées sous anesthésie générale sauf dans 2 séries (13 %),
où respectivement 52 % et 11 % des thyroïdectomies
ont été réalisées sous anesthésie locale (8, 10). Dans
2 séries, il est spécifi é que des protocoles antalgiques et
antiémétiques spécifi ques ont été mis en place pour la
Tableau II. Caractéristiques (nombre de patients et type de résection [pourcentage par rapport au
nombre total de thyroïdectomies réalisées pendant la même période] des thyroïdectomies réalisées
en ambulatoire dans l’État de New York et dans les hôpitaux universitaires de l’Arkansas.
Auteurs/année Nb de patients
(%ambulatoire) Type de résection
Nb de patients (%)
Lobectomie Thyroïdectomie totale
Tuggle CT et al.
2011 (12)
1 168 (17 %) 304 (26 %) 864 (74 %)
Stack BJ Jr et al.
2013 (16)
13 734 (14,8 %) 4 944 (36 %) 8 790 (64 %)
Total 14 902 5 248 (35 %) 9 654 (65 %)
>>>
>>>

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XVII - n°10 - décembre 2013
332332
Mise au point
chirurgie ambulatoire (6, 11). Dans 3 autres séries il est
spécifi é que les morphiniques n’ont été donnés qu’à la
demande, leur eff et narcotique pouvant compromettre
le succès de la programmation ambulatoire des patients
(3, 7, 8). Dans une seule série, une infi ltration de ropiva-
caïne, anesthésiant de longue durée d’action, dans la
cicatrice a été réalisée à la fi n de l’intervention (2). De
la dexaméthasone a été perfusée aux patients en fi n
d’intervention dans une étude, pour limiter les symp-
tômes transitoires dus à une lésion d’un récurrent (13).
Protocole chirurgical
Les thyroïdectomies ont été réalisées par voie cervicale
dans tous les cas. Quand cela a été spécifi é, l’hémostase
des vaisseaux a été réalisée dans 50 % des cas avec des
techniques standards (ligature ou coagulation mono- ou
bipolaire) [1-4, 6, 7, 10, 11]. Deux auteurs ont utilisé un
bistouri à ultrasons (Harmonic® Scalpel, Ethicon Endo-
Surgery, Inc., Cincinnati, Ohio) [5, 9]. Dans une étude, des
compresses hémostatiques ont été placées dans la loge
de thyroïdectomie en fi n d’intervention (Collagene Pad®,
Helistat Integra Lifesciences Corporation, Plainsboro,
New Jersey) [9]. Aucun système de drainage n’a été
positionné, sauf dans la série de C.W. Chin et al. (4) chez
60 % des patients. Le système de drainage a été retiré
après la sortie du patient de l’hôpital. Dans la série de
M.W. Seybt et al. (9), il est spécifi é que les muscles pré-
thyroïdiens qui, autant que possible, n’avaient pas été
sectionnés, ont été fermés lâchement. Dans 2 séries, la
colle DermaBond® (imperméable et transparente) a été
utilisée comme moyen de suture cutanée et de panse-
ment (Ethicon Endo-Surgery Inc., Cincinnati, Ohio) [6,
9]. M.W. Seybt insiste sur le pansement qui doit être
“discret” ; voire transparent pour permettre de surveiller
facilement la zone opératoire (9).
La durée opératoire, spécifi ée dans 6 séries (2, 3, 5, 7,
10, 12), a été en moyenne de 102 mn (± 24 mn ; 76 à 128).
Dans une série où cela est spécifi é, elle a été en moyenne
de 117 mn (30 à 150) pour une thyroïdectomie totale et
de 85 mn (60 à 210) pour une hémithyroïdectomie (11).
Durée de la surveillance postopératoire en milieu
hospitalier
Dans les séries de patients provenant d’un seul hôpital, la
durée moyenne de surveillance postopératoire a été de
306 mn (± 107 mn ; 180 à 450). Dans une seule série il est
spécifi é une durée de surveillance postopératoire, fi xée
à 360 mn (6). Dans les cohortes de patients de l’État de
New York (12), et des hôpitaux universitaires de l’Arkansas
(16), il est spécifi é que les patients sont rentrés et sortis
le même jour, “with no overnight stay”, mais la durée pré-
cise de la surveillance postopératoire n’est pas donnée.
Critères de sortie
Dans 64 % des séries, des critères de sortie spécifi ques
à la résection thyroïdienne, en dehors du score de
F. Chung habituel (23), ont été mentionnés : l’absence de
signe d’hémorragie ou d’hématome cervical, l’absence
de symptôme d’hypocalcémie (1-4, 8, 9, 11), l’absence
de dysphonie importante et/ou de dyspnée. Dans la
série de C. Hessman et al. (11), la PTH a été dosée et
devait être supérieure à 10 pg/l. Dans 42 % des séries,
une calcémie a été faite avant la sortie (1, 2, 4, 5, 14, 15).
Enfi n, dans 72 % des séries (10/14), du calcium et de la
vitamine D per os ont été prescrits. Cela a été fait uni-
quement après les résultats de dosages de la calcémie
ou de la PTH pour les 4 autres séries (1, 4, 5, 13).
Suivi après la sortie
Un appel téléphonique a été passé le lendemain de
l’intervention, le plus souvent par une infi rmière. Tous
les patients avaient les moyens de contacter l’hôpital
en urgence si besoin. Il est spécifi é dans certaines séries
que “l’équipe” était disponible, prête à intervenir en cas
de besoin, pendant les 24 heures suivant l’opération
(2-9, 11).
Les visites de suivi ont ensuite été programmées selon
les habitudes du chirurgien comme après une hospita-
lisation conventionnelle à 10, 15, 30 ou 60 jours (1-11).
Admissions non programmées et causes
Cent quinze patients (2,7 %) ont dû rester hospitalisés
la nuit (1-14). Les causes de ces admissions ne sont
pas toujours spécifi quement mentionnées, les plus
fréquentes étant des hémorragies ou hématomes du
cou (3, 10, 11).
Morbidité, réhospitalisations, mortalité
(tableaux III et IV)
Deux cent un patients ont eu une complication chirur-
gicale postopératoire (4,8 %) et il y a eu 43 réhospita-
lisations (1 %). Dans la cohorte provenant de l’État de
New York, il a été montré que le risque de réhospitali-
sations était corrélé à l’expérience du chirurgien et était
diminué s’il pratiquait un volume annuel important de
thyroïdectomies (12) .
Soixante-quatorze patients (1,8 %) ont eu une hypocal-
cémie, défi nitive pour 4 d’entre eux (0,1 % du total) et 43
ont été réhospitalisés pour ce motif. L’hypocalcémie a
été la cause de 46 % des réhospitalisations (1, 7-11, 13).
L’hypocalcémie a été plus fréquente dans les 4 séries où
une supplémentation calcique et en vitamine D n’avait
été donnée qu’à la demande, après un dosage de la PTH
ou de la calcémie avant la sortie (1, 4, 5, 13), comparée à
toutes les autres où cela était fait de façon systématique.
>>>
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%