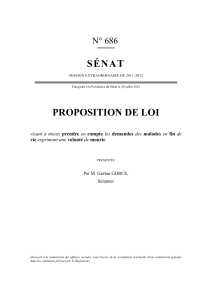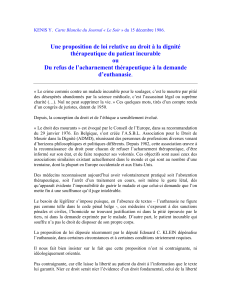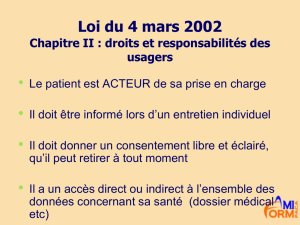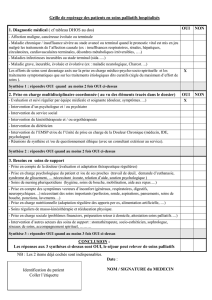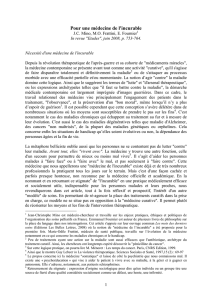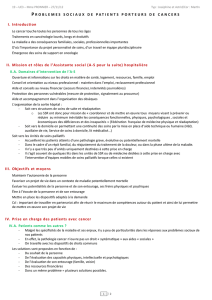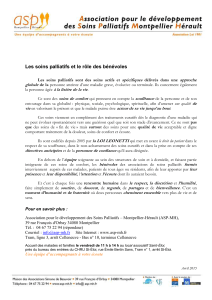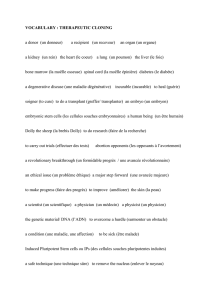Propositions pour une médecine de l’incurable Santé Éducation

26 Santé Éducation - 01 - Octobre-Novembre-Décembre 2013
Santé Éducation
UN PEU DE RECUL
Propositions pour une médecine de l’incurable
Jean-Christophe Mino*, Marie-Odile Frattini*, Emmanuel Fournier**
* Médecins chercheurs
et directeurs
du Centre national
de ressources
Soin palliatif.
** Professeur à la
faculté de médecine
Pierre-et-Marie-Curie
(Paris-VI), respon-
sable du départe-
ment universitaire
“Éthique, douleur,
soins palliatifs”.
Associer médecine et incurabilité pourrait paraître provocateur tant la médecine est défi -
nie avant tout comme une activité curatrice, ce qu’il est hors de question de nier ici. Néanmoins,
l’accent mis sur les traitements peut faire oublier que l’action “curative” ne débouche pas
forcément sur la guérison. Les maladies chroniques, en particulier, associent traitement
au long cours et incurabilité, soit par impossibilité de guérir in fi ne le malade, soit par
absence totale de médicament effi cace sur la maladie. Ce texte propose de se pencher sur
les conséquences de ce fait, en particulier sur les réagencements de conception de l’acti-
vité médicale qu’il occasionne.
A
ujourd’hui, nous concevons la médecine comme
une activité avant tout curative. Souvent associé à la
guérison, le terme désigne les traitements s’atta-
quant au processus morbide avec une effi cacité variable,
défi nitive ou momentanée. Or, cette conception curative
dominante atteint aujourd’hui ses limites et il ne suffi t
pas d’attendre la fi n de vie pour être confronté à l’incu-
rabilité. C’est le cas de nombreuses maladies, notam-
ment en phase avancée : maladies chroniques, maladies
dégénératives ou systémiques, cancers non maîtrisés,
maladies génétiques, handicap sévère et soins pallia-
tifs, toutes ces situations touchent, faut-il le rappeler,
plusieurs millions de personnes. Or la notion de faire
“contre la maladie” domine la logique curative, ainsi
que le suggèrent de nombreuses expressions arché-
typales (“il faut se battre”, “la lutte”, “l’arsenal théra-
peutique”…). Si elle est fortement mobilisatrice, cette
conception combative peut légitimer certaines interven-
tions médicales sans toujours les contrebalancer par des
considérations d’inconfort ou de répercussions néfastes.
Elle ne les inscrit pas forcément dans une perspective
permettant de mettre en regard les objectifs médicaux
et les enjeux existentiels.
La métaphore belliciste oublie ainsi que les personnes
ne se contentent pas de lutter “contre” leur maladie,
mais doivent avant tout “vivre avec”. Nous pensons que
la médecine doit alors endosser une autre fonction, celle
d’un secours pour mieux, ou moins mal, vivre, pour “faire
face” et “faire avec” le mal, et pas seulement pour faire
contre lui. Une telle façon d’envisager et d’exercer la
médecine existe déjà sur le terrain, notamment dans
les champs de la médecine générale, de la prise en
charge des maladies chroniques (diabète et mucovis-
cidose, par exemple), de la gériatrie, du handicap, ou
des soins palliatifs. Mais, si de très nombreux profes-
sionnels transforment ainsi leurs pratiques pour faire
face aux problèmes qu’ils rencontrent, c’est d’une façon
cachée, parfois honteuse, en tout cas peu reconnue par la
médecine offi cielle. En retournant le stigmate de “l’incu-
rable” en une pratique effi cace et utile, nécessaire pour
les personnes malades et leurs proches, nous jugeons
indispensable la formalisation d’un modèle médical que
l’on pourrait nommer, pour provoquer la réfl exion, une
“médecine de l’incurable”.
Lorsque l’on s’intéresse aux pratiques quotidiennes, une
telle médecine présente 3 lignes de force principales :
clinique, éthique et organisationnelle. Une médecine de
l’incurable est une pratique clinique effi cace qui cherche
sciemment à articuler le traitement de la maladie avec
la qualité de vie du malade. Les gestes, les discours et
les décisions des professionnels renvoient à un enjeu
prioritaire : concilier la prise en charge médicale avec
le traitement de l’inconfort et la vie quotidienne. Tout
en dispensant les soins, il s’agit donc de permettre aux
personnes de vivre les sensations les moins douloureuses
possibles et ainsi d’entretenir un rapport quelque peu
pacifi é avec leur corps et les soins. Au même titre que
traiter une pathologie, lutter contre la douleur et tous les
autres symptômes de souffrance physique est une acti-
vité qui s’ancre dans la pratique médicale moderne. C’est
une tâche qui requiert l’utilisation de médicaments, de
dispositifs techniques et de soins infi rmiers, diététiques,
de kinésithérapie, d’ergo thérapie, dont le mode d’admi-
nistration s’appuie sur un corpus de connaissances et
de savoir-faire cliniques complets, sur des compétences
techniques certaines.
Cette approche est indispensable pour la personne malade.
C’est un exercice complexe, très éloigné d’une médecine
qui baisserait les bras, bien au contraire. En passant du
contrôle de la maladie à la lutte contre l’inconfort, le
médecin n’ajuste plus seulement son action à des éléments
“objectifs” apportés par la biologie, l’imagerie médicale
ou les explorations fonctionnelles, mais aussi principa-
lement aux souhaits et aux dires du patient, ce en quoi
la tâche est authentiquement “clinique”. Ainsi, si l’évolu-
tion du travail clinique d’une logique avant tout curative
à une logique de qualité de vie est d’ordre technique, un
tel travail se caractérise aussi par une exigence couplant
pragmatisme et éthique.
Faute de pouvoir traiter rapidement, le médecin doit s’ap-
puyer au long cours sur la personne et tenir compte de
son avis. Cette reconnaissance va de pair avec la néces-
sité d’échanger en permanence sur la prise en charge.
Cela suppose de lui donner la parole, de la considérer
comme un sujet capable de déterminer son propre bien.
On le voit, la médecine de l’incurable exige par son objet
même une relation soignant-soigné renouvelée. En restant

27
Santé Éducation - 01 - Octobre-Novembre-Décembre 2013
Santé Éducation
attentif au point de vue du malade, on cherche à repérer
et à évaluer la charge physique, cognitive, psychique
que la maladie et les soins lui demandent, en vue de les
diminuer. Il s’agit alors, à côté du soulagement de symp-
tômes, de faciliter l’important “travail” pour vivre avec la
maladie et les soins.
Le fi l directeur d’une telle médecine n’est donc pas tant
à rechercher dans le type d’actes opérés que dans le but,
les modalités et la logique pratique qui président à l’arbi-
trage des choix. Elle concerne tout à la fois les objectifs
des pratiques professionnelles, la manière de collaborer et
de se mettre d’accord sur les raisons au nom desquelles
on intervient, la façon de prendre les décisions. Ce qui
spécifi e cette logique est d’ordonner un ensemble d’actions
(traitements curatifs, interventions contre le mal-être,
support à la vie quotidienne…), selon un double objectif
de maintien de l’état de santé et de diminution de l’incon-
fort ou, pourrait-on dire, de la charge que représente la
maladie. En permettant de réagencer la place des trai-
tements curatifs dans la prise en charge, ce modèle ne
se situe pas en opposition aux moyens curatifs. Il permet
plutôt de réorienter les moyens et les fi ns de l’interven-
tion thérapeutique.
Afi n de pouvoir s’inscrire dans le fonctionnement même
des structures et de l’exercice médical, ce modèle
demande des politiques d’organisation adaptées. La
médecine s’exerce aujourd’hui comme une immense
chaîne de travail reliant des dizaines d’acteurs dans un
véritable travail en équipe pluridisciplinaire. Promouvoir
une médecine de l’incurable nécessite que les relations
au sein des établissements et entre les établissements
et les secteurs institutionnels (hôpital, médecine de ville,
structures médicosociales) évitent autant que possible les
incohérences de prise en charge. Cette médecine devra
s’appuyer sur un soutien des responsables politiques et
des gestionnaires, au moment où la valorisation écono-
mique et les visions en termes de productivité et de renta-
bilité encouragent essentiellement les actes techniques.
Ainsi, une médecine de l’incurable ne peut que s’appuyer
sur une organisation des soins intégrant explicitement,
dans la prise en charge, des objectifs de lutte contre
l’inconfort, d’écoute, de soutien relationnel et social, et
de continuité. Son développement appelle une stratégie
créative d’élaboration de nouveaux outils, de pratiques
innovantes, de modes d’organisation et de fi nancement
destinés à promouvoir la qualité de vie.
Une telle médecine exige aussi de compléter le rapport
actuel au savoir. Elle nécessite notamment que les recom-
mandations professionnelles ne soient pas centrées
uniquement sur les références à la médecine fondée
sur les preuves (
Evidence-Based Medicine
) telle qu’elle
s’est développée jusqu’à aujourd’hui. La reconnaissance
de la normalité de l’inobservance dans le cas de mala-
dies chroniques, l’attention à porter au travail de soins
afi n d’en diminuer la charge pour le malade, les ques-
tions posées par les situations de décision dans l’incerti-
tude, le soutien au changement de logique des soins,etc.,
doivent tout autant faire l’objet de travaux et de réfl exions
professionnelles et institutionnelles. En mettant en avant
la qualité de vie et l’expérience du patient, formaliser de
telles pratiques professionnelles qui, nous le répétons,
existent souvent déjà sur le terrain sans être (re)connues,
nous semble indispensable pour aider les personnes à
mieux vivre avec la maladie.
Tout ceci nécessite donc d’expliciter, d’inventer et de
diffuser des pratiques ne se limitant pas à l’idée d’un
“combat”, mais concevant aussi l’action médicale comme
une aide à composer avec la maladie, une protection active
à l’égard de certaines souffrances, un exercice de soula-
gement et de soutien. On pourrait alors développer et
enseigner ce nouveau modèle épistémologique et éthique
d’intervention médicale et soignante. Face aux évolutions
et aux défi s liés au vieillissement de la population et à
la multiplication des maladies graves de longue durée,
il serait délétère que la médecine ne soit vue, selon l’ex-
pression du philosophe Michel Foucault, que comme une
immense “machine à guérir”. Un champ de pratiques et
de recherches innovantes doit donc s’ouvrir, qui permette
à notre médecine de s’adapter sciemment à ces boule-
versements, et en l’assumant ouvertement.
1
/
2
100%