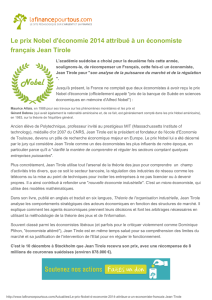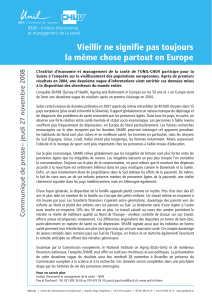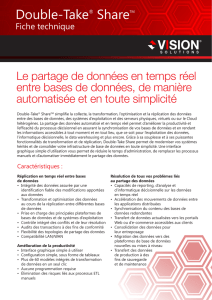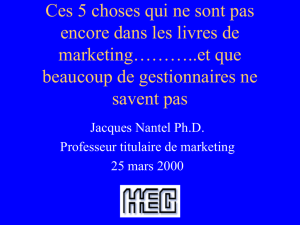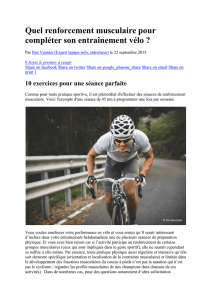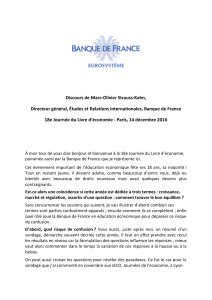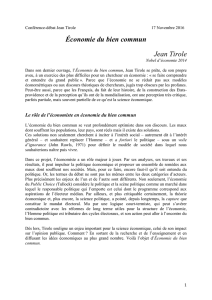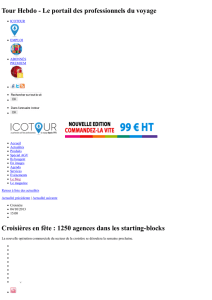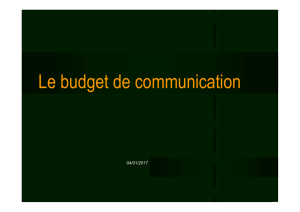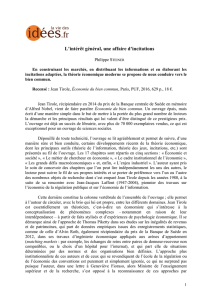S'identifier Créer son compte

SciencesHumaines.com Le Cercle Psy Editions Sciences Humaines Changer le travail S'identifierCréer son compte
Newsletter Gratuite
Rechercher
OK
Accueil Psychologie Sociologie Éducation Philosophie Anthropologie Histoire Géographie Politiques-Économie Communication-Organisations
Tweeter
Tweeter
7
3
0 commentaire
INÉDIT WEB >
Le Français Jean Tirole prix
Nobel d'économie
Mis à jour le 13/10/2014
L'économiste français Jean Tirole a reçu ce lundi 13 octobre le prix Nobel
d'économie pour son « analyse de la puissance du marché et de la régulation ».
Ni plus ni moins que « l’un des économistes les plus influents de notre époque ». C’est par
ces mots que le comité Nobel a annoncé lundi 13 octobre que le Français Jean Tirole,
chercheur à l'université de Toulouse et président de l’Ecole d’Économie de Toulouse,
s’était vu décerné le prix Nobel d’économie.
Ses travaux sur « la puissance du marché et de la régulation » ont donc été couronnés
par la plus haute distinction de sa discipline. Il est le troisième Français à obtenir cette
récompense : avant lui Gérard Debreu (1983) et Maurice Allais (1988) avaient également
été primés.
« On n'est pas très bon juge de ses propres travaux et donc ce n'est pas quelque chose
sur lequel je comptais », a déclaré à l’AFP l'économiste de 61 ans, quelques minutes
après avoir appris la nouvelle. Ci-après, nous vous proposons de (re)découvrir un
entretien que nous avions réalisé en 2008.
Entretien avec Jean Tirole : «La concurrence ne doit pas être
une religion»
Propos recueillis par Xavier De La Vega
La nouvelle économie industrielle se penche autant sur la stratégie des entreprises
que sur la régulation de la concurrence. Rencontre avec Jean Tirole, économiste,
médaille d’or du CNRS en 2007.
La firme Microsoft peut-elle être accusée d’abus de position dominante ? Les opérateurs
de téléphonie mobile ont-ils violé les principes de la concurrence par des pratiques de
collusion ? Fournir un cadre théorique pour répondre à ce type de question, c’est la raison
d’être de l’économie industrielle, dont Jean Tirole, médaille d’or du CNRS 2007, est l’un
des représentants français les plus renommés. S’inscrivant à la suite des lauréats du prix
Nobel 2007, Leonid Hurwicz, Eric Maskin – qui fut son patron de thèse au MIT
(Massachusetts Institute of Technology, États-Unis) – et Roger Myerson, l’économiste
toulousain a contribué à renouveler l’économie industrielle en y introduisant de nouveaux
outils comme la théorie des jeux et la théorie de l’information. Ces innovations mettaient à
bas deux postulats cruciaux de la théorie économique : la concurrence parfaite et
l’information parfaite. Ce faisant, la « nouvelle économie industrielle » a permis de
rapprocher considérablement la théorie des enjeux économiques les plus concrets. J.
Tirole et les économistes de TSE (Toulouse-Sciences économiques), qu’il dirige, et de
l’IDEI (Institut d’économie industrielle), dont il est directeur scientifique, s’intéressent
autant à la stratégie des entreprises de la nouvelle économie qu’à la régulation de la
Grands Dossiers N°
36
sept-oct-nov 2014
Mensuel N° 263
octobre 2014
JE M'ABONNE | LA BOUTIQUE | Mon panier | Newsletter | Dossiers
web |
Agenda | Ressources Lycée &
Prépa |
Formation
9
J’aime
J’aime

Feuilletez
un mensuel
Feuilletez
un Grands Dossiers
autant à la stratégie des entreprises de la nouvelle économie qu’à la régulation de la
concurrence, domaine dans lequel ils sont régulièrement sollicités par la Commission
européenne.
Auteur de contributions notables dans des domaines aussi variés que la finance, la théorie
des organisations ou la communication, J. Tirole est également partie prenante de l’essor
récent de la psychologie économique, un champ de recherche qui reconsidère un autre
postulat de la théorie économique : l’Homo œconomicus.
En quoi consiste la nouvelle économie industrielle ?
Elle se penche sur des questions aussi diverses que les ententes entre les entreprises, les
« regroupements de brevets », le modèle économique de Google… Sur chacune de ces
questions, nous étudions les deux dimensions du problème. D’un côté, nous analysons la
stratégie des entreprises : quelles sont les meilleures décisions de leur point de vue ? De
l’autre, nous menons une analyse en termes de « bien-être social » : à quelles conditions
les décisions des firmes conduisent-elles à un résultat satisfaisant pour les
consommateurs ? Quelles règles les pouvoirs publics doivent-ils mettre en œuvre pour
atteindre cet objectif ?
Prenons un exemple. Quel est le point commun entre Google, les quotidiens gratuits et les
fichiers PDF ? Ce sont des activités dans lesquelles l’un des côtés du marché – celui des
consommateurs – est caractérisé par la gratuité. Vous ne payez pas pour utiliser le moteur
de recherche de Google, ni pour lire un quotidien gratuit ou consulter un fichier PDF. Mais
ces services s’adressent aussi à d’autres clients, des sociétés qui elles devront payer cher
pour placer une publicité ou pour créer un fichier PDF. Un côté du marché est gratuit,
l’autre payant : c’est la caractéristique des « marchés bifaces ».
Devant de telles activités, le théoricien peut dégager un cadre de réflexion, ce que nous
avons fait, avec Jean-Charles Rochet, en montrant que ces activités répondent à un
même modèle économique général. Il peut ensuite aider les entreprises à trouver la bonne
stratégie sur ces marchés. Les firmes apprennent par l’expérience : elles tâtonnent,
choisissent un modèle économique, le modifient jusqu’à converger vers celui qui assurera
la rentabilité de l’activité. Mais elles peuvent aussi apprendre de la théorie. Par exemple,
l’un des enseignements de nos travaux est qu’il convient d’accorder des conditions
avantageuses au côté du marché qui, d’une part, est le plus sensible aux prix (les
utilisateurs de Google déserteraient le site s’ils devaient payer) et dont, d’autre part, la
présence est particulièrement prisée par l’autre coté du marché (ici les annonceurs).
Le théoricien s’adresse aussi au décideur public qui se pose quant à lui la question de la
réglementation de la concurrence. Deux firmes fusionnent : quelles en seront les
conséquences sur le prix de vente des produits, sur l’innovation ? Le nouveau groupe
aura-t-il tendance à freiner l’introduction de nouveaux produits, à réduire sa dépense de
recherche-développement ? Si c’est le cas, la fusion risque d’être défavorable à l’efficacité
économique. La Commission européenne a chargé l’IDEI d’éclaircir ces questions, afin de
l’aider à définir dans quels cas une fusion est dangereuse ou pas. L’économie n’est pas
une science exacte, mais elle peut offrir des repères très utiles aux politiques publiques.
Vous avez également beaucoup travaillé sur les « monopoles naturels » que
sont par exemple l’électricité, les télécommunications, la poste. L’introduction
de la concurrence est-elle toujours bonne à prendre ?
La concurrence ne doit pas être une religion. J’y suis favorable, mais il s’agit d’un moyen
et non d’une fin. L’introduction de la concurrence est un bienfait lorsqu’elle suscite
l’apparition de produits nouveaux, fait baisser les prix, oblige l’opérateur historique à sortir
de sa torpeur. Mais, mal conçue, elle peut tout aussi bien avoir des effets néfastes.
Par exemple, la libéralisation du secteur de l’électricité en Californie a donné
lieu à une véritable catastrophe : pendant l’été 2001, le sous-investissement
dans la production d’électricité s’est soldé par une pénurie de courant, des
coupures massives d’électricité…
Le cas de la déréglementation électrique californienne illustre parfaitement à quel point la
concurrence peut être dangereuse lorsqu’elle devient une religion. Des économistes de
renom avaient été consultés pour mener à bien cette réforme, mais ils ont peu été écoutés
et l’affaire a été menée en dépit du bon sens.
Si l’introduction de la concurrence était si facile que cela dans des industries de réseaux
comme l’électricité, elle aurait été effectuée il y a un siècle. Ces industries avaient été
délibérément laissées aux mains de monopoles. Avant de libéraliser de tels secteurs, il
convient de savoir dans quel segment de l’industrie cela pourra marcher, comment
introduire de la concurrence de façon efficace, etc. On peut montrer que la concurrence
marche plutôt bien dans les domaines de la production d’électricité. En revanche, il vaut
mieux, à mon avis (ce sujet fait l’objet de débats) que le transport soit assuré par une

mieux, à mon avis (ce sujet fait l’objet de débats) que le transport soit assuré par une
seule entreprise régulée, car les lois de l’électricité font que les lignes installées créent
beaucoup d’externalités* entre elles : il est par exemple périlleux d’éviter les «
congestions » du réseau en l’absence d’un opérateur central chargé de superviser
l’équilibre entre production et consommation d’électricité, la tension des lignes, etc.
On vous doit aussi depuis une dizaine d’années des travaux à la lisière de
l’économie et d’autres sciences humaines. Vous vous intéressez
particulièrement à la psychologie économique, champ de recherche qui met en
question les postulats de l’Homo œconomicus…
La théorie économique considère généralement que les gens sont rationnels, qu’ils
maximisent leur utilité, alors qu’en pratique ils ne le font pas toujours. Elle suppose par
ailleurs que l’information est toujours utile, alors qu’en pratique, les gens peuvent refuser
d’acquérir de l’information, avoir des croyances tout à fait sélectives, s’enferrer à
conserver des croyances erronées sur eux-mêmes ou sur la société.
Il existe par exemple de véritables tabous dans la vie économique. Faut-il créer un marché
pour les organes humains ? Certains, comme l’économiste Gary Becker, le pensent. N’est-
il pas absurde, avance-t-il, que des gens meurent en raison d’une pénurie d’organes ? Ne
sauverait-on de nombreuses vies en acceptant que les organes soient rémunérés ?
Pourtant, à défendre de telles propositions, les économistes sont souvent considérés
comme des gens immoraux. Cela dit, les tabous sont utiles, dans la mesure où ils
signalent toujours des problèmes sensibles. Mais ils ont aussi un coût important. Certaines
réformes économiques favoriseraient le bien-être général, mais se heurtent à des
blocages psychologiques.
Voulez-vous dire que les croyances sont des rigidités qui empêcheraient les
sociétés ou les individus d’atteindre un optimum ?
Ce n’est pas toujours le cas. Les individus ont par exemple souvent intérêt à entretenir
une bonne image d’eux-mêmes, en demeurant imperméables aux informations qui
menaceraient une telle croyance. Platon pensait qu’il est toujours mauvais de se mentir à
soi-même. Depuis le xxe siècle, les psychologues considèrent de leur côté que l’estime de
soi est importante. Roland Bénabou et moi avons proposé un modèle saisissant l’impact
de telles croyances. Considérons un individu qui voudrait entreprendre quelque chose.
Nous avons trouvé que vouloir préserver à tout prix une bonne estime de soi est bénéfique
pour celui qui a une forte tendance à la procrastination (remettre au lendemain…), car cela
le motive à sortir de sa léthargie. En revanche, celui qui en souffre peu risque
d’entreprendre des activités trop ambitieuses lorsque ses croyances sont trop optimistes :
celui-là ferait mieux d’écouter Platon !
Qu’est-ce que l’économiste peut apporter au psychologue ?
Il peut contribuer à comprendre certains comportements et aider à engendrer des
comportements prosociaux. Il apporte aussi sa connaissance des interactions
interindividuelles. J’ai par exemple travaillé avec R. Bénabou sur les idéologies. Si vous
interrogez des Américains sur l’origine de la réussite individuelle, ils répondent
unanimement : c’est l’effort. Les pauvres ne font pas exception : lorsque, dans les
enquêtes d’opinion, on leur demande s’ils méritent leur situation, la plupart répondent oui.
On trouve le biais opposé en Europe : la réussite s’explique toujours par les
circonstances, la chance, les relations, etc. R. Bénabou et moi avons essayé de
comprendre pourquoi. Notre réponse est que l’on a souvent intérêt à adopter les mêmes
croyances que les autres membres de la société. S’ils croient que l’effort détermine la
réussite, ils ne votent en général pas en faveur de politiques très redistributives car elles
risqueraient de décourager l’effort. Du coup, les individus n’ont pas de filet de sécurité
auquel se raccrocher et ils ont tout intérêt à se convaincre que l’effort paie, sans quoi ils
vont au-devant de grosses difficultés. Inversement, si vous vivez dans une société où la
plupart des gens pensent que la chance l’emporte, alors la redistribution est nécessaire,
mais dans ce cas, bénéficiant d’un filet de sécurité, vous n’êtes pas obligé de vous
convaincre que l’effort paie.
Dans un article récent, vous appelez à reformuler le modèle du choix rationnel
en tenant compte des apports de la psychologie économique. Vos travaux ne
vont-ils pas pourtant dans la direction inverse : analyser des questions
psychologiques ou sociologiques en leur appliquant la méthode du choix
rationnel ?
Je suis convaincu que les autres sciences sociales ont beaucoup à apprendre aux
économistes, mais je pense aussi que la méthodologie économique peut enrichir les
autres sciences sociales, en fournissant un cadre de réflexion. Elle l’a déjà fait par le
Un thérapeute
français dévoile sa
méthode pour
retrouver un poids
idéal.
Minceur123
Votre partenaire
souffre
d'éjaculation
précoce ?
Découvrez
comment lui en
parler
garderlecontrole.fr Luttez contre la
pauvreté tout en
réduisant votre ISF
: découvrez la DTU
Fondation Caritas France
Publicité

9
autres sciences sociales, en fournissant un cadre de réflexion. Elle l’a déjà fait par le
passé en science politique ou en droit économique. Les anthropologues, les sociologues,
les psychologues, les économistes traitent au fond d’un même sujet : les comportements
et les relations humaines. Il serait catastrophique qu’il n’y ait pas d’échange entre les
disciplines. Il devrait au fond n’y avoir qu’une seule science humaine.
Un défenseur du marché
Il n’en fait pas mystère : Jean Tirole est un défenseur obstiné du marché. Introduire de la
concurrence dans les secteurs administrés par des monopoles publics, instituer des
marchés nouveaux pour traiter les problèmes environnementaux (le marché des « droits à
polluer » ou « droits d’émission négociables »), renforcer la liberté de licenciement, quitte à
faire payer les entreprises qui licencient, tels ont été quelques-uns des chevaux de bataille
de l’économiste au cours des vingt dernières années.
Cela fait-il pour autant de lui un ultralibéral, qui ne jurerait que par l’autorégulation du
marché ? Certes pas. S’il partage avec les tenants de l’école de Chicago, de Milton
Friedman à Gary Becker, les mêmes prémisses méthodologiques (celles de la théorie
néoclassique), J. Tirole se range plutôt dans la tradition des économistes de la côte est
des États-Unis, consacrant ses recherches à formuler, dans chacun des domaines
abordés, les conditions d’une bonne intervention de l’État. À ses yeux, dès lors que l’on
quitte la fiction d’une économie où aucun agent n’aurait de pouvoir sur les prix (hypothèse
de concurrence parfaite), et où tous auraient en tout moment accès aux mêmes
informations (hypothèse d’information parfaite), l’action régulatrice de l’État reprend ses
droits.
Pourtant, plus qu’un critique de la théorie néoclassique, J. Tirole en est l’un des
continuateurs, poursuivant l’analyse sous des hypothèses plus réalistes. Dès lors, par
exemple, que l’information n’est plus ouverte à tous (asymétrie d’information), l’équilibre
économique n’est plus nécessairement un optimum social. Par quels moyens peut-on
réinstaurer cet optimum ? Quelles réglementations, quel régime d’incitation sont
nécessaires pour faire en sorte que les décisions des entreprises soient compatibles avec
l’intérêt des consommateurs ? Telles sont les questions que se pose le théoricien.
La problématique de la nouvelle économie industrielle s’inscrit à cet égard dans le droit fil
de Léon Walras (1824-1910), l’un des fondateurs de la théorie néoclassique, si ce n’est
dans l’outillage théorique, du moins dans l’esprit : une fois que l’économie pure a établi la
norme d’une économie parfaitement concurrentielle, il appartient à l’économie appliquée
de rapprocher la réalité au plus près de cette norme. Comme l’économie appliquée de L.
Walras, la nouvelle économie industrielle est donc une discipline au service d’un État
auquel incombe la mission de poser les fondations de l’économie de marché et de veiller
à son bon fonctionnement.
Jean Tirole
C’est au MIT (Massachusetts Institute of Technology), l’un des centres de la recherche
économique contemporaine, que Jean Tirole a fait ses premières armes d’économiste.
Après un doctorat soutenu en 1981 sous la direction du colauréat du prix Nobel 2007, Eric
Maskin, ce polytechnicien y devient professeur en 1984. C’est là qu’il contribue à jeter les
bases de la « nouvelle économie industrielle ». L’économiste toulousain Jean-Jacques
Laffont, aujourd’hui décédé, le convainc en 1992 de rejoindre le laboratoire CNRS
d’économie mathématique (Gremaq) et l’IDEI qu’il a créés dans la ville rose. J. Tirole est
aujourd’hui à la tête de ce pôle de recherche, incontournable dans le domaine de
l’économie industrielle et de l’économie d’entreprise.
Il a récemment publié :
The Theory of Corporate Finance, Princeton University Press, 2006.
Partager :
Vos Vacances à -70% Meuble & Déco La
Redoute
Profitez de l’offre !
Share
Share
Share
Share
Share
Share
Share
Share
Share
Share
Share
Share
Share
Share
Share
Share
Share
Share
Share
Share
Share
Share
Share
More

Cocotiers, lagons bleus et détente
sont au programme dans des
hôtels haut de gamme jusqu’à -
70%
Redoute
La Redoute vous présente en
exclusivité sa Nouvelle Collection
Mobilier! Livraison Gratuite*
Renault ZOE à partir de 169€/mois,
tout compris (conditions sur site).
Profitez de l’offre !
Publicité
COMMENTAIRES
0 commentaire, soyez le premier à réagir
Proposer un commentaire
(En savoir plus sur les commentaires)
Nom
Email *
Sujet
Commentaire *
Pour nous aider à lutter contre le spam, merci de recopier le code anti-spam ci-dessous *
Votre réponse
* Champs à renseigner obligatoirement
Envoyer
Contact - Aide - Signaler un contenu illicite - Conditions générales de vente - Mentions légales
Ce site utilise des cookies pour le bon fonctionnement de ses services. En poursuivant votre navigation, vous en acceptez l’utilisation. En savoir plus OK
1
/
5
100%