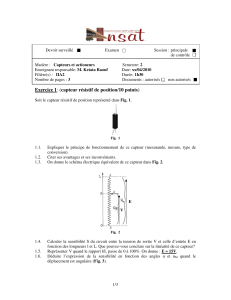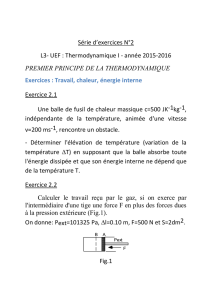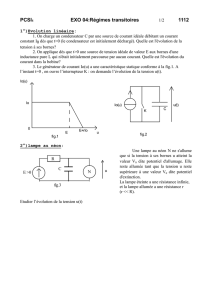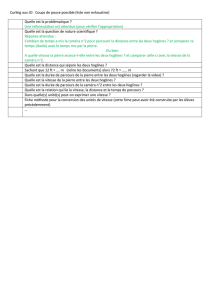La webcam en astronomie : une révolution ! (1)

8
La webcam en astronomie : une révolution ! (1)
1. Introduction
Comme en photographie classique, l’imagerie numérique est en train de détrôner la
photographie argentique chez les astronomes amateurs. Le passage au numérique s’explique
par un certain nombre d’avantages décisifs de cette nouvelle technologie, comme la facilité
d’acquisition et de traitement des images. Mais en astronomie, l’avantage essentiel du
numérique est la possibilité de fractionner une prise de vue en de nombreux clichés de
relativement courte durée, et de ne garder de ceux-ci que les meilleurs – ceux qui n’ont pas
été trop dégradés par la turbulence atmosphérique. Les heureux élus peuvent ensuite être
additionnés et traités électroniquement à l’aide de logiciels puissants. Le résultat est
spectaculaire ; il suffit de feuilleter les pages de Ciel et Espace ou de Sky and Telescope pour
constater que les photographies d’amateur atteignent aujourd’hui la qualité de celles obtenues,
voici quelques années seulement, par les grands observatoires professionnels ! Bien entendu,
ces derniers ont aussi pris le virage du numérique et font aujourd’hui appel à de très
performantes – et très coûteuses ! – caméras CCD
1
.
Il existe aussi des caméras CCD conçues pour l’astronomie d’amateur, mais celles-ci
sont, pour beaucoup, encore inabordables. Les amateurs peuvent cependant se tourner vers un
matériel beaucoup plus accessible, la modeste webcam, initialement prévue pour la
visioconférence. Toutes les webcams ne conviennent pas à la prise de vue astronomique. La
plus réputée est la Philips Toucam pro (I ou II). Très légère, elle est équipée d’un véritable
capteur couleur CCD. Son objectif se dévisse et peut être
remplacé par une bague au coulant 31,75 mm, ce qui permet de
l’adapter à un télescope ou à une lunette (Fig. 1) ; cette bague,
que l’on trouve de plus en plus facilement dans le commerce,
peut être filetée pour la munir d’un filtre.
Pour l’imagerie dite « planétaire » (Lune, Soleil,
planètes – on peut aussi s’amuser avec les étoiles doubles !), le
principe de la prise de vue est simple. La caméra, à l’origine,
travaille en mode « flux » : elle enregistre un nombre choisi
d’images par unité de temps (par exemple 10 images par
seconde) ; au bout de 60 secondes, elle aura donc accumulé
600 images, que l’on peut additionner et traiter. Mais pour la
plus grande joie des astronomes amateurs, un petit génie de
l’électronique, Steve Chambers, a apporté une modification à la
caméra qui permet à celle-ci d’effectuer des poses longues –
1
Le mot CCD est une abréviation de Charged-Coupled Device (dispositif à transfert de charges).
Fig. 1. Philips Toucam pro,
capteur couleur d’origine ¼
″
,
modifiée longue pose et
couleurs optimisées. On voit
ici l’objectif, qui a été
remplacé par une bague au
coulant 31,75 mm.

9
plusieurs dizaines de secondes –, et donc de s’attaquer à l’imagerie du ciel profond. Par
exemple, la caméra pourra enregistrer un total de 250 images de 10 secondes chacune. Je
reviendrai plus loin sur les paramètres d’acquisition, le compositage et le traitement d’images
planétaires et du ciel profond.
Fig. 2. Philips Toucam pro équipée d’un capteur Sony
noir et blanc, modifiée longue pose et mode raw. La
coque a été remplacée car le capteur 1/3
″
entrait
difficilement dans la coque d’origine. On remarque ici
le placement d’un filtre à l’extrémité de la bague
filetée.
Fig. 3. La webcam est placée dans le porte-oculaire
grâce à la bague au coulant 31,75 mm.
De plus, si on est un peu débrouillard en électronique – ce qui n’est pas mon cas ! –,
on peut remplacer le capteur couleur d’origine ¼″ par un capteur CCD noir et blanc ou
couleur plus sensible de 1/3″ et même de ½″ (Fig. 2). Il est également facile d’optimiser cette
caméra grâce à un logiciel mis au point par Etienne Bonduelle qui est téléchargeable sur
Internet : passer en mode « raw » (littéralement « mode brut »), optimiser les couleurs,…
Bref, la caméra Philips Toucam pro offre beaucoup de possibilités, que nous devons
notamment à ceux qui ont bien voulu partager leurs découvertes sur Internet. Ajoutons qu’une
caméra Philips Toucam pro II ne coûte qu’environ 80 euros, mais on en trouve également
d’occasion sur ebay, déjà modifiées. J’en possède deux et c’est avec elles que je passe de
nombreuses nuits sous la voûte étoilée !
D’autres webcams sont intéressantes : citons ici les caméras Philips Vesta pro et
Logitech Quickcam. Quelques sites Internet utiles :
• Steve Chambers : http://www.pmdo.com/wintro.htm
• Etienne Bonduelle : http://astrosurf.com/astrobond/ebrawf.htm#AviRAW
• Danny Loudèche (bagues webcam) : http://www.astromeca.com/
2. Les logiciels
Il existe de nombreux logiciels traitant les images astronomiques. Je vais vous
présenter les plus connus, ceux que j’utilise le plus :

10
• QCfocus de Patrick Chevalley, téléchargeable et gratuit : acquisition d’images. Je
l’utilise pour l’acquisition d’images planétaires.
http://www.astrosurf.org/astropc/qcam/programme.html
• Astrosnap Pro d’Axel Canicio : acquisition d’images. La version démo est gratuite ; je
l’utilise pour l’acquisition d’images du ciel profond. La version payante offre de
nombreuses fonctions très intéressantes (mise en station, autoguidage, etc.).
http://www.astrosnap.com/index_fr.html
• Iris de Christian Buil, téléchargeable et gratuit : acquisition, compositage et
traitements d’images. De prime abord, ce logiciel n’est pas très convivial, mais il
propose des leçons permettant d’en éclaircir le fonctionnement.
http://www.astrosurf.org/buil/iris/iris.htm
• Registax de Cor Berrevoets, téléchargeable et gratuit : compositage et traitement
d’images.
http://registax.astronomy.net/
• Photoshop 7, payant : logiciel photo. Je l’utilise pour les finitions.
• ImageReady 7, fourni avec Photoshop 7. Je l’utilise pour réaliser des animations.
• AstroNotes d’Olivier Gousseau, téléchargeable et gratuit. C’est un petit programme
très utile, qui permet de noter sur le terrain les réglages, les paramètres et les
conditions d’acquisition de la webcam.
http://ogousseau.free.fr/astronotes.htm
• Simulateurs de planètes et satellites ; ils sont téléchargeables et gratuits :
Mars Previewer 2.0
http://www.interstars.net/index.php?logiciel=Mars%20Previewer
Jupiter 2.0 de Sylvain Rondi
http://www.astrosurf.com/rondi/jupiter/index.htm
Satellites of Saturn 2.0
http://members.cox.net/astro7/dansoftware.html
3. L’acquisition des images planétaires
Je vous propose de commencer par la planète Mars, qui est actuellement à la « une »
de l’actualité. Je fournirai tout au long du processus de réalisation images et explications. La
technique expliquée ici est appelée L(RVB) ; on ajoute une image de luminance à l’image
couleur.

11
Le matériel utilisé :
Télescope Meade ETX 105, dont le rapport f/d est de 15. Pour les images de planètes,
on peut pousser le rapport jusqu’à 25 à 45, grâce à l’utilisation d’une ou de deux
lentilles de Barlow. Ici, j’utilise une lentille de Barlow × 3 (gentiment prêtée par
Claude), ce qui porte le rapport f/d à 45. Le seul inconvénient de l’utilisation d’une
Barlow, c’est la forte amplification de la turbulence de l’air qui peut déformer
l’image. Il est donc souhaitable d’attendre que la planète soit assez élevée dans le ciel
pour commencer les acquisitions, la turbulence étant généralement plus forte à basse
altitude. Les conditions météo – vent fort par exemple – peuvent gêner également.
Webcam Philips Toucam pro couleur pour obtenir une image couleur ou « RVB » (le
rouge, le vert et le bleu étant les trois couleurs primaires). L’utilisation d’un filtre
bloquant le rayonnement infrarouge et ultraviolet permet d’obtenir un meilleur rendu
de l’image.
Philips Toucam pro noir et blanc, dont le capteur est plus sensible que le capteur
couleur, et qui permet d’obtenir une image noir et blanc plus détaillée que l’image
couleur ; il fournira l’image de luminance ou image « L ». L’utilisation d’un filtre
rouge accentuera davantage les détails de la planète… rouge !
Nous voilà donc parés ; mais pour réaliser de belles images, il y a encore quelques
étapes à respecter. Le nettoyage des optiques par exemple est crucial : de simples poussières
peuvent altérer l’image. Un mélange de 60% d’alcool isopropylique et 40% d’eau
déminéralisée conviendra parfaitement ; il suffit de demander à un pharmacien de le préparer
en précisant qu’il s’agit de nettoyer des instruments d’optique. Le mélange est appliqué à
l’aide d’un mouchoir en papier ou du papier toilette doux, ou d’un coton-tige pour les endroits
d’accès difficile ; on laisser sécher et on utilise un spray à air sec pour chasser les peluches
éventuelles. Notons qu’il existe des techniques d’imagerie numérique pour effacer les traces
laissées sur les images ; j’y reviendrai lorsque je parlerai des images lunaires, solaires et du
ciel profond.
La mise à température est très importante, car si toute
l’optique (télescope, caméra, filtres, lentilles,…) n’est pas en
équilibre thermique il y a risque de déformation de l’image,
de dépôt de buée, etc. On sortira donc le matériel bien avant
le moment choisi pour l’observation. Si l’on prévoit
d’observer longtemps, une résistance chauffante ou même
un sèche-cheveux peut être d’une grande utilité pour
combattre la buée par nuit de forte humidité.
La mise en station est cruciale. Un bon suivi
permettra de garder la planète dans le champ du capteur, le
grossissement étant important avec l’emploi d’une lentille de
Fig. 4. Filtre « bricolé » à l’aide
d’une boîte de spindle cd, de deux
pics à brochettes et d’un peu
d’adhésif.

12
Barlow. La collimation doit être irréprochable.
La mise au point doit s’effectuer lorsque
les instruments sont à température. Il existe
plusieurs techniques très simples. J’utilise un
filtre à aigrettes (Fig. 4) : il s’agit juste de
disposer deux tiges en croix devant la lame de
fermeture. En visant une étoile brillante comme
Véga, Capella ou Sirius, on voit apparaître des
aiguilles autour
de l’étoile
(Fig. 5) ; c’est
moins évident avec un télescope de petit diamètre. Des
poses de quelques secondes permettent de mieux faire
apparaître les aiguilles. Il suffit d’affiner la mise au point
jusqu’à obtenir de belles aigrettes.
Si la caméra n’a pas été modifiée pour permettre les
longues poses, on peut utiliser un disque de Hartmann ; il
s’agit d’un disque percé de trois ou quatre trous que l’on
place devant la lame de fermeture (Fig. 6). En visant une
étoile brillante on voit apparaître sur l’écran de contrôle trois
ou quatre « étoiles » ; il suffit d’affiner la mise au point pour fondre ces images et obtenir une
seule « étoile » sur l’écran (Fig. 7). Ce disque est aussi utilisé pour vérifier la collimation du
télescope.
Avant de lancer les acquisitions, il faut encore régler les paramètres de la caméra.
L’apparence de l’écran le logiciel Qcfocus et les fenêtres de commande d’une caméra Toucam
sont présentés dans les Figs. 8 à 10. On règle ainsi le nombre d’images par seconde, la vitesse,
le gain (= la sensibilité), la luminosité, etc. Les réglages peuvent varier d’une instrumentation
à une autre. Il faut tester ! Il faut également créer un répertoire où le film (fichier .avi) sera
sauvegardé sur le disque dur de l’ordinateur.
Fig. 6. Disque « bricolé » en bois
fin, percé de trois trous circulaires
(merci à Claude, maquettiste !).
Fig. 7. La mise au point est effectuée lorsque les trois « étoiles » n’en font plus qu’une.
Fig. 5. Mise au point effectuée sur Vega avec 5s
de pose.
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%




![III - 1 - Structure de [2-NH2-5-Cl-C5H3NH]H2PO4](http://s1.studylibfr.com/store/data/001350928_1-6336ead36171de9b56ffcacd7d3acd1d-300x300.png)