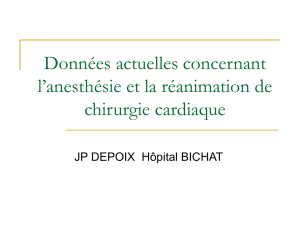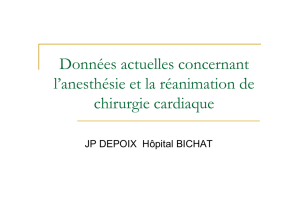PROJET DE FIN D’ETUDES TITRE

1
PROJET DE FIN D’ETUDES
Pour l’obtention du diplôme national
LICENCE APPLIQUEE
EN ANESTHESIE REANIMATION
Présenté et soutenu le 24/ 06 / 2014
Par
Nom et Prénom : Ben Romdhan Liwa eddine Mediouni Sabrine
TITRE
Extubation précoce (Fast-track anesthesie)
Complications et Echecs
Mots-clés
Fast-track - Circulation extracorporelle (CEC) -
Extubation précoce - Complications – Echecs
PRESIDENT DE JURY : Pr Ag.Mechaal BEN ALI
MEMBRES : 1) Dr .Yasser AMARA
2) Mme .Amira SOUISSI
ENCADREURS : Pr Iheb LABBENE
Mme .Zienouba chouchen

2
Table des matières
Abréviations ................................................................................................................ 7
NHYA: New York Heart Association ..................................................................... 7
BPCO : Broncho-pneumopathie chronique obstructive ........................................ 7
Introduction ................................................................................................................. 9
Matériels et méthodes .............................................................................................. 12
1. TYPE DE L’ETUDE : ...................................................................................... 12
2. CRITERES D’INCLUSION ET D’EXCLUSION ............................................... 12
2.1. Critères d’inclusion : ................................................................................. 12
2.2. Critères d’exclusion : ................................................................................ 12
3. METHODOLOGIE .......................................................................................... 12
3.1. Stratégie anesthésique : ........................................................................... 12
3.2. Période per-opératoire : ........................................................................... 13
3.3. Période post-operatoire : .......................................................................... 13
4. PARAMETRES ANALYSES : Voir fiche annexe n1 ........................................ 13
4.1. Evaluation préopératoire : ........................................................................ 13
4.2. Evaluation per-operatoire : ....................................................................... 13
4.3. Evaluation post-operatoire : ..................................................................... 14
5. ETUDE STATISTIQUE : ................................................................................. 14
Résultats ................................................................................................................... 16
1. DONNEES GENERALES : ............................................................................. 16
2. DONNEES EPIDEMIOLOGIQUES : ............................................................... 16
2.1. L’âge : ...................................................................................................... 16
2.2. Indice de masse corporelle : .................................................................... 17
3. DONNEES CLINIQUES PRE-OPERATOIRES : ............................................ 17
Les tares associées : ............................................................................................. 17
4. DONNEES PARACLINIQUES : ...................................................................... 18
4.1. Fonction ventriculaire gauche : ................................................................ 18

3
4.2. Le score ASA : ......................................................................................... 18
4.3. Le score NYHA : ...................................................................................... 19
4.4. Durée de CEC : Pas ici mais en peropératoire ......................................... 19
5. LA NATURE DE L’ACTE : .............................................................................. 20
6. ANESTHESIE : ............................................................................................... 20
6.1. Durée de l’anesthésie : ............................................................................. 20
6.2. Anesthésie : ............................................................................................. 21
6.3. Entretien anesthésique : ........................................................................... 22
6.4. Les doses totales des morphiniques : ...................................................... 23
6.5. Dose totales des hypnotiques : ................................................................ 24
7. DONNES POSTOPERATOIRES : .................................................................. 24
7.1. Stabilité hémodynamique : ....................................................................... 24
7.2. Sédation en réanimation : ........................................................................ 25
7.3. Durée d’intubation postopératoire : .......................................................... 25
7.4. Les échecs : ............................................................................................. 26
7.5. Les complications postopératoires : ......................................................... 29
Analyse comparative des facteurs influençant l’extubation tardive : Tableau n°6
........................................................................................................................... 31
Discussion ................................................................................................................ 33
Conclusion ......................................................................... Erreur ! Signet non défini.
Références ........................................................................ Erreur ! Signet non défini.

4
Liste des figures
Figure 1: Classification des patients selon l’âge ...................................................................16
Figure 2 : Indice de masse corporelle ...................................................................................17
Figure 3: fréquence des tares associées ..............................................................................17
Figure 4 : Classification des patients selon le FEVG.............................................................18
Figure 5 : Classification des patients selon le score ASA .....................................................18
Figure 6 : Classification selon le score NYHA .......................................................................19
Figure 7 : classification des patients selon la durée de CEC.................................................19
Figure 8 : classification des patients selon la nature de l’acte ...............................................20
Figure 9 : Durée de l’anesthésie ...........................................................................................20
Figure 10 : les hypnotiques utilisés dans l’induction anesthésiques ......................................21
Figure 11 : les morphiniques utilisés pour l’induction anesthésique ......................................22
Figure 12 : Les hypnotiques utilisés pour l’entretien .............................................................22
Figure 13 : les morphiniques utilisés pour l’entretien ...........................................................23
Figure 14 : les doses totales des morphinique ......................................................................23
Figure 15 : Dose totale des hypnotiques ..............................................................................24
Figure 16 : Stabilité hémodynamique à la sortie de bloc .......................................................24
Figure 17 : Sédation en réanimation .....................................................................................25
Figure 18 : Durée d’intubation ..............................................................................................25
Figure 19 : extubation précoce .............................................................................................26
Figure 20 : Echec lié à la durée du CEC ...............................................................................27
Figure 21 : Extbation supérieur à 8H ...... Figure 22 : Extbation inférieur à 8H
28
Figure 23 : Extbation supérieur à 8H ...... Figure 24 : Extbation inférieur à 8H
28
Figure 25 : Extbation supérieur à 8H ...... Figure 26 : Extbation inférieur à 8H
29

5
Liste des tableaux
Tableau 1 : les agents anesthésiques utilisés .......................................................................21
Tableau 2 : Délai d’extubation ..............................................................................................26
Tableau 3 : les causes des échecs d’extubation ...................................................................26
Tableau 4 : Echec lié à la durée de la CEC ..........................................................................27
Tableau 5 : Les complications postopératoires .....................................................................29
Tableau 6 : Analyse des facteurs de risque ..........................................................................31
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
1
/
54
100%