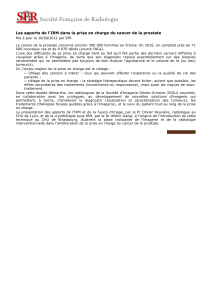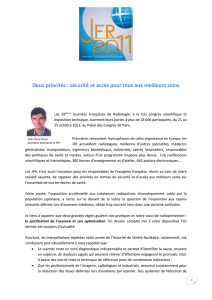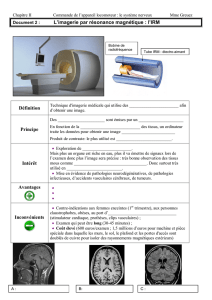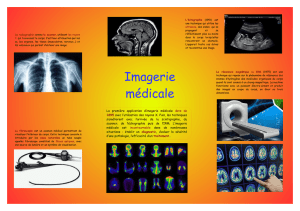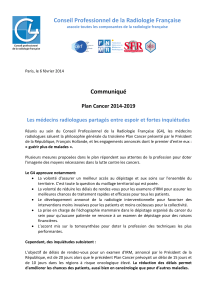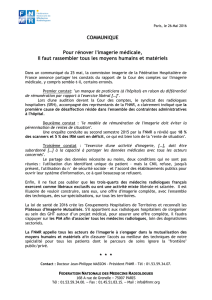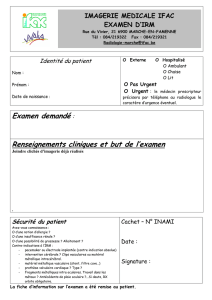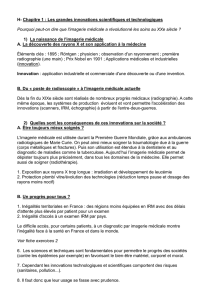Imagerie Urologique Gauthier Roland, Région Littoral Méditerranéen

ECR 2013 Reportage Bourse SFR - Agfa
1
Imagerie Urologique
Gauthier Roland, Région Littoral Méditerranéen
Au cours de l’ECR 2013, de nombreux cours et sessions scientifiques ont porté sur l’imagerie urinaire
et plus particulièrement sur l’imagerie prostatique, domaine dans lequel un grand nombre d’équipes
européennes est venu présenter leurs travaux. Il a en particulier été une nouvelle fois rappelé la
nécessité de la standardisation des comptes rendus en IRM prostatique et l’importance de
l’utilisation de la récente classification PI-RADS, calquée sur la classification BI-RADS des lésions
mammaires, proposée en 2012 par l’ESUR (European Society of Urogenital Radiology), afin que
l’ensemble des radiologues et des urologues puissent parler un même langage. Quentin et al. ont
présenté une des premières études portant sur la fiabilité de cette classification. Dans cette étude
ressort une bonne corrélation interobservateur entre les classifications PI-RADS de 167 lésions,
relues par 3 radiologues, avec des K compris entre 0,55 et 0,65. Barentsz et al. ont par ailleurs insisté
sur l'intérêt des biopsies prostatiques guidées par l'IRM qui améliorent de manière significative le
taux de détection des cancers prostatiques. Il espère que dans un futur proche, l'ensemble des
patients bénéficiera d'une IRM avant la réalisation de biopsies afin d'éviter les biopsies prostatiques
réalisées à "l’aveugle" qui sous-estiment le nombre de cancers et amène souvent à la réalisation de
nouvelles séries de biopsies.
Il a par ailleurs été montré dans plusieurs études l’intérêt de la diffusion avec des valeurs élevées du
coefficient b. Manenti et al, ont mis en particulier en évidence l’intérêt de la diffusion en IRM 3 Tesla
avec des valeurs de b à 2000 s/mm
2
dans la détection des cancers prostatiques de la zone de
transition et de la zone périphérique. Barchetti et al. ont également présenté l’intérêt de l’imagerie
de diffusion avec des valeurs de b à 3000 s/mm
2
. Celle-ci aurait des sensibilité et spécificité proches
de l’étude dynamique du rehaussement dans la recherche de récidives locales de cancers de la
prostate après traitement local par radiothérapie.
Deux études innovantes proposent l’utilisation de séquences de perfusion par « arterial spin
labelling » (ASL), technique d'imagerie utilisant le marquage des noyaux d'hydrogène de l'eau par des
impulsions radiofréquences, en remplacement des séquences de perfusion habituelles qui
nécessitent une injection intraveineuse de produit de contraste. D’une part Hagen et al. ont proposé
l’utilisation de l’ASL dans l’évaluation de la fonction rénale chez le patient greffé avec une excellente
corrélation au débit de filtration glomérulaire (p < 0,0001). D’autre part l’équipe japonaise de
Takahashi et al. a suggéré l’utilisation des séquences d’ASL dans la recherche de foyers
hypervascularisés intra-prostatiques, avec des résultats prometteurs. Cette technique d’imagerie,
bien que difficile d’accès en pratique courante, ouvre une perspective intéressante dans le futur pour
l’exploration des patients ne pouvant pas bénéficier d’injection de produit de contraste, en
particulier chez les patients greffés ou âgés.
Enfin, outre l'intérêt didactique des cours et la qualité des exposés scientifiques présentés à l'ECR
2013, avoir bénéficié de la bourse SFR-AGFA m'a permis de pouvoir rencontrer et partager mon
expérience avec d'autres jeunes radiologues de différentes régions de France, ce qui fut tout aussi
enrichissant, à la fois du point de vue professionnel et personnel.
1
/
1
100%