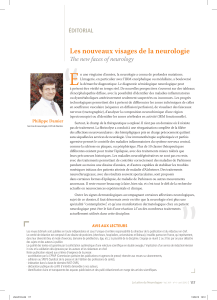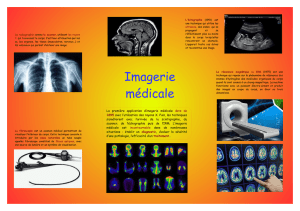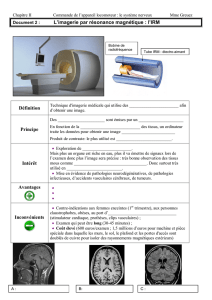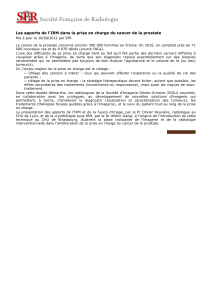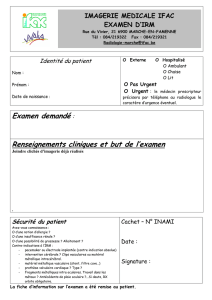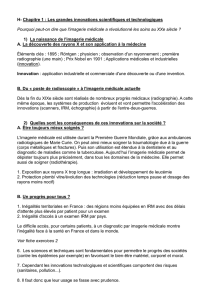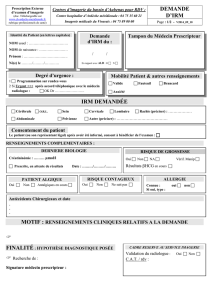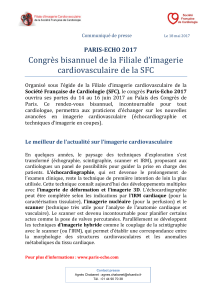Lire l'article complet

En médecine de ville, les médecins spécia-
listes ont des correspondants paramédicaux.
Pour les neurologues, ce sont d’abord les ortho-
phonistes, mais aussi les infirmières et les kiné-
sithérapeutes, qui ont cette orientation préféren-
tielle en même temps qu’une activité généraliste
de leur métier. À l’hôpital, et particulièrement
dans les hôpitaux universitaires, pour des rai-
sons d’enseignement, les services sont, pour la
plupart, désignés par la ou les disciplines qui y
sont exercées. Certains d’entre nous y trouvent
alors une pratique et une haute compétence
dans un domaine restreint de la médecine.
Les malades de neurologie
Quelle triste image en donnait autrefois “l’hos-
pice de la Salpêtrière”, avec ses immenses salles
communes de grabataires et ses invalides avan-
çant dans les cours avec difficulté ! Cette image
de l’invalidité et de la chronicité marque encore
notre discipline parce que ces malades sont en-
core nombreux. Quels sont-ils ?
Pour tout le monde, l’hémiplégie qui confine au lit
lorsqu’elle est massive ou ne permet qu’une lente
marche, “en fauchant”, est la première des mala-
dies neurologiques. Bien sûr, l’hémiplégie n’est
qu’un symptôme, conséquence habituelle
Sommaire
• Un réseau de contrôle
de traitement d’images
• Des stimuli sonores
pour encourager le réveil
• Maladie de Parkinson :
quels traitements ?
• Alzheimer :
retarder le handicap
• SEP :
une recherche active
Neurologie
Un sens profond
de la relation aux autres
La pratique médicale s’effectue souvent dans le cadre
d’une spécialité ou discipline, et la neurologie
est l’une d’entre elles. Ce sont les malades, et l’affection
du système nerveux qui les frappe, qui définissent
la discipline : qui sont-ils ? De quelle manière nous
font-ils un peu peur ? Ou au contraire sont-ils attachants ?
Nous qui en sommes les soignants !
15
●●●
©P.Michaud

16
d’un accident vasculaire cérébral athéroma-
teux après 50 ans, ou embolique d’origine car-
diaque, voire hémorragique à tout âge, du fait
d’une malformation vasculaire.
Avec l’hémiplégie, la paraplégie est encore à l’ori-
gine de cette opinion générale dévalorisante de
la neurologie, car, là encore, il y a invalidité sé-
vère, définitive, pour une cause qui peut frapper
brutalement des sujets jeunes en pleine santé,
par exemple après accident de la voie publique
et fracture du rachis.
Les malades qui ont des difficultés de communi-
cation sont nombreux : l’aphasie plus ou moins
sévère accompagne l’hémiplégie droite. Elle peut
aussi se manifester avec des troubles de la mé-
moire, voire du comportement dans le cadre de
la maladie d’Alzheimer et d’encéphalopathies de
toutes origines.
Les troubles sensitifs et sensoriels sont les mani-
festations fréquentes de maladies telles que la
sclérose en plaques : paresthésies rarement dou-
loureuses, diplopie, cécité monoculaire, vertiges
et déséquilibre sont transitoires au début, mais
on connaît le risque d’installation de troubles
permanents et sévères de la marche.
Enfin, si les services de neurochirurgie ne sont
plus le lieu des gestes opératoires aux consé-
quences graves, ils sont encore le lieu d’accueil
des traumatisés crâniens sévères avec coma pro-
longé évoluant vers la dépendance définitive.
Malades lourds, malades chroniques, malades
dépendants, malades que peu de traitements per-
mettent de soigner, voici un bien sombre tableau,
qui pourrait être celui de la médecine du
XIXesiècle. Ces malades existent encore aujour-
d’hui, même s’ils sont moins nombreux, du fait
des progrès qui ont été réalisés.
Or, il y a toujours eu, et il y a encore, des soi-
gnants de tous ordres pour les prendre en charge
en acceptant la pénibilité de certaines situations,
pour les aider, et certainement les aimer.
La prise en charge des soins
et la thérapeutique
Il est de l’expérience de chacun de nous, méde-
cins neurologues, rééducateurs fonctionnels, in-
firmières, kinésithérapeutes, orthophonistes et
psychologues, de voir des patients sévèrement
affectés de troubles moteurs ou du langage lut-
ter avec nous et participer pendant de longues
semaines au travail de réadaptation. Et nous sa-
vons alors que ces patients qui, pour des obser-
vateurs extérieurs, demeurent “des invalides”,
ont retrouvé cependant les moyens d’une vie
personnelle : l’hémiplégique qui se tient debout
et remarche, le paraplégique qui “se débrouille”
en fauteuil roulant, l’aphasique qui retrouve des
possibilités de communication, ont, à leurs yeux
mêmes, obtenu le moyen d’une réinsertion fa-
miliale, souvent aussi sociale.
Savoir cela, c’est aussi pour les soignants com-
prendre que les gestes astreignants, dits “de nur-
sing”, ne sont pas seulement des gestes de confort
physique pour les malades, mais les moyens de
passer un cap et de bien préparer l’avenir : pré-
venir les escarres, pallier les conséquences des
troubles du contrôle sphinctérien et de ceux de
la déglutition, éviter les postures qui exposent à
des rétractions tendineuses, exigent d’immenses
efforts et une attention sans cesse renouvelée.
À côté de ces patients, il y a heureusement de
plus en plus de malades que l’on guérit, et
d’autres pour lesquels un trouble mineur, voire
fugitif, est le moment de gestes préventifs d’un
nouvel épisode plus grave.
La pathologie vasculaire cérébrale bénéficie des
progrès de l’imagerie et de ceux de la neurochi-
rurgie, et des thérapeutiques médicales.
L’IRM permet la visualisation anatomique pré-
cise des malformations vasculaires ; celles-ci
peuvent alors être soit obstruées par sonde intra-
artérielle, soit faire l’objet d’une exérèse chirur-
gicale dans de bonnes conditions. Les troubles
circulatoires de nature ischémique bénéficient
en urgence également de l’imagerie, permettant
de fixer les indications des anticoagulants, voire
des fibrinolytiques, préparant ou non une chi-
rurgie des artères cervicales différée de quelques
jours. Des centres d’urgences cérébrovasculaires
se créent dans les hôpitaux parce qu’il est dé-
montré que les soins qui y sont assurés évitent
ou réduisent les déficits séquellaires.
Les tumeurs cérébrales malignes, astrocytomes
et glioblastomes, la SEP, le Parkinson, ne relè-
vent pas d’un traitement salvateur décisif. Ce-
pendant, combien leur pronostic est aujourd’hui
meilleur : ainsi, avant les corticoïdes, on estimait
que seuls 30 % des patients atteints de SEP
●●●
neurologie
©P.Garo-Phanie

demeuraient autonomes après 10 ans d’évolu-
tion. Et cette amélioration n’est pas seulement
due aux médicaments, mais au moins autant à la
prévention des complications des déficits transi-
toires, à la rééducation sphinctérienne et à la
prévention des infections urinaires.
Quant au Parkinson, son pronostic fonctionnel a
été transformé par le traitement par la L-dopa,
qui, pendant plusieurs années, a fait disparaître
les troubles moteurs. Cette thérapeutique de-
vient moins efficace et se complique de mouve-
ments anormaux après une dizaine d’années. La
possibilité d’une stimulation électrique par élec-
trodes intracérébrales implantées en neurochi-
rurgie permet encore un sursis. Cette technique
est entrée dans la pratique depuis moins de
cinq ans. Pour le Parkinson, tout comme pour
l’Alzheimer et d’autres affections dites dégénéra-
tives, le vrai traitement reste à trouver, celui qui
bloquerait le processus de déperdition et de mort
neuronale qui se poursuit inexorablement. Les
recherches dans ce domaine constituent actuelle-
ment une part majeure du budget recherche de
l’industrie pharmaceutique dans le monde entier.
D’autres affections, d’évolution lentement pro-
gressive, bénéficient aussi de ces recherches,
voire des espérances qu’ouvre la thérapie gé-
nique, telles les myopathies, certaines neuropa-
thies périphériques familiales, ou enfin, la mala-
die de Charcot.
Toutes les maladies neurologiques ne sont pas
vues en hospitalisation, sauf pour investigations
brèves : la migraine et les algies faciales, les né-
vralgies cervico-brachiales et lombaires, qui ap-
partiennent à une pathologie banale. Par contre,
l’épilepsie fait l’objet d’un suivi neurologique ré-
gulier. A l’aube du XXIesiècle, les familles atta-
chent encore aux manifestations épileptiques
une signification dévalorisante pour le malade et
son entourage. Fort heureusement, des médica-
ments simples permettent d’obtenir un bon
contrôle, et les cas chirurgicaux sont l’exception.
Les formes sévères existent encore, souvent dans
le contexte d’une encéphalopathie globale de
l’enfance.
Nous vivons cette neurologie
Le tableau clinique précédent, même éclairé par
des progrès récents, et l’espoir raisonnable de
progrès futurs, illustre une discipline assuré-
ment lourde, dans laquelle le travail soignant
peut être ressenti comme pénible.
Pourtant, ces malades qui sont les nôtres et qui
ont besoin de nous sont des malades comme les
autres. Comme tous, ils nous donnent en retour
les moyens de les aimer.
Il est d’abord remarquable que ces patients
soient presque toujours courageux, même si
des phases dépressives peuvent survenir, parfai-
tement compréhensibles. Il faut du courage
pour accepter à 20 ans un diagnostic de SEP,
ou à 50 ans celui d’une maladie de Parkinson,
même si l’on sait qu’il en existe des traitements.
Le courage, c’est celui qui sera nécessaire pour
accepter une maladie récidivante ou chronique
progressive.
Il en faut aussi pour accepter la persistance d’un
déficit fonctionnel après une maladie aiguë. Il a
déjà été question de l’hémiplégie et de la para-
plégie, mais plus difficile encore est l’acceptation
d’un symptôme que les autres ne voient pas, et
qu’il faut traiter de façon continue (l’épilepsie),
avec une efficacité parfois incomplète (certaines
algies faciales).
Également mal ou non compris de l’entourage
sont les déficits sensoriels, ou, plus graves en-
core, ceux subtils qui modifient l’intelligence,
la pensée, la personnalité, en dehors de tout
contexte proprement psychiatrique.
Ces malades, nous les connaissons bien, eux et leur
famille qui participe aux soins. La chronicité même
de la maladie explique cette relation de familiarité
affective qui se développe avec eux au fil du temps.
Les jeunes médecins, tout comme les jeunes infir-
mières, ont pour chacun de leurs malades le désir
profond du succès thérapeutique, désir qui corres-
pond à une racine fondamentale de la médecine,
désir qui entretient aussi leur enthousiasme juvé-
nile. Plus tard, nous apprenons tous que ce succès
n’est jamais promis, qu’il est difficile à obtenir, que
son prix humain peut être à la limite du suppor-
table, et notre vie professionnelle s’enrichit d’une
volonté de partager ces souffrances, de les réduire
en soulageant l’angoisse qui les accompagne.
Pr Pascal Brunet
Neurologue, ancien doyen de la Faculté de médecine
de la Pitié-Salpêtrière.
17
©Burger-Phanie

18
neurologie
Au cours des deux dernières décennies, la neuroradiologie a bénéficié
d’une évolution très rapide, avec l’apparition de nouvelles techniques
d’imagerie : scanographie au cours de la décennie 70, IRM au cours
de la décennie 80, imagerie fonctionnelle au cours de la décennie 90.
Neurologie diagnostique
Un réseau de contrôle
de traitement d’images
L’ ensemble des techniques permettant de par-
ticiper au diagnostic dans le cadre des disci-
plines neurologiques est devenu complètement
numérique.
Les différentes machines de neuroradiologie dia-
gnostique associent :
–la scanographie, récemment modernisée par la
rotation continue permettant les acquisitions en
mode spirale. Les scanographes sont particuliè-
rement utiles dans le cadre de l’urgence, mais
l’angio-CT apporte un renouveau concernant
l’étude des artères à destinée encéphalique dans
leur trajet cervical et dans l’étude de la vascula-
risation cérébrale ;
–l’imagerie par résonance magnétique : il est in-
utile de rappeler qu’il s’agit du progrès le
plus fondamental réalisé au cours des dernières
années. L’évolution future est encore extrême-
ment prometteuse aussi bien en morphologie,
qu’en fonctionnel. L’angio-MR est concurren-
tielle avec l’angio-CT ;
–l’angiographie numérisée : ces techniques de-
viennent de plus en plus indissociables de la
neuroradiologie interventionnelle. Les explora-
tions angiographiques purement diagnostiques
sont en partie remplacées par les techniques sca-
nographiques et IRM ;
–l’échographie Doppler : l’exploration des vais-
seaux dans leur trajet cervical et également
l’exploration Doppler transcrânienne sont des
outils indispensables.
D’autres techniques apportent des informations
beaucoup plus fonctionnelles que morpholo-
giques. Il s’agit de la tomographie à émission de
positons (PET), de la tomographie d’émission
de simples photons (SPECT) ou de la magnéto-
encéphalographie.
L’imagerie morphologique
La neuroradiologie est passée de l’imagerie
d’ombres (projection du faisceau de rayons X sur
un film ou sur un amplificateur de brillance) à
l’imagerie par coupes, dont les meilleurs repré-
sentants sont la scanographie et l’imagerie par
résonance magnétique.
Aujourd’hui, cette imagerie morphologique est
arrivée à un troisième stade, qui est l’imagerie vo-
lumique. En effet, tant en scanographie qu’en
IRM, il est possible d’acquérir la totalité de
l’information sur un volume comme la boîte
crânienne et son contenu. A partir de ces acqui-
sitions volumiques, il devient possible d’extraire
ce qui peut apporter des informations concer-
nant la prise en charge diagnostique ou théra-
peutique des patients. Extraire des hippocampes
pour pouvoir calculer leur volume exact, extraire
l’arbre artériel intracrânien pour rechercher une
pathologie anévrysmale, extraire une tumeur
pour mieux connaître ses rapports avec le pa-
renchyme cérébral... sont aujourd’hui des tech-
niques réalisables.
De plus, on peut prendre chacun des objets
que l’on souhaite (tumeur, arbre artériel, retour
veineux, encéphale...) et les regrouper pour réa-
liser des nouvelles images volumiques, les plus
informatives possibles. Cette imagerie virtuelle
peut aller jusqu’à la visualisation théorique de
©Garo/Phanie

voies d’abord chirurgical, ou de dosimétrie pour
la radiothérapie.
Enfin, la précision de ces techniques d’acquisi-
tion volumique atteint actuellement le milli-
mètre cube. On comprend que l’on puisse main-
tenant utiliser le scanner mais aussi l’IRM pour
les activités de stéréotaxie et en particulier les ac-
tivités de stéréotaxie fonctionnelle.
L’imagerie fonctionnelle
Cette imagerie existe depuis relativement long-
temps avec l’apparition des SPECT et des PET,
mais le recalage de ces données sur l’imagerie
morphologique a été difficile jusqu’à aujour-
d’hui. Ce problème de recalage est en train de
trouver sa solution et les prochaines années vont
inaugurer l’utilisation de l’imagerie fonction-
nelle en routine, en la superposant à l’imagerie
morphologique.
Parmi les différentes techniques d’imagerie fonc-
tionnelle, deux paraissent pouvoir être intro-
duites en routine dans un délai très court. Il
s’agit du SPECT et de l’IRM fonctionnelle.
De nombreuses discussions sont encore en cours
afin de connaître exactement la signification et la
valeur de ce que l’on observe, en particulier en
IRM fonctionnelle, par rapport aux activités de-
mandées aux patients. En effet, l’IRM fonction-
nelle, par exemple, mesure les variations locales
de débit sanguin. Peut-on rapporter directement
ces variations de débit à l’activité des neurones
sous-jacents ?
Deux autres techniques sont en évaluation. Il
s’agit d’abord de la magnéto-encéphalographie.
Quant à la tomographie à émission de positons,
elle reste encore lourde et coûteuse et est globa-
lement réservée à des centres de recherche.
Cependant, il faut se poser la question de la dif-
fusion de cette technique auprès des grands
centres regroupant les disciplines neurologiques.
L’imagerie fonctionnelle réalise aujourd’hui de
véritables cartographies d’activation du cerveau
et permet de repérer les aires de commande,
comme les aires sensorimotrices, les aires de lan-
gage ou, bien sûr, les aires sensitives comme les
aires visuelles. Actuellement, plusieurs centres
français utilisent ces techniques en routine, en
particulier en neurochirurgie, pour mieux éva-
luer les risques opératoires dans l’ablation d’un
certain nombre de tumeurs.
L’imagerie de diffusion et de perfusion
en IRM
Ces techniques très récentes permettent de me-
surer la vitesse des mouvements browniens de
l’eau au niveau du cerveau et, en pratique, per-
mettent le diagnostic, dès les premières minutes,
des accidents ischémiques artériels cérébraux.
Du fait de leur spécificité importante, ces tech-
niques sont très rapidement (en quelques mois)
devenues, pour certains centres, des méthodes
de diagnostic courantes dans la prise en charge
des accidents ischémiques cérébraux. En effet,
ces techniques permettent d’évaluer des élé-
ments pronostiques et même de pouvoir mieux
poser les indications de nouvelles thérapeu-
tiques, comme en particulier la thrombolyse
devant une obstruction artérielle.
L’intégration de ces techniques
Nous avons déjà évoqué le recalage et la fusion
des images provenant soit de techniques mor-
phologiques, soit de techniques fonctionnelles.
Cependant, il convient, dans le cadre de cette in-
tégration, de rappeler que de nombreux métiers
seront indispensables : les informaticiens, les
neurophysiologistes, les neurologues, les neuro-
chirurgiens, les anatomistes, et aussi, pourquoi
pas, les neuroradiologues...
De ce fait, les activités sur les stations de travail
permettant l’intégration de toutes ces données
deviennent une part majeure de la neuroradio-
logie diagnostique.
On imagine que des réseaux associant de nom-
breuses consoles intégreront l’ensemble de ces
données et permettront par des logiciels appro-
priés d’apporter de nouvelles réponses, y com-
pris en imagerie virtuelle.
C’est ainsi que l’on pourra imaginer (ceci est déjà
une réalité à Boston, Stanford et Zurich) de pou-
voir disposer rapidement de véritables possibili-
tés de contrôle peropératoire, comme dans le
cadre de l’IRM interventionnelle.
De plus, cette intégration permet d’améliorer la
prise en charge en termes de radiothérapie
19
●●●
©Burger/Phanie
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%