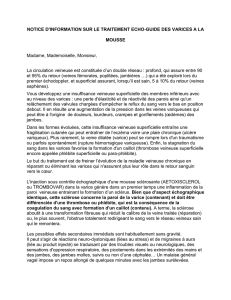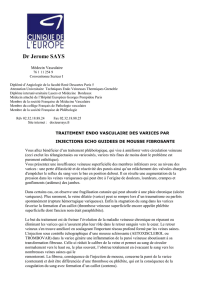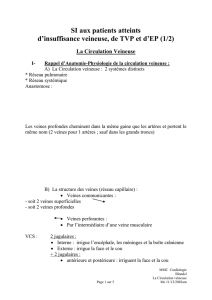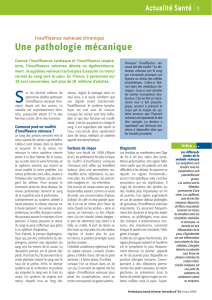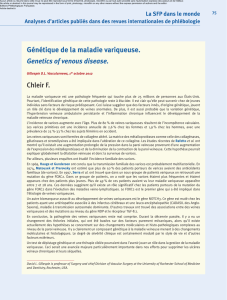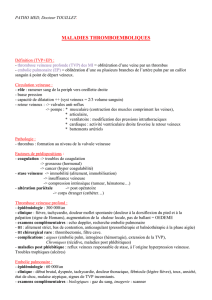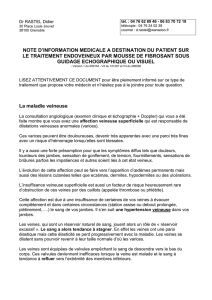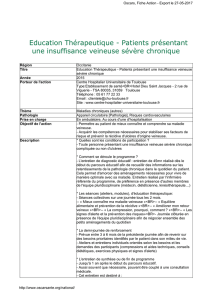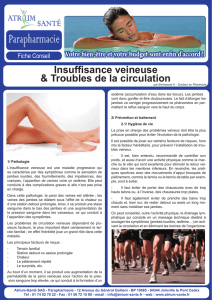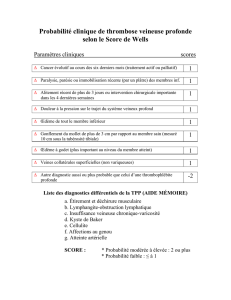Veines Infos - Institut Cellulite Aquagym

Lire page 6Lire page 7
a pathologie variqueuse est fréquente au niveau des membres
inférieurs. Si sa définition est uniciste : présence d’une dilatation
permanente des veines, en revanche, sa traduction clinique
diffère beaucoup en fonction des variantes anatomiques du système
veineux superficiel.
En effet, le système veineux des membres inférieurs ne se limite plus
aujourd’hui aux simples veines superficielles et profondes. Les grandes
veines saphènes (anciennement dénommées saphènes internes) et
petites veines saphènes (saphènes externes) sont considérées dans la
nouvelle nomenclature internationale comme des veines intermédiaires
situées dans le compartiment saphénien qui est composé d’un fascia
musculaire en dedans, et d’un fascia saphénien en dehors.
Les varices sont, quant à elles, de localisation superficielle, sus-fasciale.
Ce sont généralement des branches collatérales des troncs saphéniens
ayant traversé le feuillet superficiel du fascia. Elles sont localisées dans
l’hypoderme et/ou sous la peau. Ce sont les seules qui sont clinique-
ment visibles mais elles ne représentent que la partie apparente de l’ice-
berg, l’origine de la pathologie étant la partie immergée avec une source
de reflux sus-jacente. Ces différents réseaux communiquent entre eux
par l’intermédiaire de communicantes ou perforantes qui elles aussi peu-
vent devenir pathologiques et incontinentes.
Alors ne nous étonnons pas que la fréquence des récidives après chi-
rurgie des varices soit aussi importante dans la littérature internatio-
nale (30 à 50 % selon les études). Peut-être parce que la chirurgie des
varices se résumait jusque-là à la classique crossectomie associée à
l’éveinage sans bilan complémentaire préopératoire. Depuis les années
1990, l’exploration par écho-Doppler, d’abord appliquée au système
artériel, a été proposée pour l’évaluation anatomique des veines pro-
fondes et superficielles.
À l’heure actuelle, il n’est plus envisageable de traiter médicalement ou
chirurgicalement des varices des membres inférieurs sans établir un
bilan écho-Doppler avec cartographie du réseau variqueux. Les sur-
prises sont nombreuses car l’examen clinique, bien que nécessaire, est
insuffisant. Certaines varices de la face interne de la jambe sont ali-
mentées par une incontinence de la petite veine saphène alors que celles
de la face externe proviennent d’un reflux de la grande veine saphène.
Dans d’autres cas, les veines saphènes sont saines et continentes et
les varices sont secondaires à un reflux au niveau de perforantes incon-
tinentes, ou proviennent d’un réseau veineux inguinal ou pelvien.
Bref, chaque patient est différent. Retenons pour simplifier que le bilan
écho-Doppler est indispensable avant tout traitement de varices. Si l’on
veut réduire l’incidence des récidives après chirurgie, commençons par
réaliser un bilan complet et un traitement adapté avant d’accuser le
patient et la maladie en parlant de néogénèse.
Frédéric Vin
Rédacteur en chef
Veines InfosVeines Infos
Avril 2006
N°3
Veines Infos
1
N° 3 - avril 2006
L
édito
idèles à notre ligne éditoriale, nous vous proposons dans ce
3enuméro de Veines Infos de retrouver les aspects cliniques et
pratiques de la maladie veineuse chronique avec en particulier
les bénéfices de la gymnastique vasculaire active et la place de
l’écho-Doppler en pathologie veineuse. Quelques perspectives égale-
ment avec les actualités des récents congrès : l’avenir de la
chirurgie micro-invasive et l’émergence de la compression pneumatique
intermittente… et toujours de belles images avec notre rubrique du même
nom consacrée cette fois aux veines perforantes jumelles du mollet.
Alors bonne lecture, et n’hésitez pas à nous faire part de vos
remarques et réflexions.
Yves Nadjari
Directeur de la publication
F
sommaire
MISE AU POINT
Insuffisance veineuse :
les bénéfices de
la gymnastique
vasculaire active . . . 2
Philippe Blanchemaison
EN PRATIQUE
L’apport de l’écho-Doppler
dans la pathologie
veineuse . . . . . . . . . . 4
Franck Chleir
Maladie veineuse
chronique :
les signes cliniques
de sévérité . . . . . . . . 5
Jean-François Uhl
EN IMAGES
Dissection virtuelle
des veines perforantes
jumelles du mollet . . 6
Jean-François Uhl
ACTUALITÉS/CONGRÈS
De Paris à Miami :
les chemins
de la phlébologie
de demain . . . . . . . . . 7
Michèle Cazaubon
Insuffisance veineuse :
les bénéfices de la gymnastique
vasculaire active
Philippe Blanchemaison ■
Paris
Il est fréquent, en consultation de phlébologie, que les patientes sollicitent des
conseils à propos des activités physiques à pratiquer en cas d’insuffisance vei-
neuse. Le médecin phlébologue répond en conseillant les sports de fond, telles
la marche, la natation ou la bicyclette, et en déconseillant ceux pouvant entraî-
ner des à-coups de pression sur les valvules comme le squash, le tennis ou
l’haltérophilie. Mais nombreuses sont les femmes qui n’ont pas le goût, ou le
temps, de pratiquer une activité sportive régulière. De plus, lorsqu’elles appren-
nent que quarante-cinq minutes de natation brûlent moins de 200 calories, cela en
démotive plus d’une. Mais dans le domaine de l’insuffisance veineuse il ne faut pas raisonner en
calories mais en renforcement musculaire.
MISE AU POINT
Lire page 2
Il y a environ quarante ans, l’application de l’effet Doppler en
phlébologie débute par le Doppler continu. Dix ans plus tard,
grâce à l’échographie les veines sont visualisées. S’écoule alors
une décennie au terme de laquelle l’écho-Doppler (duplex) per-
met de coupler la morphologie et l’hémodynamique. Et dans les
années 1990, le son est plaqué en couleur sur les images écho-
graphiques. Dès le début, il ne s’agit pas d’une simple évolution
des pratiques médicales, mais d’une réelle révolution qui permet
pour la première fois de comprendre
in vivo
, sans interférence
avec le système circulatoire, la physiologie du retour veineux et
bien évidemment les mécanismes physiopathologiques de l’in-
suffisance veineuse.
L’apport
de l’écho-Doppler
dans la pathologie
veineuse
Franck Chleir ■
Neuilly
EN PRATIQUE
Lire page 4
Le premier trimestre de l’année est toujours trépidant
avec les Rencontres internationales d’angéiologie en
janvier et l’American Venous Forum en février. D’un
continent à l’ autre, les experts prennent toujours plai-
sir à se retrouver et continuent leurs discussions en
avançant progressivement dans la recherche d’une
meilleure compréhension et d’une meilleure prise en
charge des affections veineuses chroniques.
Maladie veineuse
chronique :
les signes cliniques
de sévérité
Jean-François Uhl ■
Paris
De Paris à Miami :
les chemins
de la phlébologie
de demain
Michèle Cazaubon ■
Paris
ACTUALITÉS/CONGRÈS
Les signes cliniques qui surviennent au cours de la maladie vei-
neuse chronique peuvent appartenir à deux catégories selon leur
sévérité :
- les signes de début, télangiectasies, veines réticulaires et varices,
qui sont ou non accompagnés de symptômes dits veineux ;
- les signes de décompensation tissulaire qui surviennent en géné-
ral après de nombreux mois d’évolution de la maladie et tradui-
sent une insuffisance veineuse chronique (maladie veineuse chro-
nique décompensée). Résultant de lésions organiques tissulaires
de la peau et du tissu cellulaire sous-cutané, il s’agit essentiel-
lement de l’œdème, des troubles trophiques cutanés et des
ulcères veineux.
édito
.
.

L
a gymnastique vasculaire
active s’adresse aux femmes
qui n’ont plus d’activité phy-
sique. Une gymnastique courte de
dix à quinze minutes peut leur per-
mettre de renforcer en priorité
leurs muscles posturaux, qui sont
les plus importants pour le retour
veineux. Si cette gymnastique ne
les transforme pas en athlète de
haut niveau, elle leur évitera la
fonte musculaire qui s’installe pro-
gressivement en plusieurs années
chez les femmes sédentaires, par-
ticipant à l’aggravation de l’insuf-
fisance veineuse chronique. Le lien
étroit entre les muscles et la cir-
culation veineuse des membres
inférieurs a été démontré au tra-
vers de différentes études dont les
résultats se résument en cinq
points.
Les muscles,
acteurs de
la circulation
veineuse
■ Il existe un lien entre le tonus
musculaire du mollet et le diamètre
des veines situées à l’intérieur de
ces muscles. Ceci a été démontré
par des études comparant l’ana-
lyse de la biopsie musculaire des
muscles jumeaux internes à la
mesure échographique du dia-
mètre des veines jumelles. Plus
récemment, ces résultats ont été
confirmés par des études menées
en milieu spatial. Tout se passe
comme si le muscle agissait
comme une contention naturelle
des veines profondes du mollet1-4.
■ Tous les muscles ne sont pas
égaux face au retour veineux. Les
groupes musculaires les plus effi-
caces pour assurer une bonne cir-
culation veineuse sont les muscles
posturaux, c’est-à-dire profonds,
de la jambe (soléaires), de la
cuisse (pectinés et adducteurs) et
du bassin (psoas-pyramidaux)5.
■ Certains mouvements sont plus
efficaces pour la circulation vei-
neuse que d’autres : il s’agit
d’exercices musculaires en résis-
tance, meilleurs pour les veines
que ceux en endurance ou en ciné-
tique, tels qu’ils sont pratiqués en
gymnastique dite « aérobique »6.
■ De la même manière, il faut pré-
férer les mouvements faisant inter-
venir les muscles agonistes et
antagonistes dans le même exer-
cice7. Par exemple, la bicyclette est
un sport de fond réputé excellent
pour la circulation veineuse8. Il ne
fait cependant travailler que les
muscles agonistes lorsque le pied
pousse sur la pédale, mais il n’y a
jamais de résistance quand la
pédale remonte. Cet exercice
pourrait être optimisé en utilisant
une bicyclette aquatique qui permet
d’agir simultanément sur les deux
groupes musculaires, agonistes et
antagonistes ayant un effet maxi-
mal sur le retour veineux.
■ Enfin, les mouvements amples
et complets sont préférables aux
mouvements rapides et d’ampli-
tude partielle comme ils peuvent
être parfois effectués sur une
musique en salle de gymnastique.
La souplesse des aponévroses
musculaires qui enveloppent les
muscles intervient dans la qualité
du drainage veineux depuis les
veines superficielles vers les
veines profondes9,10. La rétraction
des aponévroses postérieures de
la jambe qui peut s’établir pro-
gressivement avec l’âge entraîne
une traction sur l’ensemble des
veines perforantes de la jambe,
réduisant le débit du drainage vei-
neux de la superficie vers la pro-
fondeur. Les mouvements d’étire-
ment et d’assouplissement de ces
aponévroses, en particulier de la
chaîne postérieure de la jambe et
de la cuisse, tels qu’ils sont pro-
posés dans les séances de stret-
ching, contribuent à maintenir un
bon retour veineux.
Un fondement
physiopathologique
L’ensemble de ces constatations
nous a conduits à définir une véri-
table gymnastique vasculaire
active fondée sur les éléments
suivants :
- agir préférentiellement sur les
muscles posturaux, avec des exer-
cices en résistance faisant tra-
vailler en même temps les muscles
agonistes et antagonistes ;
- maintenir la souplesse des apo-
névroses par des étirements des
chaînes postérieures de la jambe,
de la cuisse et du bassin.
Les bases physiopathologiques de
cette gymnastique vasculaire ont
fait l’objet de plusieurs publica-
tions6-11.
Les trois principes
d’exécution
Tous les mouvements de la gym-
nastique vasculaire active doivent
être réalisés en respectant les trois
conditions suivantes :
- la conscience : avoir conscience
de chaque geste, conserver une
attention soutenue vis-à-vis des
détails pendant l’exécution des
mouvements, se représenter men-
talement l’action des muscles et
des aponévroses qui s’étirent ;
- la fluidité : les déplacements s’en-
chaînent avec aisance et liberté,
sans à-coup, les mouvements sont
doux et réguliers, et la respiration
est ample et profonde ;
- la tenue : se déplacer la tête
haute, comme tirée vers le haut
par un fil invisible, les épaules en
arrière et détendues, le torse
dégagé, le dos non voûté, le ventre
rentré, les fessiers toniques. Il faut
retrouver une bonne stabilité (liée
à la posture et aux muscles postu-
raux ainsi qu’à l’assise plantaire)
et un centrage abdominal du corps
(comme si le nombril était attiré
par la colonne vertébrale).
Ces trois principes, conscience,
fluidité et tenue, figurent déjà dans
l’ensemble des techniques de
maintien corporel qui ont résisté
au temps et aux modes : yoga, taï-
chi-chuan, méthodes Pilates (dont
le nom initial donné par Joseph
Pilates lui-même était « contro-
logy ») et Mézières. Les mouve-
ments effectués de façon rapide
et incomplète tels ceux proposés
dans l’aérobic gardent un carac-
tère ludique du fait de l’entraîne-
ment musical et de la stimulation
qu’elle génère, mais ne peuvent
prétendre aux mêmes objectifs.
Cette gymnastique peut être réa-
lisée au mieux en milieu aquatique
compte tenu de l’effet positif de
l’eau sur les tissus et de l’engoue-
ment actuel pour les thalassothé-
rapies et les spas.
La gymnastique
vasculaire
active en piscine
Adaptés à partir de la gymnastique
vasculaire activeet de l’aquadrai-
nage lymphatique, ces mouve-
ments sont effectués en milieu
aquatique. Il s’agit de stimuler en
priorité les muscles posturaux,
agonistes et antagonistes, en
résistance grâce à des mouve-
ments d’amplitude complète.
La stimulation du couple muscu-
laire psoas-pyramidaux est obte-
nue par un exercice en position
debout consistant à lever le genou
le plus haut possible contre résis-
tance. Au niveau de la cuisse, la
stimulation du couple pectiné-
adducteurs est obtenue par des
mouvements de rapprochement
contre résistance des deux genoux.
La stimulation du muscle soléaire
du mollet est obtenue en faisant
des mouvements de flexion-exten-
sion sur la pointe des pieds sur un
support permettant une suréléva-
tion de l’avant-pied par rapport au
talon. La stimulation de ces trois
groupes musculaires qui consti-
tuent les musculaires posturaux
principaux du bassin et des jambes
peut se faire sur une période de dix
à quinze minutes comprenant des
mouvements d’étirements. L’en-
semble de ces muscles peut éga-
lement être stimulé plusieurs
séances de bicyclette aquatique.
Neuf exercices de base ont été
sélectionnés en conservant le
meilleur des principes des gym-
nastiques Pilates et Mézières, et
de la gymnastique vasculaire
active. Ces neuf mouvements
(cf. page 3) permettent de renfor-
cer la chaîne posturale constituée
par les muscles psoas, adducteurs
et soléaires ainsi que la chaîne apo-
névrotique postérieure, en relation
avec l’aponévrose plantaire. Cha-
cun de ces mouvements doit être
réalisé de façon ample et com-
plète, avec une respiration pro-
fonde (expiration dans l’effort), et
le pied maintenu chaque fois que
possible en flexion dorsale.
Références bibliographiques
1. Blanchemaison P, et al. Relation entre veines
et muscles du mollet chez le sportif et chez le
sujet sédentaire. Ètude échographique et
conséquences physiopathologiques. Phlébo-
logie 1995;48,4: 435-40.
2. Stick C, et al. Measurements of volume
changes and venous pressure in the human
lower leg during walking and running. Appl Phy-
siol 1992;72:2063-8.
3. Guezennec Y, Louisy S. Modifications de la
compliance veineuse suivant le type d’entraî-
nement physique. Phlébologie 1995;48,4:463-4.
4. Neiwel PC, et al. Calf blood flow and pos-
ture : doppler ultrasound measurements during
and after exercice. J Appl Physiol. 1992;72:
1975-80.
5. Elbeze Y, et al. Ècho-doppler veineux au
repos et à l’effort chez le sportif de bon niveau.
Phlébologie 1995;48,4:445-50.
6. Blanchemaison P, Guell A. Angiologie et
espace. Angiologie 2003;55,2:64-7.
7. Chanvallon C. Les contraintes physiolo-
giques vasculaires périphériques générées par
divers types d’activité sportive. Phlébologie
1995;48,4:451-3.
8. Brunner U. Cyclisme et saphène externe.
Phlébologie 1995;48,4:469-72.
9. Lemaire R. La circulation de retour chez le
sportif. Phlébologie 1980;33:451-9.
10. Larroque P, Clement R, et al. Le syndrome
des loges des jambes. STV 1992;4:413-9.
11. Chauveau M. Hémodynamique veineuse et
exercice musculaire. Phlébologie 1995;48,4:
421-5.
Veines Infos
2
MEDIQUID, 122, rue d’Aguesseau,
92641 Boulogne-Billancourt Cedex
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques
et suggestions : [email protected]
Rédacteur en Chef
Frédéric Vin
Comité de rédaction
Philippe Blanchemaison,
Michel-René Boisseau,
Michèle Cabauzon,
Jean-François Uhl
Directeur de la publication
Yves Nadjari
Éditeur adjoint
Fabrice Nadjari
Directeur médical
Pascale Lefèvre
Secrétaire de rédaction
Virginie Laforest
N° 3 - avril 2006
Insuffisance veineuse :
les bénéfices de la gymnastique
vasculaire active
suite de la page 1
MISE AU POINT
Veines Infos
Bulletin
d’abonnement
Abonnement 1 an, 4 numéros : 18,40 €
Nom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Code postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Date et signature
MEDIQUID, 122, rue d’Aguesseau, 92641 Boulogne-Billancourt Cedex

Veines Infos
3
N° 3 - avril 2006
La gymnastique vasculaire active en piscine
1/ Échauffements. Position de départ :
debout dans l’eau, les mains derrière la tête et les
coudes écartés. Mouvement : lever les genoux
et les faire toucher le coude du même côté, en
expirant pendant la flexion. 30 mouvements en
alternant droite et gauche.
7/ Étirement des fascias cruraux postérieurs. Position de départ : debout
face au bord de la piscine, mains à plat sur le bord. Mouvement : un pied à terre et un
pied à plat contre le mur, le genou plié et les mains sur le bord de la piscine, les bras ten-
dus. Pousser progressivement sur le mur avec le pied en expirant jusqu’à déplier com-
plètement la jambe. 5 séries sur chaque jambe.
8/ Étirement des fascias cruraux anté-
rieurs. Position de départ : debout en équi-
libre sur une jambe. L’autre jambe maintenue en
arrière dans les deux mains. Mouvement : éti-
rer la jambe vers l’arrière en expirant. 5 séries
sur chaque jambe.
9/ Étirement des fascias jambiers.
Position de départ : debout, dos contre le bord
de la piscine. Mouvement : les deux pieds en
flexion dorsale, marcher sur les talons en gardant
les jambes tendues et le dos droit. Effectuer un
aller et retour complet dans la piscine.
2/ Travail des muscles psoas. Position de départ : debout, mains sur les hanches. Mouvement : lever le genou jusqu’à la taille, puis
allonger la jambe en la maintenant à l’horizontale, parallèle à la surface de l’eau, le pied en flexion dorsale. Puis, tout en maintenant la jambe
tendue et le pied en flexion, toucher le sol avec le talon. 30 mouvements de chaque côté en alternance.
3/ Travail des muscles adducteurs.
Position de départ : debout en équilibre sur un pied, une main sur les hanches, l’autre main tenant le bord de la piscine. Mouvement : éloigner une jambe de l’axe du corps sur le côté en gar-
dant le pied en flexion dorsale et la ramener contre la résistance de l’eau. 30 séries de chaque côté. Si l’on possède des rondins en mousse d’environ un mètre de longueur, les adducteurs peuvent
être travaillés en mettant un rondin sous chaque bras et en faisant des mouvements d’écartement et de rapprochement des jambes (expirer dans l’effort), en gardant les pieds en flexion dorsale
(schéma 3 bis). Une vingtaine de mouvements sont suffisants pour renforcer les muscles adducteurs et les abdominaux.
5/ Travail des muscles fessiers. Position de départ : debout
face au bord de la piscine, les mains sur le bord. Se pencher en avant avec
les bras tendus à la surface, les mains posées à plat sur le bord de la pis-
cine. Mouvement : ramener le genou sous le ventre en expirant, puis
allonger la jambe derrière soi, sans la sortir de l’eau et sans cambrer les
lombaires. 20 séries de chaque jambe. Ces mouvements insistent parti-
culièrement sur les muscles petits fessiers qui agissent sur la hauteur de
la fesse. Pour agir sur le galbe de la hanche, c’est-à-dire sur le grand fes-
sier, un autre exercice peut être proposé. Position de départ : debout
face au bord de la piscine. Mouvement : lever le genou devant soi, puis
l’écarter sur le côté, et enfin tendre la jambe en arrière.
6/ Étirement des fascias dorso-lombaires.
Position de départ : debout face au bord de la
piscine, les deux mains posées sur les bords.
Mouvement : faire le dos rond, puis en gar-
dant les jambes légèrement fléchies, reculer pro-
gressivement les jambes en arrière en gardant les
épaules souples. Expirer progressivement au fur
et à mesure du mouvement. Cinq séries.
4/ Travail des
muscles soléaires
Position de départ :
debout dans l’eau, face
au bord de la piscine,
les mains reposant sur
les bords, et la pointe
des pieds sur une
marche de step.
Mouvement : monter
sur la pointe du pied, un
pied après l’autre, et
descendre avec le talon
plus bas que l’avant
du pied. 30 séries sur
chaque pied.
En l’absence de marche
de step, ce mouvement
peut être réalisé de la
même façon à plat sur
le sol de la piscine.
Il s’agit de se mettre sur la pointe des pieds, puis de revenir le pied à
plat sur le sol, et de réaliser une flexion dorsale du pied en se main-
tenant en équilibre sur les talons.

A
ujourd’hui, l’écho-Doppler
est devenu un outil indis-
pensable pour affirmer ou
confirmer l’insuffisance veineuse
et pour élaborer une stratégie thé-
rapeutique dans une collaboration
médico-chirugicale. Il intervient
directement, et ce de plus en plus
souvent dans le geste thérapeu-
tique lui-même. C’est également
devenu un instrument incontour-
nable pour contrôler et évaluer les
traitements. Voyons l’intérêt qu’il
présente et la place exacte qu’il
occupe dans l’exploration et la
prise en charge des maladies
veineuses.
Principes
de la technique
échographique
et du Doppler
L’échographie, comme le Doppler,
est une application médicale des
ultrasons. L’échographie crée une
image anatomique des tissus tra-
versés en fonction de la quantité
d’ultrasons absorbés et du temps
de retour par rapport au moment
de l’émission. Le Doppler permet
d’étudier une variation de vitesse
en analysant une variation de fré-
quence, celle-ci est fonction de la
fréquence d’émission, de la vitesse
du mobile (le sang) et de l’angle
que forme la sonde avec le mobile
étudié. On constate que l’écho-
graphie autorise une étude mor-
phologique alors que le Doppler
fait une analyse hémodynamique.
La principale limite du Doppler
(continu) est qu’il travaille en
« aveugle », c’est-à-dire qu’en cas
de superposition de vaisseaux on
ne connaît pas avec certitude le
vaisseau qui est analysé. L’amélio-
ration du traitement informatique
a permis de « coupler » le Doppler
avec l’échographie et de former
l’écho-Doppler ou « duplex-scan »
pour les Anglo-Saxons. L’amélio-
ration des performances des
microprocesseurs et de la qualité
des logiciels a donné naissance à
une nouvelle évolution technolo-
gique : l’échographie à codage cou-
leur. Le principe repose sur l’ana-
lyse de chaque pixel et la trans-
formation de la vitesse du sang sur
un pixel en une couleur, plus ou
moins vive en fonction de la vélo-
cité, soit bleue soit rouge selon que
le sang se dirige vers la sonde ou
s’en éloigne.
Pratique
de l’examen
en pathologie
veineuse
des membres
inférieurs
Il faut distinguer deux phases à
l’examen du système veineux des
membres inférieurs : tout d’abord,
l’examen du système veineux pro-
fond, puis celui du système veineux
superficiel.
- L’examen du système veineux
profond se fait le patient allongé
en décubitus dorsal légèrement
assis afin d’assurer un meilleur
remplissage des veines profondes.
On utilise pour commencer une
sonde de 3,5 MHz. Cet examen ne
peut être fait qu’avec un appareil
duplex ou mieux couleur, l’indéter-
mination spatiale du Doppler seul
exposant soit à un diagnostic de
thrombose veineuse profonde par
excès (faux positif), soit inverse-
ment à une absence de diagnostic
d’une importante thrombose (faux
négatif par enregistrement d’une
collatérale que l’on pense être la
veine principale) avec toutes les
conséquences médico-légales que
cela implique. La veine cave infé-
rieure est examinée en premier,
suivie des iliaques, des fémorales
communes et superficielles, des
poplitées, et enfin des veines jam-
bières (tibiales postérieures et
péronières) ainsi que des veines
musculaires (soléaires, jumelles
internes et externes). Il faut tout
d’abord rechercher l’existence
d’une thrombose. On évalue dans
un premier temps la vacuité de la
lumière veineuse en échographie
à codage couleur où il existe un
bon remplissage ; puis en mode
duplex on retrouve une bonne
modulation respiratoire ; et enfin
en vérifiant la compressibilité de la
veine sous la sonde (la veine est
normalement complètement com-
pressible contrairement à l’artère).
On recherche également un épais-
sissement de la paroi ou la pré-
sence de synéchies pouvant témoi-
gner de séquelles de thrombose
veineuse profonde. Dans un
deuxième temps, on pratique des
manœuvres de compression afin
de faire une analyse hémodyna-
mique qui recherche un frein cir-
culatoire (syndrome obstructif) ou
bien un reflux (syndrome de déval-
vulation). Afin d’améliorer le rem-
plissage et donc la visualisation
des veines jambières, et après
avoir éliminé préalablement une
thrombose profonde, on peut alors
faire asseoir le patient au bord du
lit, jambes pendantes.
- L’examen du système veineux
superficiel se pratique préféren-
tiellement debout. Si la clinique l’in-
dique, on recherche une thrombose
veineuse superficielle avec la
même méthode que pour le sys-
tème profond (vacuité, compressi-
bilité, flux modulé), puis on s’attache
à rechercher un reflux significatif
(supérieur à une seconde) au niveau
des grandes et petites veines
saphènes ainsi que de leurs col-
latérales. Sont également notés le
calibre des axes saphéniens et la
nature de leur terminaison (unique
ou multiple, haute ou basse). Il faut
vérifier l’origine haute du reflux et
rechercher s’il s’agit d’une incom-
pétence de la valvule ostiale (der-
nière valvule) ou de la valvule pré-
terminale (avant-dernière valvule).
On s’attache à préciser le statut
particulier de la saphène anté-
rieure et ses rapports anato-
miques et hémodynamiques avec
la grande veine saphène. Il faut
explorer les collatérales inconti-
nentes. Par un examen minutieux,
on s’attachera à rechercher des
perforantes pathologiques, on pré-
cisera leur calibre et l’on notera
leur hauteur par rapport au sol
pour les perforantes jambières et
par rapport au pli du genou pour
les perforantes de cuisse. Au
décours de l’examen, il faudra faire
soit un schéma, afin de préciser
l’extension de la thrombose, soit
une cartographie veineuse, afin
de visualiser clairement les veines
incontinentes du système super-
ficiel.
Indications
de l’écho-Doppler
veineux
Au niveau du réseau pro-
fond, il s’agit dans l’immense
majorité des cas d’une recherche
de thrombose veineuse profonde
(photo 1). Il existe un algorithme
parfaitement clair qui définit la
place de l’écho-Doppler en fonc-
tion des données anamnestiques,
cliniques, et du résultat des
D-dimères. En dehors de la
thrombose profonde, l’examen du
réseau profond est fait systéma-
tiquement dans le cadre du bilan
d’insuffisance veineuse superfi-
cielle, à la recherche de séquelles
de thrombose veineuse profonde
(prouvée ou non), lorsqu’il existe
la notion d’œdème transitoire,
répétitif du membre inférieur
gauche (syndrome de May-Thur-
ner), devant un œdème uni- ou
bilatéral, des troubles trophiques
disproportionnés par rapport à l’in-
suffisance veineuse superficielle
ainsi que des varices sus-
pubiennes.
Concernant le réseau super-
ficiel, la première indication est
l’insuffisance veineuse superfi-
cielle primitive (photo 2). Il faut
dans tous les cas que l’examen
soit accompagné d’une cartogra-
phie veineuse superficielle pour
évaluer l’évolution de la maladie
variqueuse, pour quantifier le
bénéfice des traitements et pour
discuter d’une véritable stratégie
thérapeutique médico-chirurgicale.
L’écho-Doppler veineux doit évi-
demment être demandé en cas de
varices volumineuses mais égale-
ment lorsqu’il existe des varicosi-
tés, car celles-ci sont bien souvent
alimentées par le reflux d’un tronc
non visible et non palpable clini-
quement, et également en pré-
sence de symptômes de maladie
veineuse (œdèmes, lourdeurs,
douleurs de jambes, impatiences)
surtout lorsqu’ils apparaissent ou
sont majorés en été, à la chaleur,
en position debout ou varient avec
le cycle. Cet examen sert de docu-
ment de référence pour évaluer la
progression de la maladie veineuse
pour juger de l’impact des facteurs
environnementaux (grossesses,
traitements hormonaux, activités
sportives ou professionnelles), et
de l’amélioration en fonction des
différents traitements.
L’écho-marquage consiste à mar-
quer sur la peau, au feutre, les
veines à traiter. Le marquage se
fait grâce à un bon examen cli-
nique associé à un écho-Doppler
dans le cadre d’une stratégie thé-
rapeutique définie au préalable.
L’écho-marquage est réalisé avant
toute chirurgie (stripping, cros-
sectomie, phlébectomies), tout
geste endoveineux (Closure, laser
endoveineux) et peut également
se pratiquer avant échosclérose
(photo 3).
L’intérêt de l’écho-Doppler dans la
pathologie veineuse est unanime-
ment reconnu et désormais incon-
testable. Lors d’une thrombose
veineuse profonde, il est devenu
la pierre angulaire du diagnostic
positif et entre dans le cadre d’un
arbre décisionnel clairement défini.
Lors d’une thrombose veineuse
superficielle, il constitue un exa-
men essentiel qui permet de pré-
ciser le niveau supérieur du
thrombus, alors que la clinique
est souvent frustre. Mais surtout
toutes les études montrent
l’association fréquente (environ
30 %) avec les thromboses pro-
fondes imposant la réalisation d’un
écho-Doppler.
En ce qui concerne l’insuffisance
veineuse superficielle, l’écho-Dop-
pler est indispensable avant de
définir une stratégie thérapeutique
face à des varices, des troubles
trophiques ou un œdème. Il est
souvent utile en présence de
symptômes de maladie veineuse,
permettant alors la découverte
précoce d’une insuffisance saphé-
nienne qui, prise en charge à ses
début, n’évoluera pas vers une
varicose majeure. L’écho-marquage
est réservé au prétraitement
immédiat (24 heures avant le
geste), il permet de traiter plus
précisément les veines malades et
de préserver autant que possible
le capital veineux sain.
Veines Infos
4
N° 3 - avril 2006
L’apport
de l’écho-Doppler
dans la pathologie
veineuse
suite de la page 1
Photo 1. Écho-Doppler couleur : thrombose veineuse
profonde
Photo 2.
Varicose
diffuse
Photo 3.
Échomarquage
préopératoire
EN PRATIQUE

Veines Infos
5
N° 3 - avril 2006
U
n consensus international
d’experts réunis à Rome en
2001 sur une initiative fran-
çaise1a permis de mieux redéfi-
nir ces signes cliniques et ainsi
d’harmoniser le langage phlébolo-
gique commun à tous (voir enca-
dré). Voyons au travers de deux
tableaux cliniques l’aspect des
principaux troubles trophiques en
dehors de l’ulcère.
La triade
pigmentation,
œdème veineux
et hypodermite
inflammatoire
Madame V., 59 ans, nullipare aux
antécédents familiaux variqueux,
présente une surcharge pondérale
(IMC = 26 ) et des troubles de la
statique du pied. L’examen clinique
relève la présence de troubles tro-
phiques sévères du membre infé-
rieur gauche (figure 1) associant
un œdème veineux net à une pig-
mentation cutanée et à un placard
de lipodermatosclérose compliqué
d’hypodermite inflammatoire (zone
rouge et douloureuse située à la
partie basse de jambe). La carto-
graphie veineuse (voir écho-mar-
quage, figure 2A) montre une vari-
cose de la grande veine saphène
gauche avec incontinence majeure
ostiotronculaire. Le tronc mesure
7 à 8 mm de diamètre. On note
d’importantes dilatations vari-
queuses gonales et jambières ali-
mentées par le reflux saphénien
ainsi qu’une perforante (P) de
tibiale postérieure (Cockett)
située en arrière de la zone d’hy-
podermite inflammatoire (H). Le
duplex de la jonction saphéno-
fémorale (figure 3A) montre un
segment intervalvulaire de 28 mm.
L’ostium mesure 10 mm.
La prise en charge thérapeutique
adoptée associe :
- un laser endoveineux du tronc
saphène (tir continu à 40 joules/cm
sur 38 cm) ;
- une sclérothérapie à la mousse
des réseaux variqueux sous-
gonaux (25 cc de mousse de poli-
docanol à 0,5 %). La mousse est
introduite en peropératoire sous
contrôle échographique, et injec-
tée par canulation rétrograde
directe du tronc saphénien. Des
massages facilitent sa progression
jusqu’à la distalité du membre dans
les ectasies variqueuses.
L’utilisation de la sclérothérapie à
la mousse associée à la chirurgie2
est une technique intéressante qui
permet souvent de simplifier le
geste en évitant des complica-
tions : ici, les risques de complica-
tions cutanées des phlébectomies
liées aux troubles trophiques
sévères et à l’œdème. Le contrôle
écho-Doppler visualise à J6 un
thrombus (T) du segment interval-
vulaire traité par HBPM pendant
quinze jours (figures 3 B et C). Le
contrôle clinique à J14 montre
une diminution de l’œdème et de
l’hypodermite sous compression
de 40 mmHg associée (figure 2 B).
Figure 1.
Troubles
trophiques
sévères
Figure 2. A : Echomarquage ; B : Contrôle clinique à J14
H : zone d’hypodermite ; P : perforante de Cockett
Maladie veineuse
chronique : les signes
cliniques de sévérité
suite de la page 1
EN PRATIQUE
A B
Œdème veineux : augmentation permanente du volume du fluide intersticiel sous-cutané du membre,
caractérisé par le signe du godet. Cette définition ne comprend que l’œdème d’origine veineuse. L’œ-
dème veineux siège habituellement à la cheville, mais peut s’étendre à la jambe et au pied.
Pigmentation : pigmentation brunâtre de la peau habituellement localisée dans la région de la cheville,
mais pouvant s’étendre à la jambe et au pied. Il s’agit d’un trouble trophique cutané précoce.
Eczéma : éruption cutanée érythémato-squameuse, suintante ou phlycténoïde du membre.
Elle siège souvent au voisinage des veines variqueuses, mais peut siéger n’importe où sur la jambe. Par-
fois, elle s’étend à tout le corps. Ceci est habituellement dû à une maladie veineuse chronique et/ou à
une allergie cutanée secondaire à un traitement local.
Synonyme : dermite.
Lipodermatosclérose : induration cutanée persistante et localisée du membre inférieur, parfois asso-
ciée à une fibrose rétractile. C’est un signe de maladie veineuse sévère, caractérisée par une fibrose et
une inflammation chronique de la peau, et parfois du fascia sous-cutané.
Hypodermite : forme aiguë de la lipodermatosclérose en rapport avec une hypodermite. Elle se carac-
térise par un érythème cutané diffus dû à un processus inflammatoire aigu avec fragilité de la peau.
L’absence de lymphangite et de fièvre la différencie de l’érysipèle ou de la cellulite aiguë.
Atrophie blanche : zone d’atrophie cutanée blanchâtre, circonscrite et souvent circulaire, entourée
de taches de stase par dilatation capillaire et parfois d’hyperpigmentation.
C’est un signe de maladie veineuse sévère. Sont exclues de cette définition les cicatrices d’ulcères.
Ulcère veineux : perte de substance cutanée durable survenant sur une peau fragilisée par les
troubles trophiques secondaires à la MVC, qui ne cicatrise pas spontanément.
Corona phlebectatica : télangiectasies en forme d’éventail siégeant sur les faces médiales et ou laté-
rales du pied. Signent parfois le début d’une maladie veineuse évoluée. La place de la Corona dans la
classification clinique CEAP reste controversée. La Corona peut survenir chez des patients ayant des
télangiectasies dans n’importe quelle localisation au niveau du membre. Elle peut également être le témoin
d’une maladie veineuse plus sévère.
Synonyme : couronne phlébectasique paraplantaire (de Van der Molen).
Définitions cliniques élaborées
lors du congrès mondial de Rome (UIP 2001)
Figure 3. Contrôle écho-Doppler :
thrombose du segment intervalvulaire
Col : collatérale ; GS : grande saphène ; T :
thrombus ; VF : veine fémorale
 6
6
 7
7
 8
8
1
/
8
100%