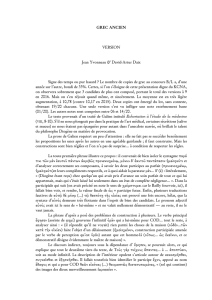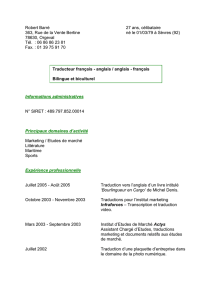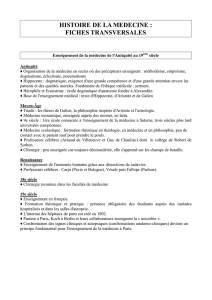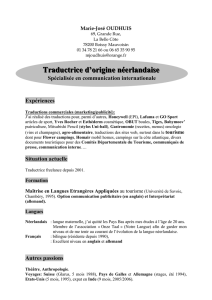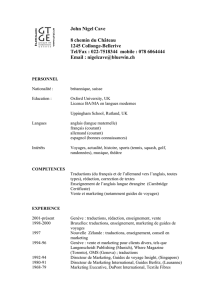vita

HISTOIRE
ιστορία
medicus
vita
ιστορία
vita
32 | La Lettre du Cardiologue • n° 457 - septembre 2012
Naissance de la clinique
à l’ombre de la scolastique
(1re partie)
Philippe Abastado*, Denis Chemla**
1 “Ceux qui s’unissent pour se consa-
crer à une tâche unique, bien déter-
minée, forment une université” ;
explication étymologique du terme
“universitas” donnée par Heinrich
Schmidinger.
* Cardiologue libéral, directeur de
recherche épistémologie appliquée,
CRPMS Paris-VII, Paris.
** EA4533, faculté de médecine Paris-
Sud-XI, AP-HP, Paris.
Universitas dicta est ab universo et universum dicitur quasi unum versum1.
M
ichel Foucault, dans son très célèbre
Naissance de la clinique, fait naître cette
dernière avec le siècle. Mais en épis-
témologie, il n’est pas de naissance. Si des publica-
tions, des découvertes, peuvent servir de repères,
l’évolution des modes de penser s’inscrivent dans
la longue durée. Ainsi, la clinique – la pratique du
soin réfléchie à l’échelon de l’individu –, survient à la
charnière du Moyen Âge et de la Renaissance, alors
que le paradigme dominant est celui de la scolas-
tique, pratique purement intellectuelle spéculant
sur un savoir théorique.
Le paradigme scolastique
La scolastique est caricaturée comme joute entre
2 élèves d’Esculape, et Molière retient de la médecine
de ces temps (celle du ou du siècle), ces
seuls jeux. Elle est d’abord une tentative de l’Église
de résoudre une contradiction apparente : concilier
la foi, qui suppose une révélation divine, et la raison,
représentée par la philosophie gréco-latine. Elle est
le produit des universités naissantes, et si le terme
“scolastique” signifie simplement “scolaire” en fran-
çais moderne, par référence à l’enseignement des
écoles des cathédrales, la scolastique marque une
prise de distance du corps enseignant de la hiérarchie
religieuse.
La médecine universitaire naissante rejette la
démarche empirique de la médecine du haut Moyen
Âge, qu’elle perçoit comme aveugle. Le renouvelle-
ment intellectuel reste longtemps axé par la décou-
verte de nouveaux textes, de traductions nouvelles.
Durant cette longue période, les commentaires des
textes ne relèvent pas d’un exercice littéraire, mais
appartiennent à ce que l’on qualifierait aujourd’hui
de travail original, appropriation et discussion d’un
savoir. Curieusement, chez un même auteur, certains
textes sont exploités, d’autres restent ignorés.
La place occupée par les traductions mériterait
d’être réévaluée. La période féconde s’étend du
au siècle, de Constantin l’Africain et Gérard de
Crémone à Arnaud de Villeneuve. La recherche de
l’œuvre authentique de Galien constitue la trame
de ces travaux successifs, à côté de traductions des
auteurs arabes (Avicenne, Rhazès, Averroès, etc.).
Au-delà du siècle, l’arabe n’est plus traduit.
Ces traductions vont se diffuser jusqu’au milieu du
siècle ; à la fin du siècle, l’ère des traductions
est achevée depuis longtemps.
L’on convient − et je conviendrai − du rôle important
des traductions. Néanmoins, des réserves doivent
être apportées.
Produit de l’Université, la scolastique s’exprime tout
d’abord dans l’enseignement. Le programme des
cours n’est pas fixé par un sujet, mais par une liste
de textes. Après la lectio – explication littérale –,
vient la quaestio – analyse sémantique –, et enfin
la disputatio – confrontation entre le maître et les
élèves, juxtaposition des textes de divers auteurs ou
de différentes traductions. Ceux qui se rapportent
aux mêmes idées sont regroupés en concordantiae.
Ainsi apparaissent avant l’heure ce que l’on appel-
lerait aujourd’hui des séances de consensus sous la
forme de conciliatiores controversiarum qui cherchent
à écarter les contradictions, réelles ou apparentes,
entre les auteurs. Ces exercices permettent de
révéler des contradictions, mais ils ne parviennent
pas encore à confronter la lecture au réel ; c’est le
chemin inverse qui se produit avec, dans l’examen
du réel, la volonté de retrouver les grands principes
théoriques. Par ailleurs, la fragmentation des sujets
ne permet pas de constituer une vue d’ensemble. La
scolastique apparaît ainsi essentiellement comme
une méthodologie du savoir.
Deux matières, pour user des termes d’aujourd’hui,
dominent : Galien et Aristote.
Aristote arrive dans le sillage d’Avicenne et prend
une place majeure. Tout d’abord, au seuil des études

HISTOIRE
La Lettre du Cardiologue • n° 457 - septembre 2012 | 33
de médecine, les étudiants commencent leur cursus
avec les arts libéraux, où Aristote règne en maître.
À la faculté des arts, ils apprennent le plus important
des 7 arts, la dialectique. À l’âge de 20 ans, ils arrivent
à la faculté de médecine avec un appareil intellectuel
d’influence aristotélicienne qui leur servira pour se
frotter aux textes médicaux. Par ailleurs, un désac-
cord entre Galien et Aristote permet aux médecins
de se définir dans leur discipline. Pour le premier, il
ne peut y avoir de vérité que la philosophie naturelle,
pour le second, l’action thérapeutique doit guider les
choix théoriques. Aristote place ainsi la médecine
dans la technè (ars en latin), qui appartient au faire,
et non dans l’epistémê qui relève du jugement des
choses universelles et nécessaires.
Son influence est prédominante dans ce que l’on
appellerait aujourd’hui la biologie. Un premier
pan, qui relève de la physique et du fonctionne-
ment mécanique du corps humain, bénéficie d’un
consensus. Vient ensuite l’aspect, qui mêle anatomie
et physiologie. Le système aristotélicien est cardio-
centrique : le cœur, organe central, est la source de
chaleur et de vie, il gouverne les sensations comme
les mouvements. Cette conception diverge de celle
de Galien qui propose ce rang à 3 organes : le cœur,
mais aussi le cerveau et le foie ; ses élèves y ajoutent
parfois les testicules. Enfin, un troisième niveau de
l’œuvre relève de la méthodologie de l’investiga-
tion scientifique et se retrouve dans ses Seconds
analytiques et dans sa Métaphysique. Il est curieux
de constater que l’exploitation de cette œuvre est
très hétérogène : commentaires et traductions de
certaines parties, ignorance de certaines autres.
Dans ce débat entre Galien et Aristote, Avicenne
joue les conciliateurs. Pour lui, le praticien n’a pas
à se préoccuper des causes premières sur lesquelles
il ne peut agir. La discussion perd ainsi tout son sel.
La même mise en perspective l’amène également
à tempérer la place de l’astrologie : véritable outil
chez Galien (Des jours critiques), mais objet de fortes
réserves chez lui.
L’influence arabe mérite d’être discutée. Les traduc-
tions, je l’ai rappelé, jouent un rôle important. Leur
rôle majeur me semble épistémologique, avec
l’influence prolongée et capitale du Canon d’Avi-
cenne, qui fait son entrée dans les programmes
des facultés de Montpellier, Paris et Bologne entre
1270 et 1320. Les statuts de la faculté de Bologne
de 1405 prévoient un enseignement directement
lié à son Canon. Ce dernier attribue à chaque partie
de la médecine un statut de science qu’il scinde en
scienta scientalis – la connaissance des principes –,
et en scientia operative – la connaissance de ce que
l’on a à faire. Mais cette séparation, absente chez
Galien, ne résiste pas à la réalité pratique quoti-
dienne et au siècle, le monde universitaire refuse
d’isoler une science purement spéculative et légi-
time progressivement toute science médicale par
sa finalité opérative. Surtout, le concept de “canon”
est capital pour l’avenir de la médecine. L’auteur
s’impose d’élaborer une œuvre qui englobe toute
la médecine. La tâche exige de créer un ensemble
cohérent, logique, et suppose une vue d’ensemble
et non une juxtaposition de principes.
À cette période où les pensées d’Aristote et d’Avi-
cenne s’installent, la scolastique conquiert le monde
médical. Mais à chaque fois qu’un paradigme devient
dominant, le militantisme de ses acteurs les conduit
à pousser le trait et quelques esprits critiques
réagissent. Le franciscain d’Oxford Roger Bacon (vers
1214-1294) stigmatise déjà des erreurs du monde de
la médecine dans De erroribus medicorum. Il critique
l’ignorance des médecins dans les constituants des
médicaments, leur mépris de l’alchimie, de l’astro-
nomie, et de tout ce qui n’est pas latin. Surtout, il
fait plusieurs séjours à Paris et rapporte que “la foule
des médecins s’adonne aux disputes de questions
infinies et d’arguments inutiles ; ils ne recourent pas
comme il conviendrait à l’expérience. Il y a 30 ans,
ils recouraient à l’expérience qui seule certifie, mais
désormais ils multiplient les questions accidentelles
infinies, les arguments dialectiques et sophistiques
encore plus infinis en se fondant sur l’art des Topiques
et des Réfutations sophistiques (Sophistici Elenchi),
à tel point qu’ils cherchent toujours la vérité sans
jamais la trouver. En effet, la découverte (inventio) se
fait grâce au sens de l’expérience et de la mémoire,
surtout dans les sciences pratiques auxquelles la
médecine appartient.” Mais, à l’époque, la notion
d’expérience relève de la métaphysique d’Aristote :
l’expérience vient de la multiplicité des souvenirs
d’une même chose. Le premier aphorisme d’Hippo-
crate la qualifie de “trompeuse” ou de “dangereuse”,
selon les traductions. Cependant, si elle peut s’appli-
quer aux premiers essais pharmacologiques, il faut
reconnaître à Galien 2 constatations que les prati-
ciens modernes de l’éthique pourraient revendiquer :
l’expérimentation ne peut s’appliquer à l’humain
comme aux objets en raison du risque encouru, et
l’interprétation de l’expérience est difficile, car l’effet
exact de la cause ne peut être isolé avec certitude.
Les problématiques ainsi soulevées sont modernes :
la notion de temps écoulé ainsi que la variabilité
infinie des poids et des mesures sont d’abord sujets
d’une glose galénique avant de devenir l’objet d’une
discussion pratique.

HISTOIRE
34 | La Lettre du Cardiologue • n° 457 - septembre 2012
Une organisation matérielle
qui modifie la perspective
La puissance normative de la scolastique, dès le
haut Moyen Âge, occulte la place de la pratique.
Cette dernière est importante et conceptualisée,
une partition entre la pratique et la théorie pouvant
être attribuée à l’influence de la médecine d’Alexan-
drie. Les 3 divisions de la philosophie selon Aristote
– théorétique, pratique et poétique –, conduisent à
diviser la médecine entre les 2 premières parties et
à donner un but purement spéculatif à la physique
et aux théories médicales. La découverte des textes
grecs, les discussions qu’ils soulèvent avec la critique
des traductions, l’influence des auteurs arabes ont
comme premier effet de hisser la médecine, qu’elle
soit comprise comme un art ou comme une science,
à une discipline intellectuelle, que ce soit compris
comme un art ou comme une science. L’enjeu sous-
jacent de cette question récurrente réside dans les
rôles respectifs de la pratique ou de la raison, une
discussion entamée dès l’Antiquité qui sous-tend
l’enseignement médical du siècle à la Renais-
sance et que la scolastique n’élude pas. Ainsi, le De
ingenio sanitatis de Galien traite du passage de la
réflexion à l’action, et plus généralement du savoir
collectif au savoir particulier. Bien qu’il ait été écrit
en grec par Galien, Gérard de Crémone le traduit en
latin à partir de l’arabe. Cet ouvrage fait référence
pendant plusieurs siècles.
La place officielle de l’enseignement pratique varie
selon l’université. Montpellier (comme Bologne),
sous l’influence d’une puissante université de droit,
aurait une orientation plus professionnelle que Paris,
“soumis à l’empire de la théologie”. Cette réputation
d’enseignement plus intellectuel est contredite dans
les faits. Des documents administratifs, des souvenirs
d’étudiants – tel le recueil, par un étudiant allemand,
des consultations de maître Guillaume Boucher à
la fin du siècle − plaident pour une formation
parisienne plus pragmatique qu’intellectuelle. Les
mêmes facultés de droit semblent également déter-
minantes pour la diffusion de la dissection. Aucun
texte n’interdit cette pratique, les poursuites judi-
ciaires connues répondent à des violations de sépul-
ture ou à des vols de cadavre. Galien disséquait, puis
la pratique disparaît et sa résurgence reste d’abord
discrète. Les séances publiques qui se tiennent à
Bologne à la fin du siècle constituent le repère
classique. Il est difficile de percevoir les éléments
qui vont lever cet interdit de fait. Pour répondre
aux demandes du monde judiciaire, des médecins
examinent les victimes à la recherche de preuves.
Il s’agit d’abord de l’examen du cadavre, l’autopsie
n’est pas obligatoire. Les premières dissections ne
font pas avancer le savoir. Les médecins voient ce
que Galien et Avicenne leur enseignaient. Les discor-
dances entre les auteurs les conduisent à vérifier de
visu. Certaines de ces dissections sont publiques, le
médecin disserte et ainsi conserve dans ses exposés
une part spéculative. Progressivement, des erreurs
du grand Galien commencent à être admises. Albert
le Grand montre que l’homme a 5 ou 4 vertèbres
sacrées (et non 3). La prééminence du savoir perdure
néanmoins et la pratique doit seulement permettre
de vérifier les principes, de faire son choix entre les
différents commentaires, interprétations ou traduc-
tions. Mais en aucun cas elle ne doit remettre en
cause les principes.
Témoin de la prégnance de la pratique, une nouvelle
forme de la littérature médicale apparaît, qui va
largement se diffuser dans toute l’Europe.
Tout d’abord, les Consilia : sur le modèle du monde
juridique, les médecins publient ce que l’on appelle
aujourd’hui des “cas cliniques” réels ou supposés.
Je les évoquerai plus en détail ci-dessous.
Au siècle apparaissent également les Practica,
encyclopédies de tout ce qui est supposé nécessaire
à l’art médical. Le propos n’occulte pas l’aspect théo-
rique. En effet, il s’agit largement d’argumentaires
dans le choix d’attitudes qui ne peuvent se passer
de références. Il est intéressant de relever que la
moquerie des raisonnements sophistes des confrères
est très répandue. Surtout, ces textes laissent percer
le désarroi répété devant l’échec. La désobéissance
des patients, la malhonnêteté des apothicaires,
l’incom pétence des confrères sont mises en avant.
Dans ces ouvrages, une attention croissante est
portée aux particularia, vérification des principes sur
des cas particuliers, compréhension des raisons de
leur échec et, in fine, leur désintégration progressive.
À suivre...
... dans le prochain numéro...
en octobre
1
/
3
100%