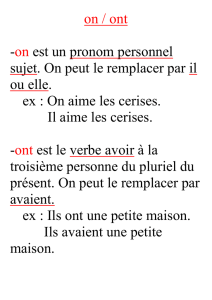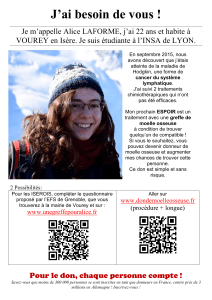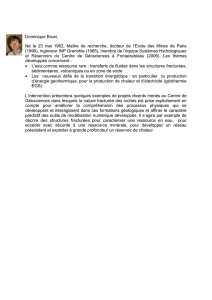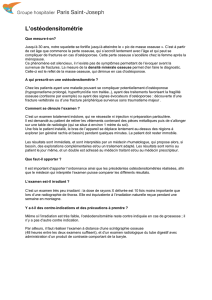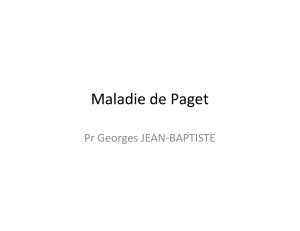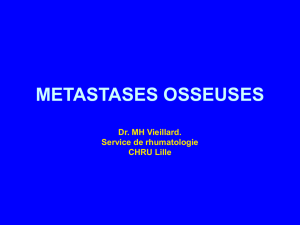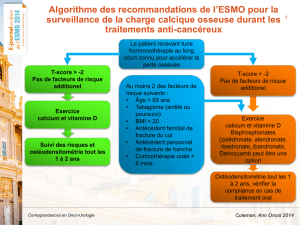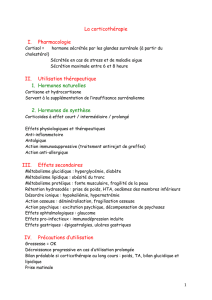Lire l'article complet

REVUE DE PRESSE coordonné par
le Pr B. Combe
6 | La Lettre du Rhumatologue • No 391 - avril 2013
Les ACPA seraient responsables
d’une atteinte osseuse précoce avant l’apparition
des signes cliniques de polyarthrite rhumatoïde
La perte osseuse locale et systémique au cours de la polyarthrite rhumatoïde (PR) apparaît
précocement et semble indiquer que l’infl ammation synoviale n’est pas la seule en cause
dans les dommages ostéoarticulaires de la PR. Les anticorps antipeptides citrullinés (ACPA)
peuvent être détectés dans le sérum de sujets sains avant qu’ils ne développent des signes
articulaires. Il a par ailleurs été récemment démontré que les ACPA pouvaient favoriser la
différenciation des ostéoclastes et ainsi la résorption osseuse(1).
A.Kleyer et al. ont analysé la microarchitecture osseuse des articulations métacarpopha-
langiennes (MCP) de sujets sains n’ayant aucune douleur ni gonfl ement articulaires mais
chez qui des taux sériques signifi catifs d’ACPA ont été découverts fortuitement(2). Ainsi,
15sujets (11femmes et 4hommes), âgés en moyenne de 52,1±11,3ans, ayant un taux
sérique moyen d’ACPA à 228±53 U/ l, et 15autres sujets (11femmes et 4hommes,
49,1±11,3ans), sans ACPA ni PR, ont eu une analyse de la microarchitecture osseuse par
microscanner ( Xtreme-CT scanner) des MCP de la main droite. Aucun sujet n’était fumeur,
aucun ne prenait de traitement à visée osseuse, de glucocorticoïdes ou de traitement
hormonal. Quatre femmes dans chaque groupe étaient ménopausées. Aucun sujet n’avait
de syndrome infl ammatoire biologique et aucun n’avait de signe clinique ni d’antécédent
d’arthrite.
Les mesures réalisées sur les 2e et 3etêtes métacarpiennes montraient que les sujets
ACPA+ avaient une diminution signifi cative du volume trabéculaire (17,2 %±0,6 % versus
20,4 %±0,4 %), une diminution signifi cative de la DMO volumétrique (280±11 mg/ cm
3
versus 237±6 mg/ cm
3
), sans différence signifi cative d’épaisseur ni du nombre de travées
osseuses. L’épaisseur corticale était signifi cativement diminuée dans le groupe ACPA+
(0,22±0,03mm versus 0,32±0,03mm) et les surfaces corticales poreuses (fenestrations
corticales) étaient signifi cativement plus abondantes (7,4±1,4 % versus 1,0±0,3 %),
mais sans différence dans le nombre et la taille des érosions corticales.
B. Bouvard (Angers)
Le pincement articulaire entraîne
une altération de la fonction articulaire
et de la capacité à travailler chez les patients
atteints d’une polyarthrite rhumatoïde
récente : protection par l’adalimumab associé
au méthotrexate
Chez les patients atteints de PR, l’infl ammation et la destruction ostéocartilagineuse
entraînent une perte de la fonction physique. La destruction articulaire se manifeste par
une atteinte osseuse représentée par les érosions ainsi que par une atteinte cartilagineuse
entraînant le pincement articulaire. Ce pincement peut également être le refl et de lésions
tendineuses ou des tissus mous. Les érosions sont généralement considérées comme
les responsables majeures des conséquences fonctionnelles de la destruction articulaire.
Cependant, des travaux récents montrent que, en fait, le pincement aurait également un
retentissement important.
Sur le plan thérapeutique, le méthotrexate diminue le risque de destruction articulaire en
inhibant l’infl ammation, alors que les anti-TNF diminuent la progression de la destruction
articulaire indépendamment du contrôle de l’infl ammation. Les données de ce travail
ont été obtenues à partir de l’étude PREMIER, une étude contrôlée et randomisée des
Commentaire
Cette étude montre que des sujets avec une
réponse immune dirigée contre les protéines citrul-
linées mais sans manifestation clinique rhumatis-
male ont une altération de la microarchitecture
osseuse des MCP, notamment de la corticale. Ces
données semblent ainsi indiquer que l’infl amma-
tion synoviale ne serait pas à elle seule respon-
sable de la destruction ostéoarticulaire mais qu’une
partie de celle-ci pourrait être précocement en
lien avec l’auto-immunité. Reste à savoir si cette
atteinte osseuse précoce est prédictive du dévelop-
pement et de la sévérité de la PR et si elle s’accom-
pagne d’une atteinte de l’os sous-chondral, d’une
atteinte cartila gineuse ou d’un œdème osseux. Les
auteurs émettent l’hypothèse que la perte osseuse
dans la PR précéderait la maladie infl ammatoire
avec un premier événement représenté par la
rupture de tolérance immunitaire conduisant à
la production des ACPA et à la perte osseuse, puis
un deuxième événement aboutissant aux manifes-
tations cliniques de la maladie avec une produc-
tion de cytokines pro-infl ammatoires renforçant la
perte osseuse. Qu’en est-il des PR ACPA négatives ?
Références bibliographiques
1. Harre U, Georgess D, Bang H et al. Induction of osteoclasto-
genesis and bone loss by human autoantibodies against
citrullinated vimentin. J Clin Invest 2012;122(5):1791-802.
2. Kleyer A, Finzel S, Rech J et al Bone loss before the clinical
onset of rheumatoid arthritis in subjects with anticitrul-
linated protein antibodies. Ann Rheum Dis 2013 Mar 21.
[Epub ahead of print]

REVUE DE PRESSE
La Lettre du Rhumatologue • No 391 - avril 2013 | 7
laboratoires Abbott visant à évaluer l’effi cacité de l’adalimumab associé au méthotrexate
comparativement à une monothérapie avec méthotrexate ou adalimumab dans la PR récente
active et naïve de méthotrexate(1). Àpartir de ces données cliniques et radiologiques,
ont été évalués l’impact des traitements sur l’activité de la maladie (DAS28CRP) et les
modifi cations du score de Sharp en érosions et pincements, ainsi que l’association de
ces scores avec l’état fonctionnel (HAQ) et la capacité à travailler(2). Six-cent trente-huit
patients ayant une PR évoluant depuis moins de 3ans ont été inclus dans cette analyse.
À l’inclusion, il n’y avait pas de différence entre les groupes de traitement.
Figure. Relation entre l’atteinte radiologique de type érosion ou pincement
et la capacité à travailler.
Érosion
Pincement
Odds-ratios (IC95)
Patients
ne pouvant travailler Patients
travaillant
À l’inclusion
À 52 semaines
À 104 semaines
0,9 1 1,1
Les résultats montrent que l’élévation du DAS28 CRP était associée au score d’éro-
sion et de pincement dans les groupes “monothérapies” mais non dans le groupe
“bithérapie”. En ce qui concerne le retentissement fonctionnel de la destruction
articulaire, le HAQ était statistiquement corrélé au DAS28 CRP. Cependant, alors que
le pincement articulaire n’était pas associé au HAQ à l’inclusion mais aux semaines52
et 104, le score d’érosion n’était quant à lui jamais associé au HAQ. À l’inclusion,
98 % des patients de l’étude avaient un travail. La capacité à travailler était signifi-
cativement corrélée, àl’inclusion, aux semaines52 et104, au score de pincement
articulaire. Ainsi, plus le score de pincement était faible et plus la capacité à travailler
était élevée (figure). La présence d’érosions, quant à elle, n’avait pas d’impact sur
la capacité à travailler.
V. Devauchelle-Pensec (Brest)
Altération sévère de la porosité corticale
chez les femmes ménopausées diabétiques
fracturées
Les études épidémiologiques ont établi que les femmes diabétiques de typeII présentent
un risque fracturaire augmenté alors qu’elles ont un indice de masse corporelle souvent
plus élevé et une densitométrie osseuse peu abaissée. Dans cette population, l’utilisation
de la densitométrie est prise en défaut pour expliquer le risque fracturaire et souligne
l’importance d’évaluer la qualité osseuse. Il y a plusieurs déterminants de cette qualité
Commentaire
Ainsi, même dans la PR récente, il existe un impact
entre la progression radiologique et l’incapacité
fonctionnelle. La progression des pincements arti-
culaires pourrait avoir un impact plus important
que les érosions sur la capacité à travailler. Ces
données sont cependant à confi rmer car elles sont
issues d’une analyse post hoc.
Références bibliographiques
1. Breedveld FC, Weisman MH, Kavanaugh AF et al. The
PREMIER study: A multicenter, randomized, double-blind
clinical trial of combination therapy with adalimumab plus
methotrexate versus methotrexate alone or adalimumab
alone in patients with early, aggressive rheumatoid arthritis
who had not had previous methotrexate treatment. Arthritis
Rheum 2006;54:26-37.
2. Smolen JS, Van der Heijde DM, Keystone EC et al. Asso-
ciation of joint space narrowing with impairment of physical
function and work ability in patients with early rheumatoid
arthritis: protection beyond disease control by adalimumab
plus methotrexate. Ann Rheum Dis 2013 Jan 24. [Epub ahead
of print]

REVUE DE PRESSE coordonné par
le Pr B. Combe
8 | La Lettre du Rhumatologue • No 391 - avril 2013
osseuse, tels les propriétés de la matrice (qualité du collagène, viabilité des ostéo-
cytes, phase minérale, microcracks,etc.), le remodelage osseux, ou encore l’architecture
osseuse. Cette dernière désigne la forme et la géométrie de la pièce osseuse, mais aussi
la microarchitecture au niveau tissulaire. Dans les pathologies chroniques, il semblerait
que la corticale, et tout spécialement la porosité corticale, soit un déterminant majeur
de la résistance osseuse.
J.M. Patsch et son équipe(1) ont utilisé le scanner périphérique à haute résolution (HR-pQCT)
pour évaluer la microarchitecture. Cette technique permet de réaliser, avec une faible
irradiation, une centaine de coupes continues de 82microns d’épaisseur. Après recons-
truction, l’image est celle d’une biopsie osseuse virtuelle du tissu calcifi é où il est possible
de séparer l’os trabéculaire de l’os cortical. En plus, à chaque voxel est attribuée une
propriété physique qui est utilisée pour soumettre virtuellement l’os à des contraintes
mécaniques (modélisation selon la méthode d’analyse en éléments fi nis) et évaluer la
résistance biomécanique de l’os. L’objectif de l’étude était de déterminer s’il existe des
modifi cations de la porosité corticale et de la résistance osseuse chez les patientes dia-
bétiques fracturées.
Méthode
Les auteurs ont recruté dans la région de l’université de San Francisco en Californie
80femmes ménopausées réparties en 4groupes : les témoins saines, les témoins fracturées,
les diabétiques de type II et les diabétiques de type II fracturées. L’antécédent de fracture
devait être prouvé par radiographie. Chacune des participantes a eu une densitométrie
lombaire et fémorale et un HR-pQCT au poignet et au radius. En plus des paramètres
classiques de microarchitecture osseuse obtenus en HR-pQCT, la force de résistance a été
calculée par analyse en éléments fi nis.
Résultats
L’âge moyen des patientes recrutées était de 62ans. Dans les groupes des patientes dia-
bétiques, il n’y avait pas de différence des caractéristiques de base en dehors d’une durée
d’évolution du diabète plus courte chez les femmes non fracturées. Par rapport aux patientes
témoins, les femmes diabétiques avaient, comme attendu, une HbA1c et un indice de masse
corporelle plus élevés. En densitométrie osseuse, aucune des patientes n’avait un T-score
inférieur à − 2,5DS. En revanche, les patientes fracturées avaient une masse osseuse signi-
fi cativement plus basse que les femmes non fracturées (− 9 % à la hanche totale pour les
témoins fracturées par rapport aux témoins saines et − 7 % pour les diabétiques fracturées
par rapport aux diabétiques non fracturées).
En HR-pQCT au tibia ultradistal et distal, les femmes diabétiques fracturées ont des pores
intracorticaux de volume augmenté (respectivement + 52,6 %, p=0,009, et + 95,4 %,
p=0,020), une hausse de leur porosité relative (+ 58,1 %, p=0,005, et + 87,9 %, p=0,011)
et une augmentation de surface osseuse endocorticale (+ 10,9 %, p=0,031, et + 11,5 %,
p =0,019) par rapport aux femmes diabétiques. L’analyse des résultats au radius montre
également des altérations architecturales chez les femmes diabétiques fracturées par rapport
aux femmes diabétiques non fracturées, avec une porosité corticale 4,7fois plus importante
au radius distal (p=0,001) et une hausse du volume des pores intracorticaux en ultradistal
(+ 67,8 %, p=0,018). De plus, la densitométrie volumique corticale au tibia était diminuée
chez les patientes diabétiques fracturées (− 6,8 %, p=0,01). L’analyse en éléments fi nis
montre que la dégradation de la porosité corticale chez les patientes diabétiques fractu-
rées, au radius distal ainsi qu’au tibia distal et ultradistal, se traduit par un retentissement
important sur la résistance et la charge à la rupture de l’os.
C.B. Confavreux (Lyon)
Commentaire
Les résultats de cette étude suggèrent qu’il existe
une altération sévère de la qualité de la corticale
chez les patientes ménopausées diabétiques frac-
turées, ce qui les expose tout particulièrement au
risque de fracture.
Cette étude de J.M. Patsch et al. souligne parfaite-
ment les progrès réalisés dans la compréhension de
l’ostéoporose. On est ainsi passé d’une défi nition
purement densitométrique à une approche quanti-
tative et qualitative du tissu osseux pour expliquer
la résistance biomécanique osseuse. Il est mainte-
nant clair qu’une densité osseuse surfacique modé-
rément abaissée peut cacher en réalité une forte
altération de la résistance osseuse par atteinte de
l’architecture osseuse. C’est le cas dans cette étude
où l’analyse en HR-pQCT a révélé des troubles pro-
fonds de la corticale, à la fois plus poreuse et moins
dense. Pour l’instant, l’utilisation du HR-pQCT reste
du domaine de la recherche et n’est pas accessible
en pratique courante. En revanche, l’utilisation des
caractéristiques morphologiques qu’il procure et
le calcul de la résistance obtenue par analyse des
éléments fi nis sont devenus systématiques dans
l’évaluation des nouveaux médicaments à visée
anti-ostéoporotique. Comprendre l’apport de cette
technique est essentiel à l’heure actuelle.
Référence bibliographique
1. Patsch JM, Burghardt AJ, Yap SP et al. Increased cortical
porosity in type 2 diabetic postmenopausal women with
fragility fractures. J Bone Miner Res 2013;28:313-24.

REVUE DE PRESSE
La Lettre du Rhumatologue • No 391 - avril 2013 | 9
La consommation de cerises
diminue le risque de crise de goutte
Malgré la disponibilité de traitements et de régimes effi caces, de nombreux patients
atteints de goutte présentent toujours des crises récurrentes. Depuis quelques dizaines
d’années, les cerises ont attiré l’attention des patients et des cliniciens pour leur effet
potentiel dans la prévention et le traitement des crises de goutte. Une étude conduite
sur 10femmes saines a montré que la consommation de cerises diminuait l’uricémie de
manière signifi cative(1), par augmentation de la fi ltration glomérulaire ou réduction de
la réabsorption tubulaire. Dans une étude chez l’animal, la consommation de jus de cerise
diminue les taux d’acide urique chez des rats atteints d’hyperuricémie, par inhibition de
la xanthine oxydase et de la xanthine déshydrogénase(2). Les cerises et le jus de cerise
contiennent de forts taux d’anthocyanines, qui possèdent des effets anti-infl ammatoires
par inhibition de la COX ou par élimination des radicaux d’oxyde nitrique. Les cerises
contiennent par ailleurs de la vitamineC, mais le taux est trop faible pour avoir un impact
sur le risque de goutte
Les auteurs d’un nouveau travail(3) ont réalisé, entre février2003 et février2010,
une étude prospective en crossover portant sur 633patients. L’objectif était d’estimer
le risque relatif de crise de goutte en fonction de la consommation ou non de cerises,
ainsi que ses éventuelles modifi cations par l’allopurinol, et les principaux facteurs de
risque de goutte.
Le recrutement des sujets s’est fait via un site Internet. Les principaux critères d’inclusion
étaient d’avoir une goutte diagnostiquée par un médecin et au moins une crise dans
les 12mois précédents. La confi rmation du diagnostic de goutte était faite par la vérifi -
cation des données médicales du patient qui devait remplir les critères de classifi cation
de goutte de l’American College of Rheumatology (ACR)[4] selon les données fournies
par le médecin traitant. Deux rhumatologues ont relu l’ensemble des données afi n de
déterminer si les sujets avaient un diagnostic de goutte compatible avec les critères
ACR. La confi rmation de la notion de crise de goutte se faisait au regard de la date de
survenue, du site anatomique, des symptômes et signes physiques, et des traitements
(colchicine, AINS, corticoïdes, infi ltrations intra-articulaires). N’ont été considérées que
les crises traitées par au moins un traitement antigoutteux, les podagres (arthrite de
la 1remétatarsophalangienne [MTP]), les douleurs maximales en 24heures, les crises
avec rougeur.
L’exposition à des facteurs de risque était évaluée pour chaque participant : facteurs
de risque diététiques, alcool, infections, vaccinations, activité physique, localisation
géo graphique, traitement antigoutteux. Les auteurs ont également noté le nombre de
cerises consommées (une part standard correspondant à 10-12cerises) et la consom-
mation de jus de cerise. Les facteurs de risque étaient recueillis sur les 2jours précédant
une crise et pendant les 12mois suivants.
L’analyse statistique portait sur la relation entre la consommation de cerises dans les
2jours précédant une crise et le risque de crise de goutte, avec ajustement sur la prise
de purine, d’alcool, de diurétiques, d’allopurinol, de colchicine et d’AINS. Afi n d’évaluer
un possible effet dose, la consommation de cerises était répartie en 5catégories : 0, 1,
2, 3 et ≥4parts. Était également évaluée la prise de jus de cerise, seul ou en association
au fruit. Ont été ajoutés des sous-groupes pour évaluer l’impact de la prise de cerises en
fonction du sexe, de l’IMC, de la prise de purine, d’alcool, de diurétiques, d’allopurinol,
de colchicine et d’AINS dans les 2jours précédant une crise.
Six-cent trente-trois patients atteints de goutte ont été suivis pendant les périodes de
crise et les périodes de contrôle (12mois consécutifs). Parmi eux, 554 remplissaient les
critères ACR de goutte. Leur moyenne d’âge était de 54ans, il s’agissait majoritairement
d’hommes (78 %), blancs (88 %), et plus de la moitié des patients avaient un niveau

REVUE DE PRESSE coordonné par
le Pr B. Combe
AVIS AUX LECTEURS
Les revues Edimark sont publiées en toute indépendance et sous l’unique et entière responsabilité du directeur de la publication et du rédacteur en chef.
Le comité de rédaction est composé d’une dizaine de praticiens (chercheurs, hospitaliers, universitaires et libéraux), installés partout en France, qui
représentent,dans leur diversité (lieu et mode d’exercice, domaine de prédilection, âge, etc.), la pluralité de la discipline. L’équipe se réunit 2ou 3fois
par an pour débattre des sujets et des auteurs à publier.
La qualité des textes est garantie par la sollicitation systématique d’une relecture scientifi que en double aveugle, l’implication d’un service de rédaction/
révision in situ et la validation des épreuves par les auteurs et les rédacteurs en chef.
Notre publication répond aux critères d’exigence de la presse :
· accréditation par la CPPAP (Commission paritaire des publications et agences de presse) réservée aux revues sur abonnements,
· adhésion au SPEPS (Syndicat de la presse et de l’édition des professions de santé),
· indexation dans la base de données INIST-CNRS, partenariat avec le GRIO (Groupe de recherche et d’information sur les ostéoporoses) et lien privilégié avec
le CRI (Club Rhumatismes et Infl ammation),
· déclaration publique de liens d’intérêts demandée à nos auteurs,
· identifi cation claire et transparente des espaces publicitaires et des publirédactionnels en marge des articles scientifi ques.
10 | La Lettre du Rhumatologue • No 391 - avril 2013
d’étude égal au lycée. Les sujets étaient recrutés dans 49États et Washington DC. Environ
61 % consommaient de l’alcool, 29 % étaient sous diurétiques, 45 % sous allopurinol,
54 % sous AINS, et 25 % sous colchicine au moment des périodes de contrôle ou de
crise. Pendant le suivi, 1 247crises de goutte ont été rapportées. La plupart survenant au
niveau des extrémités inferieures (92 %), en particulier au niveau de la 1
re
MTP, avec une
rougeur de l’articulation ou une douleur maximale en 24heures (89 %). Environ 90 %
des crises étaient traitées par colchicine, AINS, corticoïdes, infi ltration de corticoïdes ou
une combinaison de ces traitements. Le temps moyen entre le début d’une crise et la
résolution était de 3jours.
Sur les 633patients inclus, 224 (35 %) ont rapporté une consommation de cerises seules,
15 (2 %) de jus de cerise seul et 33 (5 %) des deux. La consommation de cerises sur une
période de 2jours était associée à une diminution du risque de 35 % comparée à l’absence
de prise. Le risque de crise tendait à diminuer avec l’augmentation de la consommation
de cerises, jusqu’à 3parts standard ; cependant, au-delà, il n’y avait pas de majoration
de l’effet protecteur. Le jus de cerise était associé à une diminution du risque de 45 %.
Le résultat ne changeait pas en ajustant à la prise d’une boisson caféinée. En limitant
l’analyse aux 554patients répondant aux critères ACR, l’OR était à 0,65. L’effet persistait
parmi les sous-groupes répartis en fonction du sexe et de l’IMC.
En ce qui concerne les effets combinés de la consommation de cerises et des facteurs
liés à la goutte, un accroissement de la consommation d’alcool et de purine et la prise
de diurétiques étaient associées à une augmentation du risque de goutte, alors que
l’allopurinol et la colchicine diminuaient le risque. Il n’y avait pas d’association entre
la prise d’AINS et le risque de goute. L’effet de la cerise tendait à être plus prononcé
quand sa consommation était associée à une quantité de purine plus importante, une
diminution de l’alcool, et l’absence d’utilisation de diurétiques ou d’AINS. Lorsque la
consommation de cerises était combinée à la prise d’allopurinol, le risque de crise de
goutte était diminué de 75 % comparativement au risque chez les patients non traités
durant la même période.
P. Touchard et V. Devauchelle-Pensec (Brest)
Commentaire
Dans cette étude, les auteurs ont donc montré
que la consommation de cerises ou de jus de
cerise était associée à une diminution du risque
de crise de goutte récurrente. Cette association
était indépendante des autres facteurs de risque.
Ces résultats étaient partiellement connus et per-
mettent d’augmenter l’arsenal thérapeutique non
pharmacologique de la prévention de la goutte.
Références bibliographiques
1. Jacob RA, Spinozzi GM, Simon VA et al. Consumption
of cherries lowers plasma urate in healthy women. J Nutr
2003;133:1826-9.
2. Haidari F Jr, Mohammad Shahi M, Keshavarz SA,
Rashidi MR. Inhibitory effects of tart cherry (Prunus
cerasus) juice on xanthine oxidoreductase activity and its
hypo uricemic and antioxidant effects on rats. Malays J Nutr
2009;15:53-64.
3. Zhang Y, Neogi T, Chen C, Chaisson C, Hunter DJ, Choi HK.
Cherry consumption and the risk of recurrent gout attacks.
Arthritis Rheum 2012; 64:4004-11.
4. Wallace SL, Robinson H, Masi AT, Decker JL, McCarty DJ,
Yü TF. Preliminary criteria for the classifi cation of the acute
arthritis of primary gout. Arthritis Rheum 1977;20:895-900.
1
/
5
100%