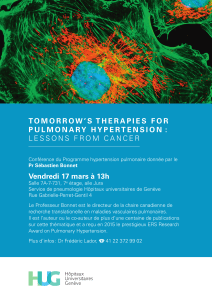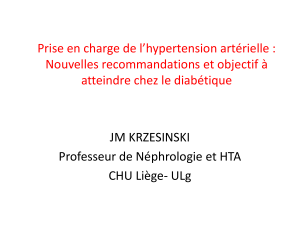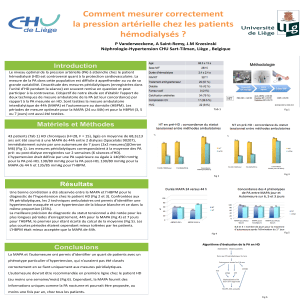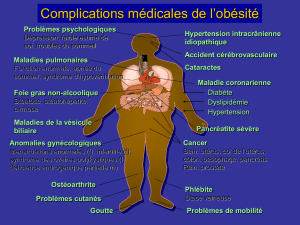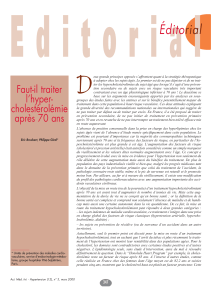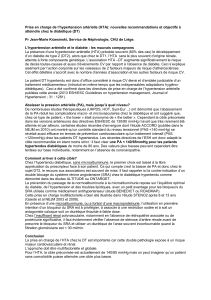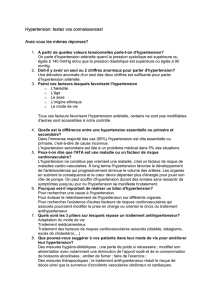L Nouvelles recommandations britanniques pour la prise en charge de l’hypertension

MISE AU POINT
14 | La Lettre du Cardiologue • n° 452-453 - février-mars 2012
* CHU de Poitiers.
Nouvelles recommandations
britanniques pour la prise
en charge de l’hypertension
artérielle
“NICE” guidelines for the clinical management of primary
hypertension
D. Herpin*
L
a mise en ligne des nouvelles recommanda-
tions britanniques pour la prise en charge de
l’hypertension artérielle (HTA) à la fin du mois
d’août 2011 peut être considérée comme un moment
fort de l’année. Ce “pavé” de l’été ne comporte pas
moins de 325 pages, 662 références et 13 appen-
dices (1) ! Fort heureusement, un résumé de 36 pages
est également disponible (2), mais la référence au
document intégral n’en est pas moins indispensable
pour une meilleure compréhension des propositions
formulées et des argumentations qui les sous-tendent.
Il s’agit certes d’une actualisation de recommanda-
tions publiées en 2004 et en 2006, mais les rema-
niements sont profonds et autorisent à évoquer une
véritable évolution dans le mode de pensée de nos
voisins britanniques.
D’emblée, les experts du NICE (National Institute for
Health and Clinical Excellence) soulignent l’impor-
tance de prendre en compte les besoins spécifiques
et les préférences de chaque patient considéré en
particulier, de communiquer avec lui de la façon la
plus claire possible et de l’impliquer directement
dans sa prise en charge.
Les éléments les plus remarquables de ces recom-
mandations concernent aussi bien le diagnostic de
l’HTA que son traitement.
Diagnostic de l’HTA
Une place essentielle est désormais dévolue à la
mesure ambulatoire de la pression artérielle (Mapa),
sans que la mesure clinique de la pression artérielle
(PA) ne perde pour autant ses droits.
Quelques principes de bon sens sont rappelés à propos
de cette mesure clinique de la PA : le médecin doit
savoir réévaluer périodiquement sa pratique et sa
performance ; les appareils automatiques doivent
être évités et remplacés par une mesure ausculta-
toire directe en cas d’arythmie évidente ; les appareils
doivent, bien sûr, être validés et régulièrement recali-
brés ; la mesure doit se faire dans un environnement
calme ; la recherche d’une hypotension orthostatique
doit être systématique chez les patients symptoma-
tiques ; enfin, si une différence de plus de 20 mmHg est
observée entre les 2 bras de façon régulière, la mesure
de référence, lors des consultations ultérieures, doit
se faire au bras présentant les chiffres les plus élevés.
Commentaire : on ne peut qu’adhérer à ces rappels
élémentaires ; les limites bien établies de la mesure
clinique ne doivent pas pour autant faire abandonner
définitivement ce geste à haute valeur symbolique
pour le patient, d’autant qu’il permet de dépister
d’emblée une hypotension orthostatique, rensei-
gnement indispensable à obtenir chez le sujet âgé.
Une fois que la PA a ainsi été mesurée cliniquement
dans des conditions optimales, plusieurs éventualités
peuvent apparaître :
➤
si la PA est inférieure à 140/90 mmHg, le patient
est considéré comme normotendu et on lui propo-
sera simplement une surveillance régulière tous les
5 ans, voire plus souvent si les chiffres sont proches
de 140/90 mmHg ;

La Lettre du Cardiologue • n° 452-453 - février-mars 2012 | 15
Points forts
Highlights
»
Regarding the diagnosis of
arterial hypertension, ambula-
tory blood pressure monitoring
(ABPM) is recommended in all
patients with repeated clinic BP
figures between 140/90and
180/110mmHg.
»
Regarding the follow-up of
hypertensive patients, home
self BP monitoring (HBPM) is
recognized as an interesting
alternative to ABPM.
»
Considering the therapeutic
management of arterial hyper-
tension, an ACEI or a low-cost
ARB (when ACEI tolerability
is poor) has to be given in
patients younger than 55 years,
as a first-line drug. A calcium
channel blocker (CCB) should
be chosen in patients over
55 years of age, as well as in
Black people of Caribbean or
African origin. A diuretic (chlor-
talidone or indapamide) has to
be considered when CCB toler-
ability is poor and when there
is evidence of heart failure or a
high risk of heart failure. Beta-
blockers should not be given as
first-line drugs, except in young
patients.
Keywords
Arterial hypertension
Ambulatory blood pressure
monitoring
Home self BP monitoring
Therapeutic management
NICE guidelines
Mots-clés
Hypertension
artérielle
Mesure ambulatoire
de la pression
artérielle
Automesure
tensionnelle
Stratégie
thérapeutique
Recommandations
»
Pour le diagnostic de l’hypertension artérielle (HTA), la mesure ambulatoire de la pression artérielle (Mapa)
est recommandée dès que la pression artérielle (PA) clinique se situe entre 140/90mmHg et 180/110mmHg.
»Pour le suivi de l’HTA, l’automesure est reconnue comme une alternative intéressante à la Mapa.
»
Concernant la prise en charge thérapeutique : chez les patients âgés de moins de 55ans, commencer par
un inhibiteur de l’enzyme de conversion (IEC) ou, si l’IEC est mal toléré, par un antagoniste des récepteurs
de l’angiotensine 2 (Ara2), de faible coût. Pour les patients âgés de plus de 55ans et les sujets noirs d’ori-
gine africaine ou caribéenne de tout âge, commencer par un antagoniste calcique (AC). Le diurétique (de
préférence chlortalidone ou indapamide) n’est envisagé que si l’AC est mal toléré ou en cas d’insuffisance
cardiaque manifeste ou potentielle. Les bêtabloquants ne sont pas proposés en première intention, sauf
éventuellement chez les sujets jeunes.
➤
si la PA est supérieure ou égale à 140/90 mmHg,
une deuxième mesure doit être effectuée pendant la
consultation, et même une troisième si la deuxième
diffère significativement de la première. La PA
clinique à retenir correspond à la valeur la plus
basse des 2 dernières mesures. Si cette valeur de
PA clinique est supérieure ou égale à 140/90 mmHg,
le NICE recommande de réaliser une Mapa, ce qui est
une grande nouveauté. Au cas où le profil du patient
paraît peu compatible avec la réalisation de cette
Mapa, l’automesure à domicile peut être proposée
comme une alternative diagnostique.
➤
si la PA clinique est supérieure ou égale à
180/110 mmHg, la Mapa n’est pas considérée
comme nécessaire, ni l’automesure, et un traitement
pharmacologique doit alors être immédiatement
proposé.
La réalisation de la Mapa doit se faire dans de bonnes
conditions techniques : le NICE recommande de
disposer d’au moins 2 mesures par heure en période
d’éveil et propose de prendre la moyenne d’au moins
14 mesures en période d’éveil pour confirmer le
diagnostic d’hypertension.
Commentaire : ainsi se dégage une autre spécificité
britannique : la valeur de la PA en période nocturne
n’est pas présentée comme une information d’impor-
tance majeure, ce à quoi on ne peut souscrire connais-
sant la forte valeur pronostique du statut dipper ou
non dipper qui persiste même après ajustement sur le
niveau tensionnel moyen des 24 heures (3, 4).
Concernant l’automesure tensionnelle, les Britan-
niques recommandent de faire au minimum
2 mesures en position assise à 1 minute d’intervalle
au moins, à 2 moments de la journée (le matin et le
soir) et cela pendant au moins 4 jours (idéalement
7 jours). La valeur retenue est la moyenne des chiffres
tensionnels obtenus à partir du deuxième jour.
Commentaire : pour l’étape diagnostique, les experts
du NICE relèguent donc l’automesure en deuxième
ligne et la réservent aux patients qui paraissent ne pas
pouvoir supporter une Mapa. Ils s’appuient pour cela
sur une revue récente (5) qui conclut à une sensibilité et
à une spécificité insuffisantes de la mesure clinique et
de l’automesure, par rapport à la Mapa, pour la mise en
route ciblée d’un traitement approprié. Ils se réfèrent
également à une analyse médico- économique (6) qui
aurait montré que les surcoûts engendrés par la Mapa
seraient contrebalancés par les économies générées
en termes de prise en charge globale.
Le recours à un spécialiste de l’hypertension est
urgent dans les circonstances suivantes :
➤
hypertension accélérée, c’est-à-dire PA supé-
rieure à 180/110 mmHg avec œdème papillaire ou
hémorragie rétinienne ;
➤
forte suspicion de phéochromocytome fondée
sur les données cliniques ;
➤
et, avec une moindre urgence, en présence de
signes et de symptômes évocateurs d’une HTA
secondaire.
En dehors du cas particulier de l’HTA sévère où, selon
les Britanniques, la prise en charge thérapeutique
doit être immédiate, le praticien prendra le temps
nécessaire pour évaluer le risque cardiovasculaire
(CV) du patient en recherchant notamment une
atteinte des organes cibles.
S’agissant de l’évaluation du risque CV, le NICE
recommande, pour tout patient hypertendu, de
rechercher la présence d’une protéinurie sur un échan-
tillon urinaire (avec estimation du rapport albumine/
créatinine) et de rechercher également une hématurie
sur bandelette. Au niveau plasmatique, il convient
de doser la glycémie, les électrolytes, la créatinine
(avec estimation du débit de filtration glomérulaire),
le cholestérol total et le HDL-cholestérol. Ce bilan
biologique initial doit bien sûr être complété par un
électrocardiogramme à 12 dérivations.
Si l’hypertension n’est pas confirmée par la Mapa ou
par l’automesure, mais qu’il y a une atteinte infra-
clinique des organes cibles, il faut alors poursuivre
les investigations à la recherche de la cause de cette
souffrance viscérale.
Prise en charge thérapeutique
de l’HTA
L’intérêt des mesures non médicamenteuses est bien
sûr rappelé : régime approprié, exercice physique
régulier, techniques de relaxation (éventuellement),
réduction de la consommation d’alcool, évitement
des consommations excessives de café ou d’autres

Nouvelles recommandations britanniques
pour la prise en charge de l’hypertension artérielle
MISE AU POINT
16 | La Lettre du Cardiologue • n° 452-453 - février-mars 2012
produits riches en caféine, apports sodés faibles,
aide au sevrage tabagique. Mais l’intérêt des supplé-
ments en calcium, en magnésium ou en potassium
n’a pas été retenu. L’implication du patient dans son
nouveau mode de vie est essentielle, de préférence
en collectivité.
Concernant le traitement pharmacologique, des
propositions nouvelles et très claires ont là aussi
été formulées.
Un traitement pharmacologique est proposé aux
patients âgés de moins de 80 ans qui ont une hyper-
tension de stade 1 (légère), associée à au moins
1 des éléments suivants : atteinte d’un organe cible,
maladie CV avérée, souffrance rénale, diabète, risque
CV absolu à 10 ans supérieur ou égal à 20 %.
Un traitement pharmacologique est proposé à toute
personne présentant une hypertension de stade 2
(modérée), quel que soit son âge.
Pour les patients âgés de moins de 40 ans ayant
une hypertension de stade 1, sans atteinte d’un
organe cible ni maladie CV ou rénale, ni diabète, un
spécialiste doit être consulté pour un bilan étiolo-
gique et une évaluation affinée des organes cibles
(en effet, le risque réel est parfois sous-estimé chez
ces patients).
L’adaptation du traitement se fait de la façon
suivante :
➤
les patients âgés de moins de 80 ans doivent être
amenés à une PA clinique inférieure à 140/90 mmHg ;
➤
les patients âgés de 80 ans ou plus doivent avoir
des chiffres inférieurs à 150/90 mmHg ;
➤
les patients identifiés comme ayant un effet
blouse blanche peuvent bénéficier d’une Mapa ou
d’une automesure en plus de la mesure clinique
de PA pour évaluer la réponse au traitement
antihyper tenseur ; la cible à atteindre est alors de
135/85 mmHg pour les patients âgés de moins de
80 ans et de 145/85 mmHg pour ceux âgés de 80 ans
et plus.
Commentaire : l’automesure, dont la bonne valeur
pronostique est reconnue, garde ainsi aux yeux du NICE
une place importante dans le suivi du sujet hypertendu,
chez qui la présence d’un effet blouse blanche est
quasiment constante.
Concernant le choix du traitement antihyper tenseur,
un revirement spectaculaire a été réalisé par les
Britanniques.
Étape 1 : chez les patients âgés de moins de 55 ans,
commencer par un inhibiteur de l’enzyme de conver-
sion (IEC) ou, si l’IEC est mal toléré, par un anta-
goniste des récepteurs de l’angiotensine 2 (Ara2),
de faible coût. Ne pas associer un IEC à un Ara2.
Pour les patients âgés de plus de 55 ans et les sujets
noirs d’origine africaine ou caribéenne de tout âge,
proposer un antagoniste calcique.
Le diurétique ne sera proposé que s’il y a une
mauvaise tolérance de l’inhibiteur calcique (œdèmes
des membres inférieurs notamment) ou une insuffi-
sance cardiaque (IC) manifeste ou potentielle. Si un
diurétique est choisi, il faut préférer la chlortalidone
(12,5 à 25 mg/j) ou l’indapamide, plutôt que les
thiazidiques classiques tels que le bendroflumé-
thiazide ou l’hydrochlorothiazide.
Les bêtabloquants ne sont pas proposés en première
intention, sauf éventuellement chez les sujets
jeunes, surtout s’ils présentent une intolérance ou
une contre-indication aux IEC ou aux Ara2, chez
les femmes en âge de procréer ou, surtout, chez
les patients ayant des signes évidents d’hypertonie
sympathique. Dans le cas où un bêtabloquant a ainsi
été proposé en première ligne, si un deuxième médi-
cament est nécessaire, le choix devra se porter sur
un inhibiteur calcique plutôt que sur un diurétique
afin de réduire le risque d’apparition d’un diabète.
Commentaire : bêtabloquants et diurétiques ont
donc ainsi perdu leurs droits en première intention ; on
peut néanmoins rappeler que les effets délétères des
bêtabloquants ont essentiellement été observés avec
l’aténolol et qu’il est peut-être hâtif d’enterrer toute
la classe ; d’autre part, l’effet diabétogène des diuré-
tiques est très étroitement corrélé à l’hypo kaliémie, et
il s’atténue considérablement si le diurétique est admi-
nistré à faible dose ou si l’hypokaliémie est corrigée.
Quant au choix délibéré de priver les sujets âgés de
plus de 55 ans d’un IEC ou d’un Ara2, il ne repose sur
aucune donnée épidémiologique récente : la littéra-
ture, au contraire, est riche de données montrant l’effet
bénéfique de ces classes thérapeutiques, même chez
les sujets très âgés.
Étape 2 : si l’objectif n’est pas atteint par la stratégie
de l’étape 1, le NICE suggère d’associer un inhibiteur
calcique à un IEC ou à un Ara2 (avec une préférence
pour l’Ara2 par rapport à l’IEC chez les sujets noirs).
Comme précédemment, le diurétique n’est préféré à
l’inhibiteur calcique que si ce dernier est mal toléré
ou s’il y a une IC évidente ou fortement susceptible
d’apparaître.
Étape 3 : une fois que l’on a vérifié que les médi-
caments proposés à l’étape 2 ont été prescrits aux
bonnes doses, on propose alors une trithérapie asso-
ciant un IEC ou un Ara2, un inhibiteur calcique et
un diurétique.

MISE AU POINT
La Lettre du Cardiologue • n° 452-453 - février-mars 2012 | 17
1. National Institute for Health and Clinical Excellence.
Hypertension: clinical management of primary hypertension
in adults. CG127. 2011. http://guidance.nice.org.uk/CG127/
Guidance/pdf/English
2. Krause T, Lovibond K, Caulfield M, McCormack T,
Williams B; Guideline Development Group. Management
of hypertension: summary of NICE guidance. BMJ 2011;343:
d4891.
3. Verdecchia P, Porcellati C, Schillaci G et al. Ambulatory
blood pressure. An independent predictor of prognosis in
essential hypertension. Hypertension 1994;24:793-801.
Erratum in: Hypertension 1995;25:462.
4. Verdecchia P, Schillaci G, Gatteschi C et al. Blunted
nocturnal fall in blood pressure in hypertensive women
with future cardiovascular morbid events. Circulation 1993;
88:986-92.
5. Hodgkinson J, Mant J, Martin U et al. Relative effectiveness
of clinic and home blood pressure monitoring compared
with ambulatory blood pressure monitoring in diagnosis
of hypertension: systematic review. BMJ 2011;342:d3621.
6. Lovibond K, Jowett S, Barton P et al. Cost-effectiveness of
options for the diagnosis of high blood pressure in primary
care: a modelling study. Lancet 2011;378:1219-30. Erratum
in: Lancet 2011;378:1218.
Références bibliographiques
Étape 4 : si la PA clinique reste supérieure à
140/90 mmHg avec la trithérapie précédente, un
quatrième médicament peut être ajouté, et l’avis
d’un expert sollicité. Le quatrième médicament
à prescrire pourra être la spironolactone à petite
dose (25 mg/j) si le taux de potassium est infé-
rieur ou égal à 4,5 mmol/l. Dans le cas contraire
(potassium supérieur à 4,5 mmol/l), on choisira
plutôt un diurétique thiazidique, en surveillant les
électrolytes et la créatinine dans le mois qui suit,
puis régulièrement. Et ce n’est que si le diurétique
à l’étape 4 n’est pas toléré ou est contre-indiqué ou
inefficace que le NICE suggère de considérer la pres-
cription d’un alpha- ou d’un bêtabloquant. L’échec
d’une quadrithérapie doit conduire à prendre l’avis
d’un expert.
Le NICE renouvelle également ses recomman-
dations de 2004 sur l’intérêt de l’éducation du
patient et sur l’importance d’obtenir une bonne
observance.
Conclusion
Ainsi, sur la base d’arguments médico- économiques,
les nouvelles recommandations britanniques donnent
une place de choix à la Mapa pour le diagnostic
de l’HTA et privilégient les “nouvelles” molécules
(IEC/Ara2 ou inhibiteurs calciques) par rapport
aux “anciennes” molécules (diurétiques et bêta-
bloquants). Cette stratégie a priori coûteuse a de
bonnes raisons de se révéler rentable à long terme, car
elle permet, d’une part, de mieux cibler les patients
relevant véritablement d’un traitement pharmaco-
logique à long terme et, d’autre part, de prévenir plus
efficacement la survenue d’accidents CV.
Certains choix peuvent néanmoins être discutés,
notamment la place plus accessoire donnée à
l’automesure, l’absence de prise en compte des
chiffres nocturnes de la Mapa et la prescription
préférentielle, après l’âge de 55 ans, d’un inhibi-
teur calcique plutôt que d’un bloqueur du système
rénine- angiotensine. ■
Conflit d’intérêts. L’auteur a ou a
eu au cours des 5 dernières années
des liens d’intérêts pour conseils
ou présentations orales avec les
laboratoires Abbott, AstraZeneca,
Bayer, Boehringer Ingelheim, Chiesi,
Ipsen, Menarini, Negma, Novartis,
Pfizer, Pierre Fabre, Sanofi, Servier
et Takeda.
3e Journée d’actualités médico-chirurgicales
■ Le 14 avril 2012
au palais des congrès
d’Aix-en-Provence
Organisation :
Association des médecins
de la poly clinique du parc Rambot
(AMPPR)
Programme :
– 18 communications interdisciplinaires présentées par des spécialistes
ou par des médecins généralistes ;
– table ronde de clôture consacrée à l’accompagnement thérapeutique
en cancérologie.
Inscription gratuite, mais indispensable, sur :
– www.atoutcom.com
– www.amppr.fr
Agenda
1
/
4
100%