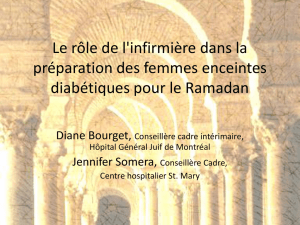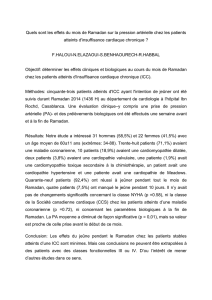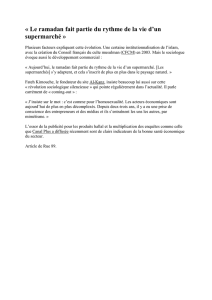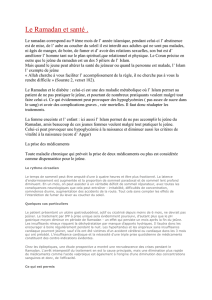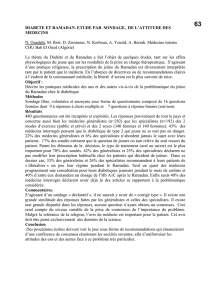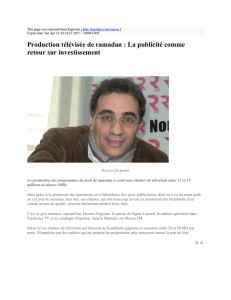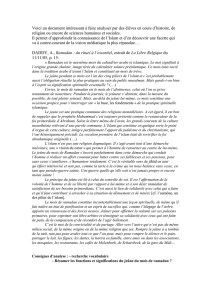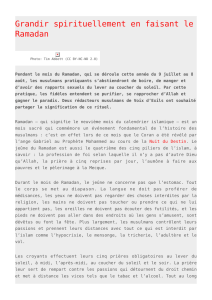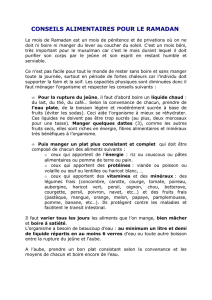Diabète et ramadan Diabetes and ramadan »

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XVII - n°10 - décembre 2013
338338
Mise au point
Diabète et ramadan
Diabetes and ramadan
Y. Kouidrat1,2, A. Amad3, J.D. Lalau1
Points forts
Highlights
»
Le mois du ramadan représente un temps fort de spiritualité
durant lequel les musulmans doivent jeûner du lever au coucher
du soleil. En dépit des dispenses médicale et religieuse, de
nombreux diabétiques décident de jeûner.
»
En jeûnant, les diabétiques s’exposent à des complications
potentiellement graves (hypoglycémies sévères, hyperglycémies,
acidocétose, etc.).
»
Depuis la première réunion internationale de consensus sur
le diabète et le ramadan en 1995, cette thématique a suscité
l’intérêt de la communauté médicale et des recommandations
d’experts ont vu le jour afi n de réduire le risque de complications
liées au jeûne.
»
Parmi les messages clés, il appartient au médecin d’accompagner
les patients durant le ramadan, de rappeler les risques de
complications et la dispense possible de ce jeûne, et ensuite
d’évaluer le niveau de risque du patient. Les patients à haut risque
doivent être dissuadés de jeûner dans la mesure du possible.
»
Un programme d’éducation thérapeutique adapté au ramadan
abordant les règles hygiénodiététiques, l’autosurveillance
glycémique et l’adaptation thérapeutique des antidiabétiques,
s’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire (diabétologues,
infi rmiers d’éducation, diététiciens) est essentiel et est exposé
dans cet article.
Mots-clés : Ramadan – Diabète – Grossesse.
The holy month of ramadan is a highlight of spirituality
during which Muslims have to fast from sunrise to sunset.
Despite medical and religious dispensations, many diabetics
decide to fast.
Fasting, diabetics are exposed to potentially serious
complications (severe hypoglycemia, hyperglycemia,
ketoacidosis, etc.).
Since the first international meeting on Diabetes and
Ramadan Recommendations in 1995, this issue has
attracted the attention of the medical community and expert
recommendations have been established to reduce the risk
of complications related to fasting.
Among the key messages, the physician’s role is to assist
patients during Ramadan, remind the risk of complications
and possible exemptions from this fast, and then assess
the risk level of the patient. Patients at high risk should be
discouraged to fast as much as possible.
A special ramadan therapeutic education program
addressing lifestyle and dietary rules, blood glucose
monitoring and adjustment of antidiabetic therapy based
on a multidisciplinary team (diabetologists, education nurses,
dietitians) is essential and is exposed in this article.
Keywords: Ramadan – Diabetes – Pregnancy.
1 Service d’endocrinologie-
nutrition, CHU d’Amiens.
2 Unité de nutrition, hôpital
maritime de Berck (AP-
HP), Berck-sur-Mer.
3 Pôle de psychiatrie,
université Lille-Nord-de-
France, CHRU de Lille.
L
e jeûne, ou “Siyam” en arabe, du mois du
ramadan correspond au 4
e
pilier de l’islam. À
ce titre, il est observé par un grand nombre
de musulmans en France. Durant cette période, les
fi dèles s’abstiennent de manger et de boire du lever
du soleil jusqu’à son coucher. La grande majorité des
personnes se réveille avant l’aube pour participer au
repas du “Sahour” permettant de faire des réserves
énergétiques jusqu’au “F’tour”, repas de rupture du
jeûne, souvent familial et festif. Le mois du ramadan
est le 9e mois lunaire du calendrier islamique et com-
porte 29 à 30 jours. Un décalage d’une dizaine de
jours environ se produit chaque année par rapport
au calendrier grégorien. Ainsi le ramadan peut-il être
célébré à diff érentes saisons, et le nombre d’heures
de jeûne dans la journée varie chaque année selon la
saison et la zone géographique. Cette année, le jeûne
du ramadan a eu lieu en plein été. Cela correspond,
par exemple, à un jeûne continu de près de 16 heures
à Marseille et jusqu’à 17 heures à Lille, pour les pre-
miers jours.
Ce mois sacré pour les musulmans représente un temps
fort de spiritualité, marqué par le jeûne et les prières.
C’est aussi un moment de renforcement du lien familial

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XVII - n° 10 - décembre 2013
339339
Diabète et ramadan
et communautaire qui transcende les fi dèles faisant
preuve de charité.
Le Coran indique de manière très claire la dispense de
ce jeûne accordée aux personnes malades et en parti-
culier aux patients souff rant de maladies chroniques.
En dépit de ces recommandations, tous les médecins
ont pu observer que de nombreux diabétiques jeûnent
au moins en partie pendant le mois du ramadan. Cette
proportion de patients reste diffi cilement appréciable.
Malgré les recommandations religieuses et malgré les
contre-indications médicales, ces patients tiennent à
leur choix, parfois de manière cachée.
L’approche biopsychosociale qui se développe dans
la prise en charge des maladies chroniques comme
le diabète, implique de prendre en compte, pour un
nombre de plus en plus grand de nos patients, cette
problématique qui relève de l'éthique. Doit-on en eff et
rester catégorique et ferme en contre-indiquant le jeûne
du mois du ramadan à tous les diabétiques ? Ou peut-
on accompagner cette demande, qui peut paraître
irrationnelle pour certains médecins, mais qui n’en est
pas moins essentielle pour nombre de nos patients ?
Porteurs d’une maladie chronique, certains peuvent se
sentir désabusés du fait du diabète qui bouleverse leur
intégrité physique, leur équilibre psychique et social.
Ainsi la non-observance du jeûne peut avoir un impact
psychologique déstabilisant (sentiment d’exclusion de
la communauté, sentiment d’opposition entre recom-
mandations religieuses et recommandations médicales,
déni de la maladie). En outre, cette maladie pourrait être
ressentie comme une punition en empêchant le fi dèle
de vivre un événement spirituel majeur, tel que celui
du mois sacré du ramadan. En défi nitive, la pratique
du jeûne demeure une décision personnelle. Même si
la sagesse médicale et religieuse voudrait que les dia-
bétiques ne jeûnent pas, un soutien médical doit être
apporté pour préserver au mieux la santé des malades
qui souhaitent jeûner. Les soignants ont pour mission
de rappeler au diabétique musulman la dispense pos-
sible de cette pratique ainsi que la réalité des risques
encourus. Toutefois, l’existence de recommandations
d’experts permettra d’encadrer la pratique du jeûne
chez les patients à risque, qui restent déterminés à
jeûner.
Impact métabolique du jeûne
Peu d’études ont été publiées sur les eff ets du jeûne et
sa tolérance chez les sujets diabétiques. La vaste étude
internationale EPIDIAR (1), menée dans 13 pays avec
des populations à forte majorité musulmane, est une
étude épidémiologique qui a inclus 12 914 patients.
Les principaux résultats montrent que, durant le mois
du ramadan, près de 43 % des diabétiques de type 1 et
79 % des diabétiques de type 2 ont observé au moins
15 jours de jeûne. Moins de la moitié de ces patients
adaptaient leur traitement aux changements liés à la
modifi cation des repas ; enfi n, l’incidence des hypogly-
cémies sévères était multipliée par 4,7 dans le diabète
de type 1 et par 7,5 dans celui de type 2.
L’Association américaine du diabète (ADA) et le colloque
international sur Diabète et Ramadan (Casablanca,
Maroc, 1995) ont identifi é des groupes de patients qui
sont particulièrement à risque de complications en cas
de jeûne (tableau I) [2].
Cette liste de facteurs de risque se fonde principale-
ment sur l’opinion d’experts. En 2005, l’ADA a publié
une déclaration de consensus sur la prise en charge
du diabète pendant le ramadan, qui a été actualisée
en 2010 (3). Un programme d’éducation thérapeutique
individualisé avant le début du ramadan ainsi qu’un
suivi médical rapproché ont été fortement recomman-
dés. En eff et, un tel programme a démontré l’améliora-
Tableau I. Catégories des risques chez les patients diabétiques qui veulent observer le jeûne le mois du ramadan.
Risque très élevé Risque élevé Risque modéré Risque faible
• Hypoglycémie sévère les 3 mois
précédant le ramadan
• Hypoglycémie récidivante
• Hypoglycémie non ressentie
• Surveillance glycémique insuffi sante
• Acidocétose les 3 mois précédant le ramadan
• Diabète de type 1
• Pathologie aiguë intercurrente
• Coma hyperosmolaire dans les 3 mois précédents
• Travail avec activité physique intense
• Grossesse
• Dialyse chronique
• Équilibre glycémique médiocre
(HbA1c entre 7,5 et 9 %)
• Insuffi sance rénale
• Complication macrovasculaire
• Patient vivant seul et traité
par insuline ou sulfamide hypo-
glycémiant
• Patient vivant seul
• Comorbidités associées
• Sujet âgé
• Prise de médicaments altérant
la vigilance
• Bon contrôle glycémique
avec un insulinosécréteur de
courte durée d’action
(répaglinide)
• Diabète bien contrôlé par les
règles hygiénodiététiques seules,
metformine ou inhibiteurs DPP4

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XVII - n°10 - décembre 2013
340340
Mise au point
© glopphy
tion des paramètres métaboliques et la réduction des
risques de complications par rapport à des patients
non sensibilisés (4).
Mode alimentaire et activité physique
Durant le ramadan, le rythme circadien, l’horloge bio-
logique, tout comme le rythme alimentaire sont tota-
lement bouleversés (5). Le mode alimentaire, l’activité
physique, et le sommeil sont complètement déréglés
(lever en milieu de nuit avec repas riche avant l’aube,
sommeil diurne compensatoire, dîner hypercalorique
et tardif le soir, et parfois même une collation supplé-
mentaire avant le coucher) [6].
Une augmentation de l’apport calorique quotidien
pendant le ramadan a été montrée chez des sujets
sains (7, 8). Certaines études ont rapporté, à l’inverse,
une diminution des apports caloriques totaux et de
la consommation de glucides dans les diabètes de
type 1 et de type 2 (9). De plus, près de 60 % des pra-
tiquants gardent un poids stable, alors que 20 % en
gagnent (10).
Risques de complications et jeûne
Les principaux risques liés à la pratique du jeûne sont
l’hypoglycémie, l’hyperglycémie et la déshydratation.
Hypoglycémie
L’augmentation du nombre d'hypoglycémies semble
être liée à diff érents facteurs non exclusifs : diminution
de l’apport alimentaire pendant les heures de jeûne,
exercice physique quotidien inchangé, non-adaptation
des traitements (1). L’hypoglycémie peut être exacerbée
par le défaut de sécrétion des hormones de contre-
régulation, particulièrement bien documenté dans le
diabète de type 1 (insulino-dépendant) [11].
Hyperglycémie et acidocétose diabétique
Il a été rapporté 5 fois plus d’épisodes sévères en
période de ramadan, avec ou sans acidocétose,
mais avec hospitalisation dans le diabète de type 2
et 3 fois plus dans le type 1 (1). Cela est attribué à
2 causes principales : la réduction excessive des doses
d’antidiabétiques oraux (ADO) ou d’insuline, et une
alimentation hypercalorique (avec un excès de glu-
cides simples, tels que les boissons sucrées, et/ou de
lipides) [10, 12].
Déshydratation et thrombose
La restriction hydrique, la diminution de l’apport ali-
mentaire et l’eff et diurétique de l’hyperglycémie pen-
dant les heures de jeûne peuvent être responsables
d’une déshydratation. Cette situation peut entraîner
une hypotension orthostatique, une syncope, voire une
thrombose vasculaire (hyperviscosité) [13]. Le dosage et/
ou le type de médicaments antihypertenseurs doivent
donc être ajustés. C’est ainsi que les diurétiques peuvent
ne pas être appropriés pendant le ramadan pour cer-
tains patients.
Diabète de type 2 non insulinotraité
Plusieurs études ont montré que le jeûne du rama-
dan n’aff ectait que peu voire pas la glycémie chez les
patients diabétiques de type 2 équilibrés avec les seules
mesures hygiénodiététiques (9, 14).
Sur le plan alimentaire, les glucides complexes doivent
être ingérés de préférence au repas du “Sahour” en
raison de leur absorption lente ; les glucides simples,
quant à eux, doivent être réservés au repas du “F’tour”.
L’activité physique intense doit être contre-indiquée en
prévention d’une hypoglycémie, en particulier pendant
les heures de jeûne.
Le choix des ADO doit être individualisé. Utilisés seuls,
les agents qui agissent en augmentant la sensibilité à
l’insuline sont associés à un risque signifi cativement
inférieur d’hypoglycémie comparativement aux insu-
linosécréteurs (3).
Metformine
Les patients traités et bien équilibrés par la metformine
seule peuvent jeûner en toute sécurité, étant donné
l’absence de risque d’hypoglycémie. Toutefois, il est
suggéré de fractionner la dose ; les deux tiers de la dose
journalière seront administrés au repas du “F’tour”, et
l’autre tiers au repas du “Sahour”.
Sulfamides hypoglycémiants
Cette classe thérapeutique a été considérée comme
faisant courir un risque au cours du jeûne, en raison
de l’effet hypoglycémiant. Dans une étude turque
récente, 52 patients avec diabète de type 2 qui ont
jeûné pendant le ramadan ont été randomisés en
3 groupes : régime seul, sulfamide (glimépiride ou
gliclazide LM : 1 fois par jour), ou répaglinide (2 mg ×
2/j). Les résultats montrent qu’un seul patient (traité
par glimépiride) a présenté une hypoglycémie. En
outre, l’indice de masse corporelle (IMC), la glycémie
à jeun et les taux de fructosamine, d’HbA1c et de
cholestérol total sont demeurés inchangés pendant
l’étude dans les 3 groupes (15). Une autre étude, qui
a comparé l’efficacité de différentes posologies du
glibenclamide au cours du ramadan, a montré que
les hypoglycémies sont moins fréquentes lorsque
>>>

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XVII - n°10 - décembre 2013
342342
Mise au point
la posologie est réduite à 75 % de la dose habituelle
(16). De plus, une grande étude observationnelle
prospective (n = 332) a démontré que l’équilibre gly-
cémique global et les taux d’hypoglycémie n’ont pas
changé selon l’horaire de prise médicamenteuse (soit
en 1 fois par jour de glimépiride prise au “Sahour”,
soit déplacée à une dose le soir prise au cours du
“F’tour”) [17].
Pour les patients prenant des ADO 3 fois par jour, la
plupart des études ont suggéré un ajustement à 2 prises
durant le ramadan. Comme le “F’tour” est habituelle-
ment le repas le plus riche au cours du ramadan, un
consensus d’experts a suggéré que la dose d’ADO soit
divisée ainsi : un tiers de la dose au “Sahour”, et les deux
tiers de la dose au “F’tour”.
Des études complémentaires sur l’utilisation des sul-
famides pendant le ramadan sont nécessaires pour
établir les recommandations les plus avisées.
Insulinosécréteurs de courte durée d’action :
glinides
En raison de leur courte durée d’action les glinides
peuvent être pris avant chaque repas. En eff et, durant
le ramadan, l’utilisation du répaglinide a été associée à
un taux d’hypoglycémie plus bas qu‘en cas d‘utilisation
du glibenclamide (18).
Les inhibiteurs de l’alpha-glucosidase
Par son mode d’action sur les glycémies postprandiales,
ce traitement peut être pris sans risque d’hypoglycémie.
Inhibiteur de la dipeptidyl peptidase-4 (I-DPP4)
Une étude menée au Royaume-Uni chez 52 diabé-
tiques de type 2 traités par metformine à raison de
2 g/j a montré que l’ajout d’un I-DPP4 (vildagliptine),
plutôt qu’un sulfamide (ici le gliclazide), a conduit à une
moindre incidence de l’hypoglycémie et à un meilleur
contrôle glycémique (19). Ces résultats ont été confi r-
més dans un large essai randomisé mené chez près de
1 000 patients (20).
Incrétinomimétiques ou analogues du gluca-
gon-like peptide-1 (GLP-1)
Bien qu’il y ait suffi samment de preuves d’effi cacité
et de sécurité en ce qui concerne l’utilisation de ces
agents (exénatide et liraglutide) en termes de contrôle
glycémique obtenu et d’incidence d’hypoglycémie, leur
utilisation durant le jeûne du ramadan n’a pas été éva-
luée. En pratique courante, la posologie n’a pas besoin
d’être ajustée pendant le ramadan, mais certains préco-
nisent de réduire la dose de sulfamide et/ou d’insuline
dans les cas de combinaison (21).
Diabète de type2 et insulinothérapie
Toute insulinothérapie devrait être mise en place plu-
sieurs mois avant le ramadan pour disposer du temps
nécessaire à la titration de l’insuline, selon sa nature, la
posologie, le rythme des injections, tout cela en fonction
du mode de vie du patient.
Plusieurs approches d’ajustement du schéma insu-
linique ont été proposées dans des revues récentes,
fondées principalement sur des avis d’experts et parfois
sur des essais cliniques, mais de taille modeste (22).
Pour les patients traités par insuline basale (seule ou
en combinaison avec la metformine, un I-DPP4, ou
un inhibiteur de l’alpha-glucosidase), il est recom-
mandé de réduire la dose (administrée de préférence
au “F’tour”) pour éviter une hypoglycémie pendant la
journée, empiriquement de 20 % à 30 %. La dose peut
être ultérieurement réglée pendant le ramadan selon
le profi l glycémique observé. L’utilisation des insulines
pré-mix en 2 injections quotidiennes à dose réduite
de 20 % à 30 % reste possible ; toutefois le manque de
souplesse concernant la titration constitue une limite
importante, de sorte que le passage à un schéma insu-
linique optimisé serait plus approprié.
Dans le diabète de type 2, le schéma basal-bolus a
l’avantage théorique d’un meilleur contrôle de la gly-
cémie postprandiale. En eff et, la dose de rapide peut
être augmentée pour couvrir les excursions glycémiques
prévisibles à la suite du “F’tour” et du “Sahour”. Dans ce
cas, il conviendra d’arrêter tout ADO insulinosécréteur.
Diabète de type1
La plupart des études portant sur les patients atteints
de diabète de type 1 ont été réalisées avec un petit
nombre de sujets, et certaines ont exclu les adolescents,
les patients âgés, ou encore les patients présentant
des comorbidités, telles qu’une insuffi sance rénale.
Les propositions de prise en charge thérapeutique ne
peuvent donc pas être généralisées à tous les cas de
diabète de type 1. De plus, il n’existe pas d’orientation
précise pour ceux qui ne font pas l’objet d’un schéma
basal/bolus.
En général, les patients diabétiques de type 1, surtout
ceux avec un équilibre glycémique précaire et/ou inca-
pables de vérifi er leur glycémie plusieurs fois par jour,
sont à haut risque de développer des complications
sévères et doivent être fortement dissuadés de jeûner
pendant le ramadan (23).
Les patients qui ne présentent pas de contre-indications
(tableau I, p. 339) devraient malgré tout faire l’objet
>>>

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XVII - n° 10 - décembre 2013
343343
Diabète et ramadan
d’une évaluation médicale complète au moins 1 mois
avant le début du ramadan et bénéfi cier d’une séance
d’éducation thérapeutique. Cette évaluation devrait
inclure un examen physique complet, ainsi qu’une
évaluation du contrôle métabolique (glycémie à jeun,
profi l lipidique, HbA1c, créatinine, microalbuminu-
rie). L’importance du respect des recommandations
de style de vie devrait également être soulignée pour
les patients souhaitant jeûner. Les médecins peuvent
envisager de voir les patients diabétiques de type 1 qui
observent le jeûne du ramadan une, voire 2 fois par
semaine pour l’adaptation du schéma thérapeutique.
L’adaptation des doses reste individuelle. Il est recom-
mandé d’utiliser un schéma basal-bolus avec réduction
de 20 % des doses habituelles. Il faut préférer la combi-
naison d’un analogue ultralent (à raison de 60 % de la
dose totale) et d’un analogue rapide (40 %) administré à
2 occasions, 1 au “Sahour” et 1 au “F’tour”. Une autosur-
veillance glycémique accrue, des ajustements réguliers
des doses d’insuline ultrarapide ainsi que la familiari-
sation avec le calcul des glucides seront d’une grande
aide pour obtenir un contrôle glycémique optimal
sans la contrepartie d’une hypoglycémie (23). Pour les
patients traités par pompe à insuline, plusieurs études
ont conclu que le jeûne du ramadan était réalisable, et
ce sans nécessairement d’hypoglycémie sévère, à la
condition toutefois d’une surveillance rapprochée (24,
25). La visite d’un prestataire de service peut s’avérer
d’une aide importante.
Durant la journée et à distance des repas, une glycémie
inférieure ou égale à 1,20 g/l doit amener le patient à
réduire le risque d’hypoglycémie en rapprochant les
contrôles glycémiques et en arrêtant toute activité phy-
sique intense ou même modérée. La survenue de symp-
tômes ou d’une glycémie inférieure ou égale à 0,70 g/l
pose l’indication d’un “resucrage” et la nécessité de
rompre le jeûne. Si la glycémie s’élève au contraire à
plus de 2,5 g/l, le patient doit rechercher la présence de
corps cétoniques et pourra éventuellement procéder à
une injection d’insuline de correction, selon une poso-
logie déterminée par avance avec son médecin (26).
Ramadan et grossesse
La grossesse se caractérise par un état d’insulinorésis-
tance accrue. Bien que la controverse persiste, jeûner
pendant la grossesse peut mener à un risque élevé de
morbi-mortalité maternofœtale, ainsi qu’à des désordres
métaboliques à long terme en raison de l’exposition au
stress métabolique intra-utérin lié au jeûne (le fameux
concept de programmation fœtale) [27-31]. Le Coran
indique que les femmes enceintes sont exemptées
de jeûne. Malgré tout, certaines patientes (présentant
un diabète de type 1, de type 2, ou encore un diabète
gestationnel) insistent pour jeûner pendant le rama-
dan. Ces femmes constituent un groupe à haut risque
de complications maternofœtales directement lié au
mauvais contrôle glycémique, comme l’a montré l’étude
HAPO (32). Par conséquent, ces femmes doivent être
informées de la contre-indication du jeûne. Si elles
persistent dans leur projet de jeûne, une surveillance
rapprochée et une prise en charge intensive devront
être mises en place (26).
Concernant le traitement insulinique, les analogues
rapides et, depuis peu, les analogues ultralents peuvent
être utilisés durant la grossesse avec une sécurité d’em-
ploi satisfaisante.
La sécurité d’emploi de l’insuline NPH, à raison de 1 ou
de 2 injections par jour, pendant le ramadan a été jugée
satisfaisante chez 24 femmes enceintes diabétiques qui
insistaient pour jeûner, dans une étude prospective. En
outre, près de 80 % des femmes ont été en mesure de
jeûner pendant plus de 15 jours sans aucune hypogly-
cémie ni atteinte fœtale, avec un équilibre glycémique
acceptable. Néanmoins, la petite taille de l’échantillon
ainsi que l’absence d’évaluation des eff ets périnataux et
à long terme doivent inciter à la prudence dans l’inter-
prétation de ces résultats (33).
Avant le ramadan, il est essentiel d’interroger ces
patientes sur leur intention de jeûner, d’évaluer leur
état de santé (équilibres métabolique et glycémique,
développement fœtal), et de les informer sur les risques
considérables liés à un mauvais contrôle glycémique
afi n de les dissuader de jeûner, ou tout au moins de
les accompagner pendant la grossesse. Idéalement,
les patientes devraient être orientées dans des centres
spécialisés multidisciplinaires faisant intervenir en col-
laboration obstétriciens, diabétologues, et infi rmiers
d’éducation.
Recommandations et conclusion
L’islam non seulement autorise mais recommande
aux patients diabétiques de ne pas jeûner pendant le
ramadan. Cependant, ceux qui insistent pour le faire
malgré la contre-indication médicale doivent faire
l’objet d’une prise en charge spécifi que grâce à une
coordination entre diabétologue, médecin traitant et
infi rmier d’éducation. Ainsi, les patients motivés pour
observer le jeûne devraient bénéfi cier au préalable d’un
programme d’éducation thérapeutique. Des conseils
relatifs à l’équilibre alimentaire, l’exercice physique
 6
6
1
/
6
100%