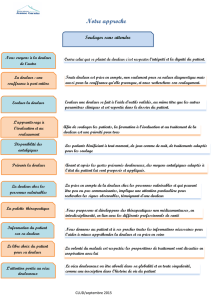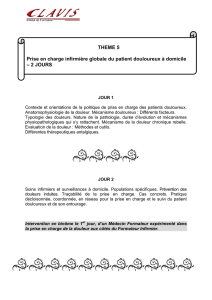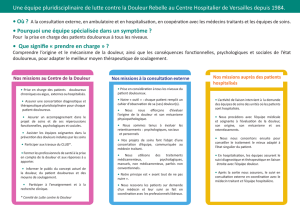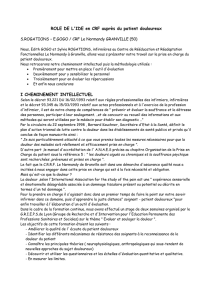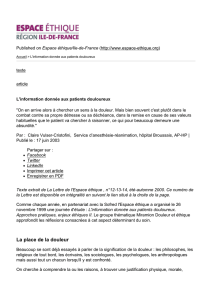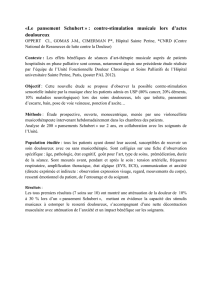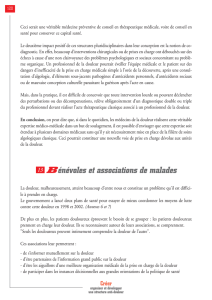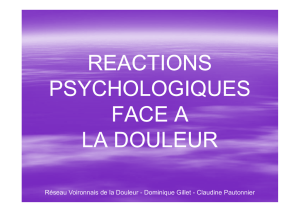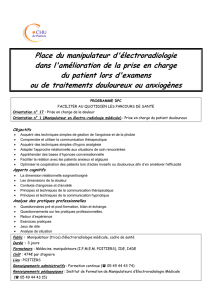FLORILÈGE 2001
46
La Lettre du Gynécologue - n° 268 - janvier 2002
e périnée fait l’objet d’un investissement lourd sur
les plans culturel, affectif, émotionnel et sexuel. Les
patient(e)s qui souffrent de douleurs périnéales chro-
niques sont souvent en détresse psychologique, en particulier
lorsque aucune cause lésionnelle n’a été identifiée. Nombre de
ces patients ont des difficultés ou des réticences pour parler de
leurs symptômes à leurs proches et même, parfois, à leur
médecin. Ils redoutent de s’entendre dire qu’ils n’ont rien et
que la douleur est “psychosomatique”. Si certains de ces
patients présentent une détresse psychologique, une véritable
pathologie psychiatrique, répondant à des critères psychopa-
thologiques positifs, n’est toutefois en cause que très excep-
tionnellement. Une anxiété ou une humeur dépressive sont fré-
quemment mises en évidence : elles sont probablement plus
souvent une conséquence qu’une cause de la douleur chro-
nique. Elles s’amendent en général rapidement lorsque le trai-
tement de la douleur est efficace. Le stress génère à la fois des
contractures musculaires et une hypertonie sympathique qui
peuvent participer à une hypertonie urétrale, par exemple, ou à
une dyschésie. En pratique, il importe peu que les difficultés
psychologiques soient considérées comme une conséquence ou
comme une cause de la douleur; elles sont là, constituent
ensemble un “système” et doivent donc faire l’objet d’une
réponse de la part d’un médecin souvent mal formé pour cela.
Face à la douleur d’un être vivant, en pratique clinique comme
en physiologie, faire la part de la souffrance psychique et de
ses manifestations somatiques ou séparer une agression tissu-
laire de ses répercussions psycho-affectives est impossible.
Dans un contexte social et culturel qui valorise la “perfor-
mance”, la douleur “physique” (si tant est que cette expression
ait un sens car, par définition, la douleur est une émotion) est
vécue par les patients et par les médecins comme une fatalité :
lorsqu’une cause est identifiée, la “réalité” du symptôme
confère une “légitimité” à la plainte. La cause du mal est, en
quelque sorte, extériorisée. Le patient qui la subit est disculpé.
En revanche, lorsque la douleur paraît disproportionnée par
rapport à la lésion tissulaire supposée être causale, le patient
est d’emblée suspect, bientôt coupable : le mal est dans sa tête,
c’est-à-dire fantasmé comme illégitime et socialement inaccep-
table. Il le sait, et tentera donc de faire alliance avec le méde-
cin pour éviter une “psychologisation” de la souffrance. Pour
le médecin, il est tout à la fois plus facile, moins fatigant, plus
rapide, plus gratifiant, mieux rémunéré, toujours mieux
accepté par le patient et généralement plus conforme à sa for-
mation de traquer inlassablement LA cause, en multipliant les
examens complémentaires et les avis spécialisés, que d’abor-
der les dimensions psychologique, émotionnelle, comporte-
mentale et sociale de la douleur. Si cette quête reste vaine, une
double culpabilité risque fort de s’installer, susceptible d’alté-
rer gravement la relation médecin-malade : renvoyé douloureu-
sement à son impuissance, le (mauvais) médecin est tenté de
rejeter sur le (mauvais) patient la responsabilité de l’échec du
diagnostic et/ou du traitement. Comme le souligne Gérard
Ostermann, le risque est alors celui d’un rejet mutuel ou d’une
escalade iatrogène dans un désir commun de soulagement à
tout prix. Nous savons pourtant que la même lésion tissulaire
ne suscite pas la même émotion douloureuse chez deux
patients différents ou chez un même patient à des moments dif-
férents ou dans des conditions différentes d’environnement. De
nombreux facteurs sont capables de faciliter ou d’empêcher la
transmission des messages nociceptifs, voire de les transformer
: l’humeur, les émotions, le stress, l’équilibre affectif, l’acti-
vité, la qualité du sommeil, l’équilibre hormonal... La mémoire
d’expériences antérieures, la culture, l’état de l’environnement,
etc., sont susceptibles d’avoir une influence sur la nociception.
Notre cerveau n’élabore l’émotion douloureuse à partir
d’informations d’origine nociceptive qu’après les avoir “inté-
grées”, c’est-à-dire évaluées, comparées avec d’autres informa-
tions présentes dans la mémoire, confrontées avec notre état
émotionnel, avec notre environnement (l’existence d’un danger
éventuel, la possibilité ou non d’un secours, d’une fuite salu-
taire...). L’affect “douleur” n’est donc pas directement le reflet
de l’agression subie, il est aussi celui de notre histoire person-
nelle, culturelle et sociale, passée, présente et à venir. La dou-
leur ressentie pourrait être considérée comme la somme de la
souffrance passée, de la douleur actuelle et de l’anticipation
sur la douleur à venir. Par ailleurs, une douleur qui dure long-
temps a nécessairement des répercussions émotionnelles et
psychologiques: fatigue et troubles du sommeil, désabusement
lié à l’inactivité, sentiment de dévalorisation, tendance au repli
sur soi, pouvant aller jusqu’à une véritable dépression. Celle-ci
aggrave encore la douleur en diminuant les possibilités de
modulation de la nociception. Il est possible d’expliquer au
douloureux que ces conséquences de la douleur sont “nor-
males”, que c’est, au contraire, l’absence d’un retentissement
émotionnel, psychologique et relationnel qui ne le serait pas.
Douleurs périnéales : la relation médecin-malade
●M. Bensignor*
L
* Unité d’évaluation et traitement de la douleur, clinique Viaud, 40, rue
Fontaine de Barbin, 44000 Nantes. Tél. : 02 40 37 26 26. Fax : 02 40 37 26 50.
E-mail : [email protected]

L’ÉCOUTE
Une écoute attentive et bienveillante est la première étape
indispensable. Pouvoir parler de sa souffrance, se sentir
entendu, reconnu, peut déjà être un soulagement. Formés dans
la perspective d’une médecine interventionnelle et activiste,
nous avons du mal à concevoir que la demande du douloureux
puisse parfois se limiter à pouvoir dire sa plainte (porter
plainte).
UNE ÉVALUATION QUANTITATIVE ET QUALITATIVE
Une évaluation convenable doit concerner non seulement
l’intensité de la douleur, mais aussi les mécanismes en cause :
mettre en évidence une lésion qui rendrait possible un traite-
ment étiologique devrait, bien entendu, constituer une priorité,
même pour un “psy”. Il convient de préciser la date et les cir-
constances du début, les caractéristiques de la douleur, les
modalités d’aggravation et d’amélioration. Les stratégies
d’adaptation du comportement sont aussi utiles à connaître :
elles permettent souvent de se faire une idée des résistances au
changement et des motivations à évoluer. Les signes associés,
les antécédents, le contexte psychologique familial et social
doivent être notés. Les différents examens cliniques et complé-
mentaires doivent être passés en revue ainsi que les traitements
antérieurement essayés et leurs résultats.
LA RELATION MÉDECIN-PATIENT
Établir une relation de qualité nécessite le respect de quelques
principes.
Croire le patient : il est indispensable de croire a priori à la
réalité de la douleur du patient. Laisser entendre à un doulou-
reux que, d’après les radios et le scanner, il ne devrait pas
avoir aussi mal qu’il le dit, est aussi absurde et improductif
que de lui signifier qu’il n’est pas possible qu’il ait un jour
éprouvé du plaisir en compagnie de son conjoint puisque ce
dernier n’est objectivement pas très attirant ! De plus, même si
le médecin n’a pas toujours un tiroir diagnostique accessible
pour faire cadrer la plainte avec son savoir, le douloureux se
connaît souvent mieux que personne et il peut avoir des idées
précises sur la cause de son mal, susceptibles de faire évoluer
les connaissances médicales.
Éviter de rendre le patient responsable de l’échec : une
réaction de suspicion vis-à-vis du patient qui résiste au traite-
ment est tentante et délétère : “Si mon (bon) traitement ne
donne rien, je ne peux pas être responsable, c’est donc de la
faute du (mauvais) patient qui résiste au pouvoir légitime de
guérir que me confère mon doctorat !” Même non prononcée,
cette suspicion est immédiatement traduite en langage non ver-
bal et décodée par le patient : “Je ne peux plus faire confiance
à mon médecin puisqu’il ne me croit pas.”
Ne pas surestimer les bénéfices secondaires : dans une situa-
tion non voulue mais qui dure malgré lui, le patient, dans une
logique adaptative, tente de profiter de certains bénéfices
secondaires (arrêt de travail, prise en charge à 100 %, pension,
réaménagement de l’équilibre familial...). Ceux-ci peuvent
renforcer les résistances au traitement. Ils ne sont toutefois que
rarement le facteur principal d’entretien du syndrome doulou-
reux. Leur rôle dans la pérennisation de la douleur ne doit être
évoqué qu’avec prudence sous peine d’altérer durablement la
relation médecin-malade.
Éviter de rendre le patient dépendant : devant un patient
qui tente de vous placer sur un piédestal : “je n’ai plus
confiance qu’en vous... vous êtes mon dernier recours...”, il
vaut mieux conserver une “position basse”. Se présenter
comme l’homme providentiel d’une situation désespérée
contribue à maintenir le patient dans un état de dépendance. Si
l’évolution n’est pas favorable, il peut être très délicat de se
dégager d’une “position haute” avec un patient déçu, sans
s’engager dans une escalade iatrogène dans le désir commun
d’un soulagement à tout prix.
Réinterpréter les symptômes : les univers conceptuels des
médecins et des patients sont parfois assez éloignés. Il est sou-
vent utile d’inciter le patient à exprimer son interprétation des
causes et des mécanismes d’entretien de sa douleur, pour
tâcher de rectifier en termes clairs et compréhensibles pour lui
les concepts erronés. Ceux-ci peuvent être fondés sur des fan-
tasmes, sur le langage d’organicistes forcenés ou de “psy”
interprétatifs consultés précédemment, sur des comptes rendus
d’imagerie qui trouvent généralement quelques particularités à
décrire, sans que leur responsabilité directe dans le syndrome
douloureux puisse toujours être affirmé avec certitude, fré-
quemment aussi sur quelques clichés simplistes complaisam-
ment véhiculés par les médias.
Se demander “comment” la douleur dure plutôt que
“pourquoi ?”
Lorsqu’un individu se trouve confronté à des difficultés qui
durent et se répètent en dépit de sa volonté et de ses efforts
pour modifier la situation, la question posée est : que faut-il
faire pour changer cette situation ? Répondre à cette question
implique de s’interroger au préalable et d’interroger le patient
sur les facteurs qui contribuent à entretenir cette situation.
Demander pourquoi la douleur perdure conduit inévitable-
ment à invoquer l’anxiété, la fatigue, la perte de l’estime de
soi, les difficultés familiales et sociales. Cette formulation
implique plus ou moins une relation de causalité et la suspi-
cion que la douleur vient de l’intérieur. Nous avons vu que ces
représentations sont socialement inacceptables et qu’il
convient “d’externaliser” la cause du mal. Dans ce contexte, il
est plus productif de (se) demander comment cette situation
non voulue persiste, comment les tensions, la lassitude,
l’agressivité contribuent à amplifier la douleur. Le dialogue
peut alors se nouer dans un climat plus serein, hors de toute
culpabilité, en envisageant non un enchaînement de causes et
d’effets, mais un système complexe dans lequel les différents
éléments interagissent naturellement. Il est alors plus facile
d’envisager que la modification d’un (ou a fortiori de plu-
sieurs) des facteurs en cause puisse contribuer à faire évoluer
47
La Lettre du Gynécologue - n° 268 - janvier 2002

FLORILÈGE 2001
48
La Lettre du Gynécologue - n° 268 - janvier 2002
l’ensemble du système. Le potentiel dynamique de cette ques-
tion est beaucoup plus fort car, en éliminant suspicion et cul-
pabilité, elle ouvre des perspectives thérapeutiques.
FAIRE PRÉCISER LA DEMANDE
La demande initiale est, en règle, celle du bon traitement radi-
cal d’une cause unique non ou mal identifiée supposée être à
l’origine de la douleur. L’éradication de la cause devrait néces-
sairement aboutir à la disparition des troubles. Or, le problème
n’est souvent pas si simple. Il importe donc d’aider le patient à
reformuler sa demande et surtout à infléchir ses espérances
vers des objectifs plus réalistes et moins enthousiasmants :
diminuer l’intensité de la douleur, la profondeur de la souf-
france, identifier et prendre en considération dans le projet thé-
rapeutique les facteurs de comorbidité associés (anxiété,
dépression, difficultés relationnelles, affectives, sociales et
professionnelles). En préalable à toute tentative de traitement,
il importe de préciser quelle est la demande exprimée du
patient et ce qui se cache derrière cette demande. Si la
demande est réaliste, compte tenu du sujet (de sa personnalité,
de ses structures névrotiques, de la pathologie en cause), de
son histoire, de son environnement, de ses désirs, des possibi-
lités de la médecine, de la psychologie, de la société, comment
y répondre ? Sinon, comment renégocier la demande pour
aider le patient à mettre en place des éléments de réponse ?
ÉTABLIR UN CONTRAT
La satisfaction que le patient est susceptible de tirer du traite-
ment dépend en grande partie de ce qu’il en espère. En
l’absence d’un objectif clairement défini et mesurable, le but
implicite du traitement est la guérison. Comme en matière de
douleur chronique, celle-ci est rarement obtenue, la déception
réciproque est prévisible. Un contrat thérapeutique doit définir
de manière précise les éléments suivants:
Les objectifs, qui ne doivent pas se limiter à une diminution
de l’intensité de la douleur (subjective), mais comporter des
critères fonctionnels réalistes et mesurables. La réalisation de
ces objectifs permet au patient de s’engager dans une dyna-
mique de changement, de constater que tout n’est pas inexora-
blement “toujours pareil”.
Les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs
négociés.
Tant les objectifs que les moyens peuvent être renégociés aux
différentes étapes de la prise en charge, en fonction de ce qui a
(ou n’a pas) changé.
Cet entretien réclame beaucoup de temps, de tact et d’énergie.
Il est difficile pour le praticien comme pour le patient. Mais de
sa qualité peut dépendre la capacité du douloureux à mobiliser
ses propres ressources et à s’orienter d’une logique de stagna-
tion, d’attentes irréalistes toujours déçues d’un traitement radi-
cal et de frustrations, vers une perspective de réadaptation :
comment diminuer l’intensité de la douleur, accepter les
inconvénients des traitements, comment faire mieux, faire plus
malgré la douleur, faute de pouvoir faire sans… L’issue de la
prise en charge à long terme est largement conditionnée par la
qualité de la relation médecin-malade, qui repose elle-même
sur la qualité des entretiens initiaux. Cet entretien devrait per-
mettre d’éviter les inconvénients de deux attitudes également
néfastes qui consistent soit à répondre au coup par coup aux
symptômes dans une escalade iatrogène en sous-estimant les
facteurs de comorbidité associés, soit à considérer prioritaire-
ment les facteurs affectifs psychologiques, émotionnels et
comportementaux en méconnaissant une pathologie doulou-
reuse identifiable et curable. Une prise en charge en relaxation
peut être indiquée; elle est susceptible de constituer une étape
vers une thérapie comportementale ou une psychothérapie plus
en profondeur pour lesquelles les douloureux ne sont générale-
ment pas spontanément demandeurs.
CONCLUSION
La dimension psycho-affective de la douleur doit occuper sa
juste place. Trop de patients sont considérés comme ayant des
douleurs psychogènes parce qu’une anomalie n’a pu être
objectivée par la clinique ou par les examens complémen-
taires. Il existe suffisamment de données pour démanteler le
cadre vague de douleurs périnéales sine materia qui devient un
diagnostic rare lorsque le patient est convenablement interrogé
et exploré. Il n’y a nul doute que d’autres progrès viendront
encore préciser la démarche diagnostique et, par conséquent, la
thérapeutique. ■
POUR EN SAVOIR PLUS...
❒Ferragut E. La dimension de la souffrance chez le malade douloureux chro-
nique. Masson éd. Paris 1994.
❒O’Hanlon WH, Weiner-Davis M. L’orientation vers les solutions. Satas,
Bruxelles 1995.
❒Queneau P, Ostermann G. Le médecin, le patient et sa douleur. Masson éd.
Paris 1995.
❒Watslawick P. Le langage du changement. Éléments de communication thé-
rapeutique. Point Seuil 1980.
© Correspondances en Pelvi-Périnéologie – n°1 – mars 2001
1
/
3
100%