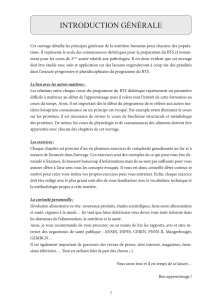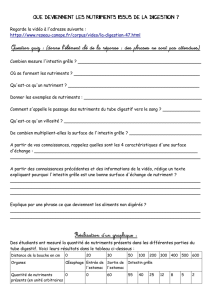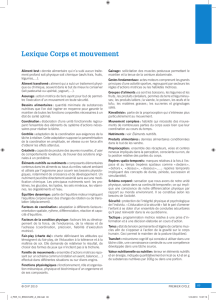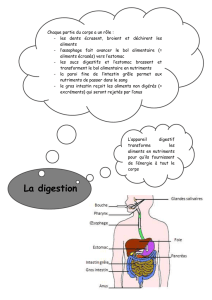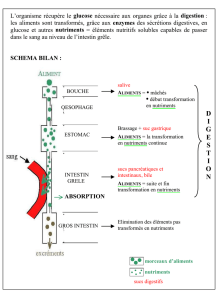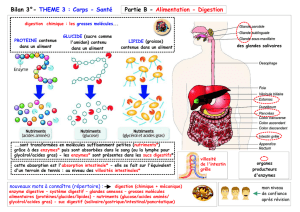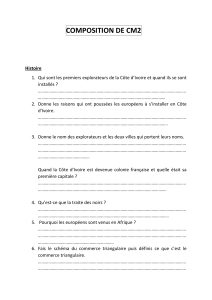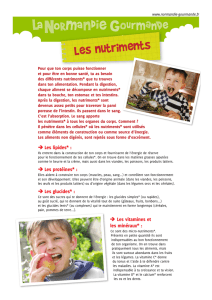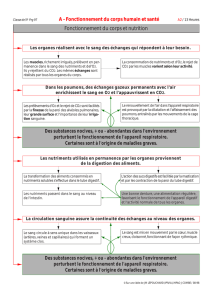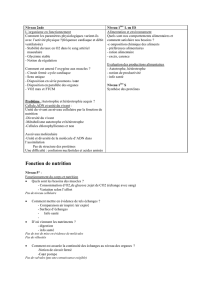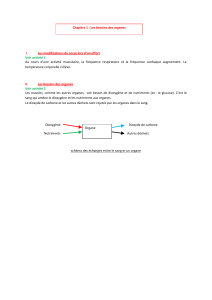Un enfant a le droit d’être nourri
correctement, en recevant une
alimentation complète (donnée
qualitative) et suffisante
(1)
(donnée
quantitative).
LA « COMPLÉTUDE »
DE L’ALIMENTATION
Est complet l’aliment qui apporte tous
les nutriments indispensables – dits aus-
si essentiels – au sens nutritionnel du
terme : molécules nécessaires à l’entre-
tien, au fonctionnement et à la croissan-
ce de l’organisme que celui-ci ne sait
pas synthétiser et que l’alimentation
doit donc apporter (vitamines, miné-
raux, certains acides aminés et acides
gras). Les autres nutriments sont dits
banals, ce qui ne veut pas dire inutiles :
ils apportent notamment les calories.
Un aliment complet peut être utilisé
comme aliment unique. Le lait maternel
en est l’archétype. Philosophiquement,
il est d’ailleurs difficilement acceptable
que l’enfant nourri au sein doive rece-
voir un complément de vitamines D et
K. Les préparations industrielles pour
nourrissons, souvent dénommées pre-
mier âge, sont des aliments complets.
Quant aux préparations de suite, la ré-
glementation précise qu’elles « consti-
tuent le principal élément liquide d’une
alimentation progressivement diversi-
fiée ». Elle ne leur impose donc pas
d’être des aliments complets. Mais les
industriels font souvent en sorte
qu’elles le soient. On le vérifie en com-
parant les compositions en nutriments
essentiels de la préparation premier âge
et de la préparation de suite, souvent
dénommée deuxième âge, d’une même
marque : en général, les différences
sont faibles, et la préparation deuxième
âge contient bien tous les nutriments
essentiels. Moyennant cette vérifica-
tion, on peut être rassuré sur la sécurité
nutritionnelle d’un nourrisson alimenté
exclusivement avec une telle prépara-
tion de suite, par méconnaissance, mé-
Médecine
& enfance
prise ou nécessité budgétaire (échan-
tillons gratuits), ou sur celle d’un nour-
risson « passé au deuxième âge » alors
que son alimentation n’est encore que
très peu diversifiée.
Pour le grand enfant, il n’y a pas d’ali-
ment complet. Plusieurs aliments doi-
vent donc être associés dans la ration ali-
mentaire, définie comme l’ensemble des
aliments consommés en une journée. La
diversité des sources alimentaires est une
exigence vitale. C’est ce qui fait dire que
le petit de l’homme est un omnivore.
Dans de nombreux pays, la complétude
est assurée par l’adjonction à l’aliment de
base, céréale (blé, riz…) ou tubercule
(manioc), de petites quantités d’autres
aliments. En France, la notion d’aliment
de base, séculairement le pain, n’a plus
de sens aujourd’hui. La complétude de la
ration est désormais assurée par l’asso-
ciation, en quantités grossièrement équi-
valentes, d’aliments de différents
groupes, ce que certains appellent une
alimentation équilibrée. Sont classés
dans un même groupe d’aliments ceux
qui ont une parenté ou une similitude
suffisante pour pouvoir être substitués
les uns aux autres sans modifier sensible-
ment la qualité nutritionnelle de la ra-
tion. La sécurité nutritionnelle n’exige
donc pas une consommation variée des
aliments d’un même groupe. Cependant,
la prise en compte des fonctions senso-
rielle, sociale et économique de l’alimen-
tation encourage cette variété, sans qu’il
soit nécessaire, ni même possible, de
« manger de tout ».
Classiquement, les aliments qui
contiennent des taux (ou teneurs) éle-
vés (inversement faibles) d’un nutri-
ment sont dits riches (inversement
pauvres) en ce nutriment. La teneur est
exprimée par rapport à la masse de l’ali-
ment (taux pour 100 g ou concentra-
tion), quelquefois par rapport à sa mas-
se sèche, ou encore par rapport à sa va-
leur énergétique (taux pour 100 kcal,
souvent appelée densité nutritionnel-
le)
(2)
. « Aliment riche, alimentation trop
riche », sans autre précision, sont des
La sécurité nutritionnelle
V. Boggio, CHU Dijon
ALIMENTATION
Rubrique dirigée par V. Boggio
février 2012
page 55
144823 55-58 16/02/12 21:30 Page55

l’âge), correspondant approximative-
ment aux besoins moyens de la popula-
tion. Les AJR sont utilisés pour l’étique-
tage des produits alimentaires et per-
mettent de réglementer certaines allé-
gations nutritionnelles sur les étiquettes
alimentaires. Ainsi, « source de X » signi-
fie que la teneur en X, pour 100 g de
l’aliment ou 100 kcal apportées par ce-
lui-ci, est au moins égale à une valeur
réglementaire exprimée en pourcentage
de l’AJR ; « riche en… » signifie que l’ali-
ment contient deux fois ou plus la va-
leur définie pour « source de… ».
Les ANC n’ont pas de portée individuel-
le. Certes, un enfant qui reçoit l’ANC de
tous les nutriments (si tant est que cela
soit possible) bénéficie d’une sécurité
nutritionnelle absolue. Mais un apport
inférieur à l’ANC (situation fréquente
pour le fer et le calcium) n’est pas néces-
sairement insuffisant pour un enfant
donné. En référence à un ANC de 100,
l’enfant dont l’apport est de 90 court un
(tout petit) risque que cet apport soit in-
suffisant pour lui, c’est-à-dire inférieur à
son propre besoin. Le risque est plus
grand si l’apport est de 65. Déduire des
résultats d’une enquête de consomma-
tion alimentaire que 50 % des enfants
ont un apport insuffisant parce que 50 %
ont un apport inférieur à l’ANC est in-
exact
(5)
. Parler de carence pour un en-
fant dont l’apport est inférieur à l’ANC
est un abus. La carence exige une ano-
malie clinique (carence clinique), bio-
chimique ou histologique (carence bio-
logique, précarence, subcarence).
DES ADAPTATIONS
SÉCURISANTES
La probabilité que tous les apports en
nutriments essentiels d’un enfant qui re-
çoit une alimentation complète soient
suffisants augmente avec la quantité de
nourriture qu’il ingère. Ainsi un enfant
ingère davantage de fer si son apport
énergétique est plus élevé. Or, un apport
énergétique élevé (enfant « beaucoup
mangeur ») résulte d’une dépense éner-
gétique élevée
(6)
. Comme la dépense
énergétique des enfants (et des adultes)
chiche, pauvre en méthionine, et la se-
moule de blé dur, pauvre en lysine, se
valorisent. La complémentation espérée
nécessite l’ingestion de ces deux pro-
téines dans le même repas, mieux dans
le même plat (exemple : couscous). Ain-
si les acides aminés résultant de leur di-
gestion parviennent simultanément
dans le sang, donc dans le pool des
acides aminés, lequel alimente les syn-
thèses protéiques de l’organisme. Cette
complémentation n’a plus grand intérêt
chez l’enfant occidental, dont les ap-
ports protéiques sont rarement inquié-
tants, mais le monde n’est pas réduc-
tible à son occident.
BESOINS NUTRITIONNELS
ET APPORTS CONSEILLÉS
Un enfant doit donc recevoir une ali-
mentation complète. Elle doit aussi être
suffisante pour couvrir les besoins nutri-
tionnels. Ceux-ci ne sont déterminés que
pour les nutriments indispensables : on
peut définir un besoin en vitamine C,
non un besoin en lactose. Les besoins
nutritionnels dépendent de l’âge. Com-
me la plupart des données biologiques,
les besoins nutritionnels individuels en un
nutriment donné sont généralement dis-
tribués, à chaque âge, selon une courbe
gaussienne autour du besoin nutritionnel
moyen. Cette variabilité interindividuel-
le du besoin est liée aux variabilités du
coefficient d’utilisation digestive du nu-
triment (rapport absorbé/ingéré), de sa
biodisponibilité et de son métabolisme.
L’apport nutritionnel conseillé (ANC) est
défini pour chaque nutriment et pour
différentes tranches d’âge en ajoutant
deux écarts types au besoin nutritionnel
moyen, de façon à couvrir la quasi-tota-
lité des besoins individuels
(3)
. L’ANC a
donc une portée collective
(4)
. Ainsi, en
France, presque tous les enfants ont un
apport en protéines supérieur à l’ANC,
et la malnutrition protéique par carence
d’apport est exceptionnelle.
Les ANC peuvent être confondus avec
les AJR (apports journaliers recomman-
dés), valeurs de référence plus gros-
sières (ils ne tiennent pas compte de
expressions ambiguës, donc décon-
seillées, car elles renvoient tantôt aux
calories, tantôt aux nutriments essen-
tiels, quand ce n’est pas au portefeuille
ou à une sorte d’impression subjective
et moralisante.
La pauvreté en un nutriment des ali-
ments d’un groupe est compensée par la
richesse en ce nutriment des aliments
d’un ou plusieurs autres groupes. Il est
donc souhaitable que tous les groupes
contribuent à la ration. Mais aucun nu-
triment n’est spécifique d’un groupe, de
sorte que l’éviction d’un groupe d’ali-
ments, par intolérance digestive, dé-
goût sensoriel ou choix philosophique
(exemple : le végétarisme), a rarement
des conséquences nutritionnelles
graves. Par contre, l’éviction de deux
groupes rend aléatoire la sécurité nutri-
tionnelle. Elle peut être dangereuse
chez l’enfant (exemple : le végétalisme,
qui exclut le groupe des viandes, des
poissons et des œufs et le groupe des
produits laitiers).
La capacité de l’organisme à stocker et à
déstocker les nutriments lui évite d’être
en péril quand la ration (alimentation
d’une journée) est incomplète. Cepen-
dant il est plus simple de promouvoir la
consommation d’une ration complète
chaque jour, mais non une complétude
à chaque repas. Ainsi le fer et le calcium
sont bien des nutriments essentiels,
mais il n’est pas primordial pour la syn-
thèse de l’hémoglobine et l’accrétion
calcique dans l’os qu’ils soient absorbés
par la paroi de l’intestin simultanément
et plusieurs fois par jour. Par consé-
quent, celui qui encourage la prise d’un
petit-déjeuner n’est pas obligé de préci-
ser « complet ». On en viendrait à
conseiller un goûter complet, un apéri-
tif complet (ça se vend déjà), voire un
grignotage complet. Publicité : « la bar-
re multivitaminée X, l’aliment le plus
complet si vous avez un petit creux ».
Exception. Soit deux protéines de faible
qualité nutritionnelle, chacune étant
pauvre en un acide aminé essentiel, ap-
pelé facteur limitant. Leur association
améliore leurs qualités nutritionnelles,
à condition qu’elles n’aient pas le même
facteur limitant. C’est ainsi que le pois
Médecine
& enfance
février 2012
page 56
144823 55-58 16/02/12 21:30 Page56

a diminué au 20esiècle, leur apport
énergétique a diminué également, d’où
le paradoxe nutritionnel des sociétés
riches (au sens propre), « bien nourries »
mais sédentaires : les apports en nutri-
ments essentiels diminuent et peuvent
devenir insuffisants comme dans les so-
ciétés « mal nourries » qui manquent
d’aliments.
Heureusement des adaptations physio-
logiques, comportementales ou socié-
tales se conjuguent pour assurer la sé-
curité nutritionnelle d’un enfant, même
si son apport énergétique est faible (en-
fant « peu mangeur »).
첸
Pour la plupart des nutriments, une
adaptation physiologique efficace et so-
lide rentabilise un faible apport, notam-
ment en augmentant l’absorption ou en
réduisant l’excrétion du nutriment. Ain-
si sa disponibilité est accrue. Une telle
adaptation (il s’agit plutôt d’une régula-
tion) utilise des mécanismes de rétro-
contrôle négatif, nombreux en physiolo-
gie. Elle explique qu’un apport très infé-
rieur à l’ANC ne s’accompagne pas né-
cessairement d’une carence.
첸
L’ajout intentionnel et contrôlé d’un
nutriment à la ration est la façon la plus
cartésienne d’augmenter son apport.
Deux familles de termes se concurren-
cent pour exprimer un tel ajout : supplé-
ment, supplémenter et supplémentation
d’une part, complément, compléter (deve-
nu parfois complémenter) et complémen-
tation d’autre part. Certains experts ai-
meraient qu’on distingue complé(men)ter
(jusqu’à la couverture du besoin) et sup-
plémenter (apporter plus que le besoin).
Mais l’usage entretient la confusion.
Supplément évoque la thérapeutique
quand complément connote la préven-
tion ; supplément est de l’ordre du né-
cessaire et complément de l’accessoire ;
supplément s’applique mieux à une pré-
sentation médicamenteuse et complé-
ment à une source alimentaire ; supplé-
ment fait craindre un excès alors que
complément est rassurant ; supplément
concerne plus souvent un nutriment
isolé et complément un mélange pluri-
nutritif ; supplément fait plus scienti-
fique quand complément est plus écolo-
gique. Au total, dans le langage courant
comme dans la langue médicale et le
vocabulaire du commerce agro-alimen-
taire, complément tend à supplanter
supplément.
첸
La supplémentation par un nutriment
administré à hauteur de l’ANC évite à
coup sûr la carence d’apport. Elle est
parfois proposée à tous les enfants.
C’est le cas pour la vitamine D (huile de
foie de morue ou présentation galé-
nique moins odorante), ou pour la vita-
mine A (huile de palme) dans les pays
où la xérophtalmie fait des ravages.
Quand une supplémentation aveugle à
hauteur de l’ANC risque d’avoir des ef-
fets indésirables, on peut la moduler se-
lon la quantité du nutriment déjà ap-
portée par les aliments et/ou l’eau habi-
tuellement consommés par l’enfant.
C’est ce que l’on fait (ou que l’on essaye
de faire) pour le fluor.
첸
La sup-(ou com-)plémentation peut
être obtenue en enrichissant les produits
alimentaires en nutriments. « Enrichi
en… » est une expression réglementée,
comme « riche en… ». Exemple efficace,
et pourtant souvent méconnu, d’enri-
chissement : l’iodation du sel de cuisine.
Elle a fait régresser de façon spectacu-
laire la carence en iode dans tous les
pays qui ont pu l’appliquer.
첸
Les compléments alimentaires sont des
aliments commercialisés sous forme de
gélules, comprimés, ampoules, capsules,
tisanes… dont le but est de compléter
l’alimentation habituelle. Ils constituent
une source concentrée de nutriments ou
d’autres substances ayant un effet nutri-
tionnel ou physiologique. Certains sont
formulés et dosés « pour les enfants ».
Leur utilisation ne nécessite ni prescrip-
tion, ni conseil médical. Heureusement
pour le médecin ! En général, celui-ci
préfère qu’on ne lui demande pas un
avis rationnel, scientifique et documen-
té sur tel complément alimentaire qui
contient 30 (sic) substances dont 9 vita-
mines et 10 minéraux, des anthocya-
nides, du carraghénane, de l’acide ma-
lique, de l’inositol… Il serait plus à l’aise
pour cautionner un complément consti-
tué des nutriments essentiels abondants
dans un groupe d’aliments que l’enfant
exclut de sa ration, autrement dit un
complément qui proposerait : « Tout ce
qu’il y a dans les légumes, sans les lé-
gumes ». Même s’ils sont inutiles, les
compléments alimentaires sont dosés
pour ne pas être toxiques. On pourrait
donc banaliser et innocenter leur
consommation. Cependant ils ont un
coût et grèvent inutilement les budgets
fragiles. Chez l’enfant sportif, ils préfi-
gurent le dopage à l’insu de son plein
gré, puisque certains sportifs confon-
dent vitamines et hormones. Enfin, les
compléments faisant partie de la pano-
plie « minceur » de nombreuses femmes,
panoplie coûteuse et inefficace, leur
usage ritualisé dans l’éducation d’une
fillette peut perturber le jugement et le
budget de la femme qu’elle deviendra.
첸
Les mêmes aliments apportent des
nutriments essentiels et de l’énergie.
Or, l’ajustement de la quantité de nour-
riture ingérée aux besoins (souvent dé-
nommée « régulation de la prise alimen-
taire ») ne tient compte que de l’énergie.
On améliore donc la qualité nutrition-
nelle de la ration en enlevant des nutri-
ments énergétiques non essentiels,
donc de l’énergie (des calories) à un ali-
ment. En effet le mangeur en mangera
davantage, donc ingérera davantage de
nutriments essentiels, pour ingérer la
même quantité de calories. Cette sous-
traction de calories est nommée allége-
ment
(7)
. Un aliment allégé peut donc
contribuer à favoriser la sécurité nutri-
tionnelle du mangeur, même si ce que
celui-ci recherche en réalité, c’est de
pouvoir manger davantage sans devoir
dépenser davantage (de calories) pour
ne pas prendre de poids. On peut allé-
ger un aliment en calories glucidiques
en enlevant du saccharose, mais on sup-
prime alors le goût sucré attractif de
l’aliment. Habituellement on remplace
donc le saccharose par un édulcorant de
synthèse : polyol, saccharine, asparta-
me (contre-indiqué dans la phénylcéto-
nurie) ou acésulfame de potassium.
L’éventuelle toxicité de certains édulco-
rants soulève régulièrement des polé-
miques. Ils sont l’objet d’une « veille
toxicologique ». L’allégement d’un ali-
ment en calories lipidiques passe par la
soustraction d’une partie des matières
Médecine
& enfance
février 2012
page 57
144823 55-58 16/02/12 21:30 Page57

grasses, le remplacement d’un ingré-
dient par un autre moins gras, le rem-
placement du gras par une graisse indi-
gestible ou une substance qui mime
l’onctueux et la texture du gras, voire
l’adjonction d’eau ou d’air. Si l’allége-
ment contribue à la sécurité nutrition-
nelle, il présente un risque, lié à l’effet
de leurre. En effet, réglementairement,
l’allégement ne doit pas changer la na-
ture fondamentale du produit : le beurre
allégé doit ressembler à du beurre et
avoir le goût du beurre, le coca light doit
ressembler au coca et avoir le goût du
coca. Or, pour ajuster l’apport à la dé-
pense énergétique, l’encéphale utilise
des informations transmises par les or-
ganes des sens. Quand ceux-ci l’infor-
ment de l’ingestion de 20 cl d’un liquide
marron, pétillant, acide et sucré, l’encé-
phale prévoit l’arrivée de 88 kcal et en
tient compte dans l’ajustement de la pri-
se alimentaire totale. Mais s’il est trompé
par un édulcorant, que comprendra-t-il
le jour où l’aliment ne sera pas allégé ? A
long terme, la régulation de la prise ali-
mentaire peut être perturbée par ces si-
gnaux trompeurs. Certains enfants sont
peut-être devenus trop gros parce que
leurs parents, voulant éviter qu’ils le de-
viennent, leur ont donné des allégés.
Vengeance de l’organisme dupé !
첸
Finalement, pour augmenter les ap-
ports en nutriments essentiels, le plus
simple est d’augmenter la dépense éner-
gétique. Alors l’apport énergétique aug-
mente, et les apports en nutriments es-
sentiels font de même. Plus un enfant
marche, plus souvent il porte un car-
table, plus sa sécurité nutritionnelle
augmente. Le petit de l’homme est un
omnivore. C’est aussi un bipède.
첸
Médecine
& enfance
février 2012
page 58
Notes
(1)
Au 21esiècle, on parle plus souvent d’une alimentation équili-
brée et variée.
(2)
En sélectionnant l’un ou l’autre des modes d’expression, on
peut valoriser ou dévaloriser la teneur d’un aliment en ce nutri-
ment.
(3)
La détermination des ANC, réalisée par des comités d’ex-
perts, à partir de la notion de besoin nutritionnel est difficile. On
ne peut pas ôter un nutriment de la ration d’un enfant, attendre
les signes de carence et déterminer la dose du nutriment qui fait
disparaître ces signes. On doit donc s’appuyer sur des mé-
thodes indirectes, biologiques et épidémiologiques. Il reste une
part d’empirisme, qui alimente les controverses.
(4)
La notion d’ANC est parfois utilisée pour les apports énergé-
tiques. Elle a alors une autre signification. L’ANC correspond à
l’apport énergétique moyen des enfants de même âge, de mê-
me stature et de même activité physique. Cette donnée est utile
aux gestionnaires de collectivités. Par ailleurs, les recommanda-
tions sur les proportions dans la ration de lipides, saturés et insa-
turés, et de glucides, simples et complexes, sont destinées à ré-
duire les facteurs de risque de certaines maladies. On est loin de
la notion d’ANC destinés à couvrir les besoins nutritionnels.
(5)
Si les résultats de l’enquête donnent la distribution des apports
individuels observés, on peut calculer la probabilité qu’un enfant
ait un apport inférieur à son propre besoin : elle est inférieure à la
proportion des enfants dont l’apport est inférieur à l’ANC.
(6)
Que certains enfants constituent progressivement un excès
de poids en raison d’un très léger décalage entre l’apport et la
dépense énergétique ne contredit pas cette assertion.
(7) Appauvrissement
convient mieux à une diminution de la te-
neur en nutriments essentiels, laquelle n’a d’ailleurs d’intérêt
que pour le sel.
samedi 13 octobre 2012
16eJournée de pathologie infectieuse pédiatrique ambulatoire
organisée par
l’Association clinique et thérapeutique infantile du Val-de-Marne (ACTIV)
Infovac-France
et le Groupe de pathologie infectieuse pédiatrique (GPIP)
sous la direction de Robert Cohen
avec Médecine et enfance
Grand amphithéâtre, Maison de la chimie, 28 bis, rue Saint-Dominique, 75007 Paris
144823 55-58 16/02/12 21:30 Page58
1
/
4
100%