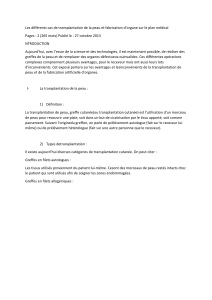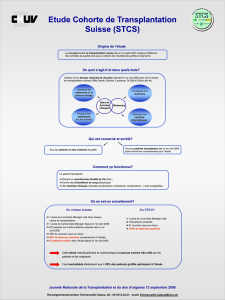Lire l'article complet

DOSSIER THÉMATIQUE
La lettre du l’hépato-gastroentérologue - n° 5 - vol. IV - octobre 2001 237
Suivi à long terme du transplanté hépatique
●C. Vanlemmens, S. Bresson-Hadni, J.P. Miguet, B. Heyd, G. Mantion*
a transplantation hépatique (TH) fait aujourd’hui partie
intégrante de l’arsenal thérapeutique des hépatopathies
chroniques évoluées. Dans les pays industrialisés, le
nombre de TH effectuées chaque année est de l’ordre de 1 pour
100 000 habitants et une TH est réalisée chez environ 5 % des
patients dont la vie est menacée par une hépatopathie chronique
(1). Les progrès constants des techniques chirurgicales et l’utilisa-
tion de nouveaux protocoles immunosuppresseurs sont à l’origine
de l’essor considérable que connaît la TH depuis plus de 15 ans
avec 30 000 TH réalisées en Europe entre 1988 et 1998. Parallèle-
ment, a émergé progressivement une population de transplantés
hépatiques dont le recul a dépassé 5 ans, voire 10 ans, avec une
survie à long terme proche de 70 % (2, 3). Cette augmentation du
recul post-TH a permis d’observer la survenue de complications
médicales jusqu’à présent méconnues, et parfois très préoccupantes.
Une meilleure connaissance et une approche thérapeutique spéci-
fique de ces complications devraient constituer une priorité dans
L
* Unité de transplantation hépatique, CHU Jean-Minjoz, Besançon.
■Une fois la première année post-transplantation hépatique
(TH) atteinte, l’espérance de vie des transplantés hépatiques
est de 80 à 90 % à 5 et 10 ans.
■Les trois principales causes de décès tardif après TH sont
la récidive de la maladie initiale, les affections
cardiovasculaires et les tumeurs de novo, alors que l’incidence
du rejet diminue avec le recul post-TH.
■Les complications médicales observées à long terme sont
essentiellement extrahépatiques, consécutives au traitement
immunosuppresseur. Une vigilance accrue du médecin assu-
rant le suivi à long terme de ces patients est indispensable, non
exclusivement focalisée sur le bon fonctionnement du greffon.
■L’hypertension artérielle, le diabète, les hyperlipidémies et
l’obésité sont les principaux facteurs de risque cardiovascu-
laire observés dans le suivi à long terme du transplanté hépa-
tique ; leur diagnostic et leur prise en charge précoces s’avè-
rent fondamentaux pour poursuivre l’amélioration des résultats
à long terme de la TH.
■Les cancers cutanés, les syndromes lymphoprolifératifs et
les sarcomes de Kaposi sont les trois tumeurs de novo (TDN)
les plus fréquentes après TH, mais l’incidence des tumeurs
solides non viro-induites est également augmentée. L’âge des
patients, le rôle de l’alcool et du tabac, certaines indications
de TH constituent des facteurs de risque supplémentaires de
TDN.
■L’insuffisance rénale chronique liée aux anticalcineurines
peut conduire à long terme à une dialyse, voire à une trans-
plantation rénale. Au-delà d’un an, 4 % des patients ont une
créatininémie supérieure à 250 µmol/l.
■L’ostéopénie constitue la plus fréquente des affections
osseuses post-TH ; son principal risque est lié à la survenue
de fractures spontanées. La décroissance rapide des corticoïdes
et un traitement vitamino-calcique sont des mesures prophy-
lactiques efficaces.
■L’intérêt de la biopsie hépatique systématique à 1 an, 2 ans,
5 ans, puis tous les 3 à 5 ans dans le diagnostic des dysfonc-
tions tardives du greffon, en particulier pour établir un dia-
gnostic précoce de récidive de la maladie initiale doit être
connu.
■L’objectif du suivi à long terme repose sur la décroissance
progressive du traitement immunosuppresseur, tout en s’atta-
chant à préserver un fonctionnement optimal du greffon. Le
suivi systématique du transplanté hépatique à long terme
consiste habituellement en deux à trois consultations annuelles.
POINTS FORTS
POINTS FORTS
HGE 5 05/11/01 12:51 Page 237

238
DOSSIER THÉMATIQUE
La lettre du l’hépato-gastroentérologue - n° 5 - vol. IV - octobre 2001
la stratégie du suivi du transplanté hépatique à long terme afin de
poursuivre l’amélioration des résultats de la TH. Dans ce chapitre,
seront développés, à cet effet, les objectifs et les modalités du suivi
médical à long terme du transplanté hépatique.
CAUSES DES DÉCÈS TARDIFS APRÈS TH
Actuellement, la majorité des décès post-TH surviennent dans les
premiers mois qui suivent la TH ; ils sont principalement dus aux
infections, conséquences de la surimmunosuppression ou, plus
rarement, à des problèmes techniques au sein desquels doit être
prise en compte la morbidité préopératoire du patient (3). Dans
la série analysant la survie à long terme de 4 000 transplantés
hépatiques de Pittsburgh, la moitié des décès, essentiellement
d’origine infectieuse, est survenue la première année. Au-delà de
deux ans, le taux de mortalité était de 1 à 4 % par an (4). Ainsi,
une fois la première année post-TH atteinte, l’espérance de vie
des transplantés hépatiques est de 80 à 90 % à 5 et 10 ans (5, 6).
Les décès survenant au-delà d’un an sont définis comme décès
tardifs. La compréhension de leur cause est fondamentale car
elle doit permettre l’identification de facteurs de risque de mor-
talité tardive.
Au-delà de la première année post-TH, les décès sont essentiel-
lement en rapport avec les complications du traitement immuno-
suppresseur, la récidive de la maladie initiale et la survenue d’af-
fections cardiovasculaires (7). Dans l’étude de Bismuth et al.
portant sur 1 052 TH, sepsis et cancers rendent à eux seuls compte
de 70 % des décès (8). La série de Asfar et al. rejoint ces résul-
tats puisque le traitement immunosuppresseur représente 40 %
des causes des décès tardifs par rejet chronique, infections ou
syndromes lymphoprolifératifs (5). La récidive de la maladie ini-
tiale sur le greffon (carcinome hépatocellulaire ou récidive de cir-
rhose virale B) représente 34 % des causes de décès, suivie par
les affections cardiovasculaires (23 % des causes de décès), dont
le délai moyen de survenue après la TH est de 4 ans.
Plus récemment, Abbasoglu et al. soulignent dans une série de
1 174 TH, la gravité potentielle de la récidive de la maladie ini-
tiale sur le greffon (carcinome hépatocellulaire ou hépatopathies
chroniques virales B ou C), première cause de décès tardif dans
leur étude (6). Les affections cardiovasculaires sont la deuxième
cause de décès, survenant dans un délai moyen de 5 ans après la
TH ; un diabète ou une cardiopathie préexistante à la TH consti-
tuent des facteurs de risque significatifs de décès tardif par affec-
tion cardiovasculaire ou accident vasculaire cérébral. Les com-
plications propres au traitement immunosuppresseur [infections,
rejet chronique, et tumeurs de novo (TDN)] arrivent en troisième
position. Comparativement aux séries plus anciennes, ce travail
met en exergue une augmentation significative de perte tardive du
greffon par récidive de la maladie initiale, et la gravité potentielle
des tumeurs et des affections cardiovasculaires observées à long
terme. Contrairement aux autres organes transplantés, la récidive
de la maladie initiale, plus que le rejet chronique, est une cause
de perte tardive du greffon, source de re-TH. Ces résultats rejoi-
gnent ceux de la récente étude de Jain concernant 1 000 TH sous
tacrolimus (3). Ses propriétés plus puissamment immunosup-
pressives par rapport à la ciclosporine A expliquent la rareté
actuelle de perte tardive du greffon par rejet. Lorsque le rejet sur-
vient tardivement, il est le plus souvent de faible intensité et faci-
lement contrôlé par le réhaussement du traitement immunosup-
presseur (9). Jain et al. confirment, dans la série des 4 000 TH de
Pittsburgh, la nette diminution d’incidence du rejet sur les 18 der-
nières années avec 13,2 % de re-TH pour rejet entre 1981 et 1985,
contre 1 % entre 1991 et 1998 (4). Cette série, qui est la plus impor-
tante en termes de recul post-TH, souligne en outre le rôle des
TDN et des affections cardiovasculaires comme causes de décès
tardif.
De façon paradoxale, pour Wiesner et al., la survenue d’un rejet
aigu de grade modéré est même significativement associée à une
amélioration de la survie du patient (10).
Ces différentes séries témoignent du rôle des affections cardiovas-
culaires comme cause possible de mortalité tardive après TH. Ainsi,
même si les affections cardiovasculaires ne sont pas une cause
majeure de décès en TH, contrairement à la transplantation rénale
où elles constituent la première cause de décès tardif, ces résultats
sont inquiétants et doivent attirer l’attention des équipes de TH.
Compte tenu de l’allongement de l’espérance de vie des transplan-
tés hépatiques, l’incidence des maladies cardiovasculaires ne pourra
que croître dans les années à venir, d’autant plus que sont acceptés
par de nombreux centres des candidats à la TH de plus en plus âgés
(11). Ces patients, de par leur âge, sont susceptibles d’être déjà por-
teurs de facteurs de risque cardiovasculaire avant même la TH. Le
suivi à long terme du transplanté hépatique sera marqué dans l’ave-
nir par la survenue de maladies liées au vieillissement physiolo-
gique auxquelles s’associeront les effets secondaires des différents
traitements immunosuppresseurs. Une série s’est intéressée à la sur-
vie à long terme des transplantés hépatiques âgés de plus de 60 ans
(12). Si la survie à court terme de ces patients était comparable à
celle des patient âgés de moins de 60 ans, la survie à long terme est
apparue en revanche moins bonne (52 % à 5 ans versus 75 %, 35 %
à 10 ans versus 60 %). La survenue de syndromes lymphoprolifé-
ratifs et de tumeurs solides représentait la première cause de décès,
sans majoration du risque de décès par affection cardiovasculaire
dans cette étude. Toutefois, les auteurs soulignent le degré particu-
lièrement élevé de sélection pré-TH des patients inclus, qui explique
la faible prévalence de décès par affection cardiovasculaire à long
terme. À Pittsburgh, le nombre de patients âgés de plus de 60 ans,
au moment de la TH, a été multiplié par 18 entre la période de 1981
à 1985 et celle de 1991 à 1998 (4). Chez ces patients, les causes de
décès sont principalement liées à l’âge, en rapport avec des affec-
tions cardiovasculaires ou respiratoires.
HGE 5 05/11/01 12:51 Page 238

La lettre du l’hépato-gastroentérologue - n° 5 - vol. IV - octobre 2001 239
DOSSIER THÉMATIQUE
COMPLICATIONS MÉDICALES À LONG TERME
Malgré l’augmentation constante du recul post-TH, les données
publiées concernant les complications médicales survenant chez
le transplanté hépatique à long terme sont bien moins connues que
celles concernant la première année post-TH (2). Alors que le fonc-
tionnement du greffon hépatique est normal dans la majorité des
cas, les complications médicales observées à long terme sont
essentiellement extrahépatiques, consécutives au traitement immu-
nosuppresseur ; le rôle du médecin assurant le suivi à long terme
de ces patients est, en ce sens, fondamental dans le diagnostic et
la prise en charge thérapeutique de ces complications. Une vigi-
lance accrue de sa part s’avère indispensable, non exclusivement
focalisée sur le bon fonctionnement du greffon hépatique.
Les facteurs de risque cardiovasculaire
Parmi les complications tardives de la TH, les facteurs de risque
de maladies cardiovasculaires que sont l’hypertension artérielle
(HTA), le diabète, les hyperlipidémies et l’obésité occupent une
place importante. Particulièrement bien étudiés en transplantation
rénale, ils ont été plus récemment individualisés après TH (13).
●L’hypertension artérielle : elle représente le facteur de risque car-
diovasculaire le plus prévalent après TH puisqu’elle concerne 50
à 70 % des patients au décours de la TH contre 6 % des malades
avant la TH (6, 14). Définie par des chiffres tensionnels supérieurs
à 140 mmHg pour la systolique et 90 mmHg pour la diastolique,
l’HTA se développe dès les premières semaines qui suivent la TH
et se poursuit alors fréquemment à long terme, malgré la réduction
des doses d’immunosuppresseurs. Le plus souvent, elle se stabi-
lise sans s’aggraver. Ainsi, à long terme, la plupart des patients
continuent à recevoir un traitement antihypertenseur (15). L’HTA
constitue un facteur de risque vasculaire majeur à long terme ; sa
gravité est liée au risque de survenue de maladie athéromateuse,
en particulier coronarienne. Les corticoïdes et les inhibiteurs de la
calcineurine en sont les deux facteurs déclenchants indépendants
mais le rôle des anticalcineurines semble prépondérant (6, 15).
L’arrêt des corticoïdes à long terme, généralement proposé, est rare-
ment suffisant pour contrôler l’HTA qui persiste le plus souvent
(15). La ciclosporine A et le tacrolimus induisent l’HTA en inter-
férant avec la régulation locale du tonus vasculaire par le biais d’une
altération de la fonction de l’endothélium vasculaire (14, 15). La
base hémodynamique de l’HTA post-transplantation est une aug-
mentation des résistances vasculaires systémiques. Les rôles vaso-
constricteurs respectifs de l’endothéline synthétisée par les cellules
endothéliales et du thromboxane A2d’origine plaquettaire sont fon-
damentaux. La ciclosporine et le tacrolimus induisent l’HTA, en
stimulant la production d’endothéline et de thromboxane A2. Les
modifications de la fonction rénale, particulièrement sensible à la
vasoconstriction, avec réduction du débit de filtration glomérulaire,
semblent pouvoir participer à la survenue de l’HTA, mais sont insuf-
fisantes pour en expliquer la pathogénie.
Les résultats des études multicentriques comparatives ont conclu
globalement à une prévalence de l’HTA chez les transplantés
hépatiques traités par ciclosporine A comparable à celle des
patients recevant le tacrolimus (16, 17).
●Le diabète : défini par la constatation à deux reprises d’une gly-
cémie à jeun supérieure à 1,26 g/l, la survenue d’un diabète au
décours de la TH constitue un problème important, source de mor-
bidité et mortalité potentielles en raison de ses complications
micro- et macrovasculaires. Une étude a mis en évidence une
mortalité accrue des patients développant un diabète de novo com-
parativement aux autres transplantés (18) ; chez les patients dia-
bétiques, l’incidence des épisodes de rejet et des infections était
plus élevée. La prévalence du diabète après TH est comprise entre
4 et 27 % (13, 18-20).
La pathogénie du diabète post-TH est multifactorielle, mais le
rôle du traitement immunosuppresseur semble prédominant. En
plus des facteurs de susceptibilité individuelle, d’éventuelles
lésions méconnues de pancréatite chronique, constatées volon-
tiers chez les patients transplantés pour cirrhose alcoolique, peu-
vent favoriser une intolérance au glucose.
Le rôle des corticoïdes prescrits à doses élevées en post-TH immé-
diate explique l’incidence accrue du diabète durant cette période.
Ainsi, l’incidence peut passer de 35 % au décours immédiat de
la TH à 18 % chez les survivants à long terme, consécutivement
à la décroissance de la corticothérapie avec le recul post-TH (2).
D’autres équipes confirment ces résultats avec une prévalence du
diabète passant de 27 % à 1 an à 7 % à 3 ans (18). Le rôle dia-
bètogène de la ciclosporine A et du tacrolimus est négligeable
comparativement à celui des corticoïdes. Ces deux anticalcineu-
rines diminuent la sécrétion d’insuline, augmentent l’insulino-
résistance et pourraient même avoir un effet direct sur les cellules
βde Langerhans. Les premières études publiées montraient un
effet diabètogène plus marqué du tacrolimus par rapport à la ciclo-
sporine A. L’utilisation de posologies relativement plus faibles
de tacrolimus dans les études ultérieures n’a pas confirmé les
résultats initiaux, sauf dans l’étude multicentrique européenne
(17). À cinq ans de la TH, dans l’étude multicentrique améri-
caine, Wiesner et al. n’ont pas mis en évidence de différence de
glycémies, que les patients aient été traités par tacrolimus ou ciclo-
sporine A (7). La majorité des études publiées soulignent en
revanche l’intérêt du tacrolimus en raison de son effet “épargneur”
en corticoïdes.
La TH ne permet pas de corriger les diabètes préexistants à la TH
(18). Ces patients restent dans la majorité des cas insulinodé-
pendants. La persistance du diabète au décours de la TH montre
que l’insulino-résistance des cirrhotiques est probablement liée
à des facteurs extrahépatiques.
●Les hyperlipidémies : 17 à 50 % des patients développent, dans
les 2 ans qui suivent la TH, une hyperlipidémie, alors que celle-
ci ne concerne que 4 % de la population générale (2, 15, 19). Le
plus souvent, il s’agit d’une hyperlipidémie mixte de
HGE 5 05/11/01 12:51 Page 239

240
DOSSIER THÉMATIQUE
La lettre du l’hépato-gastroentérologue - n° 5 - vol. IV - octobre 2001
phénotype IIb de la classification de Frederickson particulière-
ment athérogène, associant une hypercholestérolémie (hyperCT)
et une hypertriglycéridémie (hyperTG), avec une augmentation
du LDL cholestérol. L’hyperCT et l’hyperTG sont définies par
une cholestérolémie et une triglycéridémie respectivement supé-
rieures à 2,5 g/l et 2 g/l, à au moins deux reprises.
La pathogénie des hyperlipidémies post-TH est généralement
multifactorielle, dépendant de facteurs de prédisposition géné-
tique, de l’âge ou du sexe des patients, d’un éventuel surpoids,
de l’existence ou non d’un diabète et des différents traitements
immunosuppresseurs prescrits. Une étude a mis en évidence une
fréquence d’hyperCT significativement accrue chez les femmes
transplantées hépatiques (38,7 %) par rapport à celle des patients
de sexe masculin (23 %) (9). L’influence potentielle de l’indica-
tion de TH a été constatée par les travaux de Guckelberger et al.,
où l’hyperTG était plus fréquente chez les patients transplantés
pour cirrhose alcoolique (13). Le rôle de la reprise de l’alcool
dans la survenue de cette hyperTG ne peut toutefois être formel-
lement exclu.
Les conséquences de la corticothérapie sur le métabolisme lipi-
dique sont bien connues, à l’origine d’une hyperCT ou d’une
hyperlipidémie mixte de type IIa ou IIb. Cet effet hyperlipémiant
est dose-dépendant, d’autant plus marqué que les patients reçoi-
vent des doses quotidiennes supérieures à 10-15 mg/jour (9). La
grande variabilité des résultats constatés dans la littérature en
termes de prévalence d’hyperCT après TH (13 à 40-50 %) résulte
essentiellement des différents protocoles de corticothérapie uti-
lisés. La décroissance progressive de la corticothérapie corrige
efficacement les valeurs de cholestérolémie, et explique une
moindre fréquence d’hyperlipidémie à 5 ans de la TH
(hyperCT = 13 % ; hyperTG = 15,9 %) (20).
Plusieurs séries ont souligné le rôle de la ciclosporine A dans la
pathogénie de l’hyperCT (11, 19, 21). Métabolisée par le foie, la
ciclosporine A est excrétée dans la bile où elle peut inhiber, par
le biais de la 26-hydroxylase, la synthèse des acides biliaires,
limitant ainsi l’élimination biliaire du CT. Elle pourrait aussi en
augmenter la synthèse en stimulant l’activité de l’HMG-coen-
zyme A-réductase.
Les résultats des différentes études multicentriques comparant
ciclosporine A et tacrolimus concluent globalement à une moindre
fréquence d’hyperlipidémie sous tacrolimus (16, 17). Ces résul-
tats seraient essentiellement la conséquence de l’effet épargneur
en corticoïdes du tacrolimus (13).
●L’obésité post-TH : l’obésité est définie à partir d’un indice de
corpulence, l’indice de masse corporelle (IMC), rapport du poids
en kg sur le carré de la hauteur en mètre. L’IMC est devenu la
référence internationale pour définir les valeurs seuils, à partir
desquelles on parle de surpoids (IMC compris entre 25 et
29,9 kg/m2) ou d’obésité (IMC > 30 kg/m2(22). L’obésité est
clairement associée à une réduction de l’espérance de vie en rai-
son d’un risque relatif accru de mortalité par maladies
cardiovasculaires. En TH, les conséquences à long terme à redou-
ter sont la survenue d’affections cardiovasculaires et le dévelop-
pement d’une stéatohépatite non alcoolique avec ses risques éven-
tuels de re-TH. Depuis quelques années, une prise de conscience
progressive de la gravité du problème de l’obésité se développe
au sein des différentes équipes de TH, tout particulièrement amé-
ricaines (9, 23, 24).
L’incidence de l’obésité croît avec le recul post-TH : de l’ordre
de 10 % un an après TH, elle atteint 22 % à deux ans et 35 % cinq
ans après TH. L’essentiel de la prise de poids survient en moyenne
au cours des 2 premières années. Le facteur prédictif essentiel
d’excès de poids après TH est un IMC anormalement élevé
(> 25 kg/m2) au moment du bilan pré-TH (19, 23, 24). Une étude
a mis en évidence une corrélation significative entre le statut mari-
tal post-TH et le risque accru d’obésité avec une incidence de
l’obésité de 23,3 % parmi les transplantés mariés, versus 14,8 %
chez les patients non mariés (24). L’origine de la prise de poids
après TH est vraisemblablement multifactorielle :
– correction des désordres nutritionnels liés au bon fonctionne-
ment du greffon,
– effet orexigène des corticoïdes,
– reprise modérée de l’activité physique.
Les corticoïdes prescrits à forte dose après TH participent, en fait,
à la prise de poids de tous les patients, mais n’expliquent pas que
certains transplantés prennent davantage de poids que d’autres.
À distance de la TH, l’impact de la diminution ou de l’arrêt du
traitement par corticoïdes sur la modification de la corpulence
après TH reste controversé ; certains auteurs ont observé une perte
de poids après l’interruption des corticoïdes alors que d’autres
n’ont pas confirmé ces résultats. Les conséquences de l’obésité
sur la survie après TH restent méconnues ; en effet, aucune des
séries publiées sur l’excès de prise de poids après TH n’a jusqu’à
présent réalisé d’étude de survie.
Affections cardiovasculaires
Malgré la prévalence accrue des facteurs de risque cardiovas-
culaire chez les patients transplantés hépatiques, peu de don-
nées sont disponibles dans la littérature concernant les affec-
tions cardiovasculaires après TH. Le recul encore relativement
insuffisant de la TH par rapport à la transplantation rénale ou
cardiaque pourrait expliquer en partie ce constat (2). Dans la
série concernant l’analyse des causes de décès tardif de 1 174
TH, publiée par Abbasoglu et al., les décès de cause cardiovas-
culaire ont représenté 13,8 % de l’ensemble des décès tardifs ;
ils sont survenus en moyenne à 55 ans, 5 ans après la TH (6).
La principale cause cardiovasculaire de décès était l’infarctus
du myocarde, alors que des antécédents de cardiopathie étaient
retrouvés chez 27 % des patients. La question non résolue est
de savoir si les chiffres rapportés dans cette étude correspon-
dent ou non à une incidence accrue de maladie cardiovasculaire
par rapport à celle constatée au sein d’une population non trans-
HGE 5 05/11/01 12:51 Page 240

La lettre du l’hépato-gastroentérologue - n° 5 - vol. IV - octobre 2001 241
DOSSIER THÉMATIQUE
plantée d’âge et de sexe comparables. Dans une autre étude,
concernant un nombre de patients beaucoup plus faible (163),
4,9 % des patients ont développé une affection cardiovasculaire
en moyenne 2,6 ans après la TH, sans aucun antécédent connu
d’affection cardiovasculaire (20). Aucun des patients n’est
décédé des suites d’une affection cardiovasculaire au décours
de la TH. Le facteur de risque cardiovasculaire le plus fréquent
était l’HTA, qui affectait 87,5 % de ces patients.
Au sein de la population générale, les facteurs de risque de coro-
naropathie sont actuellement bien définis (tableau I). La présence
d’au moins deux de ces facteurs est corrélée à un risque élevé de
coronaropathie (19). Environ 50 % des futurs transplantés hépa-
tiques adultes ont l’âge comme facteur de risque coronarien, très
souvent associé à un tabagisme.
La prévalence de lésions de coronaropathie sévère, confirmée par
coronarographie pré-TH effectuée chez des sujets de plus de
50 ans, atteint 16,2 % (25). Le diabète, dans cette étude, consti-
tuait le facteur de risque le plus prédictif de coronaropathie sévère.
Les tumeurs de novo
La connaissance du risque accru de tumeurs de novo (TDN) après
TH et le dépistage de ces tumeurs s’avèrent fondamentaux pour
améliorer les résultats à long terme de la TH. L’augmentation de
la survie à long terme a en effet été marquée par l’émergence de
TDN au sein de cette population immunodéprimée qui consti-
tuent l’une des complications médicales du transplanté hépatique
à long terme les plus préoccupantes. Les TDN sont définies par
la survenue, après transplantation, de cancers jusque-là mécon-
nus. Très rarement, ces tumeurs sont transmises par le greffon, et
se développent alors dans celui-ci. Les TDN doivent être distin-
guées des récidives de tumeurs préexistantes à la transplantation.
L’expérience actuellement très large des transplantations, en par-
ticulier celle du rein, a permis de constater une carcinogenèse
post-transplantation qualitativement et quantitativement diffé-
rente de celle observée dans la population générale du même âge
(26). L’incidence globale des cancers est en effet 3 à 4 fois plus
importante, et varie chez les transplantés hépatiques entre 4 et
18 % (2, 27). La répartition du type de cancer est, de plus, diffé-
rente, certains cancers viro-induits tout à fait inhabituels dans la
population générale, se développant de façon accrue après trans-
plantation. C’est le cas des lymphomes non hodgkiniens (LNH)
liés à l’Epstein-Barr virus (EBV), dont le risque relatif est 28 à
49 fois plus important après transplantation, du sarcome de
Kaposi, dont le risque relatif est multiplié par 500, du cancer des
lèvres, dont le risque est 29 fois plus important. Ainsi, les virus
constituent actuellement les agents infectieux les plus fréquem-
ment associés aux cancers chez les immunodéprimés et expli-
quent que les TDN les plus fréquentes après transplantation sont
les LNH, le sarcome de Kaposi, et les cancers cutanés. Le risque
de cancers génitaux liés aux Papillomavirus humains (PVH) est
également significativement accru (100 fois supérieur à celui de
la population générale). Si on exclut les LNH et les cancers cuta-
nés, le risque relatif de développer une tumeur solide après TH
reste encore élevé à 2,7 par rapport à celui de la population stan-
dard (26).
L’incidence des TDN augmente avec la durée d’exposition au
traitement immunosuppresseur, et donc avec le recul post-trans-
plantation. Le risque cumulé de développer une TDN est respec-
tivement de 6, 20 et 50 % à 5 ans, 10 ans et 15 ans de la TH, avec
un risque relatif de TDN qui passe de 2, entre 0 et 5 ans, à 13,5
au-delà de 10 ans (26). L’imputabilité de la nature même du trai-
tement immunosuppresseur dans la survenue de ces TDN reste
discutée. La dose totale d’immunosuppresseur, plutôt que sa
nature même, semble avoir un rôle déterminant. Dans l’étude mul-
ticentrique américaine comparant les résultats de la ciclospo-
rine A à ceux du tacrolimus à 5 ans de la TH, le risque de TDN
était comparable dans les deux groupes de patients (7). L’effet
plus puissamment immunosuppresseur du tacrolimus ne semble
pas associé à un risque accru de TDN (27).
●Les cancers cutanés sont les plus fréquents après transplantation,
puisqu’ils représentent 50 % de l’ensemble des TDN (26, 28, 29).
Alors que les carcinomes basocellulaires correspondent à 80 % des
cancers dans la population générale, le cancer spinocellulaire est
le plus fréquent chez le transplanté, à l’origine de 80 % des can-
cers cutanés avec un risque relatif après TH à 70 (26). Clinique-
ment, ces cancers souvent asymptomatiques ont tendance à être
multiples, récidivant avec une évolution métastatique dans 5 à 8 %
des cas, et supérieure à celle des patients non transplantés. 5,4 %
des patients du Cincinnati Transplant Tumor Registry (CTTR), tenu
par Penn, sont décédés directement des conséquences d’un cancer
cutané. Leur évolution, particulièrement rapide et péjorative, néces-
site leur exérèse dans les plus brefs délais. Toute modification de
l’aspect d’une lésion cutanée chez un transplanté doit alerter le
médecin et faire éliminer un épithélioma spinocellulaire.
Les verrues favorisées par les PVH 5 et 8, qui agissent comme
cocarcinogènes, précèdent généralement ces cancers cutanés. Les
Tableau I. Facteurs de risque de coronaropathie (19).
Âge :
Homme > 45 ans
Femme > 55 ans
Diabète
Tabagisme
HDL-cholestérol (< 35 mg/dl)
HTA (> 140/90 mmHg)
Antécédents familiaux de coronaropathie
HGE 5 05/11/01 12:51 Page 241
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%