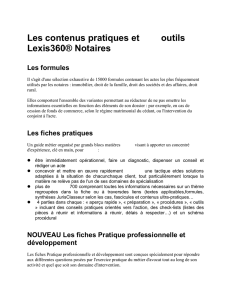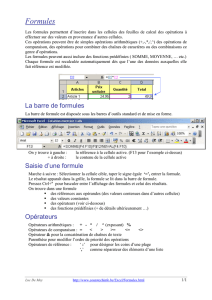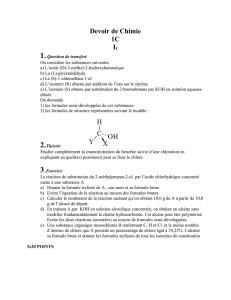Cours n°7 1 - Le calcul des séquents classique 1.1. Le calcul des

Cours n°7
AFFINER LA LOGIQUE :
DE LA LOGIQUE INTUITIONNISTE A LA LOGIQUE LINEAIRE
1 - Le calcul des séquents classique
1.1. Le calcul des séquents comme méthode de décision
Bien que la méthode des tables de vérité ne puisse pas s’y appliquer, on peut démontrer que la
logique propositionnelle intuitionniste est décidable. La méthode de décision repose alors sur
une nouvelle présentation de la logique (nouvelle par rapport aux deux que nous avons vues
jusqu’à présent : une axiomatisation « à la Hilbert » et une présentation de type « déduction
naturelle »), due à Gerhart Gentzen dans les années trente, que l’on appelle le « calcul des
séquents ». Ce calcul fut en réalité inventé par Gentzen dans le cadre de la démonstration de
la complétude de la logique des prédicats du premier ordre. Intuitivement, pour prouver la
complétude d’un système, il faut prouver que toute thèse est démontrable, donc montrer que
connaissant une thèse, on peut construire sa démonstration. La bonne méthode pour y arriver
consiste à se munir d’un système général de recherche de preuves. Gentzen travaille sur des
relations de déduction entre séries de formules.
Prenons l’exemple suivant. On sait qu’il est possible de déduire B de la suite de formules C, C
⇒ A, ¬A ∨ B. On peut écrire cette relation déductive entre une suite de formules et une
formule sous la forme :
C, C ⇒ A, ¬A ∨ B → B
où la flèche (→) sépare la suite de prémisses de la conclusion.
Si on nous demande de prouver, en logique classique, cette relation de déduction, nous
pouvons utiliser une méthode à base de valeurs de vérité en raisonnant de la manière
suivante : supposons que ce ne soit pas le cas, c’est-à-dire que C, C ⇒ A, ¬A ∨ B ne permette
pas de déduire B, alors cela signifierait qu’il existe au moins une assignation de valeurs de
vérité aux propositions atomiques A, B, C telle que :
• C, C ⇒ A, ¬A ∨ B soient vraies (= 1)
• B soit fausse (= 0)
Alors cela entraînerait que, en ce qui concerne la formule C ⇒ A :
• ou bien C est fausse (0)
• ou bien A est vraie (1)
Mais étant donné que C est vraie, la première éventualité nous conduit à une contradiction :
nous stoppons la recherche de démonstration sur cette voie.
Il reste l’éventualité que A soit vraie. En ce cas, pour ce qui concerne la formule ¬A ∨ B,
puisqu’elle est vraie, cela ne peut être que parce que :
• ou bien ¬A est vraie, donc A est fausse,
• ou bien B est vraie
Dans la première éventualité, nous stoppons la recherche de preuve également puisqu’on
obtient une contradiction entre A vraie et A fausse.
Reste la dernière éventualité : B vraie, mais au début de notre raisonnement, nous avons
supposé que B était fausse, donc là encore, nous stoppons la recherche de démonstration. Il
n’y a plus alors d’autre voie à explorer. Toutes les voies nous ayant ainsi conduit à une
contradiction, c’est que l’hypothèse d’où nous sommes partis conduit à une absurdité, et nous
devons conclure que la suite de formules C, C ⇒ A, ¬A ∨ B permet bien de déduire B.
Nous pouvons représenter l’ensemble de ce raisonnement par un tableau, ou plutôt une suite
de lignes, que nous lisons en remontant de la dernière ligne (racine d’un arbre) vers les
premières (feuilles en même temps qu’axiomes). Dans cette représentation, la flèche « → »

n’a pas d’autre rôle que de séparer les formules vraies (à gauche) des formules fausses (à
droite).
Ax.
A, C, C ⇒ A, ¬A ∨ B → A, B Ax.
Ax.
¬A, A, C, C ⇒ A, ¬A ∨ B → B B, A, C, C ⇒ A, ¬A ∨ B → B
C, C ⇒ A, ¬A ∨ B → B, C A, C, C ⇒ A, ¬A ∨ B → B
C, C ⇒ A, ¬A ∨ B → B
Dans ce tableau, nous avons mis en gras à chaque ligne: une formule (par exemple C ⇒ A à la
dernière ligne, ¬A ∨ B à l’avant-dernière à droite et ¬A à l’avant-avant-dernière à gauche)
ainsi que des formules émanant de la ligne antérieure (en partant du bas). D’autre part, nous
avons surligné les séquents au moyen d’une ligne marquée « Ax » chaque fois qu’une même
formule (atomique) figure à la fois à gauche et à droite. Ceci a un sens puisque nous avons vu
que cela signifie qu’on a une contradiction. Autre remarque : à l’avant-dernière ligne, à
gauche, nous avons un séquent qui possède deux formules à droite séparées par une virgule.
Cela signifie que notre « calcul des séquents » admet des séquents avec plus d’une formule en
partie droite, donc des séquents de la forme générale :
(1) A
1, …, Ak → B1, …, Bm
Quelle est alors l’interprétation de cette virgule en partie droite ? si la virgule en partie gauche
s’interprète de manière évidente comme une conjonction, par quoi s’interprète-t-elle en partie
droite ? Noter que dire que B et C sont faux est équivalent à dire que B ou C est faux. La
virgule en partie droite s’interprète donc comme une disjonction. Un séquent tel que (1) peut
donc se lire comme une relation de déduction : « de A1 ∧ …∧ Ak on peut déduire B1∨ …∨
Bm ». Nous verrons plus loin que la spécificité de la logique intuitionniste sera justement
d’interdire qu’il y ait en partie droite d’un séquent plus d’une formule.
1.2 Le calcul des séquents classique
Cet exemple nous montre encore que chaque passage d’une ligne inférieure à une ligne
immédiatement supérieure obéit à une règle définie strictement, qui dépend de la formule
qu’on a sélectionnée dans la ligne inférieure. Si cette formule (dite « formule active ») est une
implication ϕ ⇒ ψ, alors on a deux lignes immédiatement au-dessus (nous les appellerons
prémisses), l’une pour laquelle ϕ est faux et l’autre pour laquelle ψ est vrai.
Schématiquement, cela conduit à :
∆ → Λ, A B, Γ → Θ
A ⇒ B, ∆, Γ → Λ, Θ
On remarquera ici que ce schéma n’est pas exactement conforme aux pas mentionnés dans
l’exemple : on a supprimé l’occurrence de A ⇒ B dans les prémisses afin d’éviter de refaire
plusieurs fois le même pas dans la preuve (ce qui serait très improductif et conduirait pour
rien à des déductions infiniment longues !) et d’autre part, on a scindé le contexte de la
formule en quatre parties ∆, Γ, Λ, Θ. On fait alors l’hypothèse que seules les formules de ∆
sont utilisées pour prouver A ainsi que celles de Λ et que seules les formules de Γ sont
utilisées pour faire la preuve de Θ. On peut démontrer qu’une telle partition est toujours
possible et qu’elle ne restreint en rien la généralité. Elle va nous permettre de donner une
formulation plus simple du système.
Le schéma précédent sera appelé « règle d’introduction à gauche du symbole ⇒ ». On peut le
lire : pour que la suite de formules A ⇒ B, ∆, Γ permette de déduire la suite Λ, Θ, il suffit que

∆ permette de déduire Λ, A et que B, Γ permette de déduire Θ.
Noter que si on ne veut pas procéder à cette séparation des contextes, on peut tout aussi bien
prendre comme règle :
Γ → Θ, A B, Γ → Θ
A ⇒ B, Γ → Θ
(la formulation des feuilles en sera simplement changée)
L’exemple précédent nous a également montré que, dans le cas d’une disjonction sur le côté
gauche d’un séquent, nous avions :
A , ∆ → Λ B, Γ → Θ
A∨B, ∆, Γ → Λ, Θ
ou : (règle d’introduction à gauche du “ou”)
A, Γ → Θ B, Γ → Θ
A∨B, Γ → Θ
A la suite de ces exemples, on peut facilement deviner ce que seront les autres règles.
Règle d’introduction à gauche du « et » :
A, B, Γ → Θ
A∧B, Γ → Θ
Passons maintenant aux règles d’introduction à droite.
Règle d’introduction à droite de l’implication :
A, Γ → Θ, B
Γ → Θ, A⇒ B
Règle d’introduction à droite du « ou » :
Γ → A, B, Θ
Γ → A∨B, Θ
Règle d’introduction à droite du « et » :
∆ → A , Λ Γ → B, Θ
∆, Γ → A∧B, Λ, Θ
ou, tout aussi bien :
Γ → A, Θ Γ → B, Θ
Γ → A∧B, Θ
Nous avons aussi des règles évidentes pour la négation :
Introduction à droite :
A, Γ → Θ
Γ → Θ, ¬A
Introduction à gauche :
Γ → Θ, A
¬A, Γ → Θ
Ces règles donnent tous les pas possibles à l’intérieur d’une déduction dans le cadre du calcul
des séquents, mais elles ne suffisent pas : il faut indiquer quand on s’arrête, autrement dit
définir les feuilles de nos arbres de preuves.
Si nous retenons la version qui ne sépare pas les contextes, comme dans le cas de l’exemple
ci-dessus, nous devons considérons comme instance de l’axiome tout séquent de la forme :

A, Γ → Θ, A
Autrement dit tout séquent où figure une même formule à gauche et à droite. Si nous adoptons
la version qui sépare les contextes, nous pouvons nous contenter de l’axiome dit
« d’identité » :
A → A
1.3 Les règles structurelles
Il est important de noter aussi que le calcul des séquents manipule des suites de formules et
qu’en logique classique, on admet que les formules sont des entités « idéales », qu’on peut
aussi bien réutiliser à volonté que mettre à l’écart : la monotonie est en effet une propriété
importante de la logique classique. Si nous pouvons prouver une formule B à partir d’une
suite de formules Γ, a fortiori nous pourrons encore prouver B si nous ajoutons d’autres
hypothèses à Γ, même si nous ne les utilisons pas dans la démonstration ! On appelle cela une
règle « d’affaiblissement ». Le fait quant à lui qu’une formule puisse être utilisée plusieurs
fois ressortira d’une règle dite « de contraction ». Enfin, il n’y a bien sûr aucune contrainte sur
l’ordre des formules dans notre calcul : on peut les permuter à volonté sans qu’il en résulte
quelque inconvénient que ce soit. D’où les règles dites « structurelles » à gauche et à droite :
Affaiblissement : Γ → Θ Γ → Θ
Γ, A → Θ Γ → A, Θ
Contraction : Γ, A, A → Θ Γ → A, A, Θ
Γ, A → Θ Γ → A, Θ
Permutation : Γ, A, B → Θ Γ → A, B, Θ
Γ, B, A → Θ Γ → B, A, Θ
1.4 La règle de coupure
Enfin, Gentzen introduit une règle fondamentale qui permet de composer les preuves et qui
intuitivement est assez évidente :
Γ → Λ, A A, ∆ → Θ
Γ, ∆ → Λ, Θ
Ou, sans la séparation des contextes :
Γ → A A, Γ → Θ
Γ → Θ
C’est ce qu’on appelle la règle de coupure (cut en anglais). Intuitivement, si on peut prouver
A à partir de Γ et si, en utilisant A on peut prouver Θ, alors on peut prouver Θ directement à
partir de Γ.
On remarquera la parfaite symétrie de cet ensemble de règles. C’est cette symétrie qui est à
l’origine d’un des théorèmes les plus importants de la logique, dû à Gentzen (en 1934), qui est
le théorème d’élimination de la coupure.

Thèorème de Gentzen (Hauptsatz) : le système sans la règle de coupure possède également
les mêmes conséquences que le système avec la règle de coupure.
On remarquera également cette propriété étonnante, dite « propriété de la sous-formule », qui
réside en ceci que lorsqu’on prend toutes les règles, sauf celle de coupure, il se trouve que la
ligne supérieure ne contient que des sous-formules de la ligne inférieure. Plus précisément, à
chaque pas d’une déduction dans le calcul des séquents, une ligne supérieure contient toutes
les sous-formules (et rien que les sous-formules) de la ligne qui est juste inférieure sauf une :
celle qu’on a prise comme « formule active » et qui, par l’application d’une règles associée à
un connecteur, s’est retrouvée décomposée.
Ceci conduit à un autre algorithme que la méthode des tables de vérité pour décider de la
validité d’une formule de la logique propositionnelle : on part du séquent
→ ϕ
à démontrer et on essaie toutes les règles logiques applicables (si ϕ est une formule, le choix
de la règle à appliquer est déterminé par son connecteur principal). A chaque application de
règle, on tombe sur un ou deux nouveaux séquents à démontrer, qui n’ont pas plus
d’ingrédients que n’en avait le premier séquent (et même moins), alors on recommence sur
chaque séquent et ainsi de suite jusqu’à ce qu’on trouve (ou qu’on ne puisse pas trouver) une
instance d’axiome d’identité. Etant donné que les formules se déstructurent à chaque pas, il
arrive nécessairement un moment où il n’y a plus que des formules atomiques et où on est
obligé de s’arrêter. En ce cas, on voit si on a stoppé toutes les branches de la démonstration
par des axiomes ou si ce n’est pas le cas.
La théorème d’élimination de la coupure nous permet d’être sûr que tous les séquents
démontrables sont bien obtenus de cette manière : la règle de coupure n’en ajouterait pas
d’autres.
L’intérêt du calcul de séquents va être que, grâce à lui, la logique intuitionniste va posséder
elle aussi une procédure de décision.
2- La logique intuitionniste revisitée
2.1. Le calcul des séquents intuitionniste
Le calcul des séquents intuitionniste s’obtient simplement à partir du calcul classique en
restreignant les séquents à la forme :
A1, …, Ak → B ou A1, …, Ak →
Comme on le voit immédiatement, le premier schéma appelle une interprétation
fonctionnelle : les Ai (A1, …, Ak) sont des « inputs » et B est un « output » : nous y
reviendrons plus loin. Quant au deuxième schéma, la place vide à droite de la flèche signifie
une disjonction vide de formules, or une telle disjonction vide est nécessairement équivalente
à l’élément neutre de la disjonction, lequel comme on le sait, n’est autre que la constante qui
signifie le faux, quelque chose que nous noterons « ⊥ » (on peut dire aussi : l’absurde). D’où
les deux formes de séquents intuitionnistes :
A1, …, Ak → B
A1, …, Ak → ⊥
A cause de cette restriction, certaines règles du calcul classique disparaissent. Evidemment la
contraction et la permutation à droite n’ont plus lieu d’être. La seule règle structurelle qui
demeure à droite est celle d’affaiblissement. Elle signifie alors que si, à partir d’une suite de
formules, on peut déduire l’absurde, alors on peut déduire n’importe quelle formule : quelque
chose que nous savions déjà dans la logique classique. La règle d’introduction de « ∨ » à
droite ne peut plus exister. Elle est remplacée par deux règles :
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
1
/
14
100%