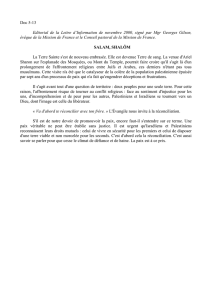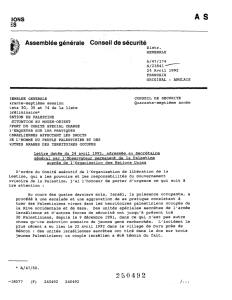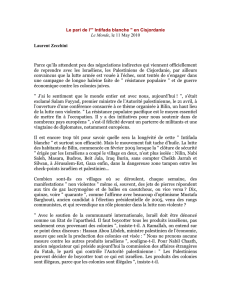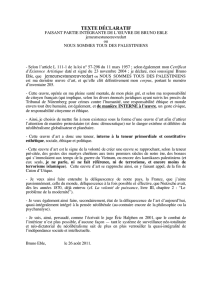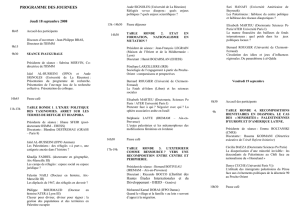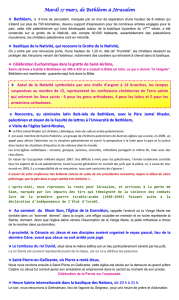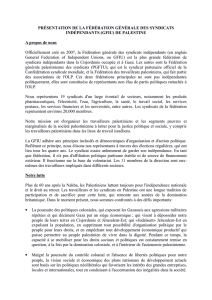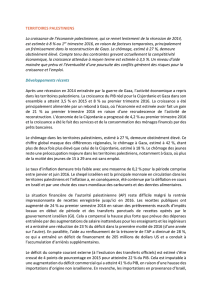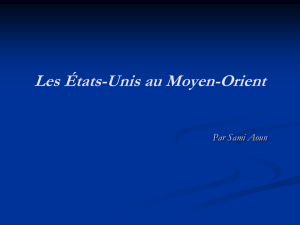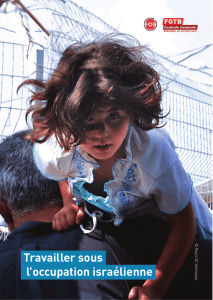La Diaspora palestinienne et la conversion des capitaux issus de la

La Diaspora palestinienne et la conversion des capitaux issus de la rente
pétrolière
Tiers Monde, Paris, 2001, p. 623-643.
Sari Hanafi
I. L’insertion difficile de l’économie palestinienne aux Emirats .............................................................. 2
II. Territorialisation des capitaux en dehors des Emirats .......................................................................... 4
III. Deux Modes d'entrepreneuriat "communautaire" et "individualiste" ................................................. 6
L' entrepreneuriat communautaire .................................................................................................. 7
Au Canada et Aux Etats Unies .......................................................................................................... 7
Dans les Territoires palestiniens ..................................................................................................... 8
Entrepreneuriat individualiste .......................................................................................................... 8
IV. Question de la motivation : Investisseur entre l’homo oeconomicus et l’homo ‘patriotus’ ............... 9
Bibliographie ......................................................................................................................................... 15
Annexe ................................................................................................................................................... 16
Tableau 1 : Niveau d'études des hommes d'affaires .......................................................................... 16
Tableau 2 : Activité économique exercée ............................................................................................ 16
Avec le processus de paix, pourraient se rétablir des liens économiques, régionaux et
internationaux interrompus par une longue période de belligérance. Déjà partiellement reliées
à leur communauté d’origine, les diasporas contribueront à façonner la géographie et les
contenus des réseaux économiques de demain. Cet article propose d’examiner certaines
hypothèses concernant le fonctionnement des réseaux locaux, régionaux et internationaux de
la diaspora palestinienne à travers l’étude de la communauté d’affaires palestinienne des
Emirats arabes unies (ci-après les Emirats).
Nous analysons ainsi l’interaction entre deux processus antagoniques d’insertion et
d’exclusion auxquels font face toutes les communautés migrantes de ce pays. Une telle étude
doit également questionner le mode d’autonomisation par rapport à la rente pétrolière dans
l’économie des Emirats arabes unis en pointant les sites, les secteurs et les modalités
d’investissement des capitaux produits par cette rente, directement aux EAU ou dans
l’économie internationale. Cette période actuelle que d’aucuns n’hésitent pas à qualifier de
« réduction de la rente » ou de « post-rentière » se situe plutôt malgré tout dans un entre-deux
tant elle reste marquée par les pesanteurs et les dépendances induites par la rente pétrolière,
qui n’ont pas seulement une incidence économique mais affectent également la structure
sociale et politique des Emirats. On rejoint là une observation de Granoveter (1985) qui
souligne que les transactions économiques sont toujours enchâssées dans la structure sociale
et ne peuvent être appréhendées ex nihilo.
Cet contribution se base sur des enquêtes conduites en 1995 et 1996 auprès de cent
trente hommes d'affaires palestiniens possédant des capitaux issus de la rente pétrolière, et
résidant soit dans les Emirats (pour soixante et onze d'entre eux), soit dans le reste du monde,
en particulier au Canada (dix-sept), soit, encore, alternativement dans ces deux zones.
1
1
- Cette contribution fait partie d’un programme de recherche "L'économie palestinienne dispersée",
lancé par le Centre d'études et de documentation économique, juridique et sociale au Caire (CEDEJ) qui vise à
mener des enquêtes empiriques auprès d'hommes d'affaires palestiniens, afin notamment d'étudier les relations
entre diaspora et centre. Quelque 600 entretiens ont donc été réalisés ces trois dernières années essentiellement

I. L’insertion difficile de l’économie palestinienne aux Emirats
Les communautés palestiniennes des Emirats arabes unis sont d'implantation assez
récente en comparaison avec la communauté iranienne, mais elles sont d'une grande
importance numérique dans la sphère des affaires. L'un des facteurs principaux de leur
ascension sociale au sein de cette dernière réside dans la mobilisation d'un capital technique
et scientifique : 64%
2
de nos interlocuteurs ont un niveau universitaire et 19% ont le
baccalauréat (voir tableau 1). Beaucoup d'actuels entrepreneurs furent en début de carrière de
simples employés d'entreprises, installés ensuite à leur compte et gérant maintenant leurs
propres affaires. Leur réussite est celle d'une intégration économique, à laquelle ont contribué
les motivations de ceux qui, ayant un statut de réfugié, éprouvent la nécessité de s'auto-
affirmer, d'exister socialement et donc d'abord économiquement. De plus, le système de
contrat annuel de travail renouvelable incite les Palestiniens à créer leur propre entreprise. Il
semble que nos interlocuteurs aient été contraints de se mettre à leur compte, non pas tant par
appât du gain, qu'en raison de l'état du marché de l'emploi et de mesures discriminatoires les
poussant à quitter le statut de salarié.
Des activités liées à la rente pétrolière
Les hommes d’affaires palestiniens sont présents dans des secteurs très variés mais qui
relèvent pour l’essentiel d’activités induites par l’économie de l’Emirat qui reste à bien des
égards marquée par la rente pétrolière. Le boom de la construction d’infrastructures et
d’immeubles est perceptible, car près du tiers de l’échantillon est très directement impliqué
dans ce secteur que cela soit par le biais de cabinets d’étude, de sociétés de construction
proprement dites ou de cabinets de contrôle et de supervision des chantiers publics.
Néanmoins, sans surprise, c’est le commerce qui demeure l’activité principale (43%). Mais le
tropisme de la construction joue à nouveau puisque près de la moitié de ces commerçants
vendent des matériaux de construction. Même ceux qui sont insérés dans le monde industriel
(16%) ont quelques liens avec le secteur précédent (fabrication de carrelage, tillage du
marbre, signalisation routière…). Cette expansion remarquable de la construction n’est pas
forcément synonyme de profits importants, car la concurrence y est particulièrement rude.
Les structures publiques sont en effet les plus importants contracteurs et certaines sociétés ont
comme partenaires un Cheikh ou un Emir qui sait utiliser son entregent pour l’obtention des
contrats. Cependant pour les Palestiniens concernés la norme est plutôt de travailler seul sans
de tels associés.
Il faut par ailleurs noter l’absence de Palestiniens non seulement dans le domaine,
certes marginal, de l’agriculture (seulement 5%) mais surtout dans les services (6%) ou dans
le tourisme (1%) alors que des Libanais y sont omniprésents (voir tableau 2).
Cependant, ces deux "niches économiques" traditionnelles que sont le Bâtiment et
travaux publics et le négoce local ont subi de plein fouet, depuis la fin des années quatre-
entre la Jordanie, les Emirats Arabes Unies, l'Egypte, la Syrie, Israël, le Liban, les Etats-Unis, le Canada, le
Chili, l'Angleterre et l'Australie.
2
- Nous avons dégagé ces pourcentages à partir de l'analyse du discours de nos
interlocuteurs. Du fait que nous ne pouvons pas démontrer la représentativité de
l’échantillon", ces pourcentages ici et ailleurs dans cette étude sont donnés à titre indicatif
pour montrer le poids d'une catégorie par rapport aux autres.

vingt, les conséquences de la baisse des revenus rentiers. Deux grandes trajectoires de
recyclage peuvent être décrites eu égard à l’échantillon considéré. Le premier est le passage
des services à l’industrie puisque la concurrence dans le premier secteur n’a fait que croître
alors que le second exige une mise en capital importante, et une expertise réelle et pointue,
autant de conditions donc qui limitent les possibilités d’accès à l’homme d’affaires ordinaire.
Cette mutation a été rendue possible par le niveau d’études élevé des entrepreneurs mais aussi
par les avantages fiscaux de la zone franche de Jebel Ali, notamment l’absence d’un
partenaire local [kafil]
3
et la liberté de rapatrier les bénéficies et capitaux sans aucune
imposition fiscale pendant 15 ans minimum. Les plus grandes usines à Doubaï et à Abou
Dhabi fabriquant des barres d’aluminium sont ainsi possédées par des Palestiniens qui avaient
débuté leur carrière comme fabricants de fenêtres et de portes. Mais il faudrait citer
également le secteur pharmaceutique, la production d’objets en plastique, les parfums ou la
réfrigération des fruits, etc… Une seconde trajectoire de recyclage est constituée par le
passage du commerce local au commerce international grâce à des réseaux transnationaux
que les Palestiniens de la diaspora ont été particulièrement aptes à tisser dans leur dispersion.
Une autre mode de reconversion consiste en la diversification des activités dans
différents secteurs. Les gains rapportés par l'activité principale sont utilisés, en marge de cette
dernière, dans des secteurs qui nécessitent peu d'expérience, comme le commerce et
l'immobilier, dans les Emirats comme à l'extérieur
4
Le mot d'ordre est alors de ne pas mettre
"tous ses œufs dans le même panier" et de ne pas risquer ses capitaux dans une seule activité.
Et ce d'autant plus que la guerre du Golfe a largement fragilisé la position des Palestiniens,
beaucoup plus que celle de leurs homologues originaires d'autres pays arabes, puisqu'ils ne
savent en général pas où se rendre en cas d'expulsion. La guerre a reconfiguré l’état d’esprit
ambiant en développant une « psychologie du temporaire », un sentiment d’être « toujours de
passage » (Sanbar, 1989 : 73) et a renforcé une culture liminale d’exil (Naficy, 1995) qui
légitime cette diversification à la fois spatiale et sectorielle de l’activité économique.
Cette reconversion économique a été facilitée par la dispersion géographique du
peuple palestinien et par l'existence de leurs réseaux sociaux et économiques transnationaux.
Ces derniers ont d'abord permis la constitution d'entreprises combinant le capital, le savoir-
faire et les connaissances technologiques appartenant aux différents segments de la parenté
souvent spatialement dispersés. Voici deux exemples révélateurs de ce déploiement des
réseaux familiaux :
La Famille M. est une famille qui a quitté la Jordanie et migré à Doubaï en 1976. Les huit
frères sont dispersés entre la Jordanie, les Emirats arabes unis, la Cisjordanie, la Roumanie.
Initialement, l’affaire familiale débute classiquement dans le secteur de la construction et par
l’association avec un kafil. Après quelques problèmes avec lui, il est décidé de monter une
fabrique de fenêtres et de portes en aluminium. Mais les affaire périclitent. La présence d’un
des frères, étudiant en médicine à Bucarest, permet d’ouvrir une société d’import/export entre
les deux pays. Cette société connaît un grand développement car la Roumanie est en pleine
phase de libéralisation économique et de reconstruction. La Roumanie peut également
exporter quelques produits très bon marché qui sont immédiatement revendu dans le monde
arabe.
3
Dans les pays du golfe, le kafil est le ressortissant du pays avec lesquels il est nécessaire de
s’associer pour obtenir une licence. Celui-ci est d’emblée actionnaire à 51% même s’il se
cantonne d’ordinaire au seul rôle de facilitateur. « Le kafil c’est comme le sel, il faut le
mettre dans tous les plats » affirme plein d’amertume un homme d’affaires palestinien.
4
Jusqu'en 1999, l'Emirat de Sharja était le seul à permettre aux étrangers d'acheter des
terrains et des immeubles.

L’autre cas illustre plus un phénomène courant. Un homme d’affaires palestinien disposant
d’un certain entregent peut ainsi obtenir pour l’un de ses amis rentré dans les territoires sous
autorité palestinienne la représentation de grandes marques d’électroménager, surtout
coréennes et japonaises.
Cependant ces réseaux transnationaux sont souvent affectés dans leur fonctionnement
par les difficultés de déplacement de leurs membres, en particulier dans les pays arabes, dont
les frontières sont souvent hermétiquement fermées aux Palestiniens, et surtout à ceux d'entre
eux qui ont le statut de réfugié. Le rôle que peuvent jouer ces réseaux dans les échanges
économiques au sein du Moyen Orient dépend donc de la subtilité des stratégies des
entrepreneurs palestiniens et reste ainsi potentiellement faible.
A la vue des cas évoqués et des difficultés rencontrées par les acteurs de ces
recyclages, il est clair que ces derniers ne sont pas chose aisée, qu'il s'agisse de ceux opérés
par les hommes d'affaire ou par des fonctionnaires accédant à la retraite et désirant se lancer
dans les affaires. Malgré ces difficultés, leur volonté de se recycler en investissant ailleurs et
en délocalisant leurs activités reste grande. Le statut juridique des Palestiniens dans les
Emirats - ils ne sont considérés que comme résidents temporaires - fragilise en effet leur
position économique. De plus, nombre d'entre eux ont connu de désagréables expériences
avec leur kafil, dans un pays où l'appareil juridique fonctionne avec "deux poids, deux
mesures", les uns pour les personnes des Emirats et les autres pour les étrangers - en cas de
litige entre une personne des Emirats et un étranger, affirment beaucoup de Palestiniens
interrogés, le juge donne la plupart du temps raison au premier. Enfin, beaucoup craignent de
payer le prix d'une éventuelle nouvelle déstabilisation du Golfe, comme ce fut le cas pendant
la deuxième guerre qu'il a connu. Face à ces deux processus antagonistes d'insertion
provisoire des communautés migrantes et de limitation de leurs possibilités d'action, les
Emirats deviennent donc un lieu de passage et une "plaque tournante" pour les hommes
d'affaires palestiniens, bien plus qu'un lieu d'ancrage et de "développement durable" de leurs
activités économiques, dans la mesure où celles-ci peuvent se développer, non sans
difficultés, en se délocalisant.
Ainsi, si ces derniers ont opté pour la diversification sectorielle et spatiale de leurs
activités, la nature de ce processus et la détermination d'un lieu d'implantation ne sont pas
d'abord fonction, comme cela est censé être le cas dans une économie mondialisée, d’une
rationalité économique fondant ses choix sur un calcul de maximisation sous contrainte
(législation en matière d'investissement et de fiscalité, par exemple), prenant en compte un
ensemble de facteurs comme la taille du marché, le coût de la main d’œuvre, ses
qualifications technologiques et performances, ainsi que la présence d'infrastructures
adéquates. Ces diversification et relocalisation sont d'abord tributaires de contraintes de type
clairement politique, comme les relations conjoncturelles entre les pays d'investissement et
l’Autorité nationale palestinienne (ainsi que l’OLP), le statut que les investisseurs
palestiniens peuvent acquérir dans ces pays, ainsi que leurs possibilités de déplacement liées
au type de document de voyage dont ils bénéficient.
Si les Emirats ne peuvent guère retenir les capitaux palestiniens issus de redistribution
de la rente pétrolière mais amorçant leur réduction de rente et si les autres pays arabes ne
répondent guère aux conditions susceptibles de les attirer, quelles sont alors les destinations
de ces capitaux ?
II. Territorialisation des capitaux en dehors des Emirats

Nos enquêtes auprès de cent trente hommes d'affaires palestiniens ayant des capitaux
provenant du Golfe et répartis surtout entre les Emirats, le Canada, les Etats-Unis et la
Grande Bretagne, nous ont permis de compter le nombre d'investissements – mais non pas le
volume des capitaux investis, car nos interlocuteurs n'ont pas toujours donné de chiffres
précis à ce sujet. Selon l'enquête, seulement 38% des investissements concernent le Moyen
Orient (hormis les Emirats) : soit 24% pour les Territoires palestiniens, 10% pour la Jordanie,
2% pour la Syrie et le même chiffre pour l'Egypte.
Les investissements en Territoires palestiniens
Il faut également mettre l’accent sur le fait que les investissements orientés vers les
Territoires palestiniens sont bien moins importants qu’il n'est en général pensé. Certes,
quelques hommes d’affaires palestiniens ont l’intime conviction qu’ils devront un jour quitter
les Emirats et retourner en Palestine, même si aujourd’hui ce droit du retour est limité. Ceux-
là ont décidé de contribuer à la construction de l’entité palestinienne. Mais un investissement
décidé dans une situation économique et politique aussi délicate semble indiquer que la
rationalité est plus qu’économique : il s’agit d’obtenir une position sociale supérieure. Il y a
ainsi 34 projets économiques qui ont débuté depuis le renouveau du processus de paix. Sur
les 75 membres de l’échantillon sélectionné pour cette étude, plus d’un tiers a investi dans les
Territoires. Ce nombre est considérable, eu égard à l’attitude des Palestiniens vis-à-vis de
l’Amérique. Il semble en tout cas qu’on retrouve cette occurrence entre proximité et
investissements. Le type d’investissement est également fonction de l’origine des
Palestiniens. En effet, ceux qui ont dû fuir en 1948 – au nombre de 8 dans l’échantillon-
prennent en général des parts dans des sociétés d’investissement comme PADICO et
International Salam Company puisqu’ils n’ont pas un accès privilégié aux Territoires
palestiniens. Les Palestiniens originaires de Cisjordanie et de Gaza se comportent
différemment. Ils mettent en place un projet avec la collaboration d’un parent ou d’un ami au
terme d’une visite pour prendre les ultimes décisions. Le tableau 3 montre quels sont les
secteurs choisis.
La part du lion des investissements des hommes d'affaires palestiniens ayant des
capitaux provenant du Golfe revient donc aux pays d'implantation situés hors du Moyen
Orient (62% en tout, soit 24% au Canada, 22% au Etats-Unis, 11% à l'Europe, 3% à
l'Australie et 2% à l'Asie). Cette part est en réalité plus importante si l'on prend en compte le
volume de ces investissements, dont certains se montent à quelques millions de dollars.
Dans les paragraphes qui suivent nous allons poser quelques questions concernant les
choix géographiques des investissements et pourquoi les palestiniens des Emirats sont allés
investir si loin, mais aussi sur les investissements en territoires palestiniens, leurs domaines et
motivations. Pour pouvoir répondre à ses questions, nous allons étudier les modes de
l’entrepreneuriat palestinien dans les pays du recyclage des capitaux palestiniens.
Depuis la première guerre du Golfe entre l'Iraq et l'Iran et la détérioration de la
situation économique dans les pétromonarchies qui s'en est suivie, des licenciements massifs
ont touché les immigrés dans les Emirats ; les Palestiniens de ces pays et tout
particulièrement les plus riches ont tenté d’émigrer en Amérique, et surtout au Canada. Le
choix de ce pays n'était certainement lié ni à l'expérience professionnelle ni au savoir-faire
entrepreneurial acquis dans les pays du Golfe, qui sont fort éloignés de ceux propres au
monde des affaires canadien. En fait, la politique canadienne d'immigration a encouragé, en
pratiquant des quota élevés, la venue des Arabes. Cette politique, surtout celle du Québec,
répond à des considérations internes mais aussi à un soucis humanitaire à l'égard des victimes
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%