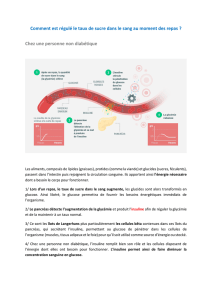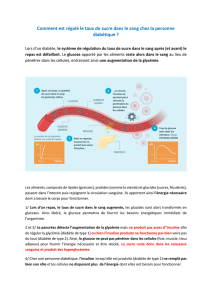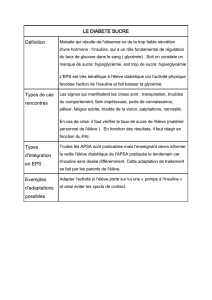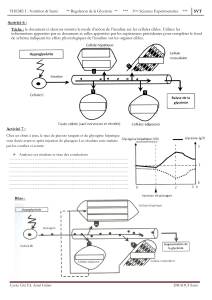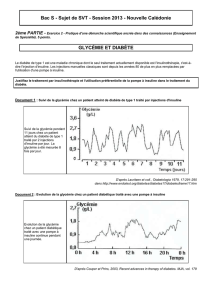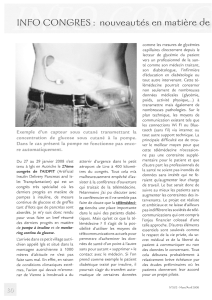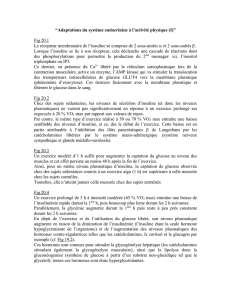L Nouvelles technologies appliquées au diabète : journée thématique de la SFD

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XVI - n° 3 - mars 2012
48
Échos des congrès
© XtravaganT
Nouvelles technologies appliquées
au diabète : journée thématique de la SFD
Paris, 16 décembre 2011
Caroline Sanz*
*Servicede diabétologie,
nutrition et maladies
métaboliques,
hôpitalRangueil,
CHU de Toulouse.
L
a journée thématique de la Société française
de diabétologie de 2011 avait pour thème les
“Technologies appliquées au diabète”. Les ora-
teurs ont su exposer la place actuelle des nouvelles tech-
nologies dans la prise en charge du diabète de type 1
et de type 2, mais aussi les développements futurs que
nous pouvons attendre. L’objet de cet article est de
rapporter brièvement les communications portant sur
le traitement par pompe à insuline, les capteurs de
glucose, la télémédecine et le pancréas artificiel. Cette
journée a fait l’objet d’un numéro spécial de Diabetes
& Metabolism (1).
Qu’attendre d’un traitement
par pompe à insuline ?
(D’après la communication de H. Hanaire, Toulouse.)
Les pompes à insuline externes ont été utilisées pour
la première fois dans les années 1970, avec comme
objectif l’obtention d’un équilibre glycémique strict
chez les patients diabétiques de type 1. L’avantage de ce
traitement était alors l’utilisation d’une insuline rapide,
en infusion continue avec une grande flexibilité, per-
mettant des débits de base variables et un ajustement
précis de la quantité d’insuline sous forme de bolus
au moment des repas. Au cours des dernières années,
plusieurs revues de la littérature se sont intéressées
à l’effet de cette pompe sur l’HbA1c. Par comparai-
son avec un traitement multi-injections, l’utilisation
d’une pompe à insuline externe permet une réduction
moyenne de l’HbA1c de 0,3 à 0,5 %. Cette réduction
de l’HbA1c est bien entendu d’autant plus importante
que l’équilibre glycémique initial est mauvais. L’autre
intérêt de ces pompes réside dans une meilleure
stabilité glycémique, avec une réduction de près de
75 % du risque d’hypoglycémie sévère. La plupart des
études ont été faites avant l’apparition des analogues
de l’insuline (d’action rapide et prolongée). Celles qui
les ont utilisés n’ont pas retrouvé de supériorité en
termes d’HbA1c du traitement par pompe à insuline
externe par rapport au traitement par multi-injections.
Cependant, des travaux chez l’enfant sont en faveur
d’une supériorité du traitement par pompe, qui reste
tout de même meilleur sur le plan de la variabilité gly-
cémique et du risque d’hypoglycémies sévères. Malgré
l’avènement des analogues de l’insuline, le traitement
par pompe externe reste le traitement le plus flexible
et le plus efficace pour les sujets ayant une variabilité
des besoins basaux, un phénomène de l’aube ou des
hypoglycémies récurrentes.
La question se pose maintenant de l’utilisation de la
pompe à insuline externe chez les patients diabétiques
de type 2. Récemment, plusieurs essais randomisés
ont comparé ses bénéfices avec ceux du traitement
par multi-injections chez les patients diabétiques de
type 2 insulinés. Les résultats sont pour l’instant discor-
dants, leur interprétation demeurant difficile puisque,
à l’inclusion, certains sujets n’avaient pas de prise en
charge intensifiée du diabète. Il faudra donc attendre
les résultats des études en cours s’intéressant à l’impact
des 2 traitements. Grâce à des doses d’insuline moindres
qu’avec un traitement par multi-injections, un autre
bénéfice attendu du traitement par pompe à insuline
est une limitation de la prise de poids. Contrairement
à ce que l’on pourrait attendre, les études disponibles
ne mettent pas en évidence d’effet favorable du trai-
tement par pompe à insuline sur la prise de poids.
Celle-ci demeure modérée et associée à l’amélioration
de l’HbA1c.
Que devons-nous attendre, dans le futur, d’un trai-
tement par pompe à insuline externe ? Des insulines
mimant encore plus précisément la sécrétion physiolo-
gique postprandiale d’insuline, des pompes associées
à des capteurs de glucose ou des pompes prenant en
compte le niveau d’activité physique en plus des glu-
cides ingérés sont les outils d’avenir utiles à une prise
en charge efficace du diabète.
Vers une utilisation optimale
des capteurs de glucose
(D’après la communication de A. Sola-Gazagnes, Paris.)
Le premier capteur de glucose a été approuvé par la
Food and Drug Administration en 1999. Ces capteurs

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XVI - n° 3 - mars 2012
49
Nouvelles technologies appliquées au diabète : journée thématique de la SFD
mesurent le glucose interstitiel et estiment le glucose
sanguin grâce à des algorithmes.
À raison de 1 toutes les 5 mn, ce sont près de
300 mesures qui sont effectuées chaque jour. Deux
types d’outils sont à notre disposition : d’une part, les
holters glycémiques, qui correspondent à un enregis-
trement du profil glycémique sur 3 à 5 jours avec une
lecture différée ; d’autre part, les capteurs de glucose,
qui donnent des informations en temps réel. Le patient
dispose alors d’une estimation de sa glycémie capillaire
en continu et d’informations sur son évolution (flèche
de tendance). L’enjeu est à présent de savoir à quels
patients ces dispositifs seront le plus utiles. Plusieurs
essais cliniques randomisés ont étudié l’intérêt des
capteurs de glucose pour la prise en charge du dia-
bète de type 1. En moyenne, la baisse d’HbA1C était
de 0,6 à 1,1 %. Le bénéfice était d’autant plus important
que le sujet portait régulièrement l’outil. Par ailleurs,
le patient restait moins longtemps en hypoglycémie
lorsqu’il utilisait le capteur. Comme avec les pompes
à insuline, plus l’HbA1c était élevée au départ, plus le
bénéfice lié à l’utilisation du capteur était important.
Le challenge consiste désormais à former de façon opti-
male les diabétologues et les patients à l’utilisation
de ces capteurs. Les échanges entre les orateurs et les
participants ont révélé nos difficultés à analyser les
300 mesures quotidiennes apportées par ces dispositifs.
Pour analyser les données des capteurs, plusieurs algo-
rithmes de décision ont été proposés, mais il n’y a pas
encore de consensus. Il semble tout de même primor-
dial qu’un temps suffisant soit consacré à l’analyse des
données. Enfin, le principal frein est le non-rembourse-
ment des capteurs de glucose par la Sécurité sociale.
Quelle place aura la télémédecine
dans notre pratique quotidienne ?
(D’après la communication de S. Franc, Corbeil.)
Le développement de la télémédecine est porté par les
autorités de santé, qui voient dans cet outil un moyen
de répondre à la pénurie des médecins et aux déserts
médicaux.
En diabétologie, la télémédecine permet une plus
grande réactivité dans la prise en charge de la maladie,
dans l’adaptation des doses d’insuline, et donc une plus
grande efficacité dans l’obtention d’un bon équilibre
glycémique. Plusieurs études portant sur l’impact de
la télémédecine et sur le contrôle glycémique ont été
détaillées dans une revue récente (2). Les résultats de
l’étude française TéléDiab-1 méritent notre attention.
Cette étude a concerné 180 adultes diabétiques de
type 1, sous traitement basal-bolus (pompe ou multi-
injections), avec un équilibre glycémique médiocre,
soit une HbA1c de 9,1 ± 1,1 % à l’inclusion. Les patients
étaient randomisés en 3 groupes : un groupe contrôle
(groupe 1), un groupe utilisant le système de télémé-
decine Diabéo avec des consultations face à face clas-
siques (groupe 2), et un groupe utilisant également ce
système et bénéficiant de consultations téléphoniques
(groupe 3).
Par comparaison avec le groupe 1, les patients du
groupe 2 ont vu une amélioration de l’HBA1C de 0,7 %
à 6 mois, et les résultats étaient encore meilleurs dans
le groupe 3, avec une baisse de l’HBA1c encore plus
importante : 0,9 %. Le taux d’hypoglycémie n’était
pas augmenté. Au total, le temps passé en consulta-
tions téléphoniques était similaire au temps passé en
consultations face à face dans les 2 groupes. Ce support
technologique semble donc utile pour l’adaptation
des doses d’insuline et pour un contact facilité avec le
médecin diabétologue. Comme pour les capteurs de
glucose, il reste à déterminer comment introduire cette
nouvelle pratique dans notre quotidien et comment
organiser le remboursement d’une telle prise en charge.
Les prises en charge classiques de télémédecine chez les
patients diabétiques de type 2 avec des consultations
téléphoniques fréquentes, réalisées par des infirmières
formées, n’ont pas montré d’efficacité notable. Les sys-
tèmes utilisant les technologies liées aux smartphones
pourraient s’avérer intéressants à l’avenir. Une étude
pilote américaine de 3 mois incluant 30 patients a mis
en évidence, chez les patients diabétiques de type 2
ayant à l’inclusion une HbA1c de près de 9 %, une baisse
d’HbA1c notable, de 2,03 % versus 0,68 % dans le groupe
contrôle. Ce dispositif permettait un meilleur ajuste-
ment des traitements antidiabétiques oraux et insuli-
niques. Dans la même lignée, une nouvelle version de
Diabéo a été développée pour les patients diabétiques
de type 2. Elle fait actuellement l’objet d’une évaluation
dans une étude multicentrique intitulée TéléDiab 2.
En route vers le pancréas artificiel
(D’après la communication d’E. Renard, Montpellier.)
Les progrès réalisés au cours des 30 dernières années
sur les performances des pompes à insuline (voie sous-
cutanée et voie intrapéritonéale) et de la mesure conti-
nue ambulatoire du glucose, ainsi que la validation des
algorithmes de perfusion d’insuline selon la mesure de
glucose, ont permis le développement expérimental
de systèmes en boucle fermée, pouvant être consi-

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XVI - n° 3 - mars 2012
50
Échos des congrès
dérés comme de véritables pancréas artificiels. Ces
dispositifs ont été testés principalement en conditions
d’hospitalisation.
Au cours des 10 dernières années, les technologies et
les algorithmes se sont modifiés et améliorés grâce
au travail conjoint de médecins, de physiologistes,
de spécialistes en modélisation et d’ingénieurs. Ces
partenariats ont permis le développement de plu-
sieurs modèles de pancréas artificiels. La première
combinaison, testée en 2002, utilisait une pompe
implantée avec délivrance péritonéale connectée à
un capteur de glycémie intraveineux. Ce pancréas
artificiel a été développé par les sociétés MiniMed
puis Medtronic. Durant les études cliniques, des
valeurs euglycémiques, c’est-à-dire comprises entre
80 et 120 mg/dl, ont été maintenues pendant 22 à
42 % du temps total. Le temps restant se découpait
ainsi : 5 à 6 % ont une glycémie inférieure à 80 mg/dl,
50 à 60 % avec une glycémie comprise entre 120 et
240 mg/dl, et 2 à 10 % avec une glycémie supérieure
à 2,4 g/dl. La nuit, le contrôle de la glycémie était
proche de la normalité. La période la plus difficile à
contrôler demeurait la période postprandiale. D’autres
systèmes ont été développés, avec l’utilisation de bolus
préprandiaux manuels, créant ainsi une boucle semi-
fermée. De manière notable, les excursions hypergly-
cémiques étaient diminuées, ainsi que les épisodes
hypo glycémiques. Les sujets passaient donc la plupart
du temps de l’étude avec des valeurs comprises entre
80 et 240 mg/dl, et un tiers était passé dans la zone
optimale de 80 à 120 mg/dl. La difficulté à atteindre
un objectif optimal était due au retard dans la mesure
de la glycémie par le capteur.
Progressivement, d’autres systèmes ont été testés, avec
une mesure de la glycémie sous-cutanée par micro-
dialyse et l’utilisation de pompes à insuline externes.
L’efficacité de ce système était nette, avec un temps
passé dans l’intervalle de 60 à 170 mg/dl compris entre
80 et 87 %. Les repas devaient être toujours signalés au
dispositif pour éviter les échappées hyper- ou hypo-
glycémiques.
L’enjeu actuel est l’utilisation du pancréas artificiel
à domicile. Plusieurs étapes préalables seront utiles
pour développer efficacement une telle technique. Tout
d’abord, un système par boucle fermée de délivrance de
l’insuline pourra être utilisé à la maison uniquement la
nuit, quand il est le plus sûr et le plus efficace. Ensuite,
ce système pourra probablement être appliqué pendant
la journée avec une boucle semi-fermée, permettant
la gestion manuelle des besoins en insuline pour cou-
vrir les repas et gérer les périodes d’exercice physique.
Plus tard, des systèmes automatiques de délivrance de
l’insuline après annonce des repas seront possibles, avec
l’utilisation d’algorithmes plus sophistiqués capables
de prendre en charge les variations complexes de la
glycémie postprandiale.
■
1. New technologies applied to diabetes. Thematic meeting
organized by the French Society for Diabetes Paris, Institut
Pasteur, December the 16th, 2011. Diabetes & Metabolism
(Elsevier Masson) 2011;37(Suppl.4).
2. Franc S, Daoudi A, Mounier S et al. Telemedicine and
diabetes: achievements and prospects. Diabetes Metab
2011;37:463-76.
3. Franc S, Daoudi A, Mounier S et al. Telemedicine: what more
is needed for its integration in eveyday life? Diabetes Metab
2011;37(Suppl.4):S71-7.
Références
1
/
3
100%