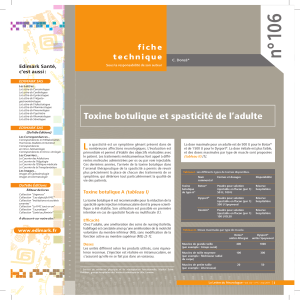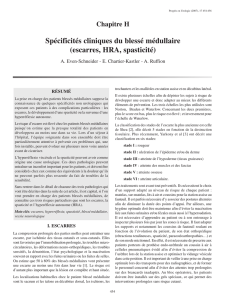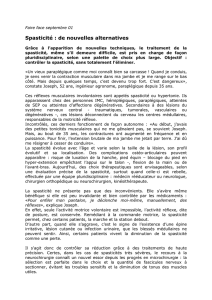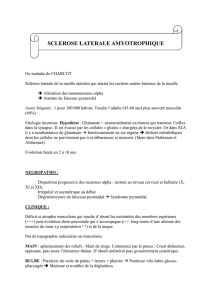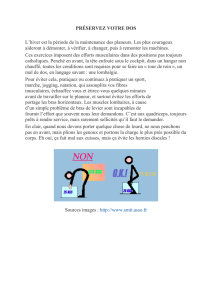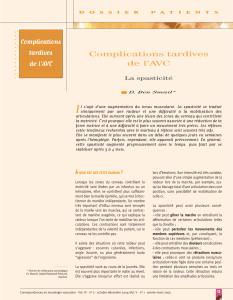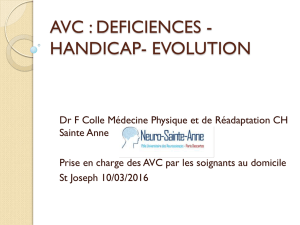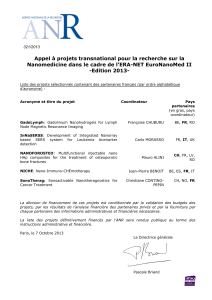Défi nir les objectifs et les cibles d’un traitement de la parésie spastique

10
Actualités en Médecine Physique et de Réadaptation - 02 - Avril - mai - juin 2014
Actualités en Médecine Physique
et de Réadaptation
DOSSIER
*
Pôle Autonomie
etSanté, unités
demédecine
physique et de
réadaptation, Hôpital
Sébastopol, CHU de
Reims.
**
Université de
Reims Champagne-
Ardenne, EA 3797,
Reims.
Défi nir les objectifs et les cibles
d’untraitementdela parésie spastique
Spastic paresis treatment defi nition: target and goal types
L. Tambosco*, A. Rapin*, L. Percebois-Macadré*, F.C. Boyer*,**
L
es conséquences cliniques d’une parésie d’origine
centrale ont souvent des retentissements négatifs
sur le mouvement et l’appareil locomoteur, mais
peuvent aussi compenser utilement certaines tâches
motrices. La consultation du patient neurolésé doit être
rigoureuse et individualisée, afi n de juger au mieux de
l’intérêt de la mise en route d’un traitement ou non.
La décision d’un traitement doit tenir compte, pour
chaque individu, des répartitions, de l’importance et de
l’association des défi ciences
(1, 2)
, des conséquences
plausibles sur le mouvement et les limitations d’acti-
vités. Les objectifs thérapeutiques les plus fréquem-
ment retenus sont de corriger l’attitude vicieuse d’un
membre (environ 75 % des cas), occasionnant des gênes
esthétiques ou des défauts d’amplitude, d’améliorer
des soins d’hygiène ou de faciliter l’habillage dans 45 %
des cas, de réduire les douleurs dans environ 40 % des
cas, et de favoriser les tâches et les performances
motrices dans moins de 20 % des cas
(3, 4)
.
Les analyses objectives de ces troubles neuromoteurs
sont diffi ciles à réaliser en pratique clinique, liées à
l’intégration de données multicomposites, avec des
combinaisons et des pratiques variables. Une revue
de A. Yelnik et al.
(5)
a fi xé les éléments contributifs à
l’analyse clinique des patients pour fi xer les objectifs
de soins pour ces patients atteints de parésie spas-
tique. Le
tableau
synthétise les éléments cliniques
possiblement combinés chez des patients neurolésés
au niveau du système nerveux central (SNC).
L’objectif de cet article est de clarifi er les procédures de
détermination d’un traitement contre les hyperactivités
musculaires liées aux lésions du SNC, au regard des
connaissances de la littérature et de la fréquence des
objectifs fi xés par les thérapeutes.
Traiter le membre supérieur
avecuneatteintemotrice complète
Les traitements généraux per os de la spasticité n’ont
pas fait la preuve de leur effi cacité sur les retentisse-
ments focaux des troubles mais aussi en raison des
effets négatifs de ces thérapeutiques sur les capa-
cités plastiques du SNC (ex. : baclofène). Le groupe
Afssaps “Traitement médicamenteux de la spasticité”
a recommandé une approche thérapeutique focale ou
locorégionale de l’hyperactivité musculaire, quelle que
soit la pathologie initiale
(6)
.
Attitude vicieuse et gênante
du membre supérieur
L’effi cacité des traitements focaux de la spasticité sur
les mesures goniométriques a été démontrée
(7)
. Le
positionnement vicieux et gênant du membre supérieur
reste l’indication la plus fréquemment retenue dans les
études
(3)
, avec des améliorations objectives de l’aspect
esthétique, une meilleure attitude du membre pour les
capacités de marche/équilibration, des soulagements
de sensation d’oppression thoracique (par spasticité
▸
Il est nécessaire de bien défi nir les typologies des
hyperactivités musculaires d’origine spastique, de
savoir les reconnaître et les mesurer, de comprendre
leurs répercussions sur le mouvement et les per-
formances motrices du patient neurolésé. Il faut être
capable de choisir les bonnes thérapeutiques pour
chaque combinaison de défi ciences, de connaître
les bénéfi ces et les effets indésirables des différentes
options thérapeutiques. Il est indispensable d’être
capable de déterminer les objectifs de traitements
personnalisés de chaque patient avant de com-
mencer un traitement.
▸
It is necessary to clearly defi ne spastic muscle ove-
ractivities, to be able to recognize and measure
spastic paresis, understand their impact on the
movement, motor performance and participation
restriction. It is important to be able to choose the
right treatment for each combination of defi ciencies,
know the benefi ts, side effects of different treatment
options. It is essential to be able to identify targets
for personalized treatment, for each patient, before
starting treatment.
Mots-clés : Parésie spastique – Hyperactivité musculaire
– Traitement – Évaluation
Keywords: Spastic paresis – Muscle overactivity –
Treatment – Assessment
POINTS FORTS
HIGHLIGHTS

11
Actualités en Médecine Physique et de Réadaptation - 02 - Avril - mai - juin 2014
Actualités en Médecine Physique
et de Réadaptation
Tableau. Physiopathologie de la parésie spastique et évaluation clinique
(D’après YelnikAP et al.)[5]
. Ces évaluations sont réalisées au repos
et lors des mouvements actifs.
Physiopathologie de la parésie spastique Évaluation clinique
Parésie
Manque de commande quantitative delamotri-
cité volontaire par atteinte de la voie cortico-
spinale
Demander
unecommandevolontaire
d’ungroupemusculaire
Mesurer l’angle de l’arrêt
delacommande volontaire
d’ungroupe musculaire parétique
(contre les résistances passives
dutissu desoutien
etlesco-contractions= angle
volontaire de l’échelle de Tardieu)
Hypoextensibilité
destissus de soutien
etmodifi cations
despropriétés
contractiles dumuscle
L’immobilisation relative provoque un rac-
courcissement et une réduction d’extensibilité
destissus de soutien, ainsi qu’une maladapta-
tion des fi bres musculaires de type I en fi bres
de type II
Goniométrie articulaire
passive àvitesse très lente Mesurer l’angle passif
d’extensibilité maximale du tissu
desoutien et des élements
musculaires contractiles
(vitesseV1 de l’échelle de Tardieu=
anglepassif)
Typologies
des hyperactivités
musculaires
La lésion de la voie corticospinale et le dys-
fonctionnement des voies descendantes cen-
trales provoquent une hyperexcitabilité des
motoneurones périphériques et une perte du
contrôle central inhibiteur, d’où une excitabilité
musculaire facilitée
Description de l’attitude
segmentaire derepos,
aumouvement passif
etaumouvement actif
Spasticité
Augmentation du réflexe d’étirement mus-
culaire proportionnel à la vitesse de mobilisa-
tion passive
Angle d’arrêt, clonus
ougradedespasticité
àvitesse très rapide
demobilisation passive
(1) Angle auquel un arrêt
demobilisation ou un clonus
survient, et (2) letype de réaction
musculaire qui apparaît ou grade
despasticité (vitesse V3 del’échelle
deTardieu= angle spastique)
Dystonie spastique
Hyperactivité musculaire au repos sans facteur
déclenchant primaire: rotation interne, adduc-
tion de l’épaule, fl exion du coude et pronation
de l’avant-bras, fl exion du poignet etdes doigts
au membre supérieur, ou équinovarus et griffe
d’orteils du membre inférieur
Description de l’attitude
dessegments de membres
aurepos
Co-contractions
spastiques
Défaut d’inhibition réciproque ou mauvaise
sélection de la commande pendant une motri-
cité active volontaire (diminue l’amplitude
active dumouvement et la capacité à effec-
tuer des mouvements alternatifs rapides
chezlespatients avec une bonne récupération
de la commande volontaire)
Nombre de mouvements
alternatifs rapides
sur15secondes
Nombre de commandes volontaires
surune période de temps défi nie
(nombre de répétitions d’amplitudes
articulaires actives volontaires
complètes d’un segment
del’appareil locomoteur)
Autres types
d’hyperactivités
musculaires
Hyperactivités insensibles à l’étirement des
fibres: syncinésies ou réactions associées,
mouvements anormaux à distance du segment
recruté par la commande volontaire.
Un recrutement exagéré des fi bres musculaires
est fréquent en cas de douleurs, de baillements
oud’efforts de toux
Description des troubles
associés à distance
dusegment recruté
encommande volontaire
Facteurs de variation
destroubles spastiques
aurepos
(dépendant delavitesse
d’étirement des fi bres)
Moment de la journée, position des autres
segments incluant le rachis cervical, stress,
température extérieure, facteurs nociceptifs
L’examen clinique comparatif
doit être réalisé
danslesmêmes conditions
(assis, debout, couché,
horaire, sans facteurs
nociceptifs ou de stress)

12
Actualités en Médecine Physique et de Réadaptation - 02 - Avril - mai - juin 2014
Actualités en Médecine Physique
et de Réadaptation
DOSSIER
des muscles adducteurs, rotateurs internes, fl échis-
seurs), ou des diffi cultés de positionnement pendant
le sommeil. Il semble donc intéressant de rechercher
ces éléments à l’interrogatoire afi n de mieux défi nir
ces objectifs avec le patient.
Soins d’hygiène
Les autres diffi cultés exprimées par une personne
parétique du membre supérieur suite à une neuro lésion
centrale, ou par son aidant, concernent l’acces sibilité
de la main, de l’aisselle ou du coude, le coupage des
ongles, avec un bénéfi ce ressenti après traitement focal
de la spasticité
(3,7-9).
Dans la plupart des études,
aucune échelle d’évaluation spécifi que n’est utilisée ;
B.B.Bhakta et al.
(8)
suggèrent d’utiliser les échelles
CBRS
(Carer Burden Rating Scale)
ou PD
(Patient’s
Disability)
, comprenant plusieurs items sur les limi-
tations d’activités chez les patients avec un membre
supérieur non fonctionnel : habillage, lavage de la main,
coupage des ongles… La
Disability Assessment Scale
(DAS) a également été validée
(9)
.
Habillage
Les diffi cultés rencontrées pour enfi ler une manche
en raison des conséquences des hyperactivités mus-
culaires gênantes indiquent parfois un traitement
focal, avec une efficacité admise dans plusieurs
études
(3,7,8)
. Les échelles précédentes d’évalua-
tion ont été suggérées
(8)
.
Douleurs
La parésie spastique retentit sur l’appareil locomoteur
et peut être source de douleurs
(5)
, liées aux spasmes
ou provoquées par la mobilisation, avec une effi cacité
des traitements focaux variable selon les études
(3,9)
.
Cependant, il faudra toujours rechercher une épine
irritative sous-jacente. Les échelles d’évaluation sug-
gérées sont l’échelle visuelle analogique (EVA)
[3]
et
la DAS
(9)
.
Traiter le membre supérieur
avec un défi cit moteur incomplet
L’amélioration des capacités de préhension après
traitement focal de la spasticité reste contro-
versée
(10)
, car les diffi cultés de préhension chez
ces patients sont la conséquence de plusieurs fac-
teurs intriqués : défi cit moteur, troubles sensitifs,
praxiques, ostéoarticulaires… Parmi les critères
moteurs, M.Rousseaux et al.
(7)
suggèrent que les
patients avec une spasticité des muscles pronateurs,
fl échisseurs du carpe et des doigts, et une bonne
conservation de la motricité des muscles distaux
sont ceux ayant les plus grandes probabilités d’être
améliorés sur certaines tâches de préhension. Plu-
sieurs études ont retrouvé une amélioration sur
des tests de performances, sans satisfaction pour
le patient
(3,11)
. Cette insatisfaction peut résulter
d’une mauvaise défi nition des objectifs fi xés avec
le patient.
Les échelles d’évaluation les plus fréquemment
utilisées dans les études ont été la Fugl-Meyer
(3)
,
imposant une passation longue et pour laquelle les
résultats sont controversés, selon les études, avec
des bénéfi ces décrits dans environ 50 % des cas
(12)
pour l’échelle des 400 points
(13)
[score considéré
comme signifi catif pour une variation supérieure ou
égale à 10points], le
Box and Block test
et
Nine Hole
Peg test
(7)
, le
Frenchay Arm test
(11)
, l’ARAT
(14)
.
Des échelles d’indépendance aux activités de la vie
quotidienne (AVQ) plus globales comme la MIF ou
l’index de Barthel manquent de sensibilité
(7)
. Lors
de l’utilisation de ces échelles de mesure d’AVQ, il
n’y avait pas d’amélioration dans près de 80 % des
cas
(12)
. L’objectif fonctionnel n’est possible que dans
une minorité de cas(20 %). Pour fi nir, la satisfaction
subjective du patient a été le plus souvent évaluée dans
les études (pourcentage de satisfaction ou échelle de
type GAS)
[3, 4, 13]
.
Traiter le membre inférieur
Déambulation et marche
Les conséquences de la parésie spastique peuvent
entraver la fonction de déambulation : les muscles
les plus concernés sont le quadriceps, empêchant
la fl exion active du genou en phase oscillante, et le
triceps sural, responsable d’un équinovarus avec
impossibilité de poser le talon au sol, une accroche de
la pointe du pied et risque de chute en phase portante.
Cependant, les répartitions des défi ciences sont par-
ticulièrement individuelles, nécessitant des examens
systématiques. Les griffes d’orteils gênantes sont
aussi très fréquentes. Un grand nombre d’échelles
d’évaluation sont disponibles selon les symptômes
et les signes retrouvés à chaque examen clinique,
comme les mesures goniométriques, les échelles
d’intensité de l’hypertonie d’origine spastique, les
échelles de co-contraction des muscles agoniste/
antagoniste ou d’hyperactivités musculaires invo-
lontaires (dystonie, syncinésie). Les retentissements
de ces hyperactivités, parésies ou rétractions sur les
performances de marche sont mesurés globalement
par le test de 10mètres et le test de 6minutes
(15)
,
la
Functional Ambulation Classifi cation
(16)
, plus
rarement des instruments de mesure réservés à
la recherche ou aux évaluations complexes (pen-
dulum test, électromyographie dynamique, labora-
toire d’analyse du mouvement)
[16]
. L’effi cacité des
traitements, dans l’objectif d’améliorer les limitations
d’activités, est variable car elle dépend des com-
binaisons des défi ciences impliquées, contrastant
avec le ressenti du patient qui est le plus souvent
satisfait
(16)
.

13
Actualités en Médecine Physique et de Réadaptation - 02 - Avril - mai - juin 2014
Actualités en Médecine Physique
et de Réadaptation
Hygiène, nursing, douleur
Les soins d’hygiène, essentiellement du périnée et du
pli de l’aine, peuvent être rendus diffi ciles par l’impor-
tance de la spasticité des adducteurs. L’effi cacité d’un
traitement focal de la spasticité des adducteurs a été
testée, avec une amélioration positive pour les critères
d’évaluation suivants : EVA de la douleur, distance entre
les genoux, mesures goniométriques de l’abduction de
hanches, échelle d’hygiène sur 6points (pas de diffi -
cultés, impossible/nécessité de 2personnes)
[17,18]
.
Attitude vicieuse et gênante
du membre inférieur
Des hyperactivités musculaires, les troubles parétiques
ou les rétractions du membre inférieur peuvent entraîner
des attitudes vicieuses responsables d’une gêne fonc-
tionnelle et/ou de douleurs. Les plus fréquentes sont les
griffes d’orteils réductibles par hyperactivité musculaire
des longs fl échisseurs ou fl échisseurs intrinsèques,
avec des conséquences néfastes pour le chaussage et
la marche, l’extension de l’hallux permanent réductible
(dystonique) entraînant des douleurs et contribuant
au varus. Les hyperactivités musculaires diffuses des
membres inférieurs, chez les patients blessés médul-
laires ou atteints de sclérose en plaques, peuvent gêner
le positionnement en station assise, provoquer des dou-
leurs ou des complications cutanées. Le choix des trai-
tements se fait selon l’importance des composantes
d’hyperactivités musculaires (spastiques, dystoniques
ou syncinétiques, des phénomènes de co-contractions),
du caractère rétracté ou mixte des défi ciences, selon la
commande motrice résiduelle et le caractère unilatéral
ou bilatéral des troubles.
Discussion
Traiter une hyperactivité musculaire gênante impose
au préalable une évaluation clinique rigoureuse com-
prenant une évaluation de l’importance de la spasticité
habituelle, de la présence ou de l’absence des signes
associés (co-contraction, dystonie, parésie, rétrac-
tion), de leurs répartitions et de leurs retentissements
néfastes et bénéfi ques, tant sur le plan des structures
corporelles (mesures goniométriques par exemple) que
sur leurs effets sur les capacités. Ces troubles doivent
être examinés assis, debout, couché compte tenu de
la variabilité de ces phénomènes neurologiques cen-
traux. Les objectifs doivent être contractualisés clai-
rement avec le patient. Les cibles des traitements sont
spécifi ques, individualisées, mesurées, atteignables
et évaluables.
Les objectifs défi nis sont de natures différentes : amé-
liorer les fonctions passives et/ ou actives ou éviter les
hyperactivités musculaires associées, ce qui implique
de choisir des mesures d’évaluation selon l’examen
clinique individualisé. La faisabilité de ces mesures
ainsi que les évaluations doivent être simples en pra-
tique clinique. Cette démarche intellectuelle demande
du temps afi n de centrer au mieux les objectifs sur les
dysfonctions de l’individu et de répondre aux attentes
contractualisées avec le patient.
Défi ciences motrices et orthopédiques
Elles ont des mesures validées et décrites dans la
littérature, dont la faisabilité est admise en pratique
clinique : les mesures goniométriques, la mesure de
l’hypertonie par l’échelle d’Ashworth (critiquable du
fait de sa faible reproductibilité et de son imprécision),
ou l’échelle de Tardieu, mieux acceptée. L’importance
des spasmes peut être mesurée par l’échelle de Penn,
la commande musculaire par l’échelle du
Medical
Research Council
(MRC), sous réserve de la standar-
disation de la position corporelle du testing et d’une
faible hyperactivité musculaire, ou bien les mesures
instrumentées isocinétiques.
Attitudes vicieuses segmentaires des membres
Les troubles du positionnement segmentaire des
membres sont des doléances fréquentes des patients,
en raison de leurs répercussions esthétiques ou de
positionnement ou par un retentissement sur les capa-
cités et performances motrices (marche, équilibra-
tion). Les mesures goniométriques sont un bon refl et
de l’amélioration obtenue après traitement, avec une
effi cacité retrouvée dans la plupart des études. La per-
ception subjective d’une amélioration par le patient
est une variable souvent rapportée. L’échelle de type
DAS pour le membre supérieur est pratique et refl ète
le ressenti du patient
(7)
.
Soins d’hygiène, nursing, habillage
Les objectifs doivent également être établis en tenant
compte de ces gênes et de la perception subjective du
patient, mais également des aidants, les évaluations
pouvant être guidées par des échelles comme la GAS,
qui reste néanmoins critiquée en pratique clinique, ou
mentionnent plus spécifi quement certains actes ciblés
de la vie quotidienne (CBRS, PD). Le gain sur le confort
doit rester l’objectif essentiel chez les patients avec
une spasticité sévère.
Limitations d’activités
Elles sont rapidement mesurables pour certaines per-
formances (exemple test des 10mètres). Les échelles
d’indépendance aux activités de la vie quotidienne (MIF,
Barthel) fournissent des scores globaux qui manquent
de sensibilité, et présentent un effet plafond en cas de
bonnes capacités fonctionnelles avant traitement
(19)
.
•Tâches de préhension
Les analyses des déficiences et des éléments
d’approche ou de saisie des tâches de préhension sont

14
Actualités en Médecine Physique et de Réadaptation - 02 - Avril - mai - juin 2014
Actualités en Médecine Physique
et de Réadaptation
DOSSIER
importantes pour défi nir des objectifs de soins. Certains
auteurs soulignent l’intérêt d’une évaluation par des
épreuves de performances des prises bimanuelles
(13)
,
en plus de la main lésée d’appoint.
•Tâches de déplacement, déambulation
ettransferts
L’analyse clinique qualitative du schéma de marche
du patient est un élément fondamental pour évoquer
l’intérêt d’un traitement. Des mesures quantitatives
de performance sont complémentaires et utiles. Le
test des 10 mètres semble être le plus intéressant :
facile à réaliser, rapide et fi able, sa mesure est chif-
frée. Il apporte des éléments sur le risque de chute
ou le risque de dépendance, sur le niveau de perfor-
mance ou encore sur les modifi cations de l’utilité des
aides techniques sur terrain régulier avant et après
traitement
(20)
. L’efficacité des traitements de la
parésie spastique sur la vitesse de marche n’est pas
constante dans la littérature. Il apparaît qu’une vitesse
Références bibliographiques
1.
Bohannon RW, Smith MB. Interrater reliability of a modifi ed Ashworth scale of muscle spasticity. Phys Ther 1987;67(2):206-7.
2.
Tardieu G, Shentoub S, Delarue R. Research on a technic for measurement of spasticity. Rev Neurol (Paris);1954;91(2):143-4.
3.
Luauté J, Landrault E, Jacquin-Courtois S, Mertens P, Rode G, Boisson D. Treatment of focal upper limb spasticity with botulinum toxin after
stroke. Interest of an individual approach. Ann Readapt Med Phys 2004;47(8):555-62.
4.
Jost WH, Hefter H, Reissig A, Kollewe K, Wissel J. Effi cacy and safety of botulinum toxin type A (Dysport) for the treatment of post-stroke arm
spasticity: results of the German-Austrian open-label post-marketing surveillance prospective study. J Neurol Sci 2014;337(1-2):86-90.
5.
Yelnik AP, Simon O, Parratte B, Gracies JM. How to clinically assess and treat muscle overactivity in spastic paresis. J Rehabil Med 2010;42(9):801-7.
6.
Afssaps. Recommandations de bonne pratique. Traitements médicamenteux de la spasticité [cited 2010 July 7] Available from: http://www.ansm.
sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/9771c86bf98d7af854c30b202846ab35.pdf
7.
Rousseaux M, Kozlowski O, Froger J. Effi cacy of botulinum toxin A in upper limb function of hemiplegic patients. J Neurol 2002;249(1):76-84.
8.
Bhakta BB, Cozens JA, Chamberlain MA, Bamford JM. Impact of botulinum toxin type A on disability and carer burden due to arm spasticity after
stroke: a randomised double blind placebo controlled trial. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2000;69(2):217-21.
9.
Brashear A, Gordon MF, Elovic E et al. Intramuscular injection of botulinum toxin for the treatment of wrist and fi nger spasticity after a stroke.
N Engl J Med 2002;347(6):395-400.
10.
Foley N, Pereira S, Salter K et al. Treatment with botulinum toxin improves upper-extremity function post stroke: a systematic review and meta-
analysis. Arch Phys Med Rehabil 2013;94(5):977-89.
11.
Sampaio C, Ferreira JJ, Pinto AA, Crespo M, Ferro JM, Castro-Caldas A. Botulinum toxin type A for the treatment of arm and hand spasticity in
stroke patients. Clin Rehabil 1997;11(1):3-7.
12.
Olvey EL, Armstrong EP, Grizzle AJ. Contemporary pharmacologic treatments for spasticity of the upper limb after stroke: a systematic review.
Clin Ther 2010;32(14):2282-303.
13.
Ferrapie AL, Vieillart A, Saint-Cast Y, Menei P, Richard I. [Botulinum toxin injections and hypertonic upper limbs. Which functional results?].
Ann Readapt Med Phys 2005;48(4):172-9.
14.
Yazdchi M, Ghasemi Z, Moshayedi H et al. Comparing the effi cacy of botulinum toxin with tizanidine in upper limb post stroke spasticity. Iran
JNeurol 2013;12(2):47-50.
15.
Hesse S, Krajnik J, Luecke D, Jahnke MT, Gregoric M, Mauritz KH. Ankle muscle activity before and after botulinum toxin therapy for lower limb
extensor spasticity in chronic hemiparetic patients. Stroke 1996;27(3):455-60.
16.
Béseler MR, Grao CM, Gil A, Martínez Lozano MD. Walking assessment with instrumented insoles in patients with lower limb spasticity after
botulinum toxin infi ltration. Neurologia 2012;27(9):519-30.
17.
Hyman N, Barnes M, Bhakta B et al. Botulinum toxin (Dysport) treatment of hip adductor spasticity in multiple sclerosis: a prospective, rando-
mised, double blind, placebo controlled, dose ranging study. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2000;68(6):707-12.
18.
Opara J, Hordy´nska E, Swoboda A. Effectiveness of botulinum toxin A in the treatment of spasticity of the lower extremities in adults – prelimi-
nary report. Ortop Traumatol Rehabil 2007;9(3):277-85.
19.
Simpson DM, Alexander DN, O’Brien CF et al. Botulinum toxin type A in the treatment of upper extremity spasticity: a randomized, double-blind,
placebo-controlled trial. Neurology 1996;46(5):1306-10.
20.
Tilson JK, Sullivan KJ, Cen SY et al. Meaningful gait speed improvement during the fi rst 60 days poststroke: minimal clinically important diffe-
rence. Phys Ther 2010;90(2):196-208.
21.
Salbach NM, Mayo NE, Higgins J, Ahmed S, Finch LE, Richards CL. Responsiveness and predictability of gait speed and other disability measures
in acute stroke. Arch Phys Med Rehabil 2001;82(9):1204-12.
de marche<0,3 m/ s correspond plus à un objectif
d’équilibration, et celle≥0,3 m/ s, à l’amélioration de
la marche et de l’équilibration
(21)
.
Conclusion
Les indications d’un traitement contre les consé-
quences d’une parésie spastique doivent être indi-
vidualisées et mesurées, afi n de garantir au mieux
l’efficacité et le niveau de satisfaction du patient.
Outre la recherche de l’amélioration des défi ciences,
ils doivent prendre en compte les retentissements sur
les capacités et les performances motrices du patient.
Les échelles d’évaluation utilisées doivent mesurer
l’atteinte de l’objectif recherché pour chaque patient
traité, ce qui signifi e une personnalisation des mesures
utilisées. Le consentement, la contractualisation, les
mesures subjectives de la réalisation des objectifs par
le patient restent complémentaires et indispensables.
1
/
5
100%