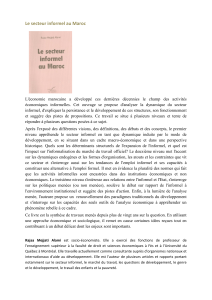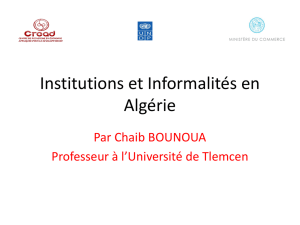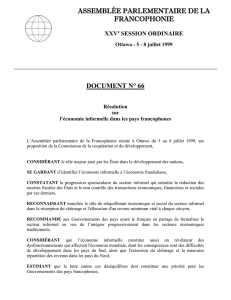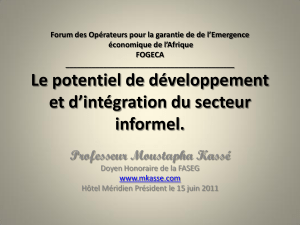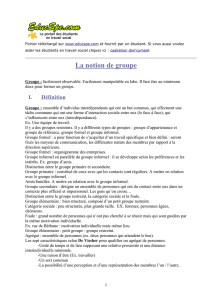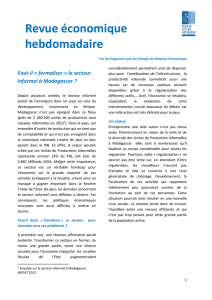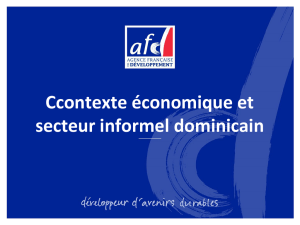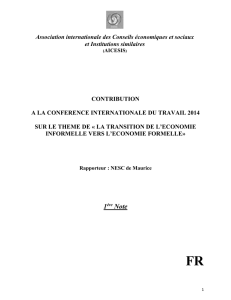L’ECONOMIE INFORMELLE A TIZI-OUZOU (ALGERIE) : DETERMINANTS, SEGMENTATION ET MOBILITE

L’ECONOMIE INFORMELLE A TIZI-OUZOU (ALGERIE) :
DETERMINANTS, SEGMENTATION ET MOBILITE
Omar BABOU (Université de Tizi-Ouzou), Philippe ADAIR (Université Paris-Est Créteil)
Résumé
Notre étude de l’économie informelle en Algérie repose sur une enquête mixte (ménages et unités de
production informelles) menée en 2012 auprès d’un échantillon de 536 ménages (1022 actifs occupés non
agricoles), répartis sur 8 communes urbaines et semi-urbaines à Tizi-Ouzou. Tout d’abord, nous définissons
les notions d’emploi et de secteur informel; nous présentons les différentes méthodes de mesure et d’enquête
sur l’emploi et le secteur informel ; nous passons en revue les diverses théories de la segmentation du marché
du travail en mettant l’accent sur la mobilité. Ensuite, nous estimons la taille du secteur informel ainsi que celle
de l’emploi informel selon notre enquête au regard des données de l’enquête nationale sur l’emploi, et nous
réalisons une typologie des activités et des individus opérant dans l’informel. Enfin, nous analysons, à l’aide
d’une régression logistique, les déterminants de l’emploi et du secteur informel, ainsi que la mobilité socio-
professionnelle des actifs tant entre les deux segments (formel et informel) qu’au sein du secteur informel lui-
même.
Mots clés : Algérie, emploi informel, enquête mixte (ménages/entreprises), marché du travail, mobilité
JEL : O17

INTRODUCTION
Depuis son apparition dans la littérature économique, suite au rapport Kenya du Bureau
International du Travail (BIT, 1972), la notion de secteur informel ne cesse d’alimenter les débats des
théoriciens et praticiens du développement sur la définition et les contours de ce concepts ainsi que
sur son dynamisme et son insertion dans le secteur formel moderne.
Sur un autre registre, celui de la modélisation du marché du travail, il est à rappeler que les premiers
modèles du marché de travail des économies en développement (Lewis, 1954) ne parlent pas de
secteur informel ni même de chômage urbain. Notions qui sont intégrés, graduellement, dans les
modèles dualistes du marché du travail à partir des années 1970.
Cela dit, bien que beaucoup d’écrits soient réalisés sur l’économie informelle il apparait que cette
réalité est loin d’être cerné dans toutes ses dimensions (définition, caractéristiques, mesure…).
En Algérie, malgré que l’on reconnaisse l’importance et la place qu’occupe cette économie, peu de
travaux sont réalisés et ces travaux ne touchent, en général, qu’un segment ou une activité de ce
secteur. Voir à ce sujet Bounoua (1995]) et Adair et Bounoua (2003) qui dressent un inventaire des
principaux travaux consacrés à l’économie informelle en Algérie. De plus, les enquêtes ménages sont
peu abondantes, tandis que, les enquêtes entreprises ne sont jamais combinées aux enquêtes ménages
dont l’importance n’est pas à démontrer.
L’économie informelle recouvre une double dimension : celle de l’emploi salarié et celle de l’emploi
non-salarié qu’illustrent les micro-entreprises. L’emploi informel constitue-t-il la norme (Jutting et
Laiglesia, 2009) ? Est-il « satisfaisant » au regard du bien-être (Bensidoun et Souag, 2013) ? Au regard
des OMD, le travail décent (ou l’emploi durable) est-il hors de portée (BIT, 2002) ? A quelles
conditions la transition de de l’économie informelle vers l’économie formelle est elle-envisageable
(BIT, 2013) ?
L’intérêt d’une enquête mixte, la première réalisée en Algérie à notre connaissance (Babou, 2013), est
d’analyser la double dimension de l’emploi informel à la fois sous l’angle de l’offre de travail (salarié)
et de l’offre de biens (demande de travail non salarié).
L’objet cette communication est l’étude de l’économie informelle en Algérie à travers le cas
spécifique de la wilaya de Tizi-Ouzou. Nous mobilisons, à cet effet, une approche par enquête mixte
(ménages et unités de production informelles).
Tout d’abord, nous définissons les notions d’emploi et de secteur informel (Vanek et al, 2014) ; nous
présentons les différentes méthodes de mesure et d’enquête sur l’emploi et le secteur informel ; nous
passons en revue les diverses théories de la segmentation du marché du travail depuis le modèle
fondateur de Lewis jusqu’aux modèles de Fields (2007) en mettant l’accent sur la mobilité.
Ensuite, nous estimons la taille du secteur informel ainsi que celle de l’emploi informel selon notre
enquête au regard des données de l’enquête nationale sur l’emploi (ONS, 2013), et nous réalisons une
typologie des activités et des individus opérant dans l’informel.
Enfin, nous analysons, à l’aide d’une régression logistique, les déterminants de l’emploi et du secteur
informel, ainsi que la mobilité socio-professionnelle des actifs tant entre les deux segments (formel et
informel) qu’au sein du secteur informel lui-même.

1. L’ÉCONOMIE INFORMELLE : DÉFINITION, COMPOSANTES, MESURES
ET THEORIES DE SEGMENTATION DU MARCHE DU TRAVAIL
1.1 Définition et composantes de l’économie informelle
Depuis l’invention du concept d’économie informelle par le BIT dans le rapport Kenya (BIT, 1972)
et par Hart (1971), les débats sur la définition, la mesure et les contours de ce phénomène suscitent
un intérêt grandissant non seulement au sein du BIT mais aussi dans les autres institutions
internationales (OCDE et Banque mondiale). Le débat est important non seulement sur l’origine du
concept (BIT ou Hart) mais dans le choix du niveau d’analyse. Ainsi, Hart situe l’analyse au niveau
des ménages et utilise d’ailleurs le concept "d’informel" sans référence à un quelconque secteur alors
que le BIT situe l’analyse au niveau des unités de production qu’il nomme "secteur informel"
(Lautier, 1994, 9).
Le consensus autour de la notion même de secteur informel n’est pas acquis, des auteurs parlent
d’économie de l’ombre, souterraine, cachée, parallèle, dissimulée, etc. Willard (1989) identifie plus
d’une vingtaine d’appellations plus ou moins synonymes. Cependant, la notion de "secteur informel"
a prit le dessus sur toutes les autres, surtout quand il s’agit des études portant sur les pays en
développement. Afin de dépasser les controverses et pour mieux cerner et harmoniser les statistiques
sur le secteur informel la 15e Conférence Internationale des Statisticiens du Travail (CIST) de 1993
propose une définition statistique opérationnelle du secteur informel mais aussi de l’emploi informel
qui sont considérés comme deux nouveaux concepts de population active venus compléter la
panoplie des concepts classiques forgés par la CIST (Charmes, 2006, 11)
Le secteur informel est considéré « comme un ensemble d’unités produisant des biens et des services
en vue principalement de créer des emplois et des revenus pour les personnes concernées. Ces
unités, ayant un faible niveau d’organisation, opèrent à petite échelle et de manière spécifique avec
peu ou pas de division entre le travail et le capital au tant que facteur de production. Les relations de
travail lorsqu’elles existent sont surtout fondées sur l’emploi occasionnel, les relations de parenté ou
les relations personnelles et sociales plutôt que sur des accords contractuels comportant des garanties
en bonne et due forme » (BIT, 1993 b). D’un point de vue statistique et opérationnel le secteur
informel est constitué des unités de productions non agricoles qui appartiennent en tant
qu’entreprises individuelles au secteur institutionnel des ménages au sein du Système de Comptabilité
Nationale (SCN), ce qui le différencie des sociétés et quasi-société sur la base de leur statut légal et du
type de comptabilité car pour ces dernières il y a une séparation précise entre la personnalité juridique
de l’entreprise et celle du propriétaire ou du ménage de même qu’elles tiennent une comptabilité
complète ce qui n’est pas le cas pour les entreprises individuelles.
Le secteur informel est constitué des entreprises informelles de travailleurs à compte propre
(entreprises familiales) employant des aides-familiaux ou des salariés occasionnels et des entreprises
d’employeurs informels (micro-entreprises) qui peuvent employer un nombre restreint des
travailleurs permanents (inférieur à 5 ou 10 selon les pays).
La population occupée dans le secteur informel comprend toutes les personnes exerçant un emploi,
pendant la période de référence, dans au moins une unité du secteur informel, indépendamment de la
situation dans la profession (indépendant, salarié, aide familial…) et de l’exercice principal ou
secondaire de cette activité (Charmes, 1997). Cette définition permet d’inclure la pluriactivité dans le
secteur informel, mais elle exclut pour des raisons pratiques l’agriculture, les activités primaires ainsi
que la production domestique destinée à l’autoconsommation du champ du secteur informel.
L’emploi informel se définit « par les caractéristiques de l’emploi occupé, en l’occurrence le non
enregistrement, l’absence de protection sociale (emplois non protégés), le secteur informel (définit
par les caractéristiques de l’unité économique dans laquelle travaille la personne) étant considéré
comme une de ses composantes » (Charmes, 2006, 16).

Schéma 1 : composants du secteur informel et de l’emploi informel
Emploi
Formel Informel
Entreprise Formelle Secteur formel (3)
Informelle (2) Secteur informel
Source : Charmes (2006,16).
L’emploi informel est donc la somme du secteur informel et de la catégorie (3) qui représente les
emplois informels dans les entreprises du secteur formel.
1.2 Méthodes de mesure et d’enquête
La mesure de l’économie informelle relève de deux approches, indirectes et directes, qui recouvrent
plusieurs méthodes non comparables et aboutissent à des estimations disparates en raison des limites
du champ des activités qui est circonscrit. Les approches indirectes reposent sur quatre méthodes
distinctes : compte nationaux, agrégats monétaires et demande de monnaie, méthode multi-variables,
offre implicite de travail (Adair, 2002 b, 16 ; Archambault et Greffe (1984). Les enquêtes directes
sont basées sur des enquêtes annuelles sur l’emploi ou sur le secteur informel. Il s’agit des enquêtes
ménages, des enquêtes établissements ou encore des enquêtes mixtes (ménages et établissements).
1.2.1 Les enquêtes auprès des ménages
La collecte d’informations sur l’emploi et le secteur informel dans le cadre de cette enquête se fait
directement auprès des ménages. Cette enquête permet de rendre compte de la pluriactivité, du
travail à domicile et d’avoir quelques informations sur les entreprises informelles. Cependant, si les
employeurs indépendants peuvent répondre facilement à toutes les questions, sauf à vouloir cacher
certaines informations, les autres catégories « salariés, apprentis, aides-familiaux et occasionnels
ignorent la plupart du temps le statut de l’entreprise où ils travaillent, si elle tient une comptabilité
complète, si elle est enregistrée… » (Charmes, 1997).
1.2.2 Les enquêtes auprès des établissements ou des entreprises
Ce type d’enquête se réalise auprès des micro-entreprises (moins de cinq ou dix effectifs selon les
pays) et permet d’avoir les estimations les plus fiables des revenus des entrepreneurs. En plus du fait
que ce type d’enquête n’est plus prisé de nos jours contrairement aux enquêtes ménages, les enquêtes
entreprises ne couvrent pas le travail à domicile, le commerce ambulant et la pluriactivité.
1.2.3 Les enquêtes mixtes (ménages- entreprises)
Ce sont des enquêtes qui combinent les enquêtes ménages et les enquêtes entreprises et se déroulent
en deux phases. La première phase consiste à faire une enquête ménages qui nous permettra
d’identifier les employeurs et indépendants activant dans le secteur informel auxquels sera administré
un questionnaire établissement en deuxième phase.
Ces enquêtes mixtes sont considérées comme les plus fiables et les plus exhaustives des méthodes
d’enquêtes sur le secteur informel.
Cependant, leur degré de fiabilité et d’exhaustivité dépend de la qualité des réponses des ménages ;
en outre, l’entrepreneur du secteur informel, comme tout chef d’entreprise, a tendance à sous-estimer
le nombre de personnes qu’il emploie ; enfin les listes d’adresses établies lors de la première étape de
l’enquête ne permettent pas toujours de retrouver facilement les entreprises lors de la seconde étape
(Charmes, 2006, 17).

1.3 Théories de segmentation du marché du travail et mobilité
Les premiers travaux sur la segmentation du marché de travail des économies en développement
(Lewis, 1954) ne parlent pas de secteur informel ni même de chômage urbain. L’existence du
chômage urbain n’est reconnue qu’à partir des années 1970 (Todaro, 1969 ; Harris et Todaro, 1970 ;
Harberger, 1971 ; Tidrick ,1975 et Mincer, 1976), tandis que celle du secteur informel n’a eu lieu que
vers le milieu des années 1970 (Fields, 1975 et Mazumbar, 1976). Fields va encore plus loin dans son
analyse de la segmentation du marché du travail des pays en développement en distinguant entre
deux segments du secteur informel l’un d’accès facile et l’autre d’accès difficile.
1.3.1 La première génération du marché du travail dual
Les premiers modèles dualistes (Lewis, 1954) ayant trait aux pays sous-développés expliquent que
ces derniers sont caractérisés par la présence de deux types de structures économiques et sociales, la
première capitaliste et moderne et la seconde traditionnelle.
Le marché du travail est lui-même caractérisé par cette dualité avec d’une part un marché du travail
dédiée au secteur capitaliste où les salaires sont importants et d’autre part le marché du travail du
secteur agricole traditionnel où les salaires sont bas. Grace à l’existence de ces deux marchés le
chômage ne peut exister et l’expansion du secteur capitaliste est même permise grâce aux migrations
des salariés du secteur traditionnel rural vers les villes.
1.3.2 La seconde génération de modèles
La seconde génération de modèles, ceux de Todaro (1969), Harris et Todaro (1970) mais aussi ceux
de Harberger (1971), Tidrick (1975) et Mincer (1976), même s’ils reconnaissent l’existence d’un
chômage urbain persistant ils ne font aucune allusion à l’existence d’un secteur informel urbain.
Suite à leurs travaux sur l’Afrique subsaharienne Harris et Todaro (1970) ont pu constater que les
migrations des ruraux vers les villes ont engendré un chômage urbain car les structures capitalistes ne
pouvaient absorber des flux de main d’œuvre très importants.
En effet, selon Fields (1990) ces modèles de seconde génération possèdent les caractéristiques
fondamentales suivantes :
• Une économie dualiste, composée d’un secteur urbain moderne protégé et d’un secteur
agricole traditionnel non protégé ;
• Un double régime de rémunération s’expliquant par :
- un salaire imposé, qui est supérieur au niveau d’équilibre du marché dans le secteur
moderne ;
- des salaires correspondant au niveau d’équilibre du marché dans l’agriculture.
• Des mouvements migratoires dus aux écarts entre les rémunérations escomptées dans les
villes et les rémunérations perçus dans les zones rurales;
• Un chômage urbain persistant.
Ces modèles dualistes du marché du travail de seconde génération, contrairement aux modèles de
première génération, reconnaissent l’existence du chômage mais pas celle du secteur informel qui
ne sera pris en comptes que quelques années plus tard dans les modèles de troisième génération que
l’on verra dans le prochain point
1.3.3 La troisième génération de modèles
La troisième génération de modèles, due, essentiellement, à Fields (1975) mais aussi à Lopez (1970)
et Mazumdar (1976), relève l’existence d’un secteur informel urbain d’accès facile contrairement au
secteur moderne, mais dont la rémunération et plus bas que dans l’agriculture.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
1
/
17
100%