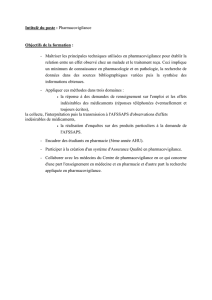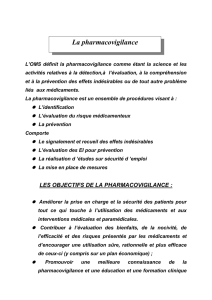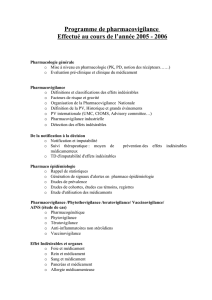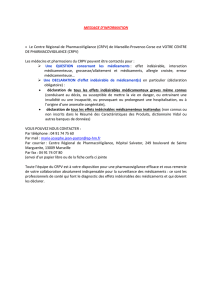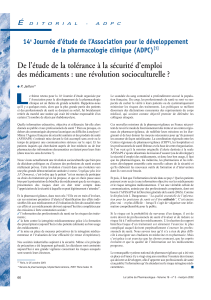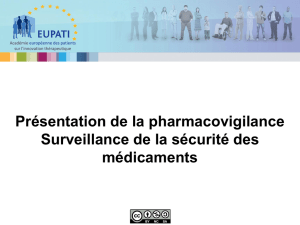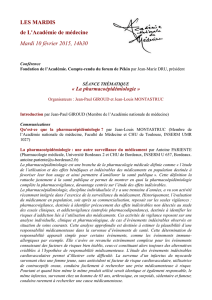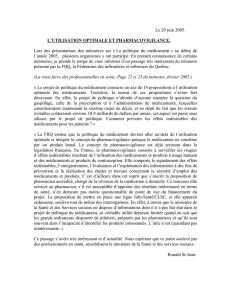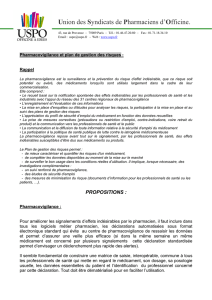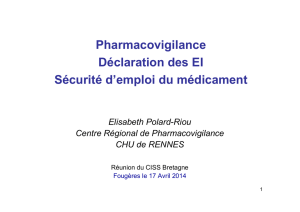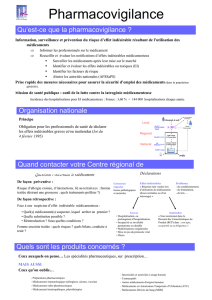T R I B U N E L I...

132
La Lettre du Pharmacologue - Volume 15 - n
os
7-8 - septembre-octobre 2001
TRIBUNE LIBRE
objectif des soins médicaux est de mettre en œuvre
des traitements efficaces, afin d’améliorer ou de
restaurer la santé des patients. Les risques associés aux
thérapeutiques sont maintenant, par le biais des médias, bien
connus du grand public et le nombre et le coût des réclamations
mettant en cause la responsabilité des hôpitaux ont augmenté
ces dernières années de façon très importante. Les sinistres les
plus fréquemment déclarés et les plus coûteux concernent
l’activité clinique, et, à l’intérieur de celle-ci, la iatrogénie
d’origine médicamenteuse. Jadis tolérés, acceptés au nom de
la fatalité, les risques iatrogènes ne sont actuellement plus
admis. Le système de soins ne pouvant garantir une innocuité
totale, il doit gérer les risques auxquels il expose les patients
pour répondre à leurs exigences croissantes en matière de sécu-
rité de soins. La seule solution efficace à long terme est la mise
en place d’une politique de prévention. C’est aujourd’hui
l’objectif premier de la vigilance sanitaire.
PLACE DES VIGILANCES DANS LA GESTION DES RISQUES
Les vigilances visent à améliorer la sécurité des patients vis-à-
vis des produits de santé. Chaque établissement de santé est
tenu de les mettre en place et de structurer leur exercice
(formation et information des professionnels de santé, rédac-
tion et mise en œuvre des procédures à appliquer en cas
d’accident) en se dotant du personnel médical nécessaire à
l’accomplissement de ces missions. La déclaration des inci-
dents et accidents liés aux produits de santé est obligatoire, ce
qui fournit l’occasion de mettre en place une démarche de
gestion des risques.
ORGANISATION ACTUELLE DE LA PHARMACOVIGILANCE
C’est la plus ancienne des vigilances, mise en place dès 1973
dans certaines régions, introduite dans la loi en juillet 1980.
La pharmacovigilance a été depuis plus de vingt-cinq ans une
préoccupation constante des pouvoirs publics : la déclaration
des effets indésirables est obligatoire depuis 1985, elle a été
étendue aux médicaments dérivés du sang en 1993. L’organi-
sation et le fonctionnement de la pharmacovigilance sont
régis (1) par les décrets du 13 mars 1995 (n° 95-278) et du
6mai 1995 (95-566).
Sa création repose sur le fait qu’une fois commercialisé, le
médicament voit ses conditions d’utilisation s’élargir par rap-
port à celles de la phase III des essais cliniques. La popula-
tion traitée grandit brusquement et le recrutement des patients
est moins ciblé, des groupes à risques apparaissent, non étu-
diés en précommercialisation, chez lesquels vont survenir des
effets indésirables non encore notifiés et non enregistrés dans
l’autorisation de mise sur le marché (AMM). Les obligations
de la pharmacovigilance sont la notification, l’enregistrement
et l’évaluation systématique des effets indésirables survenant
dans des conditions normales d’utilisation. Son objectif est
de détecter les effets indésirables inattendus ou graves des
médicaments dès leur commercialisation et de réévaluer en
permanence toutes les informations permettant de prévenir
ou de réduire les risques liés à la thérapeutique médicamen-
teuse.
Afin de faciliter les échanges d’information, la pharmacovi-
gilance est organisée en un réseau décentralisé de trente
et un centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV),
qui sont coordonnés par l’unité de pharmacovigilance de
l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
(AFSSaPS). Des alertes ou des enquêtes nationales sont mises
en place par le Comité technique de pharmacovigilance, qui
se réunit une fois par mois ; leur rapport est présenté et dis-
cuté en Commission nationale de pharmacovigilance, dont les
avis seront alors transmis au directeur de l’AFSSaPS. L’in-
formation descendante sur les mesures prises (suspension du
médicament, réévaluation du rapport bénéfice/risque, modi-
fications des rubriques du résumé des caractéristiques pro-
duit) suit plusieurs voies (communiqués de presse, mailing,
site Internet de l’Agence…).
PHARMACOVIGILANCE À L’ÉCHELON LOCAL
Il existe une grande disparité d’organisation locale de
chacune des vigilances (hémovigilance, matériovigilance,
réactovigilance…) au niveau des établissements de santé.
Actuellement, la pharmacovigilance ne s’est pas dotée de cor-
respondants locaux identifiés. Selon l’article 5144-19 du
code de la santé publique, tout médecin, chirurgien, dentiste,
sage-femme ou pharmacien qui a constaté ou a eu connais-
sance d’un effet indésirable grave ou inattendu susceptible
d’être dû à un médicament doit obligatoirement le déclarer
au CRPV.
La gestion des risques médicamenteux
!
P. Jolliet *
*Laboratoire de pharmacologie clinique, centre régional de pharmacovigilance,
44093 Nantes Cedex.
L’

La Lettre du Pharmacologue - Volume 15 - n
os
7-8 - septembre-octobre 2001
133
TRIBUNE LIBRE
Le CRPV se doit donc d’être au service des professionnels de
santé de son établissement pour remplir au quotidien une triple
mission :
"Recueillir les notifications d’effets indésirables, les ana-
lyser et les valider. L’imputabilité est standardisée au moyen
de la méthode française (2). L’observation est rendue anonyme
en ce qui concerne à la fois le patient et le notificateur, infor-
matisée dans la banque de données gérée par l’unité de phar-
macovigilance de l’AFSSaPS. La déclaration se fait au moyen
d’une fiche de type cerfa disponible dans un classeur des vigi-
lances diffusé dans toutes les unités fonctionnelles du CHU
et/ou envoyée au professionnel de santé lors d’une notification
téléphonique.
"Compléter une observation clinique en se rendant dans les
services hospitaliers où l’effet a été dépisté, discuter avec les
praticiens concernés, les alternatives thérapeutiques adaptées
au cas par cas et proposer une solution thérapeutique du
“moindre risque thérapeutique”.
"Apporter une aide personnalisée au diagnostic d’effet
indésirable médicamenteux et répondre à toute demande d’in-
formation concernant un médicament en matière de pharma-
cologie, de thérapeutique et de bon usage. Ainsi, chaque centre
régional de pharmacovigilance est un centre de renseignements,
et les praticiens qui y travaillent exercent un véritable rôle de
consultant, en matière de médicament et de bon usage, auprès
des professionnels de santé de leur région.
Dans le cas d’une notification d’administration d’un médica-
ment possiblement à risque pendant la grossesse, le cas fait
l’objet d’un suivi tout au long de la grossesse et pendant les
premiers mois de vie de l’enfant. Une banque locale de don-
nées est constituée à partir de ces cas.
MISSIONS D’UN PRATICIEN EN PHARMACOVIGILANCE
À l’heure actuelle, la majeure partie des tâches de pharmacovi-
gilance est orientée vers l’alerte conduisant à la réévaluation per-
manente au niveau national de la sécurité et du rapport béné-
fice/risque du médicament et à la modification éventuelle de
l’information qui accompagne le produit (3). Dans la démarche
actuelle de prévention des risques, le médecin praticien en phar-
macovigilance devra poursuivre cette tâche, et participer plus que
jamais à quatre étapes fondamentales de la pharmacovigilance :
le signalement de l’effet indésirable ; l’analyse et l’établisse-
ment de l’imputabilité ; l’évaluation des pratiques ; la mise en
place d’actions de prévention des risques, qui consiste à entre-
prendre des actions correctives et préventives permettant d’amé-
liorer la qualité des pratiques et des soins. Le suivi de ces pro-
cédures s’inscrit dans la démarche d’assurance qualité.
Le suivi et l’efficacité des actions de prévention au moyen
d’indicateurs évolutifs sont à créer.
Le pharmacovigilant peut apporter son expérience dans les pro-
cessus d’évaluation des risques collectifs liés au médicament,
et participer en tant qu’expert du risque médicamenteux aux
deux premières phases de gestion du risque dans l’établissement
auquel il est rattaché et dans sa région. Cette démarche ne peut
être entreprise qu’en coordination avec les autres vigilances
(CLIN, réactovigilance, hémovigilance, matériovigilance…),
de façon à simplifier les circuits d’information locaux, à iden-
tifier rapidement les principaux dysfonctionnements et à établir
des priorités. Le médecin praticien en pharmacovigilance est un
des acteurs du comité de la vigilance de son établissement.
SPÉCIFICITÉS ET PROFIL D’UN BON PRATICIEN
EN PHARMACOVIGILANCE
La démarche de pharmacovigilance est une démarche de méde-
cine clinique, qui doit être pratiquée par un médecin spécialiste
du médicament. Les candidats doivent posséder non seulement
des connaissances en pharmacologie générale et spécialisée, mais
aussi des compétences médicales leur permettant d’étayer un
diagnostic différentiel et de valider des alternatives thérapeu-
tiques conduisant à un meilleur rapport bénéfice/risque pour
le patient. Ils doivent également avoir des connaissances de phar-
macologie fondamentale pour diriger l’orientation du diagnostic
d’effet indésirable en mettant en place toutes les investigations
biologiques ciblées complémentaires nécessaires, et éventuelle-
ment initier des recherches expérimentales explicatives.
En résumé, la pharmacovigilance a besoin de praticiens hospi-
taliers, titulaires d’un DES, d’une maîtrise de pharmacologie et
si possible d’un DEA, ayant acquis une compétence spécifique
en pharmacologie expérimentale et clinique (par exemple en
exerçant les fonctions d’AHU dans un service de pharmacolo-
gie), capables de mener à bien une complexe mission hospita-
lière spécialisée d’alerte, de surveillance, de suivi, mais aussi de
formation et d’information des praticiens correspondants.
CONCLUSION
En France, la pharmacovigilance régionale et nationale est mise
en place et fonctionne depuis plusieurs années. À l’échelon
local, sa mise en œuvre obéit à une logique de conformité régle-
mentaire et, pour la sécurité des personnes, à une démarche auto-
nome de gestion des risques au sein de chaque établissement.
Cette démarche contribue à l’amélioration de la qualité de la
prestation hospitalière. La nomination de praticiens hospitaliers
pharmacologues est indispensable pour répondre aux objectifs
principaux de la gestion du risque médicamenteux : réduire par
des mesures de prévention la survenue des effets indésirables ;
combattre les conséquences dommageables de ces événements ;
rendre inutile le dépôt de plaintes ; contrôler les coûts. #
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. Décret n° 95-278 du 13 mars 1995 relatif à la pharmacovigilance et modifiant le
code de la santé publique. Journal Officiel du 14 mars 1995 ; 3935-8.
2. Bégaud B, Évreux JC, Jouglard J, Lagier G. Imputabilité des effets inattendus ou
toxiques des médicaments. Actualisation de la méthode utilisée en France. Therapie
1985 ; 40 : 111-8.
3. Bonnes pratiques de pharmacovigilance. Agence du Médicament, Saint-Denis. Édi-
tion décembre 1994 et Therapie 1995 ; 50 : 547-55.
Cet article constituant une libre opinion de l’auteur,
Pascale Jolliet invite les lecteurs à lui faire part
de leurs points de vue personnels.
1
/
2
100%