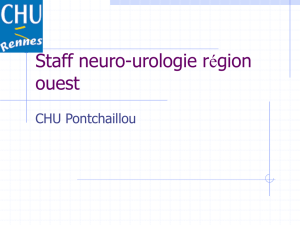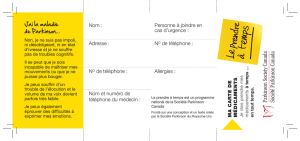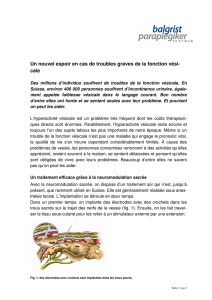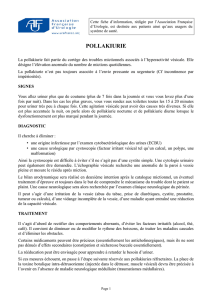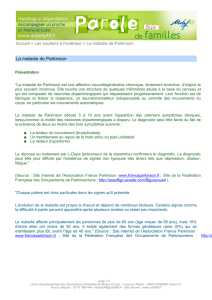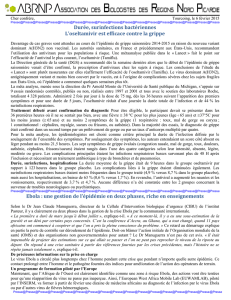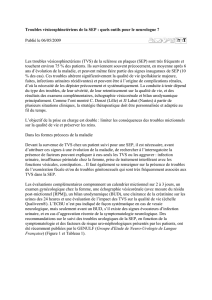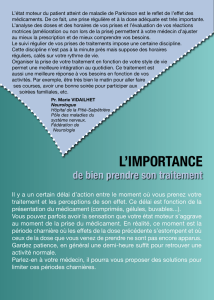Troubles urinaires et syndromes extrapyramidaux S

La Lettre du Neurologue - n° 6 - vol. II - décembre 1998 311
SÉRIE URODYNAMIQUE
es troubles de la miction dans la maladie de Parkinson
idiopathique (MPI) et les autres syndromes extrapyra-
midaux entraînent souvent, après quelques années
d’évolution, une gêne importante dans la vie quotidienne des
patients. Cette gêne s’accroît à mesure que les possibilités
motrices s’altèrent. En fin d’évolution, les problèmes devien-
nent la plupart du temps très gênants pour le patient et son
entourage, car ils aggravent la perte d’autonomie et occasion-
nent un retentissement psychologique notable. Par ailleurs, ils
s’intègrent dans un ensemble de troubles perturbant le confort et
la vie sociale, et doivent donc être envisagés globalement et non
simplement dans le cadre de la maladie neurologique.
Nous aborderons notamment au cours de cette mise au point
quelques sujets particuliers : la gravité des troubles vésico-
sphinctériens des syndromes extrapyramidaux avec dysautono-
mie, le rapport des troubles vésico-sphinctériens avec les fluc-
tuations motrices de la maladie de Parkinson, leur différencia-
tion vis-à-vis des troubles vésico-sphinctériens constatés chez
les sujets âgés, au regard des troubles qu’ils peuvent présenter
en rapport avec des pathologies fonctionnelles ou organiques,
et, enfin, les modalités thérapeutiques ainsi que l’effet des trai-
tements antiparkinsoniens sur le fonctionnement vésical.
CLINIQUE
Si dans certains cas les troubles de la miction peuvent apparaître
au début de l’évolution d’une maladie de Parkinson, la survenue
très précoce de troubles invalidants de la miction se présente
d’emblée comme un argument pour une atrophie multisystéma-
tisée (AMS), où la dysautonomie peut précéder l’apparition des
signes moteurs ou, en tous cas, les suivre au cours des deux pre-
mières années d’évolution (1, 2).
Dans la maladie de Parkinson idiopathique (MPI), les mictions
impérieuses avec pollakiurie sont les plus fréquemment consta-
tées (3). Elles sont parfois associées à une dysurie légère qui
peut, exceptionnellement, être isolée, laquelle s’accompagne
rarement de rétention urinaire en dehors d’une pathologie inter-
currente. L’incontinence urinaire par mictions impérieuses sur-
vient souvent plus tardivement dans l’évolution de la maladie.
Chez la femme, une incontinence urinaire d’effort peut égale-
ment être constatée, sans être forcément consécutive à la mala-
die elle-même mais plutôt aux désordres de la statique périnéa-
le secondaires à l’accouchement.
Dans les syndromes extrapyramidaux avec dysautonomie, tels
le syndrome de Shy-Drager (SSD), l’atrophie olivo-ponto-céré-
belleuse (AOPC), la dégénérescence striatonigrique (DSN), les
symptômes comportent beaucoup plus fréquemment une dys-
urie qui peut être associée à une rétention chronique génératrice
d’incontinence par regorgement. Cette dysurie s’associe aussi à
des mictions impérieuses et à une pollakiurie. Dans toutes ces
Troubles urinaires et syndromes extrapyramidaux
●
B. Aranda*
* 10, rue de la Montagne, Courbevoie.
Service de médecine physique et rééducation, hôpital de Gonesse.
L
■ Dans la maladie de Parkinson idiopathique, les patients
souffrent essentiellement de mictions impérieuses, de pol-
lakiurie et souvent d’incontinence en fin d’évolution.
■ Dans les autres syndromes extrapyramidaux, les troubles
urinaires sont précoces et se présentent plus souvent
comme un trouble de l’évacuation vésicale.
■ La gêne fonctionnelle peut devenir considérable quand
la maladie s’aggrave, et a pour effet de réduire l’indépen-
dance des patients.
■ L’hyperactivité vésicale et les symptômes qui en décou-
lent sont directement dus à la carence en dopamine nigro-
striée.
■ En conséquence, la L-dopa et les agonistes dopaminer-
giques améliorent les mictions impérieuses et la pollakiurie
dues à l’hyperactivité vésicale.
■ L’hypoactivité vésicale semble être secondaire à un fac-
teur pathogène neurogène périphérique. Dans l’AMS, elle
s’intègre à la dysautonomie (atteinte du noyau d’Onuf).
Dans la MPI, elle pourrait être la conséquence d’une neu-
ropathie périphérique indépendante.
■ Le traitement des troubles urinaires des syndromes
extrapyramidaux est difficile et doit faire intervenir une
prise en charge globale orientée vers le confort du malade
et de son entourage.
POINTS FORTS
POINTS FORTS

La Lettre du Neurologue - n° 6 - vol. II - décembre 1998
312
SÉRIE URODYNAMIQUE
situations, on peut observer une fluctuation des signes urinaires
et, en particulier, de l’impériosité, parallèlement aux fluctua-
tions motrices. Enfin, polyurie et pollakiurie nocturnes, signes
d’autant plus fréquents que le sujet est âgé, peuvent majorer le
handicap fonctionnel, quand le conjoint est obligé d’aider à uri-
ner à plusieurs reprises un parkinsonien ne pouvant se
débrouiller seul en raison d’une akinésie nocturne.
EXAMEN URODYNAMIQUE
Les explorations nécessaires s’appuient essentiellement sur les
examens urodynamiques. Une hyperréflexie du détrusor est le
plus fréquemment rencontrée dans la maladie de Parkinson idio-
pathique (3, 4). On peut observer également, mais plus rare-
ment, un détrusor normal ou hypoactif (capacité normale ou
augmentée, sans contraction vésicale), un trouble de la sensa-
tion du besoin d’uriner. Dans les atrophies multisystématisées,
les vessies hypoactives sont beaucoup plus fréquentes, et on
observe parfois des vessies mixtes à la fois hypo- et hyperré-
flexives (1). Les pressions urétrales sont, en moyenne, légère-
ment plus basses chez les patients atteints d’atrophie multisys-
tématisée que chez les patients parkinsoniens. Les examens uro-
dynamiques devront être complétés, si nécessaire, par une écho-
graphie vésico-rénale et prostatique, éventuellement par une
urographie intraveineuse pour dépister une pathologie méca-
nique intriquée au dysfonctionnement neurologique.
ÉLECTROPHYSIOLOGIE
Certains auteurs rapportent un aspect de dénervation et de réin-
nervation du sphincter urétral et du sphincter anal, attribué à
l’atteinte des neurones moteurs du noyau d’Onuf, qui semble
plus fréquent chez les patients atteints d’atrophie multisystéma-
tisée que chez les patients parkinsoniens (1, 4). Ils en font un
moyen de différencier la MPI des autres syndromes extrapyra-
midaux au début de la maladie. Toutefois, une atteinte neurogè-
ne périphérique des membres inférieurs et du périnée est assez
fréquente chez des patients atteints de MPI (communication
personnelle, congrès SIFUD, Annecy 1997), cette atteinte pou-
vant avoir un rôle dans l’hypoactivité vésicale. L’étude électro-
physiologique du périnée devrait donc être étendue systémati-
quement aux membres inférieurs, et mérite d’être effectuée plus
fréquemment dans le bilan des troubles vésico-sphinctériens des
parkinsoniens.
INTERPRÉTATION DE L’HYPERACTIVITÉ VÉSICALE
L’hyperactivité vésicale est directement liée à la carence en
dopamine nigrostriée responsable des symptômes de la maladie.
Les arguments pour lier ces deux phénomènes sont nombreux
chez l’animal et chez l’homme : stimulations stéréotaxiques et
enregistrement des contractions vésicales chez l’animal (5),
effet du MPTP (1-méthyl-4-phényl-1,2,3,6-tétrahydropyridine)
chez les marmousets, qui entraîne une perte sélective des neu-
rones dopaminergiques et une hyperactivité vésicale (6), et,
enfin et surtout, effet de l’apomorphine, agoniste dopaminer-
gique, qui diminue l’hyperactivité vésicale cliniquement et de
façon expérimentale, quand elle est injectée avant et après réa-
lisation d’une cystomanométrie (figure 1) (7).
L’identification récente chez l’homme, dans la paroi vésicale, de
récepteurs dopaminergiques D1 et D2 éclaire d’un jour nouveau
cette interprétation, mais il ne s’agit, pour l’instant, que d’une
étude anatomique par autoradiographie, qui ne précise pas le
rôle de ces récepteurs sur la fonction vésicale (8). Un autre argu-
ment plaidant en faveur de la relation directe entre la carence en
dopamine nigrostriée et l’hyperactivité vésicale est la survenue
de mictions impérieuses, avec éventuellement incontinence, lors
des phases OFF chez les patients fluctuants. Ces mictions impé-
Figure 1. Test urodynamique à l’apomorphine (0,3 ml en sous-cutané)
chez un patient parkinsonien sevré de L-dopa.
La capacité vésicale passe de 88 ml à 329 ml vingt minutes après l’in-
jection et la première sensation de besoin passe de 42 ml à 131 ml ; le
résidu post-mictionnel absent avant l’injection d’apomorphine devient
ensuite important.
Avant injection
20 min après injection

La Lettre du Neurologue - n° 6 - vol. II - décembre 1998 313
rieuses s’accompagnent souvent de dysurie, certains patients
restant parfois un temps prolongé à essayer d’uriner sans résul-
tat, la miction ne devenant possible qu’avec le déblocage spon-
tané ou provoqué par l’apomorphine. L’effet favorable de l’apo-
morphine sur l’hyperactivité vésicale des parkinsoniens, alors
qu’elle n’a pas d’effet sur les vessies hypoactives, apporte un
argument supplémentaire pour présumer que la carence en
dopamine n’est pas la seule cause des troubles urinaires de la
MPI.
Les phénomènes moteurs paroxystiques s’associent parfois à
des sensations très gênantes de ténesme ano-rectal douloureux,
qui peuvent être traitées par la toxine botulinique mais avec des
résultats inconstants. Il s’agit alors de patients évolués, porteurs
de complications multiples notamment motrices, difficiles à
traiter. Il faut remarquer que la toxine botulinique, qui est utili-
sée chez les paraplégiques, n’a pas a priori d’indication dans la
dysurie rencontrée lors de symptômes extrapyramidaux,
puisque celle-ci n’est pas liée à une dyssynergie vésico-sphinc-
térienne striée.
R. Gray et coll. (9) ont comparé les données urodynamiques de
sujets âgés indemnes de maladie neurologique, de sujets atteints
de la maladie de Parkinson, de sujets souffrant d’une maladie
cérébro-vasculaire et de sujets déments. Ils ont constaté que la
capacité vésicale était réduite chez les parkinsoniens hommes et
femmes par comparaison à celle des patients indemnes de mala-
die neurologique, mais que la contractilité du détrusor était
similaire dans les deux populations. L’étude des populations
atteintes de maladie cérébro-vasculaire ou de démence ne mon-
trait pas d’anomalie spécifique. R. Gray et coll. en ont conclu
que les troubles du fonctionnement urinaire dans la maladie de
Parkinson pourraient ne pas être directement liés à la maladie
mais simplement à l’âge.
Il est probable que la vérité se situe dans un terme médian avec,
d’une part, une hyperactivité vésicale en rapport avec les lésions
encéphaliques dans la maladie de Parkinson, et, d’autre part, des
troubles liés à l’âge avec la possibilité d’une hypoactivité secon-
daire à une neuropathie périphérique, ainsi qu’à une diminution de
la contractilité du détrusor, qui peut réduire l’efficacité vésicale et
entraîner ainsi une vidange incomplète, à l’origine d’une inconti-
nence, comme cela a été démontré par Resnick et Yalla (10).
THÉRAPEUTIQUE
La prise en charge des troubles urinaires dans la maladie de
Parkinson et les syndromes extrapyramidaux est difficile. Au
début, de simples mictions impérieuses peuvent être acceptées,
si tant est qu’elles n’entraînent pas de gêne, ce d’autant que l’on
connaît l’effet favorable de la L-dopa et des agonistes dopami-
nergiques sur l’hyperactivité du détrusor (7). Ces symptômes
peuvent, en effet, complètement disparaître lors de la mise en
route ou du renforcement du traitement.
Parmi les agonistes dopaminergiques, le piribédil, utilisable par
voie intraveineuse en test urodynamique (données personnelles
non publiées), est efficace sur les vessies hyperactives (figure
2), et peut, assez facilement, être utilisé per os, mais les autres
agonistes dopaminergiques sont également actifs. Les anticholi-
nergiques, telle l’oxybutinine, sont efficaces dans l’hyperactivi-
té mais ont des effets secondaires qui limiteront leur utilisation
en raison de la constipation fréquente des parkinsoniens et de
leur propension à entraîner des troubles des fonctions cognitives
chez les sujets les plus âgés (hallucinations, troubles du com-
portement, confusion). La desmopressine (Minirin®), en sur-
veillant l’apparition d’une éventuelle hyponatrémie, peut être
très utile pour réduire ou supprimer la pollakiurie nocturne. De
même, l’utilisation des formes de dopa à libération prolongée,
en prise vespérale, peut parfois être efficace sur la pollakiurie
nocturne, et aider, au moins, à préserver l’indépendance noctur-
ne des patients pour accomplir leurs besoins.
Figure 2. Test au piribédil (3 mg en intraveineux) chez un patient par-
kinsonien sevré de L-dopa.
La capacité vésicale passe de 215 ml à 259 ml vingt-six minutes après
l’injection et la première sensation de besoin passe de 68 ml à 113 ml
avec un léger accroissement du résidu post-mictionnel.
Avant injection
26 min après injection

La Lettre du Neurologue - n° 6 - vol. II - décembre 1998
314
SÉRIE URODYNAMIQUE
En cas de vessie hypoactive avec ou sans dysurie, le traitement
est délicat, car les médicaments pouvant renforcer la contraction
du détrusor sont difficiles à utiliser dans la maladie de Parkinson.
Le betanechol chloride (Urecholine®-ATU) est, en principe,
contre-indiqué, car il risque d’augmenter le tremblement ; de
plus les anticholinestérasiques sont rarement efficaces. C’est
dans le traitement d’un éventuel obstacle prostatique (médicale-
ment par alpha-bloquants ou chirurgicalement) que la prise en
charge de la dysurie est la plus efficace chez l’homme, alors que
chez la femme il n’y a guère de solution thérapeutique une fois
éliminée une sténose de l’urètre. Il faut également souligner la
difficulté de la réalisation des autosondages chez ces patients
âgés ayant une motricité réduite. Les hétérosondages par le
conjoint sont également difficiles à mettre en œuvre.
En ce qui concerne les autres syndromes extrapyramidaux, il
n’y a pas de spécificité thérapeutique. La rétention urinaire y est
toutefois plus fréquente, et il faut parfois se résoudre à la mise
en place d’une sonde à demeure qui, si elle a des inconvénients,
présente néammoins l’avantage de la simplicité. Le port d’étuis
péniens en permanence, ou seulement la nuit, peut aussi être
conseillé, à condition que l’on ait acquis la certitude d’une
vidange vésicale complète. Il faut toutefois souligner le peu de
complications urologiques rencontrées au cours de l’évolution
de la maladie de Parkinson et des syndromes extrapyramidaux.
La survenue d’infections urinaires récidivantes, en cas d’hypo-
activité vésicale avec vidange incomplète, nécessite une prise en
charge spécialisée avec contrôle soigneux du transit intestinal et
de la flore intestinale, ainsi que la mise en place d’une antibio-
thérapie adaptée initialement sur l’antibiogramme urinaire, puis
poursuivie de façon discontinue, en essayant d’améliorer le rési-
du post-mictionnel. ■
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. Stocchi F., Carbone A., Inghilleri M. et coll. Urodynamic and neurophysiolo-
gical evaluation in Parkinson’s disease and multiple system atrophy. J Neurol
Neurosurg Psychiatry 1997 ; 62 : 507-11.
2. Bonnet A.M., Pichon J., Vidailhet M. et coll. Urinary disturbances in striato-
nigral degeneration and Parkinson’s disease. Clinical and urodynamic aspects.
Mov Disord 1997 ; 12, 4 : 509-13.
3. Aranda B. Les troubles vésico-sphinctériens de la maladie de Parkinson. Rev
Neurol (Paris) 1993 ; 149 : 476-80.
4. Eardley I., Quinn N.P., Fowler C.J. et coll. The value of urethral sphincter elec-
tromyography in the differential diagnosis of parkinsonism.
Brit J Urol 1989 ;
64 : 360-2.
5. Yoshimura N., Sasa M., Yoshida O., Takaori S. Dopamine D1 receptor-media-
ted inhibition of micturition reflex by central dopamine from the substantia nigra.
Neurol Urodyn 1992 ; 11 : 535-45.
6. Albanese A., Jenner P., Marsden C.D., Stephenson J.D. Bladder hyperreflexia
induced in marmosets by 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine. Neurosci
Letters 1988 ; 87 : 46-50.
7. Aranda B., Cramer P. Effects of apomorphine and L-dopa on the parkinsonian
bladder. Neurol Urodyn 1993 ; 12 : 203-9.
8. Escaf S., Cavallotti C., Ricci A. et coll. Dopamine D1 and D2 receptors in
human ureter and urinary bladder : a radioligand binding and autoradiographic
study. Brit J Urol 1994 ; 73 : 473-9.
9. Gray R., Stern G., Malone-Lee J. Lower urinary tract dysfunction in
Parkinson’s disease : changes relate to age and not disease. Age and ageing.
1995 ; 24 : 499-50.
10. Resnick N.M., Yalla S.V. Detrusor hyperactivity with impaired contractile
function. JAMA 1987 ; 257 : 3076-81.
1
/
4
100%