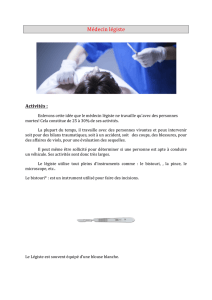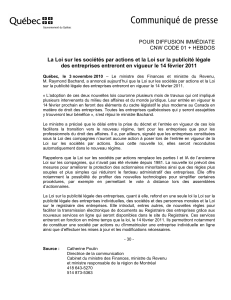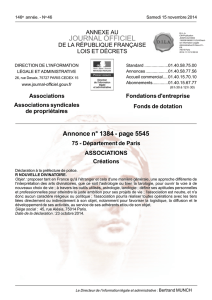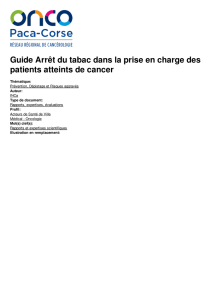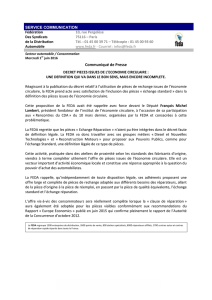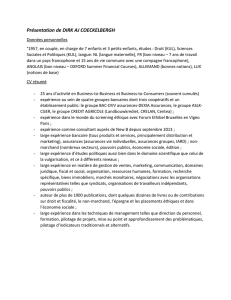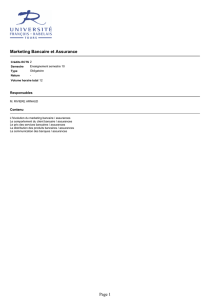D
éfinir le rapport entre ces deux spécialités né-
cessite au préalable que les légistes se présentent,
ainsi que leur spécialité, la formation et l’activité
médico-légales n’étant pas univoques.
DÉFINITION - ACTIVITÉS - FORMATION
Définition
La médecine légale est classiquement définie comme l’interface
entre justice et médecine ; il correspond mieux à la réalité contem-
poraine de considérer les légistes comme médecins spécialistes
de la violence sous ses deux aspects :
– celui des victimes : qu’elles soient mineures, majeures, vic-
times de violences psychologiques ou physiques, volontaires ou
accidentelles ;
– celui des agresseurs : l’examen médical des gardés à vue sur-
tout, mais aussi, pour certains services de médecine légale, la res-
ponsabilité des soins médicaux en milieu pénitentiaire.
Activités
Contrairement aux autres spécialités médicales dans lesquelles,
pour la plupart d’entre elles, la zone de compétence et le type
d’activité sont parfaitement définies, la médecine légale est hété-
rogène tant au niveau mondial qu’aux niveaux européen et natio-
nal. L’activité médico-légale au sein d’un CHU, par exemple, n’a
la plupart du temps rien de comparable avec ce qui se passe dans
une ville de plus petite taille à l’infrastructure hospitalière non
adaptée et/ou non motivée.
Ces réserves étant émises, on peut distinguer deux grands types
d’activités médico-légales et quelques activités plus accessoires
dépendant du contexte local.
Activités judiciaires
Elles sont subdivisées en activités pénales et civiles.
• Les activités pénales sont quantitativement les plus nombreuses
(4 125 par an pour l’équipe de médecine légale du CHU de Mont-
pellier) ; elles se font sur réquisition de police ou de gendarmerie,
selon qu’il s’agit d’une zone urbaine ou rurale, ou sur ordonnance
d’une commission d’experts, et comportent essentiellement :
– l’examen des personnes mises en garde à vue (toute personne
ayant des problèmes de santé), qui représentent 63 % des réqui-
sitions au CHU de Montpellier (2 474) ;
– l’examen des victimes de violences volontaires, plus accessoi-
rement involontaires, pour description des blessures et détermi-
nation de la durée de l’ITT (incapacité totale de travail), ce qui
représente 18 % (750) des réquisitions ;
– l’examen des victimes d’agression sexuelle adultes (viol, etc.) :
113, soit 2,7 % de l’activité ;
– l’examen de mineurs de 15 ans (dès que l’on a 15 ans, on
n’est plus mineur, du moins aux yeux du Code pénal et en tant
que victime) essentiellement victimes d’agressions sexuelles
(148, soit 3,5 % de l’activité), mais aussi de violences volontaires
(128, soit 3,1 %) ;
– enfin, l’activité thanatologique (relative aux cadavres), certes
emblématique de la spécialité, mais qui ne représente que 8 %
de l’activité de notre équipe, regroupant 195 levées de corps
(c’est-à-dire déplacement sur les lieux d’une mort suspecte) et
140 autopsies médico-légales par an ;
– le reste recouvre des activités diverses : certificats d’hospitali-
sation d’office, compatibilité avec la détention en maison d’arrêt,
évaluation du dommage corporel dans le cadre d’une mesure
d’instruction, etc.
Toutes ces activités pénales ont comme point commun d’être
urgentes, nécessitant donc la création d’une permanence 24 heures
sur 24, 365 jours par an (près de 40 % des réquisitions sont hors
heures ouvrables) ; parfois difficiles, elles sont également tou-
jours délicates.
•Les expertises civiles judiciaires
Elles sont beaucoup plus attractives, car effectuées sur rendez-
vous et financées par le plaignant (provision), mais en quantité
limitée dans un marché très compétitif. En effet, la loi dite “Badin-
ter” du 5 juillet 1985 a transféré le contentieux des accidents de
la voie publique vers les compagnies d’assurances, qui règlent
maintenant plus de 85 % des dossiers à l’amiable.
Il s’agit essentiellement d’expertises pour évaluation du dom-
mage corporel (date de consolidation, taux d’IPP, quantum dolo-
ris, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, etc.) et plus rare-
ment d’expertises en responsabilité médicale, en général
délocalisées, une cour d’appel nommant des experts inscrits dans
une autre pour éviter que médecins mis en cause et experts ne se
connaissent.
Activités médico-légales non judiciaires
Très rares (mais cela existe) sont en France les médecins légistes
qui exercent une activité judiciaire exclusive, car celle-ci ne leur
est pas réservée à titre de monopole, les magistrats ayant la pos-
VIE PROFESSIONNELLE
Pneumologue et médecin légiste
●
E. Baccino*, A. Dorandeu*
127
La Lettre du Pneumologue - Volume IV - no3 - mai-juin 2001
* Service de médecine légale, hôpital Lapeyronie, CHU Montpellier.

sibilité légale de désigner le médecin de leur choix, quelle que soit
la mission ; les médecins légistes ont donc, en général, une autre
activité médicale associée, qu’elle soit de médecine générale, de
spécialiste ou de médecins conseils de compagnies d’assurances.
• Ces médecins conseils de compagnies d’assurances, qui ont
souvent une grande expérience pratique, remplissent, dans le
cadre de la loi Badinter, des missions identiques aux expertises
judiciaires civiles (cf. ci-dessus), mais exercent surtout dans le
cadre des assurances individuelles, dont les missions varient en
fonction des contrats (justification d’un arrêt de travail, taux
d’invalidité et notion de dépendance, etc.) ; c’est aussi dans ce
cadre que se situe l’arbitrage, expertise contractuelle au cours de
laquelle un particulier et une compagnie d’assurances décident
d’un commun accord de régler un contentieux (désaccord por-
tant en général sur l’expertise du médecin conseil de cette com-
pagnie) en désignant un arbitre, cela ayant pour but de rempla-
cer la procédure judiciaire, beaucoup plus longue et onéreuse.
À noter que, dans les “petites” cours d’appel où le contentieux
est limité, experts judiciaires et médecins conseils de compagnies
d’assurances sont souvent les mêmes personnes avec, pour seule
restriction, celle de ne pas intervenir dans la même affaire pour
les deux commanditaires.
•Autres expertises
Il s’agit d’expertises pour la Sécurité sociale dans le cadre de l’article
L 141-1 du Code de la Sécurité sociale (litiges d’ordre médical tant
pour le risque maladie que pour celui d’accident du travail ou au
sein du tribunal du contentieux de l’incapacité), pour la commis-
sion d’aptitude au permis de conduire, le tribunal des pensions mili-
taires, etc. Toujours minoritaires dans l’activité d’un légiste, elles
représentent cependant un domaine dans lequel il exerce en tant que
médecin spécialiste de l’évaluation (évaluation des dires et des
preuves médicales, des certificats en tous genres, des séquelles, etc.).
•Les consultations hospitalières de médecine légale
et de victimologie
Dans certains grands centres, on a assisté récemment – surtout
depuis les circulaires du 27 mai 1997 (DGS/DH), du 27 février 1998
(DH/AF) et du 13 juillet 2000 (DGS/DH) sur la prise en charge,
dans les hôpitaux, des victimes d’agression sexuelle adultes et des
mineurs quel que soit le type de violence – à la création d’unités
de médecine légale hospitalière.
Elles ont pour fonction, en sus de répondre aux réquisitions judi-
ciaires, de fournir des avis médico-légaux à tout moment, en
réponse aux besoins des services hospitaliers et surtout des
urgences, lorsque ceux-ci sont confrontés à des problèmes poten-
tiellement médico-légaux. En pratique, au CHU de Montpellier,
il existe une permanence médico-légale qui permet, lorsque se
présentent, par exemple, une suspicion de sévices à enfant, de
violence par arme, de coma suspect ou une victime d’agression
sexuelle, de joindre un médecin légiste qui, en urgence, exami-
nera la victime de première intention (en particulier pour les
mineurs et les agressions sexuelles), éventuellement en présence
du médecin qui a déjà accueilli la personne en question.
Cette démarche a plusieurs avantages :
– éviter des examens multiples engendrés par la classique filière
médecin hospitalier-dépôt de plainte-réexamen par l’expert dési-
gné par les forces de l’ordre ;
– décider en équipe d’un éventuel signalement en urgence aux
autorités judiciaires ;
– mettre à la disposition de l’équipe un médecin habitué à ce
genre de situations.
Au CHU de Montpellier, après deux ans de pratique, ce type de
consultation représente environ 200 cas par an.
Cette activité de consultation est complétée depuis deux ans par
celle de la Commission Violence du CHU, qui comprend :
– un pôle de référence “enfance maltraitée” (PREM) : 250 dos-
siers traités en 2000 ;
– un pôle de référence “adultes maltraités” (PRAM) : une tren-
taine de dossiers en 2000.
Ces PREM et PRAM sont en fait des groupes multidisciplinaires
se réunissant chacun deux fois par mois pour l’examen de dos-
siers délicats et/ou difficiles, la coordination de leur suivi, le déve-
loppement de programmes de formation et de recherche.
Des consultations de psychologie, psychiatrie, et victimologie
ont également été créées, visant à la prévention du syndrome de
stress post-traumatique (PTSD) et plus simplement à l’accom-
pagnement psychologique des victimes d’agressions pénales
(environ 200 consultations en 2000 dans le service de médecine
légale, qui n’est pas le seul lieu où elles se déroulent).
Ces consultations se font pour beaucoup à la demande du méde-
cin légiste réquisitionné au préalable, qui participe donc là à une
démarche de soin en l’initiant ; il en va de même lorsque nous
adressons les victimes de viol ou de morsures au service des
urgences en charge du traitement préventif gratuit de l’infection
à VIH.
Autres activités
Pour certaines équipes, la prise en charge des soins aux détenus
représente aussi une activité importante (personnels, fonction de
soins, nombre de consultations, etc.).
Cette activité est légitimée par l’expérience qu’ont acquise les
légistes en examinant les personnes en garde à vue, dans la mesure
où la problématique est exactement la même : gérer le conflit per-
manent qui existe entre l’intérêt médical et psychologique du
patient (qui n’est que très rarement d’être incarcéré) et les obli-
gations pénales ainsi que de sécurité (qui ne sont jamais aussi
bien assurées dans les hôpitaux que dans les prisons).
Pour des raisons diverses, tenant aux traditions locales et aux autres
spécialités de certains collègues, des centres médico-légaux ont vu
se développer certaines activités moins répandues : psychiatrie
médico-légale et/ou pénitentiaire, droit médical et déontologie
médicale, activités biologiques diverses (anthropologie physique
et odontologie médico-légale pour l’identification des cadavres,
anatomopathologie, toxicologie, empreintes génétiques, etc.).
Formation
Historique
Jusqu’à la fin des années 80, la plupart des médecins légistes
sont passés par le CES, fait en deux ans, qui était satisfaisant
du point de vue théorique, mais beaucoup moins complet du
point de vue pratique.
Par la suite, ce sont des DU dits “de médecine légale” qui ont
assuré la formation des légistes, avec les mêmes remarques (au
VIE PROFESSIONNELLE
128
La Lettre du Pneumologue - Volume IV - no3 - mai-juin 2001

mieux) que pour le CES ; même si rien n’empêche qu’ils conti-
nuent d’exister, en pratique ne devraient demeurer que ceux des-
tinés à former seulement à l’expertise de dommages corporels.
Possibilités actuelles
• En 1999/2000 a été créée une capacité de pratiques médico-
judiciaires, qui connaît un certain succès (7 à 8 candidats par an
à Montpellier). Elle est ouverte à tout médecin désireux d’être
formé à la médecine légale “de terrain” et le fait bénéficier d’une
formation comprenant 160 heures de séminaire sur deux ans et
30 jours de stage par an dans un service de médecine légale selon
des modalités définies dans chaque centre.
La formation théorique des médecins légistes doit comporter,
pour permettre de répondre aux missions décrites ci-dessus, une
introduction au droit médical, qui est même, dans le cas de la
capacité, reconnue comme fondamentale, puisque c’est sur cette
matière que se fait la sélection du probatoire ; à Montpellier, elle
donne lieu à une cinquantaine d’heures d’enseignement par tra-
vaux dirigés.
Bien que le recul soit faible, on peut estimer, d’après notre propre
expérience, que ces médecins devraient être aptes à exercer, de
façon autonome, la plupart des missions judiciaires (gardes à vue,
examen des victimes de violences et agressions sexuelles, levées
de corps, etc.), à l’exception des autopsies médico-légales, qui
doivent être pratiquées par un senior en collaboration avec le
médecin qui s’est rendu sur les lieux ;
• Les médecins issus de l’internat via la voie des DESC de méde-
cine légale peuvent, eux, espérer être totalement autonomes à la
fin de leurs deux ans de stage dans des services validants, même
si leur formation théorique mérite d’être structurée (celle de la
capacité est un minimum requis pour ces candidats). Ce sont les
seuls qui, “ordinalement” parlant devraient pouvoir s’appeler
médecin légiste.
• Toutefois, et contrairement aux autres spécialités médicales, la
validation par l’exercice de cette formation ne sera pas le fait
d’instances médicales et/ou universitaires, mais judiciaires. Ce
sont les procureurs de la République du tribunal de grande ins-
tance (TGI) concerné qui décideront si tel ou tel médecin légiste
ou capacitaire peut participer à la permanence médico-légale et
recevoir des réquisitions, ainsi que la durée pendant laquelle il
devra être supervisé par un médecin légiste plus expérimenté.
Surtout, c’est une commission de la cour d’appel à laquelle ne
participe aucun médecin qui décide des inscriptions sur les listes
d’experts près la cour d’appel. En pratique, et compte tenu de la
pénurie chronique (et peut être croissante) des médecins légistes
effectuant les activités pénales (dont on connaît grandeurs et ser-
vitudes : cf. plus haut), être inscrit à la rubrique “médecine légale”
pose peu de problèmes si l’on a la formation requise. Il en va dif-
féremment pour ceux qui aspirent à s’inscrire dans les rubriques
“d’expertises civiles”. Une fois par an, la candidature doit être
déposée auprès du procureur de la République avant le 1er mars,
la réponse étant donnée en général en novembre. En pratique, il
faut déjà avoir effectué un certain nombre d’expertises (en étant
désigné au coup par coup en tant qu’expert, puisque les magis-
trats ont toute liberté en ce domaine), faire valoir cette expérience
et avoir donné satisfaction pour espérer être inscrit. Il est rare que
l’inscription s’effectue à la première demande. Par la suite, lorsque
l’expert est inscrit, rares sont les fautes justifiant une radiation de
la liste, le motif le plus fréquent (à défaut d’être le plus grave dans
l’absolu) étant le retard dans le dépôt des rapports.
QUELQUES QUESTIONS MÉDICO-LÉGALES
QUE VOUS POUVEZ VOUS POSER
Compte tenu de l’étendue (c’est ce qui fait une partie de son
charme) de notre spécialité, et dans le cadre d’un article au for-
mat défini, il est impossible d’aborder toute la médecine légale,
nous avons donc sélectionné de façon arbitraire, et donc obliga-
toirement incomplète, quelques questions que le pneumologue
peut se poser, soit parce qu’elles sont fréquentes, soit parce
qu’elles sont importantes.
Responsabilité médicale
La France n’est pas les États-Unis
Il suffit pour cela de comparer la prime d’assurances couvrant la
responsabilité civile d’une des spécialités les plus exposées (chi-
rurgie esthétique), qui est d’environ 40 000 F par an en France,
aux 250 000 F que devra payer un généraliste new-yorkais (il faut
un peu d’imagination pour concevoir ce que peut payer un neu-
rochirurgien californien, et ce, bien qu’il refuse 10 à 15 % de sa
clientèle pour “risque médico-légal” : être avocat ou marié à un
avocat entre dans ce pourcentage). Une certaine inquiétude trouve
son origine dans la publication annuelle, par les compagnies
d’assurances, des chiffres bruts de signalements d’incidents par
les assurés (les situations où la responsabilité des médecins peut
être mise en cause, ce qui n’est pas du tout la même chose que les
plaintes) et du nombre brut de mises en cause de la responsabilité
des médecins, les deux sont en augmentation. Le seul travail dont
nous disposons sur cette “croissance” des mises en cause sur une
décennie, mais rapportée à l’activité médicale et au nombre des
médecins, montre que, en fait, par médecin, et par acte médical,
les poursuites n’auraient pas significativement augmenté (le
nombre des médecins et des actes croissant plus vite qu’elles).
Cette situation nationale s’explique par deux motifs essentiels :
nos magistrats sont tous professionnels, formés dans une seule
école (l’ENM) en France et non élus ; le “pacte quotalitis” qui per-
met aux avocats américains de se payer au pourcentage (souvent
plus du tiers des indemnités payées à la victime), et donc à leurs
clients de ne rien débourser, est certes partiellement autorisé en
France (sorte de prime de résultats), mais dans une proportion bien
moindre, et sans que les honoraires puissent être supprimés. Le
fait que les États-Unis, avec 10 % de la population mondiale,
“s’enorgueillissent” de rassembler 50 % des avocats de la planète
n’est peut être pas non plus indifférent à l’affaire.
Les médecins ne sont pas tous égaux
devant la responsabilité médicale
Certaines spécialités sont plus exposées que d’autres (chirurgie
esthétique déjà citée plus haut, anesthésie, gynécologie, et surtout
obstétrique, etc.). Les médecins travaillant dans le secteur public
sont beaucoup moins souvent mis en cause directement que ceux
du secteur privé car, dans l’immense majorité des cas, c’est l’hôpi-
129
La Lettre du Pneumologue - Volume IV - no3 - mai-juin 2001

tal qui sera poursuivi, et éventuellement condamné, devant les tri-
bunaux administratifs. Le médecin hospitalier n’étant mis en cause
nommément que s’il a commis une faute exceptionnelle (en géné-
ral de l’ordre du délit pénal, cf. ci-dessous.) “détachable” du ser-
vice. Pour ceux du secteur privé, les plaintes seront jugées devant
les TGI (en général, plus de 50 000 F sont en jeu, somme limite
supérieure pour la compétence des tribunaux d’instance) ; c’est
leur assurance qui paiera les frais de procédure, et éventuellement
les indemnités s’ils sont condamnés.
La mise en cause de la responsabilité (toujours douloureuse
psychologiquement) n’est vraiment pénible
que lorsque c’est de responsabilité pénale qu’il s’agit
Pour cela, il faut avoir violé un des articles du Code pénal, qui
concernent, pour les médecins, le secret professionnel, la non-
assistance à personne en danger, les coups et blessures involon-
taires, l’homicide involontaire, les faux certificats, les diffama-
tions, etc. La procédure elle-même est parfois plus douloureuse
que la condamnation, car le médecin voit souvent son nom étalé
dans les médias : il peut être mis en garde à vue, interrogé par les
forces de l’ordre, et donc “condamné avant même d’être jugé”.
Fort heureusement, les condamnations pénales sont rares, les pro-
cureurs, du fait de leur pouvoir de décider de l’opportunité des
poursuites, jouant un rôle de filtre extrêmement important : moins
de 2 % des mises en cause de la responsabilité des médecins avec
dommage corporel se soldent par une condamnation pénale (pour
5 081 dossiers entre 1987 et 1991).
Tous les médecins, qu’ils soient hospitaliers ou du secteur privé,
peuvent voir leur responsabilité pénale mise en cause, et ce dans
les mêmes conditions ; ils sont égaux devant le droit pénal.
Il faut donc éviter à tout prix que les patients poursuivent les méde-
cins au pénal, en suivant quelques recommandations simples :
– bien évidemment, ne pas commettre de grosse faute ;
– savoir avouer une faute ou une erreur dès qu’elle est commise
car, très souvent, c’est l’impression de dissimulation, d’avoir été
grugé, qui va susciter une rancœur personnelle du patient envers
son médecin, la procédure pénale ayant alors pour fonction de
sanctionner, de “faire mal” au médecin : car en sus des indemni-
tés qu’il attribuera au plaignant, le tribunal pénal est le seul qui
pourra infliger au médecin une amende et/ou une peine de prison ;
– devant la diversité des situations et parfois leur complexité, il
est donc impératif que tout médecin se sentant mis en cause
contacte immédiatement son assurance professionnelle pour
bénéficier de son assistance juridique (qui doit, bien évidemment,
faire partie du contrat) ; une concertation avec elle est indispen-
sable pour définir la conduite à tenir la plus appropriée.
Notons aussi que la procédure pénale est gratuite, contrairement
à la procédure civile ou administrative pour laquelle le plaignant
doit avancer les frais d’expertises, d’avocats, et que, surtout, elle
permet de bénéficier de la puissance d’investigation de la force
publique : enquêteurs mis à disposition, saisie de dossier par le
juge d’instruction, etc.
•Le devoir d’information envers le patient a-t-il changé ?
Oui, il y a eu le 25 février 1997 une jurisprudence de la première
chambre civile de la Cour de cassation entraînant un “renverse-
ment de la charge de la preuve”, c’est-à-dire que c’est mainte-
nant au médecin de prouver qu’il a bien informé son patient ; cela
s’applique à tous les actes diagnostiques et thérapeutiques, en
dehors de l’urgence ; en effet, en cas d’urgence, le médecin a
pour seul devoir de prendre les mesures nécessaires, ce qui, la
plupart du temps, ne lui laisse pas le temps d’informer son patient.
Lorsque le geste médical est programmé, et d’autant plus qu’il
existera des alternatives thérapeutiques (par exemple, cœliochi-
rurgie versus laparotomie), le choix du patient doit reposer sur
une information “simple, intelligible et loyale” ; de plus, il doit
être informé de tous les risques graves (même s’ils sont très rares).
Le médecin doit pouvoir prouver qu’il a fourni cette information
(en d’autres termes, un consentement éclairé obtenu par écrit est
plus sûr). Cette obligation s’applique aussi bien aux médecins du
secteur privé que du secteur public, le Conseil d’État s’étant ali-
gné récemment sur la Cour de cassation civile.
Que faire d’un témoin de Jéhovah qui refuse les soins ?
Tant qu’il est conscient, sa volonté doit être respecté ; dès qu’il
est inconscient, le médecin doit prendre toutes les mesures néces-
saires pour sauver la vie de son patient, quelles qu’aient été ses
déclarations antérieures. Pour éviter que l’entourage s’oppose
aux soins, il faut avoir au préalable prévenu le procureur de la
République ou son substitut (il y a une permanence du parquet),
qui fera appel à la force publique si nécessaire.
Des parents s’opposent à des soins
que vous jugez nécessaires sur un mineur
Là aussi, un contact doit être pris avec le procureur de perma-
nence du TGI le plus proche, pour lever en urgence l’autorité
parentale.
Soins aux personnes âgées et familles opposantes
Si la personne âgée peut donner valablement son avis, il faut res-
pecter sa volonté. Si ce n’est pas le cas (personne démente, dans
le coma, aphasique, etc.), le médecin doit prendre toutes les
mesures qu’il juge bénéfiques et utiles pour son patient, en expli-
quant ses motifs aux proches mais en passant outre s’il le faut.
À ce propos, signalons qu’un tuteur, un curateur ou un juge des
tutelles n’a pas de pouvoir en ce qui concerne les décisions rela-
tives à la santé d’un “adulte handicapé” (malades mentaux en
particulier) ; son domaine d’action se limite aux biens.
Secret professionnel
Le problème n’est pas essentiellement judiciaire
La violation du secret professionnel est, certes, un délit pénal,
mais les poursuites pour ce motif sont très rares. Le secret pro-
fessionnel a surtout une importance fonctionnelle et culturelle
comme un des piliers de la “médecine à la française”. Contrai-
rement aux États-Unis, où le rapport médecin-malade est de
l’ordre de la prestation de service, il repose chez nous sur une
relation de confiance où la confidentialité (qui permet la confi-
dence) joue un rôle essentiel.
Les textes sont simples (articles 226 13 et 14 du Code pénal
et les articles 4, 71, 72, 73, 95 et 96 du Code de déontologie
médicale).
VIE PROFESSIONNELLE
130
La Lettre du Pneumologue - Volume IV - no3 - mai-juin 2001

La jurisprudence est évolutive et leur application pratique est
aisée dans la mesure où on est guidé par l’intérêt de son patient
(qui s’arrête là où l’escroquerie commence).
Le secret n’est pas “opposable” au patient,
qui doit être informé, avec cependant quelques limitations
On peut (article 35 du Code de déontologie) cacher un pronostic
grave ou fatal à un patient (tel qu’un cancer, mais pas l’affection
à VIH qui bénéficie dans le Code de déontologie d’un régime
particulier).
Comment accéder au dossier hospitalier
Le patient n’y a pas accès directement, mais par l’intermédiaire
d’un médecin de son choix. C’est en général son médecin trai-
tant, mais ce peut être tout médecin désigné nommément et par
écrit, selon la règle du “si et seulement si” ; on ne peut donc pas
refuser l’accès du dossier à ce médecin, même s’il s’agit d’un
médecin conseil de compagnie d’assurances. Il y a un consensus
à cet égard, mais quelques points de contentieux demeurent, du
fait notamment des avis du Conseil de l’Ordre, pour certaines
expertises médicales (hors loi Badinter) diligentées pour les com-
pagnies d’assurances. La CADA (Commission d’accès aux
documents administratifs) est là pour trancher, ou une juridiction
civile dans les autres cas (TGI).
Secret médical et téléphone
Il est impossible, pour un établissement hospitalier, de refuser de
donner des informations par téléphone. Certaines de ces infor-
mations peuvent cependant être très préjudiciables aux patients
si elles sont diffusées à certaines personnes, voire au public. Une
application pratique et raisonnable du secret professionnel au télé-
phone consiste donc à définir des “domaines sensibles” où le
secret doit être encore plus secret, c’est-à-dire qu’il ne faut pas
même mentionner que tel ou tel patient est hospitalisé dans telle
ou telle unité, et a fortiori ne pas mentionner le diagnostic.
Il s’agit des situations suivantes : toxicomanie (dont l’alcoolisme),
infections sexuellement transmissibles ou liées à la toxicomanie,
psychiatrie (maladies mentales, suicides et toxicomanie).
Le personnel médical et paramédical nécessite une sensibilisa-
tion particulière dans ces secteurs.
Il existe des dérogations au secret médical
En pratique, elles ne concernent que les mineurs de 15 ans qui,
lorsqu’ils sont victimes de sévices, peuvent voir leur cas signalé
par les médecins à l’autorité judiciaire (procureur du TGI le plus
proche) ou administrative (ASE). Il s’agit, aux yeux du Code
pénal, d’une dérogation facultative : le médecin peut se taire,
mais n’a pas le droit de ne rien faire ; en d’autres termes, il doit
prendre les mesures adaptées à la protection de l’enfant pour satis-
faire, comme tout citoyen, aux obligations d’assistance à per-
sonne en danger (article 223-6). Aux yeux du Conseil de l’Ordre
(article 44), il s’agit en revanche d’une obligation déontologique,
“sauf circonstances particulières”, et donc exceptionnelles, où le
médecin pourrait éventuellement se taire.
La situation est beaucoup moins simple pour les femmes battues
et les vieillards maltraités, puisque, sauf si la victime est un adulte
handicapé (tutelle, curatelle, etc.), ce n’est qu’avec son accord
que le signalement à la justice pourra être effectué.
Expertises
Tout médecin peut (devrait ?) assister son patient en étant présent
à l’occasion d’une expertise civile ou d’un examen par un méde-
cin conseil de compagnie d’assurances dans le cadre de la loi Badin-
ter (AVP impliquant un véhicule à moteur), car la procédure y est
contradictoire (toutes les parties ont droit aux mêmes informations).
Lorsqu’il s’agit d’une expertise pénale (à la demande d’un juge
d’instruction) ou d’une expertise d’assurances, cela n’est pas néces-
saire dans le cas d’une assurance individuelle.
Ces expertises se comptent par milliers chaque année dans un
département comme l’Hérault, et elles représentent des enjeux
financiers et psychologiques importants.
Quelles que soient les situations, le médecin pourra toujours
conseiller valablement son patient en lui expliquant les compo-
sants fondamentaux des missions d’expertise.
Durée des arrêts de travail
L’expert n’est pas lié par les arrêts de travail prescrits par les
médecins traitants. Lorsqu’il s’agit d’une personne sans emploi
(groupe majoritaire si l’on y inclut les scolaires et les retraités),
une durée d’ITT sera attribuée, par analogie avec les critères
employés pour les certificats de violences volontaires (cf. infra).
Date de consolidation
Ce n’est pas la date de guérison, mais celle à partir de laquelle
aucun traitement ne peut faire évoluer l’état du patient (on peut
donc être consolidé et avoir toujours des traitements en cours).
IPP (incapacité permanente partielle)
Ce sont les séquelles fonctionnelles permanentes que présente le
patient à la suite d’une pathologie médicale ou traumatique.
Attention : il existe plusieurs barèmes qui, pour une même affec-
tion entraînant les même séquelles, peuvent donner des taux d’IPP
(en pourcentage) très différents. Ne pas confondre le barème
Cotorep, celui de la Sécurité sociale, ceux des accidents du tra-
vail, et le barème dit du “Concours médical” de 1993 (ou, plus
récent, celui de 2001), qui est le plus fréquemment utilisé en droit
commun, en attendant d’apprécier l’impact du nouveau barème
publié sous l’égide de la Société de médecine légale et de crimi-
nologie de France (SMLCF) en 2000. Ces deux derniers barèmes
(droit commun) sont fondés sur une évaluation anatomique des
lésions, ainsi que sur leur retentissement fonctionnel pour le
barème de la SMLCF, mais ils ne tiennent absolument pas compte
du travail du patient.
Quantum doloris
C’est l’évaluation des souffrances endurées entre les faits et la
date de consolidation. Elle prend en général en compte le nombre
d’interventions, la durée d’hospitalisation, le nombre de séances
de kinésithérapie, la nature des traitements mis en œuvre (injec-
tions ou non), le retentissement psychologique transitoire, la
nature et la quantité des antalgiques pris. Elle est évaluée sur une
échelle de 0 à 7, où l’on progresse de demi-point en demi-point ;
131
La Lettre du Pneumologue - Volume IV - no3 - mai-juin 2001
 6
6
 7
7
1
/
7
100%