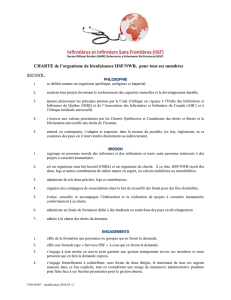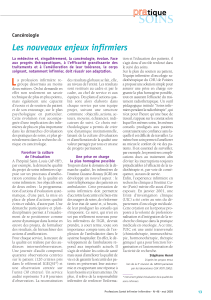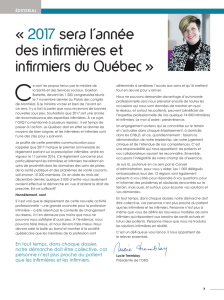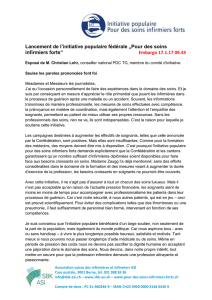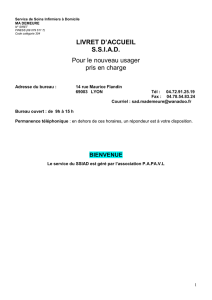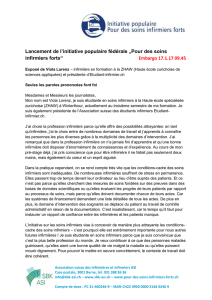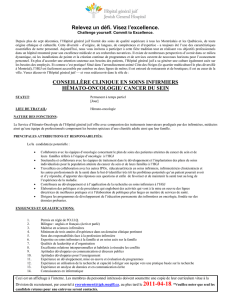D Éditorial

136 Volume 25, Issue 2, sprIng 2015 • CanadIan onCology nursIng Journal
reVue CanadIenne de soIns InfIrmIers en onCologIe
Éditorial
Dans le cadre de mon travail, j’ai régulièrement l’occasion de parler avec des inrmières
et inrmiers en oncologie œuvrant d’un bout à l’autre du Canada. J’aime savoir ce qu’ils
font et les écouter parler de leur pratique. Je suis constamment émue par leurs descriptions des
façons dont ils font une diérence dans la vie des patients et de leur famille. Et je suis curieuse
de savoir comment ils gèrent les dés qui se présentent dans leurs lieux de travail et comment ils
s’assurent que les patients reçoivent le genre de soutien et de soins dont ils ont besoin.
Récemment, j’ai remarqué trois thèmes récurrents dans ces conversations. Trois dés impor-
tants pour les inrmières et inrmiers en oncologie, à savoir : les modèles de soins, le champ de
la pratique et le travail en équipe interprofessionnelle.
Le terme « modèle de soins » fait référence à la façon dont les organismes gèrent leur per-
sonnel et l’environnement dans lequel les soins sont prodigués. L’adoption d’un modèle de soins
met souvent en jeu diérentes façons de travailler, ainsi que de nouveaux rôles et responsabilités.
Le concept de « champ de la pratique » sert souvent à déterminer si les inrmières exercent plei-
nement leur pratique. Beaucoup trop souvent, j’entends des voix revendiquer que les inrmières
et inrmiers puissent exercer leurs compétences pleinement, parce que leurs rôles actuels sont
trop restreints et axés sur la tâche et, dans bien des cas, comprennent trop de responsabilités
non liées aux soins inrmiers. Le dialogue entourant le travail en équipe interprofessionnelle est
perçu comme une façon de déterminer la combinaison gagnante de soins (basés sur des données
probantes et conformes aux besoins du patient) aux patients au moment opportun (sans attentes
exagérées), oerts par un fournisseur de soins approprié (le membre de l’équipe qui possède les
connaissances et les compétences nécessaires pour répondre au besoin cerné du patient).
Il s’agit là de questions complexes qui ont d’importantes implications pour les inrmières et
inrmiers en oncologie et leur exercice. Elles ont également d’importantes ramications pour
les patients et les soins aux patients. En tant que groupe professionnel, les inrmiers et inr-
mières en oncologie devraient se parler de ces enjeux. Nous nous devons de comprendre les
inuences sous-jacentes qui alimentent ces changements dans les soins de santé, étudier l’im-
pact des diverses approches et anticiper les résultats de certaines orientations pour les patients
et leurs familles. Je suis certaine que les diérents modèles de soins, champs de pratique et rôles
des membres d’équipes interprofessionnelles auront diérentes répercussions sur les soins aux
patients et sur leurs résultats naux.
An d’engager la discussion et de participer aux résultats de ces discussions, nous devons
comprendre les besoins des patients, les meilleures façons d’y répondre et les types de contribu-
tions que nous pouvons faire en tant qu’inrmières / inrmiers et membres d’équipes interpro-
fessionnelles. Nous devons arriver à décrire clairement chacun de ces aspects — et en parler — et
à savoir ce qui répond le mieux aux besoins des patients.
J’espère que les articles et rubriques contenus dans ce numéro de la Revue nourriront le dia-
logue sur ces questions. Les articles de Wilkins, d’une part, et de Loughery et Woodgate, d’autre
part, jettent un éclairage sur les besoins de deux populations de patients plutôt uniques en leur
genre. Wilkins décrit les points de vue de personnes ayant reçu plus d’un diagnostic de cancer
primitif, tandis que Loughery et Woodgate se concentrent sur les besoins en soins de soutien de
femmes qui vivent avec le cancer du sein dans des milieux ruraux. Les inrmières et inrmiers

137
Canadian OnCOlOgy nursing JOurnal • VOlume 25, issue 2, spring 2015
reVue Canadienne de sOins infirmiers en OnCOlOgie
sont très bien placés, à titre de travailleurs de première ligne, d’éducateurs ou de chercheurs,
pour contribuer au bassin de connaissances scientiques sur les besoins des patients, puisqu’ils
peuvent saisir les points de vue de ces personnes et les aider à les communiquer. Nous serons
plus en mesure de défendre leurs droits et intérêts et d’organiser une prestation de soins ecace
et signicative si nous adoptons des approches davantage centrées sur le patient, sur la personne.
L’article de Janzen et Perry décrit les actions d’inrmières en oncologie dans des contextes de
soins marqués d’un sentiment de futilité et d’impuissance. Les actions prises par ces inrmières
pour veiller aux besoins des patients dans ces situations reètent ce qui peut arriver lorsque
les inrmières et inrmiers ont l’occasion d’exercer pleinement leur pratique en vertu de leur
préparation.
L’article de Savage et collègues, ainsi que les contributions d’O’Leary et de Severson, mettent
l’accent sur le besoin de leadership judicieux et de stratégies variées pour soutenir le personnel
inrmier dans ses démarches d’éducation continue et dans ses eorts visant à fournir des soins
de qualité dans l’environnement complexe de soins de santé. Nous devons assurer une planica-
tion intentionnelle de l’éducation et de la défense des intérêts dans le lieu de travail pour faire en
sorte que les inrmiers et inrmières en oncologie aient accès aux connaissances et aux compé-
tences nécessaires pour exercer pleinement leur pratique. Lorsque ces conditions sont remplies,
les résultats pour les patients et leurs proches sont meilleurs.
Il est crucial que les organismes professionnels soient en mesure de décrire des normes de
pratique inrmière en oncologie et d’articuler les connaissances et compétences requises pour
les adopter. Nous devons mettre en place des stratégies novatrices d’éducation continue et de
perfectionnement professionnel en vue d’aider le personnel inrmier à maintenir ces normes
et d’élargir son champ de compétences. Le leadership d’organismes inrmiers professionnels
comme l’ACIO/CANO (c.-à-d. établissement de normes, ore d’occasions d’apprentissage, créa-
tion de réseaux inrmiers et de communautés de pratique) ore aux inrmières et inrmiers
une orientation dans leurs milieux de travail. Cela contribue à leur capacité de parler des rôles
inrmiers, de l’inuence des soins inrmiers sur les résultats pour les patients et de ce qui
constitue des approches exemplaires en matière de pratique ou de soins.
Les patients atteints de cancer, les survivants et leurs proches ont besoin d’inrmières et d’in-
rmiers forts qui comprennent leurs points de vue et leurs besoins en tant qu’individus vivant
avec le cancer. Ils ont besoin d’inrmiers et d’inrmières qui poursuivent leur éducation tout au
long de leur carrière et qui se tiennent au courant des avancées dans leur domaine. Et ils
méritent des inrmières et inrmiers qui sont engagés dans le remaniement du lieu de travail,
dans l’exercice d’une pratique interprofessionnelle et dans l’élaboration de modèles de soins
ayant, comme considération centrale, le patient et sa famille. Les patients ont besoin d’inrmiers
et d’inrmières en oncologie qui sont bien préparés à défendre les besoins des personnes vivant
avec le cancer et qui adoptent des approches à la fois scientiques et axées sur la personne.
Margaret Fitch, inf., Ph.D.
Rédactrice en chef
1
/
2
100%