Lire l'article complet

32 | La Lettre d’ORL et de chirurgie cervico-faciale • n° 336 - janvier-février-mars 2014
CONGRÈS
RÉUNION
Colloque 2013 de la SOFRESC
Paris, 16 novembre 2013
D. Bouccara*
* SOFRESC ; service d’ORL, groupe
hospitalier de la Pitié-Salpêtrière,
AP-HP, Paris.
Le colloque 2013 de la Société française de réflexion sensori-cognitive (SOFRESC)
s’est déroulé le 16 novembre 2013 à Paris, à l’Institution nationale des Invalides. Il
a réuni une centaine de participants, médecins, rééducateurs, audioprothésistes,
intervenants médicosociaux et responsables d’établissements.
Les objectifs de ce colloque étaient, d’une part, de faire le point des connaissances sur
l’impact des atteintes sensorielles, en particulier auditives, sur les troubles cognitifs,
et d’autre part, de définir les aspects pratiques qu’elles impliquent dans la prise en
charge des personnes âgées. Les travaux et publications du Pr F. Lin (Baltimore, États-
Unis) ont démontré de façon robuste les liens entre hypoacousie et troubles cognitifs.
Invité à ce colloque, il a présenté la synthèse de ses travaux et, surtout, les perspec-
tives en termes de prise en charge précoce des troubles sensoriels, avec un enjeu en
matière de santé publique : réduire la sévérité et l’impact des troubles cognitifs liés
au vieillissement.
Troubles sensoriels et cognitifs
liés à l’âge : données actuelles
S’agissant des troubles auditifs, Xavier Perrot (Lyon)
a rappelé d’emblée que, parmi les plus de 6 millions
de malentendants en France, les 2/3 ont plus de
60 ans, et que seuls 20 % à 30 % d’entre eux sont
appareillés. Du point de vue physiopathologique,
l’atteinte est triple : système auditif périphérique
(cellules ciliées internes et externes, avec possibles
zones inertes cochléaires sans fonctionnalité),
système auditif central (vieillissement propre et
effet de la désafférentation auditive) et système
cognitif avec altération des processus attentionnels,
mnésiques et automatiques. Les processus cogni-
tifs seront d’autant plus sollicités que la déficience
auditive est importante, mais seront d’autant moins
efficaces que le vieillissement cognitif est marqué.
L’évaluation de la presbyacousie est clinique (oto-
scopie, acoumétrie, audiométrie tonale et vocale
dans le calme et dans le bruit), et les questionnaires
permettent d’évaluer, pour une personne donnée,
l’impact de la déficience auditive sur la qualité
de vie. Le traitement est fondé sur l’appareillage :
adaptation prothétique, associée, selon le cas, à
une rééducation auditive pour améliorer, grâce à
la rééducation orthophonique, la compréhension
avec les aides auditives, et d’éventuelles mesures
psychosociales. Plusieurs études présentées lors
de ce colloque ont montré les bénéfices perceptifs,
cognitifs et psychologiques apportés par l’appareil-
lage, ainsi qu’en termes de qualité de vie.
Les troubles visuels liés à l’âge ont été présentés par
Brigitte Chouard (Paris). Tout comme les troubles
auditifs, ils augmentent en fréquence et en gravité
avec l’âge, avec un impact négatif sur les activités
quotidiennes, la cognition et l’humeur, et une majo-
ration potentielle de la dépendance. La malvoyance,
qui correspond à une acuité visuelle entre 1/20 et
3/10, touche 21 % des personnes de plus de 80 ans,
et la cécité, définie par une acuité visuelle inférieure
à 1/20, 6 % des personnes de ce même groupe d’âge.
La malvoyance est caractérisée par des difficultés
importantes à bien lire de près et à reconnaître
le visage d’une personne à 4 mètres, malgré une
correction visuelle. Le vieillissement physiologique
s’accompagne d’un besoin de lumière : 2 fois plus
à 60 ans qu’à 20 ans et 4 fois plus à 80 ans. Les
4 pathologies les plus fréquentes sont la cataracte,
la dégénérescence maculaire liée à l’âge (DMLA), le
glaucome à angle ouvert et la rétinopathie diabé-
tique. La cataracte a une prévalence qui augmente
avec l’âge : plus de 60 % à partir de 85 ans et 100 % à
100 ans. Elle est la première cause de baisse d’acuité
visuelle des personnes âgées, et son traitement est le
premier acte chirurgical réalisé en France : de l’ordre
de 80 000 interventions par an. Les résultats de
cette chirurgie sont moindres en cas de grand âge,
de comorbidités générales et de troubles cognitifs.
Une étude réalisée à l’hôpital Tenon (Paris) avait
montré l’impact de la chirurgie de la cataracte en
cas de troubles cognitifs : amélioration visuelle
importante, mais aussi, potentiellement, troubles
du sommeil, troubles de la mémoire à court terme,
et troubles de l’humeur.
Dans un certain nombre de pathologies, l’évolution
vers la basse vision doit faire proposer une rééduca-
tion adaptée impliquant plusieurs disciplines : oph-
talmologiste, orthoptiste, opticien, ergothérapeute
et psychologue. Elle utilise des moyens techniques
(correction optique, systèmes avec grossissement,

La Lettre d’ORL et de chirurgie cervico-faciale • n° 336 - janvier-février-mars 2014 | 33
CONGRÈS
RÉUNION
etc.), et une rééducation intégrant le potentiel visuel
à l’ensemble des perceptions sensorielles, en par-
ticulier auditives.
S’agissant de l’approche gériatrique du vieillisse-
ment cognitif, Joël Belmin (Paris, Ivry) a évoqué
l’intérêt d’une approche précise. Même en l’absence
de maladie, un certain nombre de fonctions sont
altérées avec l’âge : sommeil, soif, rythme circadien,
et bien sûr les fonctions cognitives : attentionnelles,
exécutives et la capacité de mémoire. D’autres
fonctions cognitives restent intactes, par exemple
le langage. En situation pathologique, les troubles
cognitifs vont connaître une intensité variable : du
vieillissement cognitif “usuel” modéré à la démence.
Pour favoriser un vieillissement cognitif “réussi”, les
principaux axes thérapeutiques sont les suivants :
➤
éviter les agressions cérébrales : traumatismes,
maladies cérébrovasculaires, effets de certains
médicaments (benzodiazépines…) ;
➤
maintenir une stimulation cognitive par des
activités fréquentes et variées impliquant la
mémoire ;
➤conserver des activités physiques ;
➤
favoriser les interactions sociales : lutte contre
l’isolement social et les déficits sensoriels.
Ces éléments s’intègrent dans de nombreuses moda-
lités thérapeutiques qui bénéficient des progrès
technologiques, par exemple avec le support de jeux
“d’entraînement cérébral” disponibles sur consoles
et tablettes électroniques. Certaines études ont
montré l’intérêt cognitif possible et variable selon
le type de procédure cognitive lié à ces jeux.
Dans le cas de la maladie d’Alzheimer constituée,
le traitement des troubles cognitifs comporte
plusieurs orientations, comme l’a montré Anne-
Sophie Rigaud (Paris). Ce traitement, formalisé
par des recommandations de la Haute Autorité de
santé (HAS) en 2011, est fondé sur une approche
pluridisciplinaire impliquant les aidants, avec la
formalisation de l’annonce diagnostique, une prise
en charge médicale (nutrition, comorbidités, inter-
actions médicamenteuses, etc.), et, surtout, une
prise en charge coordonnée médicosociale reposant
sur différentes structures (centres locaux d’informa-
tion et de coordination, équipes Alzheimer, unités
cognitivo-comportementales, etc.). Certains médi-
caments sont parfois utilisés : agents cholinergiques
et antiglutamates. Les interventions auprès des
patients sont importantes : rééducation orthopho-
nique avec stimulation cognitive, ergothérapie, etc.
Sans oublier les interventions auprès des aidants :
psychoéducation et groupes de soutien. L’ensemble
de ces éléments bénéficie des développements
technologiques. Les perspectives médicamenteuses
existent à plus long terme à partir de l’utilisation des
connaissances physiopathologiques sur la maladie
d’Alzheimer.
Une modalité thérapeutique intéressante est,
comme l’a présenté Séverine Samson (Paris et
Lille), l’utilisation de la musique, avec des modalités
cognitives spécifiques.
Les progrès de l’imagerie, en particulier en IRM et en
IRM fonctionnelle, ont été montrés par Stéphane
Lehericy (Paris). Les modifications anatomiques
cérébrales liées à l’âge sont connues : réduction du
volume de la substance grise, atrophie précoce des
zones frontale, associative et pariétale, et atrophie
plus tardive pour le lobe temporal et l’hippocampe.
Des études ont montré le lien entre le volume de la
substance grise frontale et la cognition. Parmi les
éléments étudiés en imagerie, on peut retenir le
volume de l’hippocampe, qui peut varier, d’une part,
d’un individu à l’autre et, d’autre part, avec le temps,
chez une même personne. Ainsi, l’activité physique
régulière peut s’accompagner d’une augmentation
du volume de l’hippocampe avec un impact sur le
déclin mnésique. Concernant les lésions vasculaires
de la substance blanche, des lésions sévères pour
la topographie périventriculaire peuvent expliquer
l’altération de certaines fonctions exécutives.
L’imagerie fonctionnelle (IRM, PET-scan) permet de
montrer une baisse de l’activité corticale rattachée
au vieillissement visuel et auditif.
Enfin, la présentation de Christian Corbé, ophtal-
mologiste et ancien directeur de l’Institution natio-
nale des Invalides (Paris), a montré l’importance de
concevoir des projets rééducatifs multidisciplinaires
du vieillissement impliquant à la fois les domaines
sensoriels et cognitifs.
Conférence de Frank Lin
(Baltimore, États-Unis)
Oto-rhino-laryngologiste spécialisé en otologie,
Frank Lin est aussi directement impliqué dans des
programmes gériatriques et épidémiologiques
centrés sur les liens entre surdité et cognition.
Ses publications font référence en la matière. Ses
principaux résultats, publiés en 2011 (Archives of
Neurology), ont montré, dans le cadre du suivi
d’une cohorte de plus de 600 adultes durant
plus de 10 ans, un lien certain entre la sévérité
des troubles cognitifs et l’importance de l’hypo-
acousie, en faisant abstraction des autres facteurs
(âge, niveau éducatif, tabagisme, HTA, etc.). Cela

…ET TOUJOURS SUR EDIMARK.TV
Le regard de l’avocat
Accédez à la rubrique “Le regard de l’avocat”,
afin de tout comprendre de l’actualité du droit médical.
Me Gilles Devers
(avocat à Lyon)
nous livre en vidéo son analyse
sur “l’affaire Vincent Lambert”.
Scannez ce fl ashcode
pour voir la vidéo
www.edimark.tv
“L’affaire Vincent Lambert” sur le vif !
14:28
34 | La Lettre d’ORL et de chirurgie cervico-faciale • n° 336 - janvier-février-mars 2014
CONGRÈS
RÉUNION
conduit même à s’interroger sur le lien possible
entre atteinte auditive périphérique et atteinte
neurologique centrale, en particulier une accéléra-
tion de l’atrophie au niveau du lobe temporal, et, en
conséquence, à s’interroger sur l’effet positif attendu
de la correction de l’atteinte auditive vis-à-vis des
troubles cognitifs. Pour répondre à ces questions, des
études prospectives sont envisagées, pour évaluer
les effets de la réhabilitation auditive à long terme.
Table ronde :
comment développer
de nouveaux réseaux
d’évaluation et de soins ?
La table ronde modérée par Murielle Jamot (Paris)
et Isabelle Mosnier (Paris) avait pour objectif de
montrer les possibilités de prise en charge pratique
des troubles sensoriels et cognitifs de manière à
obtenir un impact réel sur la qualité de vie et sur les
risques de dépendance. Plusieurs démarches ont été
effectuées par des structures publiques ou privées,
en particulier mutualistes, dans cette direction ; par
exemple, le Centre d’évaluation et de réadaptation
des troubles de l’audition (CERTA), à Angers, ou l’Ins-
titut CLER Basse Vision, à Nancy. Ces établissements
permettent une prise en charge pluridisciplinaire
et coordonnée des troubles cognitifs et sensoriels.
Pour les personnes vivant dans des établissements
de soins (EPHAD), la collaboration des différents
spécialistes, l’information et la délégation de tâches
aux soignants permettent de mieux répondre à ces
situations. Enfin, l’information développée dans
toutes les directions permet de sensibiliser les méde-
cins généralistes et spécialistes, les rééducateurs et
toutes les personnes impliquées dans les soins, sur
l’intérêt d’un dépistage précoce des troubles sen-
soriels, en particulier la presbyacousie. ■
La Société française de réflexion sensori-cognitive
(SOFRESC) est une association loi 1901.
Ses objectifs sont les suivants :
➤mener une réflexion sur l’évaluation des troubles
sensori-cognitifs ;
➤promouvoir les initiatives et les actions de recherche
dans le domaine des pathologies dégénératives céré-
brales ;
➤organiser des actions de formation pour les profes-
sionnels concernés ;
➤favoriser les échanges pluridisciplinaires autour des
problématiques sensori-cognitives des personnes âgées.
Un maître mot pour cette société savante, créée en 2005 :
“pluridisciplinarité”. L’idée est de développer une approche
pluridisciplinaire au service d’un diagnostic précoce des
pathologies neurodégénératives et neurosensorielles,
afin que les patients âgés polypathologiques profitent de
la complémentarité des compétences de chaque profes-
sionnel de santé. Grâce à un réseau amical, scientifique
et médical capable de s’adapter aux différentes situations,
la Sofresc souhaite favoriser le lien entre les différentes
spécialités pour proposer de nouvelles réflexions et de
nouveaux projets.
Site internet : www.sofresc.com
Encadré. La SOFRESC.
L’auteur déclare ne pas avoir
deliens d’intérêts.
1
/
3
100%
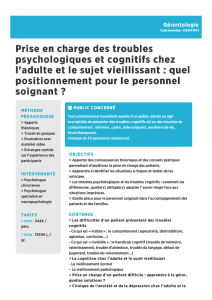

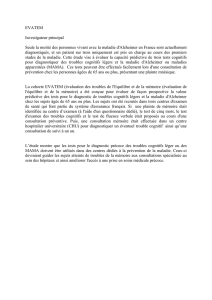
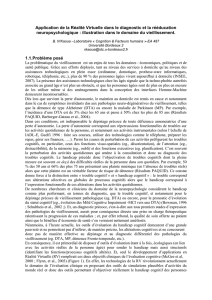
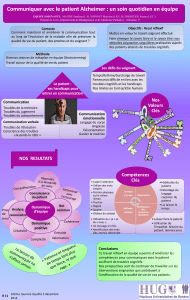
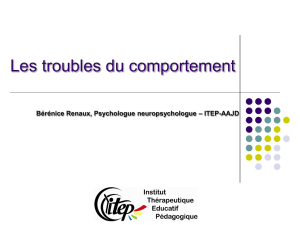
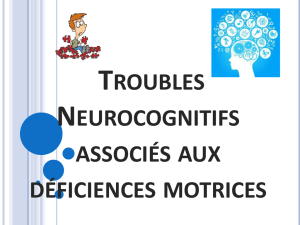
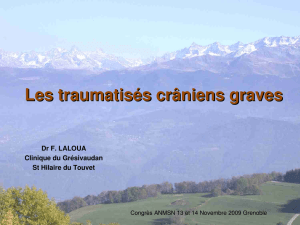
![9_expériencen°3BORDET_AVC [Mode de compatibilité] - FHP-SSR](http://s1.studylibfr.com/store/data/004836702_1-1abf3a10f6b16063102b68201f93c8b3-300x300.png)
