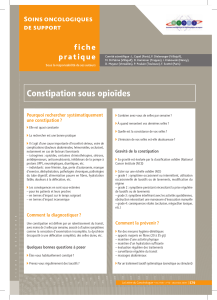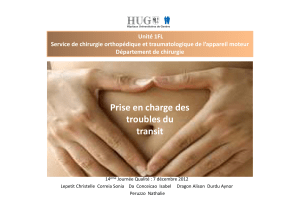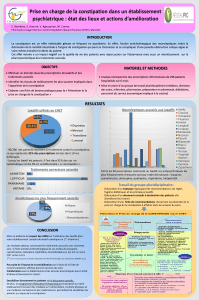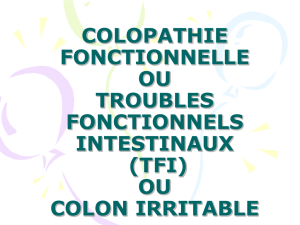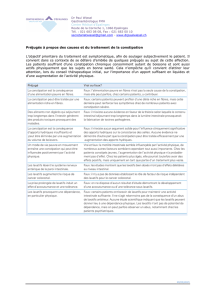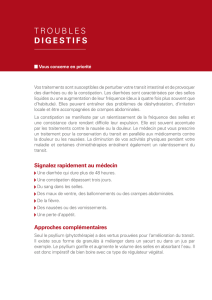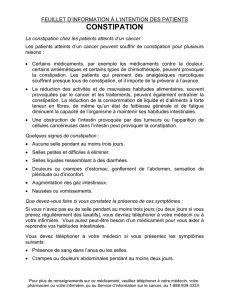L Prise en charge de la constipation : des recommandations ?

322 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XVIII - n° 6 - juin 2009
SOINS DE SUPPORT
EN ONCOLOGIE
Prise en charge
de la constipation :
des recommandations ?
F. Scotté*, A. Morel*, S. Marsan*, C. Vulser**, H. Jaulmes***, S. Oudard*
* Service d’oncologie médicale,
hôpital européen Georges-Pompidou,
Paris.
** Unité d’évaluation et de traite-
ment de la douleur, hôpital européen
Georges-Pompidou, Paris.
*** Équipe mobile de soins palliatifs,
hôpital européen Georges-Pompidou,
Paris.
L
a prise en charge de la constipation est un
problème quotidien en cancérologie, tant du
fait des traitements administrés aux patients
que de l’évolution de l’état général de ces derniers.
Sa prévalence en phase palliative de cancer varie de
23 à 65 % selon les études et représente le troisième
sujet de plainte des patients, après la douleur et
l’anorexie (1, 2). Elle met parfois en jeu le pronostic
vital et s’accompagne de douleurs, de complications
et d’inconforts incompatibles avec une qualité opti-
male de prise en charge.
L’impact économique de la constipation est loin
d’être négligeable, évalué à 2 253 dollars par patient
hospitalisé aux États-Unis (coût infirmier et médica-
ments), et comme l’ont également montré plusieurs
études britanniques (3). Une première enquête a
rapporté que 80 % des infirmières passent plus d’une
demi-journée par semaine à traiter la constipation de
leurs patients (4). Une deuxième enquête signale que
5,5 % des appels auprès d’un service de soins infir-
miers de garde ont trait à des problèmes de transit
ralenti (5). La prise en charge de ce symptôme est
souvent effectuée en fonction de l’expérience des
équipes et des moyens à disposition. Des recomman-
dations sur la gestion de la constipation des patients
en phase palliative ont été récemment publiées (6).
En raison de la pauvreté de la littérature dans ce
domaine, ces propositions de prise en charge sont
essentiellement issues d’accords de professionnels
soignants, paneuropéens, médecins et infirmières,
rassemblés au sein d’un groupe de travail sur le thème
de la constipation, en fonction de leur expérience
clinique. Bien que le référentiel proposé résulte d’un
accord d’experts, ce groupe a mené son travail guidé
par des échelles de qualité de vie validées (National
Service Framework for Long Term Conditions, Oxford
Quality Scale et Rinck Scale) [7-9].
La rédaction de ces recommandations a d’abord
consisté en une revue systématique de la littéra-
ture, comportant une analyse des articles indexés
dans PubMed entre 2001 et 2006 et de ceux de la
Cochrane Library. Seuls 4 essais randomisés versus
contrôle ont été mis en évidence par le groupe de
relecture, ce qui montre la nécessité de conduire
des études dans le domaine de la constipation en
phase palliative, dont la gestion repose aujourd’hui
sur des recueils d’expérience disparates.
La constipation est classiquement caractérisée par un
nombre de défécations inférieur à 3 par semaine (10).
En phase palliative, le retentissement de ce symp-
tôme sur la qualité de vie du patient est mis en
avant ; la constipation a ainsi été définie, dans le
cadre des recommandations, selon deux aspects : le
ralentissement du transit, défini selon la fréquence et
les caractéristiques de la défécation, et la perception
que le patient en a (6).
Les facteurs de risque de survenue de constipation
sont multiples au cours d’une maladie cancéreuse,
avec en premier lieu les traitements antalgiques
utilisés, le plus souvent des opioïdes (tableau I). La
prévalence de la douleur, et donc de ses traitements
en phase palliative, fait que 90 % des patients sous
opioïdes sont constipés (11, 12).
Le diagnostic de constipation et son évaluation se
fondent d’abord sur l’interrogatoire du patient ou
des soignants (qui surveillent le transit). Il convient
d’écouter et d’entendre les plaintes du malade. Un
examen rectal est recommandé en cas d’absence
complète d’évacuation rectale depuis plus de 3 jours,
afin d’éliminer un fécalome. Un syndrome occlusif
conduira éventuellement à des examens complé-
mentaires tels qu’un abdomen sans préparation,
voire un scanner, afin d’opter pour une éventuelle
indication chirurgicale. Une liste de questions à
poser au patient est proposée dans le cadre de ces
recommandations :
Quelles sont la fréquence et la consistance des ➤
mouvements digestifs ?
Y a-t-il modification du transit ? ➤

La Lettre du Cancérologue • Vol. XVIII - n° 6 - juin 2009 | 323
SOINS DE SUPPORT
EN ONCOLOGIE
De l’inconfort et de la douleur sont-ils ressentis
➤
(au moment de l’évacuation) ?
Y a-t-il sensation d’évacuation complète ? ➤
Quelle est l’importance des mouvements intes-
➤
tinaux pour le patient (anxiété) ?
Des facteurs environnementaux rendent-ils la
➤
défécation difficile (perte d’intimité, etc.) ?
Prévention de la constipation
Le traitement préventif de la constipation consiste
tout d’abord en une surveillance régulière et rigou-
reuse du transit et des facteurs de risque. On tentera
de faire en sorte que l’intimité et l’autonomie du
patient soient optimales afin qu’il ne soit pas gêné
lors des évacuations. On anticipera tout effet indési-
rable iatrogène par la prescription prophylactique de
laxatifs. On pourra également proposer aux patients
des massages abdominaux. La prévention repose
essentiellement sur deux thèmes : les apports en
liquides et en fibres et l’exercice physique.
L’apport de liquide recommandé pour maintenir un
transit correct est évalué à 2 litres par 24 heures,
et l’apport de fibres doit être majoré, recomman-
dations difficiles à tenir en situation palliative dans
un contexte d’anorexie (13).
La mobilité et l’exercice physique devraient égale-
ment faire partie d’un accompagnement standard
des patients, recommandation, là encore, difficile
à respecter selon la situation du patient.
Traitement de la constipation
Les laxatifs actuellement mis à la disposition des
prescripteurs sont globalement répartis en deux
catégories, selon leur mode d’action : ramollis-
sement des matières ou stimulation du péristal-
tisme. En dehors des actions mécaniques, d’autres
traitements existent pour favoriser la reprise du
transit : les suppositoires rectaux et les lavements
rectaux.
Enfin, des traitements spécifiques à certaines situa-
tions sont à présent disponibles, parmi lesquels, en
premier lieu dans le cadre des constipations induites
par les opioïdes, la méthylnaltrexone, inhibiteur
sélectif périphérique des récepteurs µ.
Les laxatifs osmotiques ne sont pas absorbés et
agissent par rétention de l’eau et des électrolytes
dans le côlon. Leur action s’effectue en général en
1 à 2 jours, avec pour principaux effets indésirables
des douleurs abdominales et des ballonnements
intestinaux. On distingue différents types de laxatifs
osmotiques :
les osmotiques sucrés : ➤
– lactulose,
– sorbitol ;
les osmotiques salins :
➤
– sels de sodium et de potassium, et phosphates.
Une forte concentration augmente l’hydratation
des selles. L’inconvénient principal est un passage
partiel sanguin du sel qui entraîne un risque d’aug-
mentation de la pression artérielle et, à forte dose,
un risque d’œdème,
– chlorure de magnésium. Ingéré en grandes quantités,
le magnésium provoque un effet laxatif avec appel
d’eau par effet osmotique. En découle une meilleure
hydratation des matières et un effet laxatif ;
les osmotiques purs : ➤
– macrogols. Cette famille regroupe des polymères
linéaires constitués de molécules d’éthylène glycol.
On les appelle également polyéthylène glycol (PEG).
Les propriétés laxatives du macrogol sont liées à un
accroissement du volume des liquides intestinaux.
Les selles étant plus molles, car mieux hydratées,
elles transitent plus vite dans le côlon et sont plus
facilement évacuées.
Tableau I. Facteurs de risque de constipation.
Sexe : risque plus élevé chez les femmes (causes hormo nales :
les prostaglandines et la progestérone contribuent à la dimi-
nution de l’activité du muscle lisse, entraînant une moins
bonne mobilité du tube digestif)
Âge : majoration du risque avec l’âge (en raison de la perte
d’autonomie et du manque d’exercice, de la déshydratation,
d’un régime déséquilibré et pauvre en fibres)
Pathologies chroniques avec altération de l’état général,
baisse d’activité, etc.
Pathologies du tube digestif
Alimentation pauvre en fibres et en liquides
Sédentarité, inactivité physique
Causes iatrogènes : médicaments (liste non exhaustive)
Antalgiques de paliers 2 et 3 (opioïdes)
Antiacides
Antidépresseurs, neuroleptiques
Laxatifs utilisés en excès
Anticholinergiques
Anticonvulsivants
Diurétiques
Antispasmodiques
Suppléments de fer et de calcium
Antiparkinsoniens
Changements hormonaux (grossesse, ménopause)
Cause psychogène

324 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XVIII - n° 6 - juin 2009
SOINS DE SUPPORT
EN ONCOLOGIE
Les laxatifs stimulants agissent sur le péristaltisme et
augmentent ainsi la motilité intestinale. Ils peuvent
avoir des effets indésirables à type de ballonnement
et de douleurs abdominales, parfois sévères, tels que
les colites, et présentent un risque d’interactions
médicamenteuses. Il existe différentes classes de
laxatifs stimulants :
dérivés anthraquinoniques naturels : ➤
– séné et ses dérivés. Il s’agit d’extraits d’un petit
arbuste de la famille des Caesalpiniaceae, utilisé
comme purgatif, proche de l’aloès et de la rhubarbe.
Ses principes actifs sont des dérivés de l’anthraqui-
none. Le séné agit sur le côlon en augmentant ses
mouvements péristaltiques,
– casse (plante de la même famille) ;
dérivés anthraquinoniques synthétiques ; ➤
dérivés du diphénylméthane : ➤
– bisacodyl,
– bisoxatine,
– picosulfate de sodium.
Les laxatifs à usage rectal déclenchent rapidement
un réflexe exonérateur. L’usage répété provoque des
irritations anales. On distingue :
la glycérine par voie rectale ; ➤
les lavements évacuateurs (Microlax®,
➤
Normacol®).
Les laxatifs de lest comprennent les fibres alimen-
taires et les mucilages. Ils rendent les selles plus
denses, plus volumineuses et leur font retenir plus
d’eau, ce qui favorise le péristaltisme naturel et
donc la progression des matières, avec un transit
colique d’une durée de 2 à 3 jours. On distingue, par
exemple, les graines de psyllium ou d’ispaghul, la
gomme de sterculia. Ces laxatifs ne sont pas utilisés
en phase palliative, en raison de la nécessité d’ap-
ports hydriques abondants sans lesquels le risque
d’occlusion est majeur.
Cas particulier
de la constipation sous opioïde
Une prophylaxie laxative systématique doit être
proposée en cas de traitement par opioïde. Souvent,
les patients présentent une constipation opiniâtre qui
mène parfois à la mauvaise observance du traitement
antalgique, source de douleurs et de dégradation de
la qualité de vie. Des recommandations spécifiques
ont été proposées par le National Comprehensive
Cancer Network (NCCN) en 2009 dans le cadre des
recommandations générales de gestion des effets
indésirables des opioïdes (14) [tableau II].
Jusque-là ignorée ou méconnue, la constipation
opio-induite fait actuellement l’objet de recherches
cliniques qui ont mené à la découverte d’un antago-
niste sélectif périphérique des récepteurs µ.
Cette nouvelle molécule, la méthylnaltrexone
(Relistor®), vient d’avoir l’AMM et doit être mise
à la disposition des prescripteurs durant le second
semestre de 2009. Présentée lors du congrès de 2008
de l’American Society of Clinical Oncology (ASCO),
l’étude qui a permis son référencement est une
phase III randomisée versus contrôle, menée avec une
première phase en double aveugle et une seconde
en simple aveugle (15). Les 133 patients inclus dans
cette étude recevaient un traitement par opioïdes
depuis plus de 2 semaines, avec une posologie stable
depuis au moins 3 jours, et des laxatifs prescrits. Le
traitement par laxatif n’ayant pas d’efficacité sur la
constipation induite par le traitement antalgique, les
Tableau II. Gestion des effets indésirables des opioïdes : la constipation (D’après les recom-
mandations du NCCN).
Mesures préventives Médications prophylactiques
Association de laxatifs stimulant et osmotique
Augmentation de la dose de laxatifs selon la dose d’opioïdes
Maintien d’une hydratation adéquate
Maintien d’un apport en fibres adéquat
Le complément par laxatif de lest du type mucilage n’est pas
recommandé dans la constipation opio-induite
Maintien d’une activité, si possible
En cas de développement
d’une constipation
Évaluer les causes et la sévérité
Éliminer une occlusion
Traiter d’autres causes
Administrer progressivement des laxatifs en évitant de maintenir
un transit tous les 1 à 2 jours
Évaluer l’administration de coanalgésiques pour réduire la dose
d’opioïdes
Évaluer l’administration d’autres agents tels que l’hydroxyde
de magnésium (30 à 60 ml/j), le bisacodyl (2 à 3 comprimés
par jour) ou un suppositoire rectal quotidien ; du lactulose
(30 à 60 ml/j) ; du sorbitol (30 ml toutes les 2 à 3 heures à la
demande) ou du citrate de magnésium ; du polyéthylène glycol
(1 dose pour 8 mesures d’eau p.o. x 2/j)
Lavement à l’eau tiède plate ou salée
Évaluer l’utilisation de prokinétiques
(par exemple, métoclopramide 10 à 20 mg x 4/j p.o.)
Pour les patients ayant une maladie avancée
et recevant des soins palliatifs, évaluer l’administration
de méthylnatrexone 0,15 mg/ kg sous-cutané x 1/j au maximum
Évaluer les antalgiques de la voie neurogène et les techniques
de neuro-ablation pour réduire la posologie des opioïdes

Surveillance
▸ Surveillance de la satisfaction du patient quant à son transit selon checklist
▸ Surveillance des améliorations ou des détériorations du transit
▸ Surveillance des facteurs de risque de constipation
▸ Anticipation des effets indésirables des agents pharmacologiques tels que les opioïdes
– Prescription prophylactique de laxatif
Éducation thérapeutique du patient
▸ Encourager les modifications des habitudes en respectant les capacités du patient
– Augmentation des apports de liquides
– Encourager la mobilité
– Assurer une intimité et un confort permettant une défécation normale
Plainte du patient concernant une constipation (défécation < 3 fois par semaine)
Confirmation du diagnostic
Évaluation des causes
Élimination de l’occlusion intestinale tumorale
Traitement des causes
Poursuite
du traitement
Poursuite
du traitement
Étape suivante
Traitement de la constipation
Première intention : traitement par laxatif oral
▸ Association d'un laxatif osmotique et d'un stimulant
▸ Adaptation aux besoins du patient
Deuxième intention
▸ Suppositoire rectal et lavement
▸ Évaluation d’un antagoniste spécifique périphérique
des opioïdes (methylnaltrexone) en cas de traitement par opioïde
Troisième intention
▸ Évacuation manuelle
▸ Évaluation d’un antagoniste spécifique périphérique des opioïdes
(méthylnaltrexone) en cas de traitement par opioïde
Prise en charge prophylactique
Prise en charge curative
Corrigibles
Amélioration
des
symptômes
Amélioration
des
symptômes
Amélioration
des
symptômes
Non corrigibles
Figure. Recommandations pour le traitement de la constipation (6).
La Lettre du Cancérologue • Vol. XVIII - n° 6 - juin 2009 | 325
SOINS DE SUPPORT
EN ONCOLOGIE
patients ont alors été randomisés, dans une première
phase en double aveugle, entre 2 bras de traitement :
placebo et méthylnaltrexone par voie sous-cutanée
à la posologie de 0,15 mg/ kg/j pendant 2 semaines.
Les 2 groupes avaient des caractéristiques similaires,
notamment concernant le niveau de douleur et le
traitement antalgique.
L’objectif principal de l’étude était la reprise du
transit (évacuation de matières) dans les 4 heures
suivant la première administration du produit à
l’étude. L’effet laxatif dans les 4 heures après 2 ou
plusieurs administrations des 4 premières doses
était également évalué.
Les patients ayant complété cette phase de l’essai
pouvaient intégrer une seconde phase ouverte de
3 mois.
Les résultats de cette étude ont été satisfaisants,
puisque 48 % des patients du bras traité ont eu un
effet laxatif dans les 4 heures suivant la première
administration de méthylnaltrexone, versus 15 %
dans le bras placebo (p < 0,001). Cette efficacité a été
également complétée en cas d’absence de réussite
après la première administration. Cinquante-deux
pour cent des patients recevant la méthylnaltrexone
ont en effet recouvré un transit après les 2, 3 ou
4 premières doses, versus 8 % dans le bras placebo
(p < 0,001). Des résultats positifs ont également
été retrouvés lors de la deuxième phase ouverte du
protocole versus placebo, avec un délai d’apparition
de l’effet laxatif de 30 premières minutes après l’ad-
ministration du produit pour 50 % des patients. Ce
traitement, correctement toléré malgré quelques
douleurs ou flatulences, n’a eu aucun impact sur
l’efficacité antalgique, ne passant pas la barrière
hémato-méningée.
Des résultats similaires ont été retrouvés lors d’une
autre étude en double aveugle comparant 2 doses
de méthylnaltrexone (0,15 et 0,30 mg/ kg) à un
placebo (16). L’effet laxatif a été efficace dans les
4 heures suivant la première dose de méthylnal-
trexone pour 62 % des patients traités à la dose de
0,15 mg/kg versus 58 % à la dose de 0,30 mg/kg et
14 % dans le bras placebo (p < 0,0001).
Ces 2 études récemment publiées font de la méthyl-
naltrexone une option de traitement intéressante
pour les patients constipés et traités par opioïde, si
bien qu’elle a été immédiatement intégrée aux recom-
mandations de prise en charge de la constipation.
Recommandations en curatif
En phase palliative, seules 3 études randomisées
dont deux portent sur la constipation induite par
les opioïdes, évaluent l’efficacité et la tolérance
des laxatifs (17-19). Aucune n’a permis de montrer
de différence franche entre les laxatifs, adminis-
trés individuellement. Il convient de s’adapter à
chaque patient, en fonction de sa situation et des
lésions (syndrome de la queue de cheval, fin de

326 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XVIII - n° 6 - juin 2009
SOINS DE SUPPORT
EN ONCOLOGIE
vie, traitement opioïde, etc.), afin de proposer une
solution optimale présentant le minimum d’effets
indésirables.
Les recommandations proposées et publiées par le
groupe paneuropéen préconisent donc, en situation
palliative, de toujours réévaluer les attentes, la situa-
tion et la qualité de vie du patient, en s’adaptant au
maximum à chacun.
Ces recommandations sont résumées sous forme
d’organigramme dans la figure (6).
L’attitude classique consiste à associer, si possible, les
2 classes pharmacologiques de laxatifs (un stimulant
et un osmotique), en première ligne de traitement
après identification et, éventuellement, traitement
de la cause de la constipation. Il s’agit bien, une
fois encore, de s’adapter à chaque situation indivi-
duelle, certains patients ne pouvant tolérer ou se voir
administrer les 2 classes de laxatifs : on évitera, par
exemple, l’administration d’un laxatif irritant à un
malade souffrant d’incontinence liée à un syndrome
de la queue de cheval, qui risquerait de déclencher
une irritation cutanée périanale.
En cas d’inefficacité, la deuxième étape consiste à
proposer des suppositoires rectaux et un lavement.
Dans le cas d’un traitement par opioïde, la place de
la méthylnaltrexone est à discuter.
Ce n’est qu’en cas d’inefficacité de cette deuxième
ligne que l’évacuation manuelle est proposée, à
évaluer encore une fois en fonction de la situation
et du souhait du patient en phase palliative. On
proposera une poursuite du traitement par méthyl-
naltrexone en cas de traitement opioïde.
L’évaluation régulière et la réaction rapide en cas
de problème avéré nécessite le travail d’une équipe
performante et formée. Le rôle de l’équipe soignante
est majeur pour l’optimisation de la prophylaxie et
du traitement de la constipation. Elle devra surveiller
régulièrement les points suivants :
quantité et qualité des selles ; ➤
durée de chaque défécation ; ➤
diarrhée et fausse diarrhée ; ➤
continence et incontinence ; ➤
efficacité des laxatifs ; ➤
utilisation de traitements complémentaires ; ➤
apports alimentaires et hydriques ; ➤
satisfaction quant à l’environnement permettant
➤
intimité et confort ;
nécessité de massage abdominal. ➤
C’est par une évaluation, une attitude rigoureuse
didactique telle que présentée dans ces recomman-
dations, et par un travail d’équipe que les patients
seront pris en charge de manière optimale. La mise
sur le marché de molécules nouvelles va également
permettre de limiter les effets indésirables des
opioïdes et éviter aux malades ainsi qu’aux soignants
la pratique de lavements évacuateurs, chronophages,
douloureux et blessant pour l’intimité. Cette prise en
charge répondra alors aux critères de qualité d’ac-
compagnement exigés par une démarche de soins
de support. ■
1. Potter J, Hami F, Bryan T, Quigley C. Symptoms in
400 patients referred to palliative care services: prevalence
and patterns. Palliate Med 2003;17:310-14.
2. Solano JP, Gomes B, Higginson IJ. A comparison of
symptom prevalence in far advanced cancer, AIDS, heart
disease, chronic obstructive pulmonary disease and renal
disease. J Pain Symptom Manage 2006;31:58-69.
3. Frank L, Schmier J, Kleinman L et al. Time and economic
cost of constipation care in nursing homes. J Am Med Dir
Assoc 2002;3:215-23.
4. Poulton B, Thomas S. The cost of constipation. Prim
Health Care 1999;9:17-22.
5. Withell B. A protocol for treating acute constipa-
tion in the community setting. Br J Community Nurs
2000;5:114-7.
6. Larkin PJ, Sykes NP, Centeno C et al. The management
of constipation in palliative care: clinical practice recom-
mendations. Palliat Med 2008;22:796-807.
7. Department of Health. The National Service Framework
for Long Term Conditions March 2005. http://www.dh.gov.
uk/en/Healthcare/NationalServiceFrameworks/Longter-
mconditions/index.htm.
8. Jadad AR, Moore RA, Carroll D et al. Assessing the quality
of reports of randomized clinical trials: is blinding neces-
sary? Control Clin Trials 1996;17:1-12.
9. Rinck GC, Van Den Bos GAM, Kleijnen J et al. Methodolo-
gical issues in effectiveness research on palliative cancer care:
a systematic review. J Clin Oncol 1997;15:1697-707.
10. Thompson WG, Longstreth GF, Drossman DA et al.
Functional bowel disorders and functional abdominal pain.
Gut 1999;45(Suppl. 2):II43-II47.
11. Sykes NP. The relationship between opioid use and
laxative use in terminally ill cancer patients. Palliat Med
1998;12:375-82.
12. NCCN clinical practice guidelines in oncology pallia-
tive care. V. 1. 2009. http://www.nccn.org/professionals/
physician_gls/PDF/palliative.pdf.
13. Anti M, Pignataro G, Armuzzi A et al. Water supple-
mentation enhances the effect of high fiber diet on stool
frequency and laxative consumption in adult patients
with functional constipation. Hepatogastroenterology
1998;45:727-32.
14. Swarm R and the NCCN Adult Cancer Pain Panel
members. Adult cancer pain, version 1.2009.
www.nccn.org.
15. Thomas J, Karver S, Cooney GA et al. Methylnaltrexone
for opioid-induced constipation in advanced illness. N Engl
J Med 2008;358:2332-43.
16. Slatkin N, Thomas J, Lipman AG et al. Methylnaltrexone
for treatment of opioid-induced constipation in advanced
illness patients. J Support Oncol 2009;7:39-46.
17. Sykes NP. A clinical comparison of laxatives in a hospice.
Palliat Med 1991;5:307-14.
18. Ramesh PR, Kumar KS, Rajagopal MR et al. Managing
morphine-induced constipation: a controlled comparison
of an Ayurvedic formulation and senna. J Pain Symptom
Manage 1998;16:240-44.
19. Agra Y, Sacristan A, Gonzalez M et al. Efficacy of senna
versus lactulose in terminal cancer patients treated with
opioids. J Pain Symptom Manage 1998;15:1-7.
Références bibliographiques
Les Lettres - Les Courriers - Les Correspondances - Les Images - Les pages de la pratique médicale
Edimark SAS, 2, rue Sainte-Marie - 92418 Courbevoie Cedex - Tél. : 01 46 67 63 00 - Fax : 01 46 67 63 10 - E-mail : contacts@edimark.fr - Site Internet : www.edimark.fr
1
/
5
100%