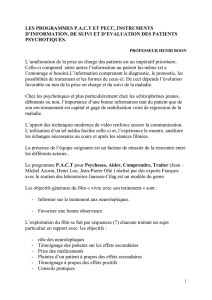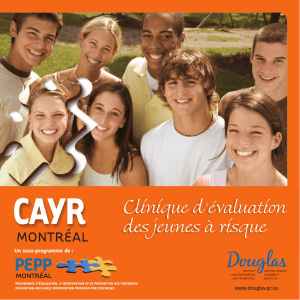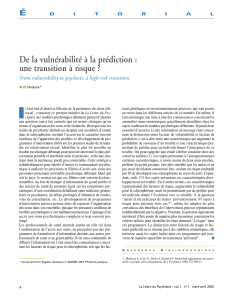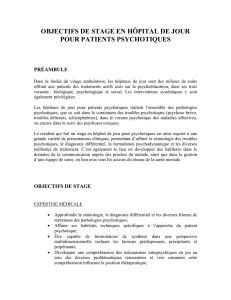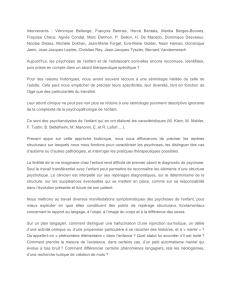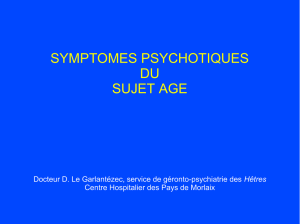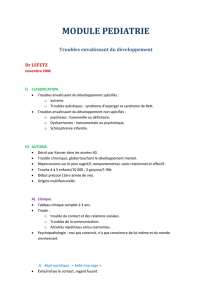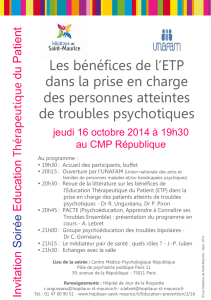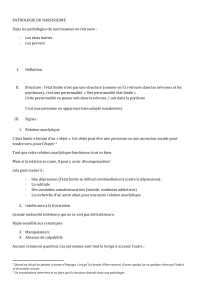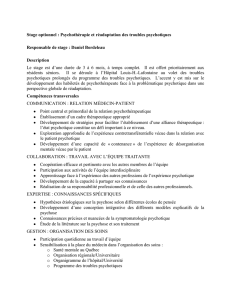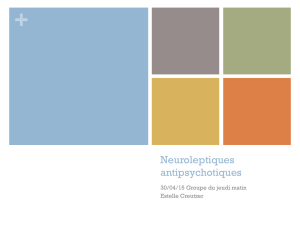Des troubles psychotiques aux troubles bipolaires J.-M. Azorin

© L’Encéphale, Paris, 2008. Tous droits réservés.
L’Encéphale (2008) Supplément 4, S127–S129
journal homepage: www.elsevier.com/locate/encep
Bonhoeffer (1909) différencie les psychoses exogènes,
liées à une cause extérieure, et les psychoses endogènes,
où la cause est interne – généralement méconnue, mais
conçue comme de nature héréditaire [in 5].
Une étape importante dans la représentation de la psy-
chose est constituée par l’œuvre de Jaspers, qui introduit
une défi nition des psychoses relativement simple, en parlant
d’un changement durable de la personnalité dans son ensem-
ble, qui est le résultat d’un processus. Le terme de processus
fait référence au fait que les états psychotiques ne sont pas
psychologiquement compréhensibles, leur compréhension
nécessitant de sortir du cadre de la psychologie courante.
La démarche de Jaspers aboutit à l’isolement des psy-
choses à partir du groupe des « psychoses, psychopathies et
psychonévroses » ; Jaspers oppose à ces processus non
compréhensibles des états compréhensibles de développe-
ment de la personnalité, qu’il appelle psychopathies ; par
ailleurs, de cet ensemble, sera isolé par Freud (1924) et
Bumke (1925) le groupe des névroses (Fig. 1).
Des troubles psychotiques aux troubles bipolaires
J.-M. Azorin
Hôpital Sainte Marguerite, Service de Psychiatrie Adulte, 270 boulevard Sainte Marguerite, 13274 Marseille cedex 9
Le terme de psychose est dû à un psychiatre allemand (von
Feuchtersleben) en 1845, qui décrit des « états d’affec-
tions de la personnalité dans son ensemble, secondaires à
une perturbation des relations psychophysiques », que la
cause de cette perturbation soit de nature physique ou psy-
chique [in 5].
Ces états de psychoses sont conçus à l’époque comme
appartenant à une psychose unique, états s’enchaînant les
uns les autres par degré de sévérité croissante. La manie et
la mélancolie sont des étapes de cette psychose unique,
qui évolue vers la démence schizophrénique [2]. Aujourd’hui,
au contraire, la défi nition des troubles psychotiques est
très restrictive. Dans le DSM, ils sont défi nis simplement
comme des états s’accompagnant d’idées délirantes ou
d’hallucinations prononcées.
Troubles psychotiques :
principales étapes évolutives
Vers le milieu du XIXe siècle, les termes de psychose, de
psychopathie ou de psychonévrose sont équivalents : les
psychoses ou psychopathies constituent l’aspect psycholo-
gique des névroses, tandis que le terme névrose met l’ac-
cent sur l’aspect neurologique de ces troubles.
Remak (1864) isole, à partir du groupe des psychoses,
les psychoses organiques, et Fuerstner (1881) isole les psy-
choses fonctionnelles, pour lesquelles on ne peut pas met-
tre en évidence de facteurs organiques de manière certaine
[in 5].
* Auteur correspondant.
E-mail : [email protected]
L’auteur n’a pas signalé de confl its d’intérêts.
Figure 1 Troubles psychotiques. Principales étapes évolutives
(d’après Schneider, 1933).
Jaspers 1913
Psychoses
Freud 1924
Bumke 1925
Névroses Psychopathies
Jaspers 1913
Psychoses
Psychopathies
Psychonévroses

J.-M. AzorinS128
Enfi n, dès la fi n du XIXe siècle, divers auteurs décrivent,
sous des termes différents, ce qui sera appelé « bouffée
délirante » dans la nosographie française : psychoses atypi-
ques, Leidesdorf 1865 ; psychoses réactionnelles, Jaspers
1913 ; psychoses psychogéniques, Wimmer 1916 ; psycho-
ses schizo-affectives, Kasanin 1933 ; psychoses schizophré-
niformes, Langfeldt 1939 [in 5]. Ceci s’oppose à l’idée de
Jaspers, soutenant que les psychoses sont nécessairement
un processus durable, sévère, et irréversible.
Troubles psychotiques :
émergence de la signifi cation actuelle
La conception actuelle des troubles psychotiques débute
en 1980, avec les propositions de T. Crow différenciant
schizophrénie positive et schizophrénie négative, et celle
d’Andreasen (1982) distinguant les symptômes positifs et
les symptômes négatifs, ce qui a conduit à la création
d’échelles d’évaluation de ces symptomatologies [in 6].
Différents auteurs vont effectuer des analyses facto-
rielles de ces échelles d’évaluation dont l’intérêt est le
passage d’une solution à deux facteurs à une solution à
trois facteurs : positif, négatif, désorganisation [7].
Par la suite est apparue l’idée que l’on pouvait repro-
duire cette solution à trois facteurs pour d’autres troubles.
Dans un premier temps, la solution à trois facteurs se
retrouve dans les troubles affectifs bipolaires [9] ; puis
cette solution à trois facteurs est décrite dans les troubles
schizophréniformes, les troubles schizo affectifs, les trou-
bles de l’humeur, les troubles délirants, les psychoses réac-
tionnelles et atypiques [10].
Ces facteurs apparaissent donc indépendants de la
maladie, constituant des dimensions transnosographiques,
appelées négative, désorganisée et psychotique (le terme
de positif recouvrant les facteurs psychotique et désorga-
nisé). Sur le plan psychométrique, le terme de psychotique
correspond donc à la somme des symptomatologies déliran-
tes et hallucinatoires.
Troubles bipolaires :
principales étapes évolutives
Les premiers travaux du XIXe siècle décrivent manie et mélan-
colie comme des entités séparées (Esquirol 1838). Puis manie
et mélancolie, en alternance ou en association, sont partie
intégrante d’une même affection : la folie circulaire (Falret
1854), ou la folie à double forme (Baillarger 1854).
Kraepelin (1899) décrit la folie maniaco-dépressive, qui
comprend les manies isolées, les mélancolies isolées, et
l’alternance de manies et de mélancolies, éléments qui
seront repris en 1907 par deux auteurs mineurs, Camus et
Deny, qui créent le terme de psychose maniaco-dépres-
sive.
C’est Kleist, en 1953, qui utilise le premier le terme de
bipolaire, dans la défi nition de la psychose bipolaire qui
intègre manie et mélancolie en alternance. Pour Kleist,
celle-ci s’oppose aux psychoses unipolaires, qui compren-
nent les manies isolées et les mélancolies isolées.
Les travaux de Angst (1966) limitent le trouble bipolaire
à l’association de manies et de mélancolies et aux manies
isolées, alors que les mélancolies isolées constituent la
dépression unipolaire [in 1].
Dès le XIXe siècle, plusieurs auteurs avaient identifi é des
formes mineures des troubles bipolaires (cyclothymie,
Hecker 1877 ; hypomanie, Mendel 1881 ; dysthymie,
Kahlbaum 1882 ; hyperthymie, Kahlbaum 1882).
Au XXe siècle, il faut attendre les travaux de Dunner
(1976) pour isoler le trouble bipolaire de type II, point de
départ à l’isolement de formes de moins en moins sévères
de troubles bipolaires (spectre des troubles bipolaires :
Angst 1978, Klerman 1981, Akiskal et al 1983), allant des
formes psychotiques au sens classique du terme, jusqu’aux
formes tempéramentales et pseudo-névrotiques [in 8].
Relations troubles psychotiques-
troubles bipolaires
Dans les classifi cations actuelles, les relations entre ces
deux troubles sont évoqués dans deux catégories : les trou-
bles schizo-affectifs de type bipolaire, et les épisodes
maniaques ou mixtes avec caractéristiques psychotiques.
Les critères du trouble schizo-affectif de type bipolaire
sont la présence d’un épisode maniaque (ou mixte) et de
symptômes caractéristiques de la schizophrénie, et la sur-
venue isolée de symptômes psychotiques pendant 2 semai-
nes au moins. Ceux des épisodes bipolaires avec
caractéristiques psychotiques sont la survenue d’épisodes
sévères, avec caractéristiques psychotiques congruentes à
l’humeur ou non-congruentes à l’humeur.
L’étude EPIMAN [3] avait cherché à valider sur le plan
psychométrique ces données (Tableau 1). Les analyses de
régression logistique montrent que les éléments les plus
prédicteurs des caractéristiques psychotiques chez les
maniaques sont le score MRS (sévérité de l’épisode), mais
également la présence de phobie sociale, et le célibat [4].
Tableau 1 Psychométrie des manies psychotiques à J0
(EPIMAN II-Mille) [3]
Manies ss CP
(n = 546) M + CPC
(n = 364) M + CPNC
(n = 180) p
TOTAL MRS 37,0 41,1 38,7 < 10–4
- TOTAL MSS 20,1 22,9 20,4 < 10–4
- TOTAL BIS 16,9 18,2 18,3 < 10–4
TOTAL BM 189,5 242,5 228,9 < 10–4
SAPS 30,3 49,3 50,1 0,05
MADRS 15,4 14,7 16,4 0,05
La manie avec caractéristiques psychotiques non
congruentes s’oppose à la manie avec caractéristiques psy-
chotiques congruentes, par la présence de symptômes psy-
chotiques de premier rang de Kurt Schneider (intensité plus
importante des hallucinations auditives, des délires de per-
sécution, des délires de grandeur, du délire somatique, du

Des troubles psychotiques aux troubles bipolaires S129
délire de référence). Par ailleurs, dans les manies non
congruentes, l’humeur est beaucoup plus instable que dans
les manies congruentes (Tableau 2, Tableau 3). Ainsi, ce qui
rendrait non compréhensibles les caractéristiques psycho-
tiques, serait qu’elles soient dépendantes d’altérations de
l’humeur qui se caractérisent par des cycles ultra-rapides.
Tableau 2 Caractéristiques psychotiques : congruents
versus non congruents (EPIMAN II-Mille) [3]
Items SAPS/scores J0 M + CPC
(n = 364) M + CPNC
(n = 180) p
Hallucinations auditives 1,03 1,30 0,05
Délire de persécution 1,94 2,74 < 10–4
Délire de grandeur 3,17 2,03 < 10–4
Délire religieux 1,46 0,76 < 10–4
Délire somatique 0,54 0,82 0,01
Délire de référence 1,50 1,83 0,01
Tableau 3 Caractéristiques psychotiques : congruents
versus non congruents (EPIMAN II-Mille) [3]
Items SAPS/scores J0 M + CPC
(n = 364) M + CPNC
(n = 180) p
Comportement agressif - agité 2,45 2,92 0,0002
Logorrhée 3,53 3,36 0,05
Distractibilité 2,99 2,62 0,003
Associations par assonances 1,85 1,40 0,0004
Troubles psychotiques et troubles
bipolaires : aspects génétiques
Sur le plan génétique, la dimension psychotique apparaît
plus élevée chez les apparentés de premier degré sains de
probants schizophrènes et bipolaires psychotiques que chez
les apparentés de premier degré sains de probants schi-
zophrènes et bipolaires non psychotiques. En outre, il
existe une corrélation intrafamiliale des scores de dimen-
sion psychotique chez les frères et sœurs sains des probants
schizophrènes et bipolaires [11].
On peut penser qu’il existe une double vulnérabilité :
vulnérabilité psychotique et vulnérabilité bipolaire.
L’épisode maniaque sévère constitue un stress important,
qui révèle la vulnérabilité psychotique associée à la vulné-
rabilité bipolaire, si elle existe. Si la vulnérabilité psycho-
tique est peu marquée, elle disparaît avec la régression de
l’épisode maniaque, résultant en un épisode avec caracté-
ristiques psychotiques. Si au contraire, cette vulnérabilité
psychotique est marquée, le stress de l’épisode maniaque
révélera la vulnérabilité psychotique qui par la suite perdu-
rera, conduisant à un trouble schizo-affectif bipolaire.
Conclusion
L’isolement des troubles bipolaires de l’ensemble des trou-
bles psychotiques en a permis le démembrement, en parti-
culier vers le spectre des formes de moindre sévérité. La
« laïcisation » des troubles psychotiques, c’est-à-dire le
fait de ne pas les considérer systématiquement comme des
états sévères, chroniques, non susceptibles de rémission,
en a fait un concept heuristique dont l’incidence au sein
des troubles bipolaires peut être étudiée de façon opéra-
toire.
Références
[1] Angst J. Historical aspects of the dichotomy between manic-
depressive disorders and schizophrenia. Schizophr Res 2002 ;
57 : 5-13.
[2] Azorin JM, Dassa D. La psychose unique : aspects conceptuels.
Neuro-Psy 2000 ; 15 : 82-5.
[3] Azorin JM, Akiskal H, Hantouche E. The mood-instability
hypothesis in the origin of mood-congruent versus mood-
incongruent psychotic distinction in mania : validation in a
French National Study of 1090 patients. J Affect. Disord 2006 ;
96 : 215-33.
[4] Azorin JM, Akiskal H, Akiskal K et al. Is psychosis in DSM-IV
mania due to severity. The relevance of selected demographic
and comorbid social-phobic features. Acta Psychiatr Scand
2007 ; 115 : 29-34.
[5] Beer MD. Psychosis : a history of the concept. Compr Psychiat
1996 ; 37 : 273-91.
[6] Berrios GE. Positive and negative symptoms and Jackson. A
conceptual history. Arch Gen Psychiatry 1985 ; 42 : 95-7.
[7] Liddle PF. Schizophrenic syndromes, cognitive performance
and neurological dysfunction. Psychol Med 1987 ; 17 : 49-57.
[8] Marneros A, Angst J. Bipolar disorders : roots and evolution
In : Marneros A, Angst J (eds). Bipolar disorders : 100 years
after manic depressive insanity. Kluwer Academic Publishers.
Dordrecht ; 2000 : 1-36.
[9] Maziade M, Roy MA, Martinez M et al. Negative, psychoticism,
and disorganized dimensions in patients with familial schizo-
phrenia or bipolar disorder : Continuity and discontinuity
between the major psychoses. Am J Psychiatry 1995 ; 152 :
1458-63.
[10] Peralta V, Cuesta MJ, Farre C. Factor structure of symptoms
in functional psychoses. Biol Psychiary 1997 ; 42 : 806-15.
[11] Schürhoff F, Szöke A, Méary A et al. Familial aggregation of
delusional proneness in schizophrenia and bipolar pedigrees.
Am J Psychiatry 2003 ; 160 : 1313-9.
1
/
3
100%