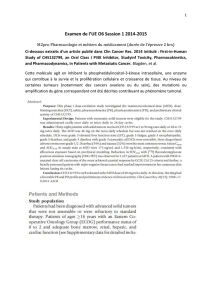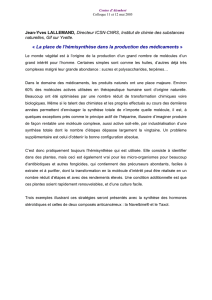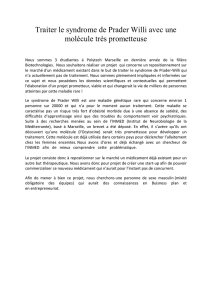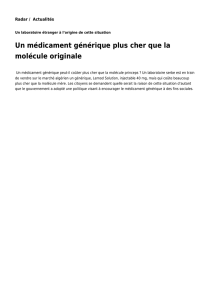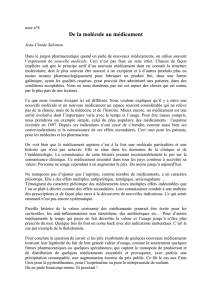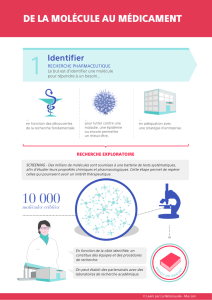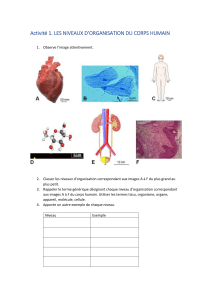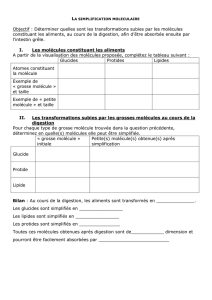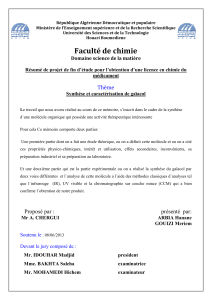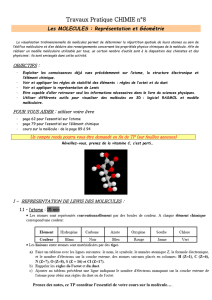Rémunération du progrès thérapeutique M. Zylberman Introduction

© L’Encéphale, Paris, 2008. Tous droits réservés.
L’Encéphale (2007) Supplément 5, S143-S145
journal homepage: www.elsevier.com/locate/encep
méthode choisis selon certains objectifs. Or, ces objectifs
varient selon la perspective que l’on a et qui, elle aussi,
peut être différente d’abord selon les acteurs qui réalisent
l’évaluation, ensuite en fonction du moment auquel est
procédé à l’évaluation et fi nalement en fonction du lieu
d’application de cette innovation, c’est-à-dire celui de la
prise en charge.
Très schématiquement, quatre acteurs de l’évaluation
peuvent êtres dénombrés : les médecins, les patients, l’in-
dustriel lui-même et enfi n la société et/ou l’environnement
politico-administratif dans laquelle elle prend place (Fig. 1).
Rémunération du progrès thérapeutique
M. Zylberman
Laboratoire Lilly, 13 rue Pagès, 92158 Suresnes
Introduction
Un des freins à l’accès d’une molécule au marché est, pour
de bonnes ou de mauvaises raisons, la possibilité d’obtenir un
remboursement. En effet, les autorités de santé n’acceptent
de mettre sur le marché un médicament que dans la mesure
où il pourrait apporter un certain niveau d’innovation.
Par la suite, le degré d’innovation thérapeutique est à
la base de la valorisation du médicament : la rémunération
du progrès thérapeutique passe donc par une nécessaire
évaluation. Cette évaluation nécessite des critères et une
* Auteur correspondant.
E-mail : zylberman_myriam@lilly.com
L’auteur est salarié du laboratoire Lilly.
Qui ? = Acteurs Quand ? = Moment Où ? = Lieux des prise en charge
Sociétés savantes
Hôpital vs villeSelon les besoins
Élargissement
des
connaissances
Les industriels
Administration
Médecins
Société
Médias
AMM
ASMREfficacité/
tolérance
sur la base
du dossier de
dévelopement
(Guidelines)
Situation naturelle
de traitement :
évaluation
de l’efficacité/
tolérance
et de l’utilisation
Patients
QdV
satisfaction
Remboursement
et prix
AMM Au cours de
la vie du produit Géographique Dans l’organisation
du système de soins
Figure 1
4509_05_Zyl ber man. i ndd 1434509_05_Zylberman.indd 143 14/ 12/ 07 14: 42: 2614/12/07 14:42:26
> XPress 6 Noir

M. ZylbermanS144
Si la perspective de l’industriel se confronte à toutes
les autres, la première à laquelle elle s’oppose est celle de
l’administration.
Le médicament sera ensuite accessible aux utilisateurs,
tant les médecins que les patients, qui pourront dès lors,
faire leur propre évaluation. Tant que la perspective de
l’industriel ne sera pas confrontée à celle de l’autorité de
santé, aucun des utilisateurs ne pourra se faire sa propre
évaluation.
Le moment le plus important dans la vie d’un médicament
est donc celui de l’autorisation de mise sur le marché
(AMM).
Toutefois, cette AMM déterminée par les résultats d’es-
sais de recherche clinique réalisés sur 4 000 à 5 000
patients, donne certain niveau d’information sur le rapport
risque bénéfi ce dans une population de patients pré sélec-
tionnés et dans un contexte particulier qui est assez loin de
ce qui sera, in fi ne, la réalité de la prescription. Ainsi, au-
delà d’une innovation thérapeutique purement scientifi -
que, observée dans des conditions strictes de recherche, il
est également nécessaire de vérifi er que cette innovation
se traduit par une innovation pragmatique dans les condi-
tions réelles de prise en charge des patients, par exemple,
dans les différents lieux de prise en charge possibles (hos-
pitalière ou libérale) ou encore selon les pays dans la
mesure où les systèmes de soins n’y sont pas parfaitement
comparables de l’un à l’autre : c’est probablement là que
se situe le progrès thérapeutique. Ce passage d’une évalua-
tion fondée sur l’observation de l’effet à proprement parlé,
à une évaluation prenant en compte les facteurs infl uen-
çant la survenue de l’effet, revient en fait à passer d’une
perspective strictement individuelle (quel est l’effet
attendu pour un patient donné ?) à une vision plus popula-
tionnelle (quel est l’effet attendu pour une population ?).
Dans ce passage, l’innovation peut se révéler et se traduire
par un progrès thérapeutique ou au contraire s’évanouir.
C’est de cette traduction de l’innovation en progrès théra-
peutique que la molécule tire toute sa valorisation et ce, à
double titre : d’abord en espèces sonnantes et trébu-
chantes, puisque plus grand est le progrès thérapeutique et
plus élevé pourra en être son prix, négocié en France ;
ensuite et surtout, c’est de son existence et de son inten-
sité que dépend évidemment le succès de la molécule
auprès des médecins comme des patients.
Qu’est ce que l’innovation
pour la Commission de la Transparence ?
En France, un médicament reconnu comme potentielle-
ment innovant par la commission de la transparence peut
bénéfi cier d’un accès accéléré au marché.
Pour démontrer le potentiel innovateur de son produit,
l’entreprise doit justifi er que la molécule est un nouveau
mode de traitement, en raison notamment de son méca-
nisme d’action ou de sa classe pharmacologique, de sa
population cible ou de sa voie d’administration.
Le médicament doit également démontrer une supério-
rité par rapport aux thérapeutiques disponibles en matière
d’effi cacité, de tolérance, de facilité d’accès et d’utilisa-
tion.
Dans une indication donnée, la molécule doit couvrir
totalement ou en partie le besoin médical disponible.
Ces règles successives et additionnelles comportent un
certain nombre de notions que l’industriel pourra utiliser
pour développer ses nouvelles molécules afi n d’accéder au
marché le plus rapidement et avec le plus grand succès
possible.
Qu’est ce que l’innovation pour Lilly
« L’innovation recouvre un besoin médical non couvert, en
comparaison aux thérapeutiques disponibles et dont la
valeur est reconnue par les payeurs et les patients »
Lors de sa réponse à la demande de l’administration,
Lilly prend le parti de l’implication du patient en tant
qu’acteur de l’évaluation de l’innovation.
Les quatre composantes du concept de l’innovation
selon Lilly sont donc :
le Besoin non couvert : l’innovation doit améliorer les
traitements disponibles ou la prise en charge dans des
conditions où les alternatives médicales sont peu fré-
quentes ;
la Comparaison : l’innovation est évaluée par rapport aux
thérapeutiques existantes ;
la Valorisation : une innovation doit pouvoir être valori-
sée et perçue par les utilisateurs comme suffi samment
importante pour être prescrite, recommandée, utilisée
et enfi n remboursée ;
la Perspective : l’évaluation de l’innovation dépend du
point de vue et des perspectives des différents acteurs,
notamment de celle des patients.
Réfl exions sur l’innovation
et le progrès thérapeutique
L’innovation à l’origine d’un progrès médical dans la prise
en charge thérapeutique, est souvent incrémentale. Par
exemple, l’appartenance d’une molécule à une nouvelle
classe pharmacologique ne permet pas, à elle seule, de lui
octroyer le statut de molécule innovante : encore faut-il
que ce nouveau mécanisme d’action se traduise par un effet
nouveau par rapport à l’existant et surtout cliniquement
pertinent. Par ailleurs, les autorités de santé ne considèrent
le progrès thérapeutique que lorsqu’il est important : une
molécule qui n’améliore que marginalement l’état de santé
du patient, n’est pas considérée par le payeur, à ce jour,
comme vecteur d’innovation. Or, en réalité, la plupart des
progrès survenus dans les années les plus récentes, se pré-
sentent comme le résultat de la survenue successive de
petits progrès de degrés divers. En effet, chaque étape dans
le développement de la prise en charge, si minime soit elle,
conduit à une amélioration du devenir du patient.
Des progrès qui pourraient paraître limités au premier
regard, sont, en réalité, absolument nécessaires pour
accomplir une avance sensible.
•
•
•
•
4509_05_Zyl ber man. i ndd 1444509_05_Zylberman.indd 144 14/ 12/ 07 14: 42: 2814/12/07 14:42:28
> XPress 6 Noir

Rémunération du progrès thérapeutique S145
L’exemple du cancer du sein est à cet égard assez élo-
quent. En effet, cette pathologie considérée désormais
comme chronique par les oncologues a fortement bénéfi cié
de l’apport des diverses molécules qui se sont succédées
ces dernières années sur le marché. Pourtant, ces molécu-
les n’amélioraient que marginalement l’état d’une popula-
tion mais permettaient de mieux adapter le traitement à
chaque individu et surtout d’offrir une alternative une fois
qu’une première thérapeutique rencontre un échec.
Le besoin médical non couvert
Son identifi cation est importante car c’est une des portes
d’entrée par laquelle le progrès thérapeutique peut être
reconnu par les payeurs et les systèmes de prise en charge.
Partant de l’idée qu’une diminution du besoin médical
non couvert doit amener à une amélioration de la santé
voire de la productivité d’une population, le payeur ne
reconnaît souvent comme innovantes que les molécules qui
permettent de traiter une pathologie pour laquelle il
n’existe pas d’alternative thérapeutique.
Or, il est globalement reconnu que la variabilité des trai-
tements disponibles permet de mieux couvrir le besoin médi-
cal. Un traitement innovant est donc également celui qui
vient combler des champs non couverts des traitements exis-
tants tel que la résistance à un premier traitement antidé-
presseur. L’existence d’alternatives thérapeutiques permet
donc une meilleure couverture du besoin médical et consti-
tue de ce fait un progrès thérapeutique.
L’évaluation comparative
La notion d’innovation est toujours comparative notam-
ment par rapport à la situation préexistante à la mise sur le
marché d’une molécule innovante. L’innovation peut être
évaluée en termes d’amélioration du bénéfi ce, de diminu-
tion du risque ou d’élargissement de la population cible
atteinte (par exemple, les non répondeurs aux précédents
traitements).
De la valeur de l’innovation ou du progrès
thérapeutique… un cercle vertueux
Dans l’industrie pharmaceutique, l’innovation est un pro-
cessus complexe dont les effets positifs vont évidemment
s’exercer en tout premier lieu au niveau du patient lui-
même mais également au-delà de celui-ci, au sein du sys-
tème sociétal dans lequel l’entreprise fonctionne ainsi
qu’au sein même de l’entreprise.
En effet, le progrès thérapeutique, par le biais de
l’amélioration de l’état de santé de la population et de la
réduction de certains coûts antérieurement associés à la
prise en charge (par exemple réduction des coûts d’hospi-
talisation), est générateur à la fois d’une amélioration de
la productivité globale de la société, d’une optimisation de
l’utilisation des ressources voire en libérer un certain mon-
tant destiné à le rétribuer pour ces effets positifs.
Au sein des entreprises à l’origine du développement
des molécules innovantes, la valorisation de ce progrès
thérapeutique à la fois par la reconnaissance du marché
(médecins et patients) et par les payeurs, doit renforcer le
potentiel d’investissements en Recherche et Développe-
ment, constituant ainsi ce que l’on peut dénommer le cer-
cle vertueux du progrès thérapeutique (Fig. 2).
Les politiques de forte régulation économique qui limi-
tent le champ conceptuel de l’innovation et du progrès
thérapeutique peuvent, en en diminuant la rémunération,
aboutir à des pertes et des désinvestissements en termes
de recherche et développement. Ce frein à la découverte
de molécules innovantes pourrait se révéler alors particu-
lièrement préjudiciable pour la survenue du progrès théra-
peutique et à celle de ses impacts, tant auprès du patient
lui-même que pour la société dans laquelle le patient évo-
lue.
Amélioration de la prise en charge
L’innovation
Amélioration de l’état
de santé d’un patient,
de la population
Amélioration de la
productivité de la société
Une meilleure régulation
des dépenses de santé
(par exemple diminution
des coûts associés
aux effets secondaires)
Une moindre contrainte
sur les dépenses ultérieures
Succès de l’entreprise
Nouveaux
investissements
en R&D
Figure 2
4509_05_Zyl ber man. i ndd 1454509_05_Zylberman.indd 145 14/ 12/ 07 14: 42: 2914/12/07 14:42:29
> XPress 6 Noir
1
/
3
100%