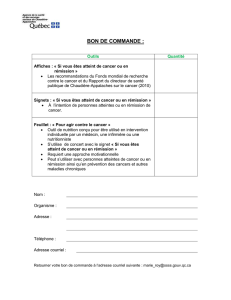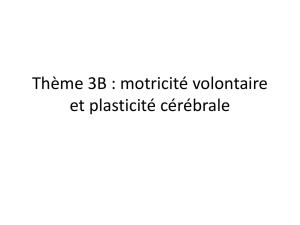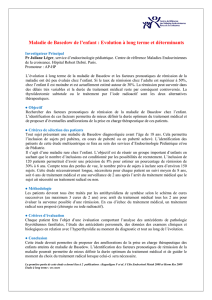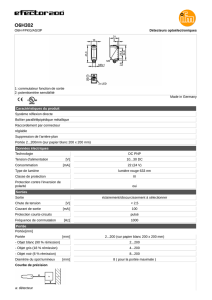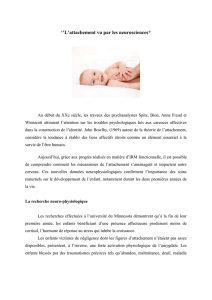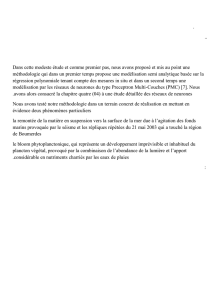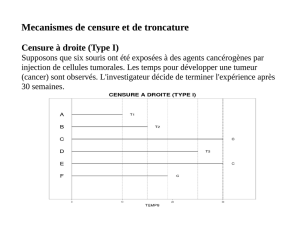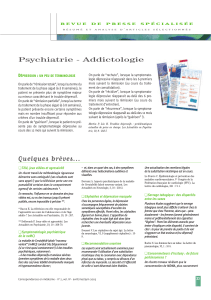Questions – réponses

S 716 L’Encéphale, 33 : 2007, Septembre, cahier 4
Questions – réponses
Que faire lorsqu’on constate qu’un patient est signi-
ficativement amélioré ?
La qualité de la rémission fait partie du pronostic,
immédiat et à long terme. Dans les objectifs d’améliora-
tion du patient, hors du registre de la prise en charge
immédiate, il faut prendre en compte, au moment de la
rémission, les réaménagements de vie, la gestion des
sources de stress, des complications, la sollicitation du
réseau social, le réaménagement autour de l’épisode
dépressif majeur, qui a des impacts parfois très impor-
tants. Par exemple, le niveau de stress ressenti abaisse
les manifestations anxieuses et donc favorise le passage
de la rémission partielle à la rémission complète. Pour
les patients ayant une réponse incomplète ou partielle,
il faut utiliser toutes les armes possibles, pour que la
rémission soit la meilleure possible, sans se contenter
d’un traitement moyennement efficace. Il ne faut pas
hésiter à augmenter les doses, à changer le traitement
si les réponses sont insuffisantes, et profiter de cette
amélioration, pour favoriser, par réadaptation neuro-
cognitive, psychosociale ou psychothérapeutique, l’évo-
lution des patients.
La remédiation sur ordinateur va se développer dans
l’arsenal thérapeutique pour les déprimés. Toutes les psy-
chothérapies sont de l’apprentissage : quel que soit le clan
théorique, elles jouent sur la plasticité, qui n’est pas seu-
lement neuronale. Il n’y a pas de thérapie efficace sans
apprentissage. Or, les apprentissages nécessitent une
bonne flexibilité cognitive, un fonctionnement neuronal de
bonne qualité. À l’hôpital, les patients déprimés acceptent
volontiers de travailler sur un ordinateur pendant une
heure avec un infirmier, et ils reviennent ensuite en
ambulatoire ; il y aura peut-être un jour un pilotage sur le
web, ce qui permettra des entraînements cognitifs répétés
régulièrement. Ceci doit se faire en parallèle au traitement
antidépresseur, les effets des thérapeutiques biologiques
et cognitives étant synergiques.
Dans le cadre de la dépression, les études qui évaluent
les effets bénéfiques des thérapies de remédiation cogni-
tive doivent reposer sur des critères solides, comme le
taux d’absence de récidives, ou la diminution du temps
passé en dépression.
À partir de quel moment commençons-nous notre
involution ? Ne sommes-nous pas tous en évolution
vers une diminution neuronale à partir de l’âge de 18
ou 20 ans ? Et l’involution est-elle cyclique ou longitu-
dinale ? Les dépressions réactionnelles ou situation-
nelles entraînent-elles aussi une atteinte neuronale ou
évoluons-nous vers une diminution longitudinale des
balances noradrénergiques, dopaminergiques, séro-
toninergiques, plutôt que vers une diminution au cours
des phases dépressives seulement ?
Nous savons que nous involuons à partir de la nais-
sance. Ce qui est nouveau, c’est qu’en dehors du fait que
notre capital neuronal global à tendance à diminuer à partir
de l’accouchement chez l’Homme (un peu plus tard pour
les autres espèces moins évoluées), nous avons la grande
particularité d’avoir la possibilité de voir apparaître de nou-
veaux neurones, essentiellement dans le gyrus dentelé et
dans une partie du tubercule olfactif : ces nouveaux neu-
rones indifférenciés, qui vont redevenir des neurones, au
sens adaptatif du terme, ont la possibilité de migrer dans
des régions relativement proches de leur lieu d’origine, du
gyrus dentelé sur l’ensemble des noyaux de l’hippo-
campe, par exemple.
Ceci est probablement au cœur des processus évolutifs
de type cellulaire. Mais même si nous perdons des neu-
rones, le fait d’augmenter nos connexions est peut-être
beaucoup plus important.
Pouvons-nous transposer le modèle de stress de
la souris caressant ses souriceaux à l’être humain, par
exemple pour les carences affectives précoces ?
Comment cette résistance au stress peut-elle être
acquise chez l’être humain, et les choses peuvent-
elles être récupérées ensuite ?
Oui, le grooming est un modèle pertinent, d’autant qu’il
répond à de nombreuses caractéristiques du modèle
d’interaction mère-enfant, notamment le fait que la sépa-
ration de la mère, quelques heures par jour, est très délé-
tère sur l’axe HPA. Le handling, le fait de faire passer le
petit souriceau de main en main, donc dans un milieu
inconnu, est un stress dont les effets perdurent, non seu-
lement immédiatement après, mais sur l’ensemble de la
vie, ainsi qu’au niveau de l’expression des récepteurs aux

L’Encéphale, 2007 ; 33 : 716-7, cahier 4 Questions – réponses
S 717
glucocorticoïdes. Chez l’Homme, beaucoup d’autres
paramètres rentrent en jeu : il s’agit donc d’un modèle sim-
plifié mais réellement intéressant dans l’interaction mère-
enfant et ses effets perdurants.
Le rôle de l’amygdale est important : ne serait-elle
pas un point de départ commun à différentes patho-
logies ?
On peut, dans une perspective dualiste, considérer que
le bon équilibre entre activité physique et mentale se situe
lorsqu’il y a une bonne homothétie du haut en bas, ou du
plus physique au plus métasymbolique. En neuroscien-
ces cognitives, on sait que l’amygdale est le gendarme
attentionnel de tout ce que nous ne connaissons pas : elle
n’a pas seulement un rôle au niveau de l’anxiété ou de
la peur, mais c’est le « mirador » des événements que
nous ne connaissons pas, qu’ils soient heureux ou délé-
tères. L’amygdale commence, lors du stress (qui est l’un
des éléments étiopathogéniques possibles des effets des
carences ou des maltraitances, puis des dépressions),
par s’hypertrophier sous l’effet d’une hyperstimulation
amygdalienne, puis elle s’épuise en s’atrophiant, comme
tous les organes ayant été trop sollicités. Ceci paraît en
miroir de travaux sur l’amour, montrant que c’est la seule
situation de la nature durant laquelle on observe une
extinction de l’amygdale, puisque cela s’accompagne
d’une hyperactivation des noyaux gris centraux et d’une
extinction de l’amygdale droite : l’amour est une hyperex-
citation de l’animal en nous, avec un abandon de la
méfiance…
Plus il y a de symptômes résiduels, plus on risque
de rechuter, et plus il y a de rechutes, plus il y a de
symptômes résiduels, nécessitant donc un acharne-
ment thérapeutique. Mais les personnes qui guéris-
sent ont deux fois et demie plus de chances de faire
un geste suicidaire que les autres. Est-ce que ce ne
sont pas ceux-là qu’il faut s’acharner à suivre malgré
tout, bien qu’ils aillent bien, qu’ils aient envie de fonc-
tionner à nouveau normalement et donc d’oublier leur
maladie ?
En fait, au décours de l’épisode, les patients en rémis-
sion complète ont très peu de risques de suicide, ceux qui
restent déprimés ont sept fois et demie plus de risque sui-
cidaire, et ceux en rémissions partielles, qui sont répon-
deurs, mais symptomatiques, ont deux fois et demie plus
de risques. Il faut donc bien, effectivement, s’acharner sur
ces sujets…
1
/
2
100%