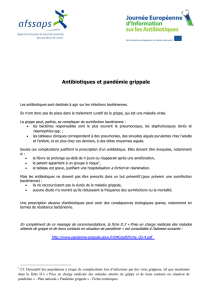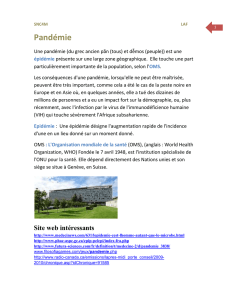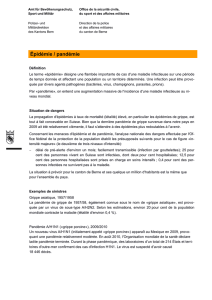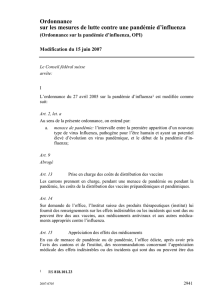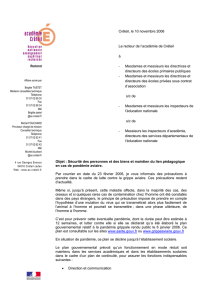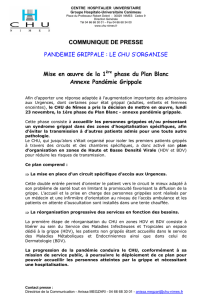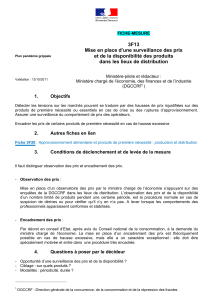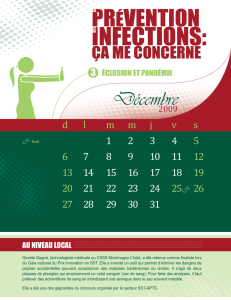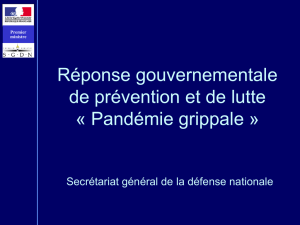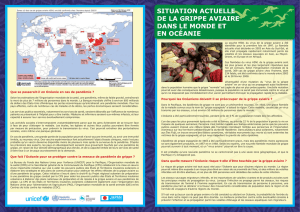Pandémie de grippe aviaire : événement imprévisible à risque faible

Sébastien Lavoie, économiste Le 23 mai 2007
Carlos Leitao, économiste en chef 514-350-3000
Sébastien Lavoie, économiste 514-350-2931
Stéphane Martial, stagiaire 514-350-2881
Martine Bérubé, assistante de recherche 514-350-3006
Pandémie de grippe aviaire : événement imprévisible
à risque faible et aux conséquences économiques importantes
pour le Canada et pour le Québec
Sommaire
• La présente note consiste en une évaluation des conséquences
potentielles d’une pandémie d’influenza sur les économies du
Canada et du Québec.
• Au moins 99,8 % de la population mondiale, canadienne et
québécoise devrait survivre à la grippe aviaire.
• En termes relatifs, l’effet néfaste de la pandémie serait plus
important pour l’économie que pour la population.
• Une grippe pandémique pourrait occasionner des perturbations
économiques dans le monde entier, surtout sur de petites
économies ouvertes comme celles du Canada et du Québec.
Mais tout comme il est difficile de prévoir la gravité d’une
pandémie, il est difficile d’en prévoir avec exactitude les
conséquences économiques.
• L’estimation de Recherche économique VMBL est que, selon sa
gravité, la pandémie pourrait gruger de deux à cinq points de
pourcentage de la croissance du PIB réel au Canada et au
Québec. Par exemple, si le pays était frappé par une pandémie
légère en 2008, le PIB réel ne progresserait que de 1 % plutôt
que de 3 %. Une pandémie grave conduirait l’économie
canadienne à une récession similaire à celle du début des
années 90. Le PIB réel diminuerait alors de 2 % plutôt que de
croître de 3 %.
• Au Québec, les effets seraient semblables à ceux que
connaîtrait le pays dans son ensemble. La production réelle du
Québec progresserait modestement de 0,5 % ou chuterait de
2,5 %, selon l’ampleur de la pandémie.
• En supposant que la grippe aviaire dure pendant toute l’année
2008, nous estimons que les économies canadienne et
québécoise reprendraient en 2009 et en 2010. En 2011,
l’activité économique serait revenue à la normale.
• L’estimation de Recherche économique VMBL doit cependant
n’être vue que comme une suggestion.
Pandémie de grippe aviaire : une
menace réelle
• Par le passé, des pandémies se sont déclarées en trois vagues
qui duraient chacune trois mois ou plus, totalisant une durée
moyenne d’environ un an. Trois pandémies ont frappé le globe
au XXe siècle. la grippe espagnole de 1918-1919, la grippe
asiatique de 1957-1958 et la grippe de Hong Kong de 1968-
1969. La grippe espagnole a été la pire de toutes.
Elle a duré environ un an, faisant de 30 000 à 50 000 victimes
au Canada et de 20 à 40 millions de victimes dans le monde.
• La grippe aviaire, ou grippe H5N1, est une maladie respiratoire
infectieuse des oiseaux causée par certaines souches du virus
de l’influenza. La souche du virus de la grippe aviaire est
apparue en Asie au milieu des années 90. La pandémie de
grippe aviaire s’est propagée chez les oiseaux dans une très
grande proportion depuis quelques années, notamment dans le
Sud-est asiatique.
• La plupart des experts et des autorités de la santé estiment
qu’une pandémie d’influenza est inévitable, même si personne
ne peut prédire le moment où elle se déclarera. Elle pourrait
avoir lieu l’an prochain, ou même seulement dans un siècle. La
question n’est pas de savoir si la prochaine pandémie de grippe
frappera, mais bien quand.
• Le virus ne peut se transmettre entre les humains aussi bien
qu’entre les oiseaux. Des humains ne peuvent être infectés que
s’ils sont directement exposés à des oiseaux malades ou morts,
par exemple à des volailles. Pour que le virus H5N1 de la grippe
aviaire occasionne une pandémie chez les humains, il faudrait
d’abord que ses caractéristiques génétiques changent pour qu’il
devienne transmissible entre humains. Le virus pourrait se
propager plus facilement dans les pays en voie de
développement, où les conditions d’hygiène et les conditions
sociales sont plus précaires que dans les pays industrialisés.
Par la suite, la pandémie se propagerait dans le reste du
monde, y compris au Canada et au Québec.
• Les premières victimes humaines de la grippe H5N1 se sont
déclarées en 1997, à Hong Kong. Au printemps de 2006, alors
que la grippe aviaire suscitait le plus vif intérêt des autorités de
la santé et des médias, on dénombrait 200 cas humains
d’infection au virus H5N1. Même si la grippe aviaire ne fait plus
la manchette en 2007, la maladie persiste et se propage. En
avril 2007, l’Organisation mondiale de la santé (OMS)
dénombrait 291 cas dans le monde, dont 172 décès, ce qui
représente un taux de mortalité élevé de 59 %.

Carlos Leitao, économiste en chef 514-350-3000
Sébastien Lavoie, économiste 514-350-2931
Stéphane Martial, stagiaire 514-350-2881
Martine Bérubé, assistante de recherche 514-350-3006
Taux de survie d’au moins 99,8 % chez
les Canadiens, malgré les décès liés à la
pandémie
Pour pouvoir évaluer les effets économiques, il est important de tenir
d’abord compte des conséquences pour la population.
• L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a averti qu’une
pandémie occasionnerait au moins de 2 à 7 millions de décès
dans le monde entier et que plus de 10 millions de personnes
auraient besoin de soins médicaux. D’après les chiffres actuels
sur la population mondiale (6,6 milliards de personnes), nous
pouvons affirmer qu’au moins 99,8 % des humains devraient
survivre. Les plus vulnérables seraient les personnes de 15 à
50 ans et les femmes enceintes.
• Santé Canada estime que de 4,5 à 10,6 millions de Canadiens
seraient déclarés cliniquement malades, c’est-à-dire qu’ils
seraient incapables de se rendre au travail. Cela représente une
proportion de 15 à 35 % de la population et ne comprend pas
les personnes qui contracteraient le virus et se sentiraient
malades, mais poursuivraient leurs activités habituelles. Santé
Canada estime également que de 2,1 à 5,0 millions de
personnes auraient besoin de soins en clinique externe, de
34 000 à 138 000 personnes auraient besoin d’être
hospitalisées et de 11 000 à 58 000 personnes mourraient au
Canada pendant une pandémie d’influenza. En comparaison,
environ 8 000 Canadiens meurent chaque année de la grippe
saisonnière. 58 000 personnes ne représentent que 0,2 % de la
population canadienne (qui s’élevait à 31 612 897 personnes au
recensement de 2006). En d’autres mots, au moins 99,8 % des
Canadiens devraient survivre.
• Comme environ 24 % de la population du Canada vit dans la
province de Québec, nous pouvons déduire que de 2 600 à
14 000 Québécois pourraient mourir pendant une pandémie
d’influenza. Le gouvernement du Québec a également défini
son propre scénario : 2,6 millions de personnes seraient
affectées sur huit semaines, soit près du tiers de la population
de la province. Sur ces 2,6 millions, 1,5 million de personnes
pourraient avoir besoin de soins médicaux, 34 000 personnes
pourraient avoir besoin d’être hospitalisées. Cette estimation se
situe environ au milieu de la fourchette de 2 600 à 14 000 que
nous avions déduite à partir des chiffres de Santé Canada.
• Recherche économique VMBL abonde dans le même sens que
Santé Canada. Par exemple, supposons que l’épidémie se
déclare en 2008 et dure toute une année. Suivant ces
hypothèses, VMBL Recherche économique estime qu’en 2008,
la population du Canada et du Québec se maintiendrait en cas
de pandémie légère et fléchirait très légèrement en cas de
pandémie grave. Par la suite, en 2009, la croissance
démographique du Canada et du Québec reprendrait sa
tendance normale, soit entre 1,0 % et 0,7 %, respectivement
(voir tableau 1 en annexe).
Effets néfastes de la pandémie plus
importants pour l’économie
En termes relatifs, les effets néfastes de la pandémie seraient plus
importants pour l’économie que pour la population. Les estimations
des conséquences économiques sont sujettes à un haut degré
d’incertitude, car elles sont fonction de la gravité et de la durée de la
pandémie, ainsi que de la réaction des ménages, des entreprises,
des gouvernements, etc. Cela dit, nous pouvons affirmer avec plus
de certitude qu’une grippe pandémique perturberait l’économie dans
le monde entier : Même si la pandémie se déclarait dans une seule
région du monde, tous les pays seraient affectés, en raison de la
mondialisation, des chaînes d’approvisionnement planétaires et du
commerce international. Par conséquent, de petites économies
ouvertes comme celles du Canada et du Québec seraient très
touchées.
Certains organismes ont tenté de quantifier les effets néfastes d’une
pandémie sur l’économie. Ces études, menées depuis quelques
années, se fondent sur différentes séries d’hypothèses et de
méthodologies. La plupart en viennent à la conclusion qu’une
pandémie de grippe freinerait considérablement la croissance du PIB
réel durant toute la période de pandémie, suivie d’une reprise rapide.
• D’après la Banque mondiale, une pandémie mondiale
d’influenza chez les êtres humains entraînerait un fléchissement
du PIB mondial de 2 % ou plus, soit l’équivalent de
800 milliards $US par an. Le Fonds monétaire international
(FMI) a déclaré que l’économie mondiale connaîtrait un impact
marqué mais de courte durée (pendant un ou deux trimestres)
en cas de pandémie grave, et qu’elle reprendrait rapidement.
• Le bureau du budget du Congrès américain (CBO) prévoit
qu’une vague d’influenza pandémique pourrait faire chuter le
PIB réel de 5 % au pire et, au mieux, elle ne créerait qu’une ride
à la surface de l’économie (recul de 1,5 % de la croissance du
PIB réel). Pour fins de comparaison, les récessions typiques
que nous avons connues depuis la Seconde Guerre mondiale
ont réduit la croissance du PIB réel américain de 4,7 %. Le CBO
prévoit que l’économie américaine se remettrait de la pandémie,
tout comme elle s’est remise des autres désastres naturels et
des autres difficultés. Le CBO affirme également que les
secteurs des loisirs, des arts et de l’hébergement seraient les
plus touchés par la pandémie.
• Le ministère fédéral des Finances du Canada, pour sa part,
semble plus optimiste que tout autre organisme. Il prévoit que si
une pandémie de grippe se propage au Canada, cela pourrait
retrancher 14 milliards $ de l’économie du pays et que la
croissance du PIB diminuerait de 1,2 point de pourcentage.

Carlos Leitao, économiste en chef 514-350-3000
Sébastien Lavoie, économiste 514-350-2931
Stéphane Martial, stagiaire 514-350-2881
Martine Bérubé, assistante de recherche 514-350-3006
« Mécanisme de transmission » de la
pandémie à l’économie »
Les estimations qui suivent révèlent de combien l’économie serait
frappée. Il est cependant important de comprendre comment la
pandémie de grippe se transmettrait à l’économie.
• Premièrement, les pertes de main-d’œuvre seraient énormes en
raison des décès et des personnes cliniquement malades. Le
taux d’emploi, le nombre d’heures travaillées et le revenu
disponible chuteraient de façon importante. Le ministère fédéral
des Finances estime que les employeurs devraient prévoir un
taux d’absentéisme total de 20 % à 25 % pendant la période
pandémique de pointe, ce qui est bien supérieur au taux total
moyen d’absentéisme pendant un hiver normal (8 %).
• Les dépenses de consommation chuteraient. Premièrement,
elles s’effondreraient parce que les gens s’éviteraient, craignant
les contacts directs. De plus, la baisse des revenus d’emploi
entraînerait une baisse des dépenses. Par conséquent, la
demande de prêts bancaires aux particuliers chuterait. Dans
l’ensemble, la richesse des ménages diminuerait sûrement.
• Du côté des entreprises, celles-ci connaîtraient un important
recul de la demande et de la rentabilité, des problèmes
logistiques, des perturbations de la chaîne d’approvisionnement,
de l’absentéisme, etc. La gestion des activités quotidiennes, de
la production et des stocks deviendrait une tâche difficile. Il est
donc probable que le nombre de faillites et de défauts de
paiement augmenterait alors. Les banques à charte
répondraient probablement en resserrant les conditions de
crédit aux entreprises et aux consommateurs.
• L’effet de la grippe aviaire ne serait pas ressenti de façon
identique par tous les secteurs. Évidemment, les secteurs de la
transformation des aliments et de l’agriculture (surtout l’élevage
des volailles) seraient touchés. Les exportateurs seraient
durement frappés par la baisse de l’activité commerciale et par
les restrictions en matière de transport. Les activités liées au
tourisme comme l’hébergement et la restauration plongeraient,
de concert avec un recul massif du secteur des voyages.
L’industrie des assurances sera touchée par la pandémie dans
une mesure similaire à celle des événements du 11 septembre
ou d’importants désastres naturels. Les transports publics, de
même que les activités de loisir et de divertissement pourraient
être relativement déserts. Le commerce de détail serait touché,
car les consommateurs préféreraient rester à la maison.
Cependant, aussi absurde que cela puisse paraître, une
pandémie pourrait être une situation gagnante pour certains
secteurs. Les soins de santé privés, les services médicaux,
ainsi que certaines sociétés pharmaceutiques et technologiques
pourraient connaître un élan d’activité et de rentabilité.
• Sur le plan budgétaire, les gouvernements seraient contraints
d’accroître leurs dépenses, fournissant des soins de santé et de
l’assistance financière aux particuliers et aux entreprises. Les
revenus fiscaux risqueraient de chuter, par suite de
l’affaiblissement de l’activité économique. En fin de compte,
certaines provinces pourraient avoir de la difficulté à boucler
leur budget (déficit zéro) durant la pandémie de H5N1, ce qui
accroîtrait leur dette et leurs besoins de financement.
• Les marchés financiers, pour leur part, devraient entrer dans
une période baissière. Les investisseurs pourraient manifester
de l’aversion pour le risque. Les actions et les obligations de
sociétés perdraient du terrain. De plus, une pandémie pourrait
déclencher une poussée de la demande des titres à faible
risque, comme l’argent en espèce et les valeurs tangibles
comme l’or. Le dollar américain bénéficierait probablement de
son statut de monnaie-refuge. Le marché obligataire connaîtrait
une forte hausse, car les banques centrales du monde entier,
dont la Banque du Canada, assoupliraient leur politique
monétaire. Les banques centrales baisseraient probablement
leurs taux d’intérêt à de très faibles niveaux, même si nous
estimons que l’effet sur l’économie serait mitigé au coeur de la
pandémie. Le FMI indique également que les banques centrales
devraient prévoir un approvisionnement adéquat de billets de
banque et leur livraison aux institutions financières en temps
utile pour veiller à ce que les banques à charte puissent
répondre à une augmentation soudaine de la demande de
liquidité. On peut s’attendre à une baisse des prix des matières
premières, ce qui refléterait un affaiblissement de la demande
globale, entraînant une dépréciation du dollar canadien.
Cependant, d’éventuelles perturbations d’approvisionnement de
produits de base comme le pétrole brut pourraient venir brouiller
les cartes.
Une pandémie retrancherait de 2 à
5 points de pourcentage de la
croissance du PIB réel au Canada et au
Québec
Recherche Économique VMBL estime qu’une pandémie modérée de
grippe aviaire réduirait la croissance du PIB réel du Canada de
2 points de pourcentage, tandis qu’une pandémie grave la ferait
fléchir de 5 points de pourcentage. Dans l’éventualité la plus
probable qu’aucune pandémie ne se déclare à court terme, nous
prévoyons que l’économie canadienne connaîtra une expansion
d’environ 3,0 % en 2008, 2009, 2010 et 2011 (voir tableau 2 en
annexe ou figure 1 ci-dessous). Par exemple, supposons maintenant
que la pandémie se déclare en 2008 et dure toute une année.
Suivant le scénario d’une pandémie légère, la perte annuelle de
2 points de pourcentage ferait alors descendre la croissance du PIB
réel à un faible 1,0 %. En cas de pandémie grave, cela mènerait
l’économie canadienne à une récession. En effet, la croissance du
PIB réel fléchirait de 2,0 % (voir figure 1).

Carlos Leitao, économiste en chef 514-350-3000
Sébastien Lavoie, économiste 514-350-2931
Stéphane Martial, stagiaire 514-350-2881
Martine Bérubé, assistante de recherche 514-350-3006
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Pas de pandémie
Pandémie modérée en 2008
Pandémie sévère en 2008
Graphique 1: PIB réel -- Canada
Source: Recherche Économique VMBL, Statistique Canada
(chang. annuel en % )
-2.9
-2.1
-2.0
1.6
1.8
1.0
-4 -3 -2 -1 0 1 2
récession 1982
récession 1991
pandémie sévère en 2008
ralentissement 1996
ralentissement 2001
pandémie modérée en 2008
Graphique 2: PIB réel au Canada lors de périodes
sélectionnées
Source: Recherche Économique VMBL, Statistique Canada
(chang. annuel en % )
Bref, la contraction du PIB réel en cas de pandémie grave (-2,0 %)
rappellerait la récession du début des années 90, mais serait moins
forte que la récession du début des années 80 (voir figure 2). Suivant
un scénario d’une pandémie légère, la croissance du PIB réel serait
à peine plus faible qu’au cours du ralentissement économique de
1996 et de 2001 (voir figure 2). Cela dit, tant une pandémie légère
qu’une pandémie grave auraient des conséquences plus
douloureuses et plus persistantes sur l’économie canadienne que les
événements du 11 septembre 2001, la crise du SRAS de 2003 et la
saison des ouragans de 2005.
En 2009 et en 2010, les deux années qui suivraient la pandémie,
nous sommes convaincus que l’économie canadienne reprendrait
rapidement de la vigueur. Si une pandémie légère survenait en 2008,
la croissance du PIB réel remonterait à environ 4,0 % en 2009 et à
3,3 % en 2010, avant de revenir à 3,0 % en 2011. Si une pandémie
grave survenait en 2008, le rétablissement en 2009 serait encore
plus solide, à environ 4,5 %. En 2011, l’activité économique serait
revenue à la normale (voir figure 1).
Au Québec, effets semblables à ceux du
pays dans son ensemble
Au Québec, les conséquences néfastes d’une pandémie de grippe
seraient similaires aux effets que connaîtrait l’ensemble du Canada,
compte tenu des similitudes de leur structure économique respective.
Si la pandémie ne se déclarait pas, la croissance du PIB réel au
Québec serait d’environ 2,5 % en 2008, 2009, 2010 et 2011 (voir
tableau 2 en annexe ou figure 3 ci-dessous). Par conséquent,
suivant le scénario d’une pandémie légère, le PIB réel du Québec
progresserait modestement de 0,5 %. En supposant une grave
propagation de la maladie, le PIB réel du Québec chuterait de 2,5 %.
En 2009 et en 2010, nous estimons que l’économie du Québec
connaîtrait une reprise rapide, avant de revenir à 2,5 % en 2011 (voir
figures 3 et 4).
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Pas d'épidémie
Épidémie modérée en 2008
Épidémie sévère en 2008
Graphique 3: PIB réel -- Québec
Source: Recherche Économique VMBL, Statistique Canada
(chang. annuel en % )
-3.6
-2.7
-2.5
1.0
1.5
0.5
-4 -3 -2 -1 0 1 2
récession 1982
récession 1991
pandémie sévère en 2008
ralentissement 1996
ralentissement 2001
pandémie modérée en 2008
Graphique 4: PIB réel au Québec lors de périodes
sélectionnées
Source: Recherche Économique VMBL, Statistique Canada
(chang. annuel en % )

Carlos Leitao, économiste en chef 514-350-3000
Sébastien Lavoie, économiste 514-350-2931
Stéphane Martial, stagiaire 514-350-2881
Martine Bérubé, assistante de recherche 514-350-3006
Une estimation suggérée
Il est important de mentionner que notre évaluation des
conséquences économiques d’une pandémie de grippe aviaire ne
constitue qu’une suggestion. Il est impossible de prévoir avec
exactitude les effets réels d’une pandémie. Il serait cependant
possible d’élaborer une série plus exhaustive de prévisions au
moment de la pandémie, car nous disposerions alors de plus
d’information.
Annexe
Canada 2006 2007 2008 2009
Scénario de base 31,613 31,929 32,248 32,571
PIB réel % 1.0 1.0 1.0 1.0
Pandémie modérée 31,613 31,929 32,237 32,560
PIB réel % 1.0 1.0 0.97 1.0
Pandémie sévère 31,613 31,929 32,190 32,512
PIB réel % 1.0 1.0 0.82 1.0
Quebec 2006 2007 2008 2009
Base-case scenario 7,546 7,599 7,652 7,706
PIB réel % 0.7 0.7 0.7 0.7
Pandémie modérée 7,546 7,599 7,642 7,695
PIB réel % 0.7 0.7 0.57 0.7
Pandémie sévère 7,546 7,599 7,631 7,684
PIB réel % 0.7 0.7 0.42 0.7
* hypothèse: grippe aviaire en 2008 pour une période de 1 an
Source: Recherche Économique VMBL, Santé Canada, Statistique Canada
Table 1 : Impact d'une épidémie de la grippe
aviaire sur la
p
o
p
ulation
(en milliers)
Canada 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Scénario de base 1,190 1,218 1,255 1,292 1,331 1,371
PIB réel % 2.7 2.4 3.0 3.0 3.0 3.0
Pandémie modérée 1,190 1,218 1,230 1,279 1,322 1,318
PIB réel % 2.7 2.4 1.0 4.0 3.3 3.0
Pandémie sévère 1,190 1,218 1,194 1,253 1,297 1,336
PIB réel % 2.7 2.4 -2.0 5.0 3.5 3.0
Quebec 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Scénario de base 242.0 242.0 248.1 254.3 260.6 267.2
PIB réel % 1.7 1.5 2.5 2.5 2.5 2.5
Pandémie modérée 242.0 242.0 243.2 251.8 258.8 267.9
PIB réel % 1.7 1.5 0.5 3.5 2.8 3.5
Pandémie sévère 242.0 242.0 236.0 246.6 254.7 263.6
PIB réel % 1.7 1.5 -2.5 4.5 3.3 3.5
* hypothèse: grippe aviaire en 2008 pour une période de 1 an
Source: Recherche Économique VMBL, Santé Canada, Statistique Canada
(en milliards de dollars)
Tableau 2: Impact d'une épidémie de la grippe
aviaire sur le PIB réel
Sources
A Potential Influenza Pandemic: Possible Macroeconomic Effects
and Policy Issues, Congressional Budget Office (CBO), décembre
2005.
The Global Economic and Financial Impact of an Avian Flu
Pandemic and the Role of the IMF, Fonds monétaire international,
février 2006.
The Economic Impact of An Influenza Pandemic, ministère des
Finances du Canada, Division de l’analyse et des prévisions
économiques, février 2006.
Santé Canada http://www.hc-sc.gc.ca/
Agence de santé publique du Canada http://www.phac-aspc.gc.ca/
Gouvernement du Québec http://www.pandemiequebec.ca
1
/
5
100%