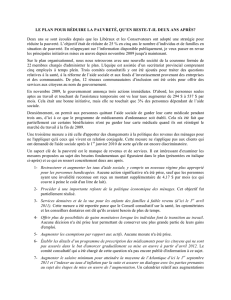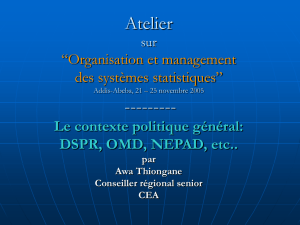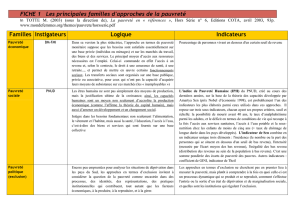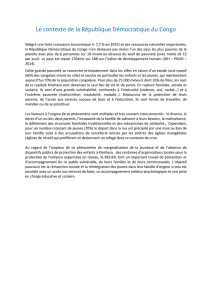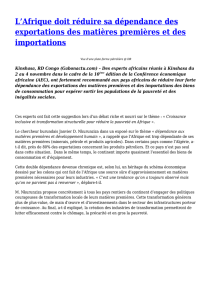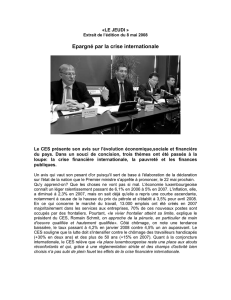Kassé Pr. Moustapha Introduction

1
VERS UN NOUVEAU CONTRAT MONDIAL POUR LE
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL DE
L’AFRIQUE.
Par
Pr. Moustapha Kassé
Introduction
Au début des années 60, beaucoup de pays africains avaient une situation économique
et financière quasi-similaire à celle des Nouveaux Pays Industrialisés (NPI). Aujourd‟hui, les
conditions se sont inversées : l‟Asie s‟est industrialisée et a refait son retard alors que
l‟Afrique s‟enfonce dans le sous-développement. Les greniers sont vides en Afrique et pleins
en Asie. Pourquoi certains pays se développent-ils et d‟autres pas ? Comment interpréter le
rattrapage économique des NPI ? Comment expliquer le développement d‟un pays ? Quels
sont les points de passage obligés ? Toute réflexion sur le développement en Afrique doit
commencer par ces interrogations qui imposent l‟identification des conditions économiques,
sociales et politiques favorables au développement.1
Dans la première décennie des indépendances africaines, les stratégies de
développement appliquées visaient notamment à transformer profondément le système
productif et l‟appareil administratif. Elles avaient alors conduit à la mise en place, au plan de
l‟équipement et de l‟infrastructure sociale, de politiques coûteuses d‟investissement qui se
sont révélées, par la suite, massives, peu réalistes et d‟une faible efficacité. Dans le même
temps, la grave rupture survenue entre les structures de production – alimentaires en
l‟occurrence – et les structures de consommation, a fondamentalement contribué à opérer une
double extraversion : celle de la production et celle de la consommation. Il en est résulté un
approfondissement du déséquilibre entre la production intérieure et la demande globale au
sein de laquelle prédominait une consommation finale excessive et, conséquemment, un
accroissement du déficit en ressources. Celui-ci sera artificiellement entretenu et financé par
l‟aide publique et l‟endettement extérieur. En effet, les excédents des pétro-dollars avaient
favorisé des emprunts publics à des taux relativement faibles. A la faveur de l'augmentation
de la dette publique des Etats dans les années 1980, les marchés financiers sont arrivés aux
commandes. Cela s'est traduit par une augmentation des taux d'intérêt dont le niveau a
dépassé non seulement l'inflation, mais aussi la croissance.
1 Depuis le Japon, il y a un siècle, à la Chine aujourd‟hui, le modèle adopté a été peu ou prou le même : un développement
tiré par les exportations dans un premier temps de produits à fort contenu en main d‟œuvre (textile, petites industries)
montant en gamme peu à peu vers des produits plus sophistiqués et bifurquant, à un moment vers l‟industrie lourde, un
marché intérieur protégé, souvent complètement opaque ; un capitalisme certes libéral et parfois sauvage, mais souvent
fortement protégé autour de conglomérats bénéficiant de la protection des Etats, une main-d‟œuvre disponible faisant preuve
d‟un niveau d‟épargne élevé ; enfin des régimes politiques rarement démocratiques et très souvent corrompus sans que ce
dernier point ne nuise à l‟efficacité économique contrairement à l‟Afrique…Tout ceci ne correspondait guère aux canons
économiques ni des marxistes, ni des libéraux » (Bulletin Economique de la SFAC n°1O16 , dec. 1997) »

2
Les Etats qui avaient un fort niveau d'endettement sans être producteurs de pétrole ont
eu de plus en plus de mal à équilibrer leurs exercices budgétaires. Il a fallu emprunter pour
rembourser les emprunts passés, à des taux qui promettaient d'engendrer de nouvelles
difficultés. Faute de remèdes radicaux, cette situation vouait irrémédiablement les pays à la
faillite. Il s‟y ajoutait dans plusieurs cas, une énorme distorsion entre l‟affectation théorique et
l‟utilisation effective de la dette extérieure, qui n‟a pas favorisé la création de conditions
adéquates de formation et de mobilisation de surplus indispensables à l‟amortissement
régulier du service de la dette (principal et intérêts échus). Cette situation risquait de
constituer assurément le fondement d‟une crise de paiements dont la perpétuation, si rien
n‟était entrepris, pouvait déboucher sur une crise sérieuse de solvabilité. La cessation de
paiements se traduirait alors par un retrait des financements extérieurs et un effondrement des
importations qui aurait des incidences sur la production par le biais des nombreux secteurs qui
recourent à des biens d'équipement importés. Ces difficultés sont propres à la majorité des
Etats qui avaient financé leur croissance par l'endettement. Elles ont naturellement été plus
aiguës au Sud, mais les problèmes n'ont pas épargné le Nord, où l'Etat Providence a subi de
nombreuses attaques, tandis que les politiques d'offre se sont partout substituées à la
régulation par la demande.
Cette montée des déséquilibres, de l‟endettement et de la stagnation de la production a
rendu inéluctables les politiques de stabilisation et d'ajustement structurel. Aussi a-t-elle fait
durement ressentir ses conséquences, du fait de la compression drastique des dépenses en vue
d‟une réduction des créances futures. Le choix, à l'époque, n'était pas entre le refus d'une telle
politique et son acceptation passive, mais entre la possibilité d'entrevoir, au prix de sacrifices,
un avenir meilleur, et la certitude de s'enfoncer dans la voie du déclin. Cette politique qui
consiste à affamer pour développer n‟est pas nouvelle.
La conjugaison de toutes ces situations a conduit progressivement tous les Etats
africains à adopter des programmes de stabilisation et d‟ajustement et les mécanismes de
gestion qui les accompagnent avec l‟appui de la Banque mondiale et du FMI, au détriment des
stratégies planifiées de développement. A une politique volontariste orientée vers la
modernisation des bases du développement a ainsi succédé un ensemble de programmes de
gestion des déséquilibres macroéconomiques et à court terme.
Toutefois, les stratégies de développement telles qu‟elles se sont déployées durant un
quart de siècle, ont conduit à l‟impasse au double point de vue des perspectives de
développement national et de celui d‟une insertion qualitative dans l‟ordre mondial. Les
problèmes des nations comme ceux des individus se sont multipliés et compliqués.
Paradoxalement, l‟abondance n‟a pas apporté aux populations, l‟amélioration du niveau ou de
la qualité de la vie. Elle a plutôt pollué l‟environnement, gaspillé de gigantesques ressources,
engendré la peur et le doute relativement aux relations intergénérationnelles.
L‟incapacité à maîtriser les turbulences des systèmes économiques et financiers, à
gérer les risques et les incertitudes et à gouverner l‟ordre mondial sont des manifestations
évidentes qui rendent indispensables et urgents des changements fondamentaux dans toutes
les sphères des économies. L‟Afrique est confrontée à l'aggravation de ses déséquilibres
financiers, à la stagnation, voire au recul de ses systèmes de production mais encore à la
pauvreté grandissante (avec un approfondissement du couple chômage et pauvreté). Les
populations sont de plus en plus insatisfaites et impatientes et les jeunesses sont frustrées par
leur impuissance face aux nécessités les plus élémentaires de la vie : nourriture, éducation,
soins médicaux, logement, eau potable. Or, il est bien connu qu‟un monde qui désespère est
un monde qui va exploser.

3
Tous ces paramètres indiquent la crise profonde du développement caractérisée par
plusieurs manifestations qui en expriment la profondeur et la gravité2. La première est
l‟existence et la perpétuation d‟un sévère dysfonctionnement agro-alimentaire découlant des
politiques agricoles inadéquates et faisant du continent une zone d‟insécurité alimentaire
endémique. L‟Afrique a remplacé l‟Asie et l‟Amérique Latine dans le recours à l‟aide
alimentaire internationale. Cette évolution procède de trois facteurs maintenant bien connus :
des politiques agraires inadéquates privilégiant les cultures de rente (pourvoyeuses de
devises) au détriment des cultures vivrières ; la faible croissance de la production agricole
(1,3% en moyenne par an depuis 1960) insuffisante pour couvrir le croît démographique
(entre 3 et 4%) et l‟extraversion de la structure de consommation fondée sur des biens de
consommation importés. Nulle part en Afrique, la révolution verte, même dans ses formes
chaotiques et parcellaires ne s‟est réalisée. Ce qui dénote l‟absence d‟une amélioration
substantielle et continue de la productivité par actif rural et par hectare cultivé. Les zones
rurales abritent le pourcentage le plus élevé de pauvreté : entre 50 et 70% de la population.
Ce phénomène est lié à des causes interdépendantes dont on peut énoncer une liste non
exhaustive : mauvaises politiques agricoles, absence ou faiblesse du revenu monétaire, baisse
de l‟autoconsommation, difficultés d‟accès au crédit et à la terre, faiblesse de la couverture
des services sociaux de base, lourdeur du travail des femmes, faiblesse du niveau
d‟instruction, etc. Le revenu moyen rural est entre 3,5 et 20 fois inférieur à celui du milieu
urbain. Cette forte inégalité entrave toute accumulation qui permettrait d‟asseoir des
entreprises génératrices d‟excédents agricoles et de revenus. Paradoxalement, le monde rural
est l‟objet de divers prélèvements qui ne laissent aux paysans aucune base autonome
d‟accumulation.
La deuxième manifestation est l‟échec de l‟industrialisation d‟import-substitution ou
de valorisation des matières premières d‟origine agricole ou minière. Le secteur industriel des
décennies 1960 et 1970 devait occuper une place centrale dans le modèle d‟accumulation :
assurer la transformation des productions agricoles et minières, fournir aux agriculteurs les
intrants qui améliorent la productivité du travail, employer la main-d‟œuvre excédentaire,
procurer des devises. L‟incohérence des politiques industrielles avec le démantèlement des
protections, l‟absence d‟incitation et d‟un système financier adéquat, le désengagement de
l‟Etat a abouti à la liquidation de toute velléité d‟industrialisation.
La troisième manifestation est l‟urbanisation accélérée et chaotique. En 1960, 1 africain
sur 10 vit en ville, aujourd‟hui le rapport est 4/10 et en 2015 il sera de 6/10. Cette urbanisation
est la conséquence de l‟échec des politiques agricoles. C‟est dire qu‟elle n‟est ni l‟expression
d‟une croissance économique ni celle d‟un processus de modernisation. Dans les villes, vont
se concentrer les pauvres qui n‟ont que de faibles accès aux services de base. Les manques,
les frustrations, le chômage, les différentes exclusions, les formes nouvelles de ségrégation,
les inégalités entre les citadins des quartiers résidentiels et ceux des bidonvilles surchargés
font des villes des volcans en ébullition, des zones de tempête qui peuvent exploser à la
moindre étincelle.
La quatrième manifestation est l‟endettement massif qui hypothèque tout financement
du développement. Les ressources empruntées n‟ont pas toujours servi à des investissements
productifs mais plutôt, soit à financer des surconsommations urbaines ou des équipements
publics sans réelle utilité, soit à alimenter la corruption. Une part non négligeable des recettes
2 Moustapha Kassé(1992) :Démocratie et développement, Edit CREA-NEAS.

4
d‟exportations des pays endettés est transférée tous les ans vers les créanciers Nord. Ces
prélèvements sur les ressources pèsent lourdement sur la capacité à investir et sur les niveaux
de vie. Par ailleurs, cet endettement excessif a pour conséquence de créer un climat
d‟incertitude qui encourage les sorties de capitaux et décourage les arrivées d‟investissements
directs étrangers ou le retour des capitaux enfuis. Enfin, l‟endettement pose un problème
d‟équité et de justice, car ceux qui remboursent (les populations rurales et urbaines) ne sont
pas les principaux bénéficiaires des projets financés par la dette. Non seulement les diverses
remises de dette opérées au titre des différents programmes d‟allégement sont restées
modestes mais leur impact sur les pays bénéficiaires est limité.3
Cette crise africaine est-elle celle du régime d‟accumulation fondé sur la valorisation de
la rente agricole et minière ou celle des institutions de régulation libérale, conséquemment à la
généralisation des programmes d‟ajustement structurel issus du « consensus de
Washington »4? Dans tous les cas, les études prévisionnelles ou prospectives sur l‟évolution
du monde au-delà de l‟an 2025 sont formelles : l‟Afrique restera toujours à cette échéance, à
la périphérie d‟une mondialisation déferlante, c‟est-à-dire, classée dans la catégorie des pays
les moins avancés avec une condition sociale désastreuse. Evidemment, ces prévisions sont
loin d‟être des prophéties ou encore des fatalités ; en conséquence, que doit faire le continent
pour modifier cette trajectoire ? Cela suppose une évaluation sans complaisance des politiques
économiques passées. Nonobstant le fait qu'elles étaient incontournables, pourquoi n‟ont-
elles pas réussi à assainir les systèmes économiques menacés de faillite ? Ont-elles crée un
environnement favorable au développement de l‟offre productive, au sein d‟une économie
ouverte ? Pourquoi n‟ont-elles pas déclenché un processus durable de croissance permettant la
conquête de marges de manœuvre propices à la lutte efficiente contre la pauvreté ? Pourquoi
n‟ont-elle pas réconcilié justice sociale et efficacité économique ? Les réponses à ces
questions devraient faciliter la découverte d‟autres modèles et stratégies de développement
plus appropriés que ceux qui ont eu cours jusqu‟à maintenant.
Les chercheurs comme les partenaires au développement s‟interrogent pour savoir
s‟il est possible de sortir le continent africain de ce scénario tendanciel de stagnation, voire
de régression et amorcer un processus de développement durable qui satisfasse les besoins de
la génération actuelle, sans priver les générations futures de la possibilité de résoudre leurs
propres besoins. Cette question est aujourd‟hui au cœur des préoccupations des dirigeants
africains qui l‟ont manifesté à travers leur dernière initiative économique : le NEPAD. Mêmes
préoccupations pour les institutions financières internationales comme la Banque mondiale, le
FMI et le PNUD qui ont multiplié les Programmes comme les Documents Stratégiques de
Réduction de la Pauvreté (DSRP), les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD)
et «l‟affranchissement de la pauvreté par le travail ». Il existe des engagements émanant des
différentes composantes du système des Nations-Unies comme la FAO, l‟UNICEF,
l‟UNESCO, ainsi que des ONG. Partout, la lutte contre la pauvreté est érigée au rang de
priorité de la communauté internationale. Plusieurs conférences internationales qui ont réuni
la quasi-totalité des Chefs d‟Etat du Monde ont pris l‟engagement d‟aider au développement
de l‟Afrique : Sommet de la Terre à Rio (1992), Sommet pour le Développement social de
Copenhague (1995), la Quatrième Conférence Mondiale sur la Femme (Pékin 1995), le
sommet de la Terre de Johannesburg (2002). Les nouveaux schémas de développement sont-
ils vraiment pertinents? Ces engagements vertueux seront-ils jamais tenus alors même que
3 Moustapha Kassé : L‟Afrique endettée, Edit Nouvelles du Sud, voir aussi « L‟initiative PPTE et après »,
Marchés Tropicaux n° 3000 mars 2003
4 Hakim Ben Hammouda (1999): L‟économie politique du post-ajustement, Edit. Karthala,393p.

5
les ressources nécessaires pour les réaliser sont dérisoires5? Les nouveaux Programmes mis en
œuvre verront-ils jamais un début d‟exécution ou resteront-ils de simples vœux pieux?
La recherche économique s‟intéresse à toutes ces questions et les auteurs redécouvrent
le vieux débat sur le développement économique et la croissance avec la crise permanente des
économies africaines et ce, malgré les efforts sans précédent des bailleurs de fonds
internationaux pour instaurer un processus de croissance et d‟éradication de la pauvreté6. La
communauté des économistes académiques comme celle des institutions internationales
s‟aperçoit qu‟elle a très peu réfléchi sur les modèles et stratégies de développement. Dans ce
contexte, que disent et que font les économistes africains face à toutes ces questions ? A quoi
servent toutes leurs théories, leurs recherches et leurs modèles ? Les rendent-ils capables de
transformer pareille situation par la force des idées ? La question revêt une grande
importance avec les multiples contestations de l‟épure des PAS, suite à ses résultats mitigés :
faible croissance, fort endettement et pauvreté de masse. Cela impose aujourd‟hui un nouveau
questionnement sur les stratégies du développement qui, tenant compte des enseignements du
« miracle » des pays d‟Asie, devraient déboucher sur de nouvelles formulations du
développement africain.
Ce texte n‟a pas l‟ambition d‟apporter des solutions idéales dont la valeur marginale
serait faible. Elle est plutôt une contribution au débat sur le développement et la croissance à
la lumière des nouveaux engagements (des africains et de leurs partenaires internationaux)
d‟inscrire au cœur des priorités l‟éradication de la pauvreté, le développement humain,
l‟avènement de systèmes de gouvernements meilleurs et la protection de l‟environnement. Un
contrat mondial sur le développement économique et social de l‟Afrique est-il possible ?
I-Crise du développement économique et social de
l’Afrique: faux problèmes et vrais défis.
Le cadre intellectuel qui a influencé les différentes approches des processus de
développement économique du dernier quart de siècle gravitait autour de la croissance
économique considérée comme voie unique de sortie du sous-développement. Les pays qui
s‟engageaient dans ce processus devaient réaliser une croissance à la fois accélérée, au taux
le plus élevé possible et durable. De plus, il était souhaité que cette croissance soit
harmonieuse, équilibrée et débarrassée de toute fluctuation trop forte en baisse comme en
hausse. L‟adaptation de ce modèle de croissance aux pays africains allait inclure d‟autres
facteurs : la quantité et la qualité de l‟aide étrangère publique ou privée, les investissements
directs étrangers (IDE) destinés à compléter le capital local insuffisant et les transferts de
technologie. Les faibles efforts de mobilisation interne des ressources rendaient les
5 Pour le PNUD, l‟aide nécessaire pour financer les volets essentiels du développement durable est environ de
50 milliards de dollars, c‟est insignifiant relativement aux sommes engagées pour la guerre en Iraq et
reconstruire ce qui a été détruit soit 400 milliards de dollars. Un autre argument concerne les dépenses militaires
dans le monde qui s‟élèvent a quelques 780 milliards soit plus 15 fois les besoins en ressources des PVD.
6 La conférence organisée par l‟Université de Zagreb et la Banque mondiale sur « L‟avenir de l‟économie du
développement » est sur ce point assez édifiante. Le compte rendu est réalisé dans l‟ouvrage intitulé « Aux
frontières de l‟économie du développement » édité par G.Meier et J.Stiglitz, Edit. BM- ESKA, paris 2002, 470p
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
1
/
58
100%