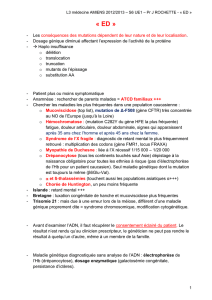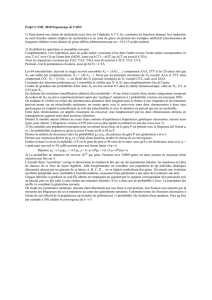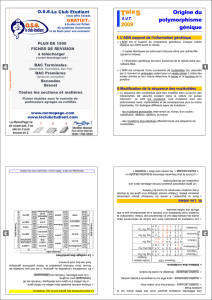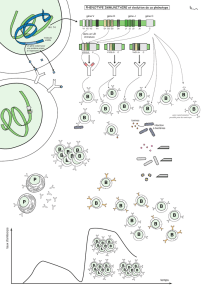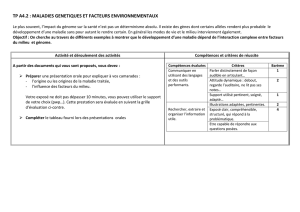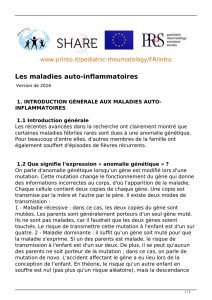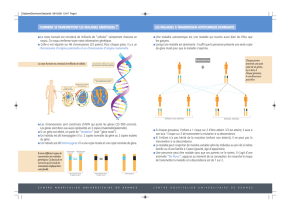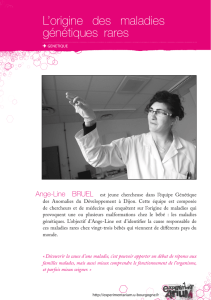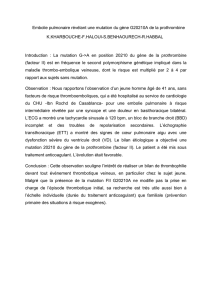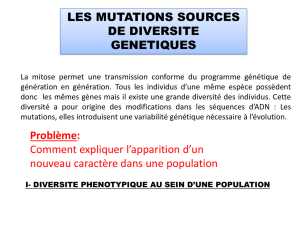R e v u e d e ... Acides gras oméga 3 et risque cardiovasculaire

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XVII - n° 9 - novembre 2013
274274
Revue de presse
Coordination : Estelle Louiset (Rouen)
Acides gras oméga 3
et risque cardiovasculaire
L’irisine, l’hormone
de l’exercice,
augmente avec l’obésité
L’athérosclérose,
une maladie ancienne ?
Les mutations
somatiques infl uencent-
elles la sécrétion
d’aldostérone dans les
adénomes de Conn ?
Mutation du gène
MKRN3 incriminée dans
la puberté précoce
Acides gras oméga3
et risque cardiovasculaire
L’étude GISSI (2009) avait concerné des patients ayant eu
un infarctus du myocarde. Il s’agit ici de la même équipe
italienne qui, avec la même méthodologie – 860 géné-
ralistes sur tout le territoire italien et 1 g d’acides gras
oméga 3 à longue chaîne EPA-DHA sous forme d’esters
éthyliques – a souhaité vérifi er si les AGPIω3 LC avaient
également un bénéfi ce chez des sujets n’ayant pas fait
d’infarctus. L'étude a porté sur 12 513 patients, randomi-
sés en 2 groupes, l’un recevant 1 g d’oméga 3 LC, l'autre
1 g d’huile d’olive (placebo). Rappelons que dans l’étude
GISSI il n’y avait pas de double aveugle car le groupe
ne recevant pas d’oméga 3 ne recevait rien, soit pas de
placebo ! Au bout de 1 an, en raison d’un faible taux
d’événements − plus bas que prévu −, l’objectif primaire
a été revu. Initialement, il s’agissait du taux cumulatif
de décès, d’infarctus du myocarde et d’accidents vascu-
laires cérébraux non fatals, le nouvel objectif primaire
est devenu le délai pour le décès cardiovasculaire ou
l’admission à l’hôpital pour raison cardiovasculaire. La
durée du suivi a été de 5 ans. L’analyse a été faite en
intention de traiter sauf pour une analyse per protocole
de l’objectif primaire chez les patients qui n'ont pas
interrompu leur traitement, sans violation majeure de
protocole. Tout cela altère un peu la qualité méthodolo-
gique de l’étude. Les patients étaient des sujets à haut
risque cardio vasculaire : 47,9 % d'entre eux avaient un
diabète avec 1 ou plusieurs facteurs de risque cardio-
vasculaire ; 29,5 % avaient des antécédents d’athéros-
clérose et 20,8 % avaient au moins 4 facteurs de risque
cardiovasculaire. À la fi n de l’étude, le profi l de risque
cardiovasculaire s’était amélioré dans les 2 groupes. De
même, la prescription de médicaments à visée cardio-
vasculaire a augmenté dans ces 2 groupes. L’analyse en
intention de traiter et l’analyse per protocole (de ceux
qui n’ont pas arrêté leur traitement) n’ont pas montré
de diff érence sur l’objectif primaire. Cependant, dans
le groupe oméga 3 le nombre d’admissions pour insuf-
fi sance cardiaque était moindre, de façon hautement
signifi cative (p = 0,002). De même, le nombre d’évé-
nements (pour l’objectif primaire) était plus bas pour
le “sous-groupe” des femmes avec signifi cativement
moins d’événements (− 18 % ; IC95 : 0,67-0,99 ; p = 0,04)
chez celles ayant reçu les oméga 3.
Il est clair que les auteurs sont déçus, mais pour autant
ils ne sont pas “seuls” contrairement à ce qu’ont titré de
nombreux articles de presse.
Pourquoi les résultats ne sont-ils pas aussi spectaculaires
que ceux de GISSI ?
✓
parce que les oméga 3 agissent peut-être plus sur la
thrombose et sur les troubles du rythme post-infarctus,
que sur une athérosclérose peu évolutive (il y a eu très
peu de cas de mort subite) ;
✓
parce qu’il n’y a pas eu assez d’événements car les
patients sont de mieux en mieux traités. Il eût fallu plus
de sujets et/ou une durée plus longue ;
✓
parce que les 2 groupes ont amélioré leur facteur de
risque et renforcé leur traitement, et donc le gradient
entre les 2 groupes n’est pas assez fort.
Il est clair que, dans ces conditions, les oméga 3 n’ont
pas entraîné de diff érence chez des sujets à risque sans
antécédent d’infarctus, mais cela s’explique.
J.M. Lecerf (Lille)
• Risk and Prevention Study Collaborative Group et al. N Engl J Med 2013;
368(19):1800-8.
L’irisine, l’hormone de l’exercice,
augmente avec l’obésité
L’irisine, l’hormone produite par le muscle squelettique
au cours de l’exercice physique, favorise le développe-
ment d’adipocyte brun exprimant la protéine décou-
plante UCP1 (uncoupling protein 1) qui permet de
dissiper de la chaleur au cours du métabolisme des tri-
glycérides. Ces données suggèrent que cette hormone
est une cible potentielle pour le traitement de l’obésité
et du syndrome métabolique. Toutefois, les mécanismes
de contrôle de la sécrétion de cette hormone ne sont
pas encore élucidés. A. Stengel et al. ont dosé l’irisine
circulante chez 40 sujets de diff érents indices de masse
corporelle (IMC) incluant des anorexiques (12 kg/m2),
des sujets d’IMC normaux (22 kg/ m2) et des obèses
(entre 30 et 50 kg/m
2
) [1]. Les auteurs ont constaté une
corrélation positive entre le taux plasmatique d’irisine
et l’IMC, la masse grasse et l’insulinémie. En revanche,
l’irisine plasmatique n’était pas corrélée à la ghréline,
au cortisol ni à la TSH circulants. En étudiant une autre
cohorte de 151 sujets, K.H. Park et al. ont démontré
que le taux d’irisine le plus élevé était associé à une
glycémie et une triglycéridémie à jeun élevées, un
taux faible de HDL-cholestérol et un risque accru de
syndrome métabolique (2). L’irisinémie était corrélée
négativement à la concentration plasmatique d’adi-
ponectine. Ces données montrent que, au cours de
la prise de poids, la sécrétion d’irisine est augmentée.
L’irisine pourrait être libérée en plus grande quantité par
le muscle mais également par les adipocytes, puisque
J.M. Moreno-Navarrete et al. ont récemment observé

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XVII - n° 9 - novembre 2013
275275
Revue de presse
ARSENAL-CDM - PP667028 - 03/13 - Bayer Santé - 220 avenue de la Recherche - 59120 Loos - SIREN : 706 580 149 RCS Lille
*
®
Système d’autosurveillance glycémique
®
Contour® next : Dispositif d’Auto Surveillance Glycémique (ASG) destiné aux patients diabétiques. Utilisation : Le lecteur de glycémie
Contour® next s’utilise avec les bandelettes réactives Contour® next. Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions fi gurant dans
le manuel d’utilisation du lecteur de glycémie et la notice des bandelettes réactives. L’ASG ne doit pas être une mesure automatiquement
généralisée à l’ensemble des diabétiques ; ni une mesure passive, n’entraînant pas de conséquence thérapeutique immédiate. Fabricant :
Bayer Consumer Care AG (Suisse). Classifi cation : DMDIV Liste B, conformément à l’annexe II de la Directive 98/79/CE. Organisme
notifi é : Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd (LRQA) – Identifi cation n°0088. Remboursement : Dans les limites suivantes au titre de
la LPP : lecteur (adulte : 1/4 ans - enfant : 2/4 ans), bandelettes réactives (200/an pour DT2 non insulinodépendant).
(1) Résultat situé par rapport au moment du repas. Fonction Autolog activée par défaut.
(2) Résultats d’exactitude et de répétabilité. Manuel d’utilisation du système d’autosurveillance
glycémique Contour® next.
(3) Jusqu’à 30 secondes pour compléter le 1er échantillon sanguin.
* 150 Ans, la science pour une vie meilleure.
Navigation autoguidée
Précision de nouvelle génération qui
dépasse les critères de la norme
ISO 15197:2003
(2)
Réapplication de sang possible
(3)
Contour®
mène à la glycémie
systématiquement qualifi ée (1)
in vitro une sécrétion d’irisine par des adipo-
cytes (3). Ces études suggèrent que l’éléva-
tion de production d’irisine pourrait refl éter
l’existence d’un mécanisme de compensation
d’une résistance à l’irisine qui se développe-
rait avec l’obésité.
E. Louiset (Rouen)
1. Stengel A et al. Peptides 2013;39:125-30.
2. Park KH et al. J Clin Endocrinol Metab 2013 (sous presse).
3. Moreno-Navarrete JM et al. J Clin Endocrinol Metab
2013;98(4):E769-78.
L’athérosclérose,
une maladie ancienne ?
L’athérosclérose n’a pas fi ni de livrer tous ses
secrets. Maladie de civilisation ? Maladie de
l’âge ? Maladie d’une autre origine ? Avec le
doublement de l’espérance de vie dans les
pays développés entre 1800 et 2000, l’athéro-
sclérose a dépassé les maladies infectieuses
en termes de causes de mortalité. Elle est
aujourd’hui en apparent déclin dans les pays
développés, à la fois parce qu’on la soigne
mieux et parce que l’espérance de vie aug-
mentant encore, le cancer devient plus fré-
quent et la mortalité par cancer aussi. Mais
existait-elle déjà dans le passé ? Une compo-
sante habituelle de la plaque d’athérome
mature est la calcifi cation vasculaire, quasi
pathognomonique de cette affection. Le
scanner du corps entier permet de repérer
cette lésion. Elle a été identifi ée sur des corps
momifi és retrouvés dans les glaces datant
d’environ 3000 av. J.-C. Il y a plus d’un siècle,
sir Armand Ruffi es avait identifi é des lésions
d’athérosclérose sur des momies égyptiennes
datant de 1000 av. J.-C. Récemment, l’ana-
lyse de 20 momies égyptiennes datant de
1981 à 364 av. J.-C. a confi rmé ces faits mais
il s’agissait d’Égyptiens de haut statut socio-
économique. Une nouvelle étude a été réalisée
par scanner sur 137 momies de 4 000 av. J.-C.
provenant de diff érentes régions et popula-
tions (Égypte ancienne, ancien Pérou, Indiens
pueblos d’Amérique du Sud-Ouest, Unangan
des îles Aléoutiennes [chasseurs cueilleurs]).
L’athérosclérose a été définie dans cette
étude par la présence d’une plaque calcifi ée
dans la paroi artérielle, et comme probable
>>>

Correspondances en Métabolismes Hormones Diabètes et Nutrition - Vol. XVII - n° 9 - novembre 2013
276276
Revue de presse
F
si des calcifi cations étaient observées sur le
trajet d’une artère. Une athérosclérose a été
constatée chez 34 % des momies (entre 25 %
et 60 % chez les chasseurs cueilleurs). L’âge
au moment du décès (43 ans avec athéro-
sclérose, 33 ans sans athérosclérose) était
corrélé au nombre de lits artériels concernés
(32 ans pour les momies sans athérosclérose
et 42 ans pour celles avec 1 ou 2 atteintes,
44 ans pour celles avec plus de 3 lits artériels
atteints). Ainsi, cette étude balaie l’idée qu’il
s’agit d’une maladie de civilisation et suggère
qu’il peut y avoir une prédisposition pour des
facteurs sous-estimés (infection, infl amma-
tion). L’athérosclérose est plus fréquente
avec l’âge. Cela n’exclut pas que les facteurs
environnementaux générant des facteurs de
risque puissent en accentuer la survenue. Le
mode de vie idéalisé des chasseurs cueil-
leurs (mode de vie proche de celui mené au
Paléolithique) n’empêche pas son apparition.
J.M. Lecerf (Lille)
• Thompson RC et al. Lancet 2013;381(9873):1211-22.
Les mutations somatiques
infl uencent-elles la sécrétion
d’aldostérone dans les adénomes
de Conn ?
Le séquençage de l’exome d’adénomes
surrénaliens responsables d’un hyperaldo-
stéronisme primaire a permis d’identifi er des
mutations somatiques aff ectant les gènes
codant pour le canal potassique GIRK4
(KCNJ5), la sous-unité α1 de la pompe Na/K
ATPase (ATP1A1) et la pompe calcique PMCA3
(ATP2B3). Ces mutations sont à l’origine d’un
déséquilibre ionique de part et d’autre de la
membrane plasmique et d’une dépolarisation
membranaire. Cette dépolarisation pourrait
augmenter le signal calcique dans les cellules
et, par voie de conséquence, stimuler la syn-
thèse d’aldostérone. L’équipe de M. Reincke
(Munich, Allemagne) a dosé l’aldostérone et
le cortisol plasmatiques en périphérie et dans
les veines surrénaliennes gauche et droite
afi n de calculer l’index de latéralisation (rap-
port aldostérone/cortisol entre les surrénales
adénomateuse et controlatérale) et l’index de
freination (rapport aldostérone/cortisol entre
la surrénale controlatérale et la périphérie) [1].
Aucune diff érence signifi cative n'a été consta-
tée entre les résultats des 19 patients porteurs
d’une mutation KCNJ5, ceux des 8 patients
présentant une mutation des séquences
ATP1A1 et ATP2B3, et ceux des 32 sujets ne
présentant aucune de ces mutations. Cette
étude ne retrouve donc pas un index de laté-
ralisation plus élevé chez les porteurs d’une
mutation KCNJ5, comme rapporté antérieu-
rement par P. Rossi et al. (Padoue, Italie) dans
une série de 18 adénomes mutés et 14 non
mutés pour KCNJ5 (2). La discordance entre
ces résultats pourrait refl éter l’hétérogénéité
des patients considérés comme non porteurs
de mutation mais qui pourraient être en fait
atteints d’une mutation récemment identi-
fi ée du gène CACNA1D (3, 4), codant pour
la sous-unité α1 du canal calcique de type L
Cav1.3, ou d’une tout autre mutation encore
inconnue.
E. Louiset (Rouen)
1. Oßwald A et al. Eur J Endocrinol 2013;169(5):657-63.
2. Seccia TM et al. J Clin Endocrinol Metab 2012;97(12):E2307-13.
3. Scholl UI et al. Nat Genet 2013;45(9):1050-4.
4. Azizan EA et al. Nat Genet 2013;45(9):1055-60.
Mutation du gène MKRN3
incriminée dans la puberté précoce
La puberté est initiée par une augmentation
de la sécrétion pulsatile de GnRH par les
neurones hypothalamiques dont l’activité
demeure inhibée durant l’enfance. Le déclen-
chement de l’activité pulsatile des neurones
à GnRH est sous l’infl uence de nombreux fac-
teurs génétiques, nutritionnels et environ-
nementaux. La puberté précoce, défi nie par
une puberté apparaissant avant l’âge de 8 ans
chez les fi lles et de 9 ans chez les garçons,
survient dans 27 % des cas dans un contexte
familial. Deux mutations ont été associées à
une puberté centrale précoce, l’une aff ecte
le gène codant pour le peptide kisspeptine1
(KISS1) et l’autre le gène codant pour son
récepteur (KISS1R). En vue d’identifi er de nou-
velles mutations responsables d'une puberté
centrale précoce, les équipes de A.C. Latronico
et U.B. Kaiser (Boston) ont réalisé le séquen-
çage complet de l’exome de 40 sujets prove-
nant de 15 familles aff ectées. Les chercheurs
ont répertorié 71 gènes susceptibles d’être
impliqués dans cette pathologie. Ils ont iden-
tifi é 4 mutations dans la séquence du gène
MKRN3 codant pour la protéine makorin RING-
fi nger protein 3 dans 5 des 15 familles. Le gène
MKRN3 est situé sur le chromosome 15 dans la
région 15q11.2, région qui est délétée chez les
patients atteints de syndrome de Prader-Willi
(15q11-q13). Ce gène soumis à empreinte
maternelle (seul l’allèle paternel est exprimé)
code pour une protéine appartenant à la
famille des protéines à doigt de zinc connues
pour interagir avec l’ARN. Les mutations déce-
lées dans le gène MKRN3 correspondent à
3 mutations ponctuelles (p.Ala162Glyfs*14,
p.Arg213Glyfs*73, p.Tyr391fs*) entraînant un
décalage du cadre de lecture, ainsi qu’une
mutation faux-sens (p.Arg365Ser) qui pourrait
être à l’origine d’une perte de fonction de la
protéine. Les auteurs ont montré que le niveau
d’expression du gène MKRN3 qui est très élevé
dans le noyau arqué de l’hypothalamus des
jeunes souris mâles et femelles, diminue
fortement avant la puberté. Ce travail révèle
que la perte de fonction du gène MKRN3 est
impliquée dans le déclenchement précoce de
la puberté. Il suggère que la protéine produite
par ce gène jouerait un rôle dans l’inhibition
des neurones à GnRH avant la puberté.
E. Louiset (Rouen)
• Abreu et al. N Engl J Med 2013;368(26):2467-75.
Les auteurs déclarent ne pas avoir deliens d’intérêts.
>>>
1
/
3
100%