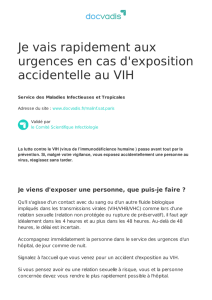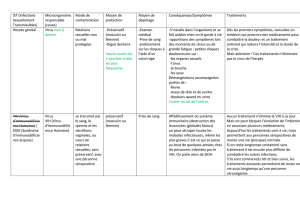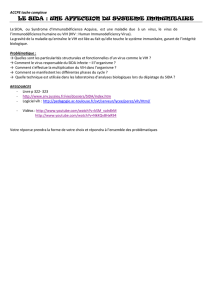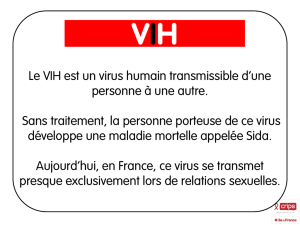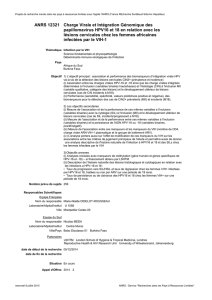Manifestations neurologiques du VIH - Psychologie

Manifestations neurologiques du VIH
C Lacroix
Résumé.
–
Les complications neurologiques liées à l’infection par le virus de
l’immunodéficience humaine (VIH) sont fréquentes, touchant le système nerveux central et
périphérique et le muscle. Ces complications peuvent se rencontrer à tous les stades de la
maladie, de la séroconversion au stade du syndrome d’immunodéficience acquise (sida).
Les infections opportunistes doivent systématiquement être suspectées lors d’une atteinte
centrale, en particulier la toxoplasmose et la tuberculose ; des traitements efficaces
spécifiques prescrits précocement peuvent conduire à la guérison du malade. Si
l’encéphalite VIH, vue au stade tardif, lorsque les patients ont moins de 100 lymphocytes
T-CD4
+
/mL, n’a pas de réel traitement spécifique, les nouveaux traitements de la maladie
VIH par trithérapie font reculer de manière spectaculaire son apparition et entraînent peut-
être une amélioration clinique. Malgré ces très importants apports thérapeutiques, on
observe encore aujourd’hui des encéphalites liées au Cytomégalovirus (CMV), des
leucoencéphalites multifocales progressives et des lymphomes primitifs du système nerveux
central. Si les neuropathies liées au CMV et les neuropathies tardives douloureuses sont
moins fréquentes actuellement, des neuropathies inflammatoires ou causées par une
vascularite s’observent encore. Les neuropathies causées par des traitements
neurotoxiques (didéoxycytidine [ddC], didéoxyinosine [ddI]...) sont les plus fréquentes,
depuis quelques mois, chez les patients VIH. Si les myopathies liées à la zidovudine (AZT)
ont quasiment disparu, des myosites inflammatoires ne sont pas rares.
©
1999, Elsevier, Paris.
Introduction
Les atteintes du système nerveux central et périphérique et du muscle sont
fréquentes au cours de l’infection par le VIH. L’invasion du système nerveux
semblant précoce, des manifestations neurologiques peuvent s’observer à
tous les stades de l’infection. Les troubles neurologiques peuvent être liés
directement au VIH, à des infections opportunistes, à un lymphome, ou
secondaires à une toxicité médicamenteuse. Certains troubles neurologiques
peuventêtreréversiblesspontanémentousoustraitementspécifique,d’autres
sont responsables du décès des patients, faute de thérapeutique efficace.
Depuisl’utilisationdestrithérapiesetlapréventionsystématiquedecertaines
infections opportunistes (toxoplasmose et CMV), l’immunodépression des
patients étant moins profonde, il semblerait que certaines manifestations
neurologiques soient plus ou moins réversibles, comme l’encéphalite liée au
VIH, et, surtout, la survie des patients est nettement prolongée. Cependant,
des infections opportunistes du système nerveux central, en particulier la
toxoplasmose,restentencoreunmodederévélationdel’infectionparleVIH.
Il est certain qu’un dépistage précoce de l’infection par le VIH, associé à une
trithérapie, peut éviter, ou au moins retarder, l’apparition de lésions du
système nerveux.
Système nerveux central
Encéphale
Encéphalites liées au VIH
Lorsdelaséroconversionoudanslessemainesquilasuivent,uneencéphalite
aiguë réversible peut survenir. Ses manifestations sont une confusion, une
fièvre, des myalgies, parfois des crises convulsives et des troubles cognitifs.
Ces symptômes peuvent être, chez quelques patients, associés à une
neuropathie périphérique de type polyradiculonévrite (PRN) aiguë. L’étude
Catherine Lacroix : Praticien hospitalier, laboratoire de neuropathologie, centre hospitalier
universitaire de Bicêtre, 78, rue du Général-Leclerc, 94275 Le Kremlin-Bicêtre cedex, France.
Toute référence à cet article doit porter la mention : Lacroix C. Manifestations
neurologiques du VIH. Encycl Méd Chir (Elsevier, Paris), Neurologie, 17-051-B-10, 1999,
11 p.
du liquide céphalorachidien (LCR) montre des bandes oligoclonales et une
synthèse intrathécale d’anticorps anti-VIH
[15]
. Tous ces troubles régressent
spontanément en quelques semaines.
L’encéphalite tardive du VIH est une encéphalite d’évolution subaiguë,
survenant chez des patients qui ont un taux de CD4 inférieur à 100/mL,
spécifique par ses lésions et de pathogénie très discutée. Son incidence dans
lapopulationVIHesttrès difficileàévaluercar elle est souventassociéeà des
infections opportunistes cérébrales et surtout générales qui ont des
manifestations cliniques souvent plus bruyantes ; les patients ne sont pas
toujours suivis par un neurologue, et l’autopsie, seul moyen de confirmer le
diagnostic, est rarement effectuée. L’apport récent des trithérapies semble
diminuer sa fréquence, voire faire régresser certains symptômes. Quelques
études épidémiologiques ont été faites aux États-Unis, mais aucune chez
l’adulteen Europe. Safréquence dans lapopulationVIH va de7à68%selon
lesétudes,l’évaluationdestroublesneurologiques,destestspsychométriques
oudes autopsies étanteffectuée àpartirde la clinique.En pratique, dansnotre
expérience, l’encéphalite VIH est retrouvée dans environ 20 % des autopsies
des patients atteints de sida et souvent associée à d’autres pathologies. Chez
l’enfant, une encéphalite VIH peut apparaître de manière plus précoce
[7]
.De
nombreux tests neuropsychologiques ont été réalisés chez des patients ayant
17-051-B-10
ENCYCLOPÉDIE MÉDICO-CHIRURGICALE 17-051-B-10
© Elsevier, Paris

un taux de CD4 élevé ou inférieur à 100/mL. Certains ont démontré la
présence de troubles précoces, d’autres se sont avérés normaux
[8, 52]
. Mais il
faut tenir compte des troubles dépressifs chez de nombreux patients,
dépression qui peut simuler des troubles cognitifs. Les troubles évoluent sur
1 à 10 mois, avec de fréquentes fluctuations. Les premiers symptômes sont
destroubles ducomportement, cognitifs et moteurs. Lespatients seplaignent
de difficultés de concentration et de troubles de la mémoire. Leur
comportement social est modifié, avec une irritabilité inhabituelle, des
modifications dans leurs habitudes sociales, voire une désinhibition. Les
patients ont des difficultés pour lire et écrire, une désorientation
temporospatiale, une aboulie et une apathie, ce qui conduit rapidement à des
arrêts de travail
[57]
. Les céphalées et crises comitiales sont rares. Les réflexes
ostéotendineux sont pyramidaux avec un signe de Babinski. La marche est
ataxique et il existe un déficit moteur modéré des membres inférieurs.
Progressivement, les troubles des fonctions supérieures vont s’aggraver ainsi
que les troubles moteurs. En phase finale, des troubles sphinctériens vont
apparaître, associés à des myoclonies, une hypertonie et une apraxie, le
patient devenant grabataire en quelques mois
[61]
. L’imagerie,
tomodensitométrie (TDM) ou imagerie par résonance magnétique (IRM), est
nécessaire lors de l’apparition de troubles neurologiques, essentiellement
dans le but d’éliminer une infection opportuniste, en particulier une
toxoplasmose qui pourrait bénéficier d’un traitement spécifique. La TDM
montre des images non spécifiques, atrophie cortico-sous-corticale et
dilatation ventriculaire. L’IRM, plus sensible, montre des lésions de la
substance blanche sous la forme d’hypersignaux en T2
[60]
. Mais certains
patientspeuvent présenter dessignescognitifs et moteurspatentset avoir une
imagerie normale. Une myélite vacuolaire est très souvent associée aux
lésions d’encéphalite VIH, mais n’est pas visible en IRM. L’étude du LCR
estégalementutilepourélimineruneméningite,enparticulieràcryptocoques
ou mycobactéries. Lors de l’encéphalite tardive du VIH, on retrouve souvent
une discrète lymphocytose et une sécrétion oligoclonale
d’immunoglobulines G. Le virus a pu être isolé et cultivé dans quelques cas.
La présence d’antigène p24 dans le sang et le LCR serait plus fréquente chez
les patients ayant une encéphalite que ceux qui ne sont pas déments.
Différents dosages de cytokines effectués en recherche ont montré une
élévation de certaines d’entre elles, en particulier le TNF α(tumour necrosis
factorα),maiscesexamensnesontpasutilesen routine, nipourlediagnostic,
ni pour le suivi des patients
[34]
. L’électroencéphalogramme est souvent
perturbé mais ne montre pas d’anomalies spécifiques.
Le diagnostic d’encéphalite VIH est donc porté sur un faisceau d’arguments,
uneinfection opportunisteou un lymphome ayant étééliminés parl’imagerie
et l’étude du LCR. Une biopsie stéréotaxique n’est pas utile dans ces cas et la
dispersion des lésions la rend aléatoire.
Le diagnostic formel ne peut être confirmé que par l’autopsie. Cependant, en
cas de forte suspicion d’encéphalite VIH, si le patient n’a que des troubles
mineurs,lamiseen route ou l’instaurationd’un traitementantiviral, aumieux
par des analogues nucléosidiques de la reverse transcriptase, comme la
zidovudine,la ddC oula ddI,associésà des inhibiteursnonnucléosidiques de
la reverse transcriptase (nevirapine [Viramunet]...) et des antiprotéases
(ritonavir, indinavir ou nelfinavir [Viraceptt]...), rend possible au moins une
stabilisation de l’état neurologique ou, mieux, une amélioration.
En effet, les lésions encéphaliques retrouvées lors de l’autopsie de patients
ayant une encéphalite tardive du VIH sont compatibles, en partie, avec des
lésions réversibles. Différents types de lésions sont rencontrés, parfois
associés : multiples foyers disséminés de nécrose, de microglie, de
macrophages et de cellules géantes plurinucléées qui contiennent des
antigènes du VIH ; une leucoencéphalopathie caractérisée par des lésions
diffuses de lasubstanceblanche, une démyélinisation,une gliose astrocytaire
réactionnelle ; une leucoencéphalopathie vacuolaire et une polydystrophie
diffuse
[10, 67]
.L’intensitédes lésions retrouvéesàl’autopsie n’est pas toujours
corréléeaveclaprofondeurdeladémence.Lepoids du cerveau est en général
diminué,inférieur à 1 kgdans notre expérience(pourune normale supérieure
à1,5 kg chez l’adulte jeune). Leslésionsdunéocortexsonttrèscontroversées,
certains retrouvant une perte neuronale
[22]
, d’autres non
[68]
; l’amélioration
des troubles neurologiques chez certains patients traités par zidovudine
plaiderait plutôt contre des lésions neuronales massives. Les lésions de la
substanceblanche et desnoyauxgriscentrauxsontretrouvéesdansla majorité
des cas, de manière plus ou moins intense. Une démyélinisation diffuse ou
plurifocale modérée est observée dans 50 % des cas. Il s’y associe une gliose
astrocytaire parfois dense et la présence éparse de cellules plurinucléées
(fig 1)
[69]
. Dans quelques cas, une vacuolisation focale et des zones de
démyélinisation péricapillaires suggèrent des anomalies de la barrière
hématonévraxique. La gliose astrocytaire prédomine dans les régions sous-
corticales. La présence de nodules microgliaux dans la substance blanche et
les noyaux gris centraux, mais aussi parfois dans le tronc cérébral et le
cervelet, n’est pas spécifique de l’encéphalite VIH, mais très évocatrice, si,
aux cellules microgliales, aux lymphocytes et aux astrocytes, sont associées
descellulesgéantes plurinucléées (fig 2)
[70]
.Cescellules géantes sontparfois
isolées ou par petits groupes, souvent périvasculaires
[9]
. Ces cellules géantes
sont d’origine microgliale/macrophagique
[26]
. Des études en microscopie
électronique ont montré la présence de particules virales dans des cellules
plurinucléées. L’immunohistochimie permet de détecter des anticorps anti-
p24ougp41danscescellulesgéantes,confirmantla présence du virus (fig 3).
Des quantifications de l’antigénémie p24 dans le tissu cérébral n’ont pas
montré de corrélation avec l’intensité de la démence, certains patients non
déments ayant des taux élevés
[30]
. En résumé, les lésions cérébrales sont
parfois modérées par comparaison avec l’intensité de la clinique.
La pathogénie de l’encéphalite tardive du VIH a fait verser des flots de
littérature et reste toujours débattue, car probablement multifactorielle. Les
lésions de l’encéphalite de la séroconversion sont vraisemblablement
inflammatoires, donc rapidement réversibles. On sait que le VIH pénètre très
précocement dans l’encéphale, mais chez l’adulte les manifestations
1Encéphalite due au virus de l’immunodéficience humaine. Gliose astrocytaire (flèches)
massive du noyau caudé et microcalcifications (têtes de flèche). Coupe en paraffine
(hématéine-éosine, ×800).
2Encéphalite due au virus de l’immunodéficience humaine. Nodule microglial situé dans
la substance blanche, présence de cellules géantes (flèches). Coupe en paraffine
(hématéine-éosine, ×800).
3Encéphalite due au virus de l’immunodéficience humaine. Nodule microglial situé dans
le noyau lenticulaire, marquage de cellules microgliales par un anticorps anti-gp41/VIH.
Coupe en paraffine (DAB, ×1 400).
MANIFESTATIONS NEUROLOGIQUES DU VIH Neurologie17-051-B-10
page 2

encéphalitiques spécifiques sont tardives, lorsque les patients sont au stade
sida. L’infection directe des neurones n’a jamais été démontrée et
l’intervention d’autres facteurs que le virus lui-même est très probable. Des
facteurs indirects induits par la présence du virus, même en faible quantité,
dans le système nerveux sont certainement à l’origine de l’encéphalopathie.
La libération, par les macrophages, de substances toxiques telles que
protéines virales, cytokines, glutamate, acide quinoléique, récepteur du N-
méthyl-D-aspartate (NMDA) et diverses molécules d’adhérence, pourrait
expliquer l’évolution lentement progressive, fatale, combinée à des lésions
microscopiquespeuintenses
[1, 49]
.Àcôtédurôleprimordial probablejouépar
les macrophages dans la genèse de l’encéphalite VIH, d’autres auteurs,
arguant de leur petit nombre dans certains cas, font intervenir les astrocytes
réactionnels présents dans la substance blanche par l’intermédiaire de
molécules d’adhérence. Mais l’importance de la détérioration intellectuelle
et des troubles moteurs impose que des substances toxiques agissent sur les
neurones corticaux et/ou des noyaux gris centraux, peut-être de manière
réversible.
Depuis 1988, date du début des traitements par la zidovudine, il semble que
l’incidencedes encéphalites tardivesduVIH diminueen Europe etauxÉtats-
Unis
[19]
.Depuis 2 ans, l’effetdestrithérapies,malgrél’absence de publication
récente, est spectaculaire, et nous n’avons observé aucune encéphalite VIH,
le taux des autopsies des patients VIH étant divisé par cinq.
À côté des lésions encéphalitiques, des désordres vasculaires ne sont pas
exceptionnels chez les patients atteints du VIH, immunodéprimés ou non. Si
les accidents vasculaires ischémiques étendus sont rares chez ces patients,
leursurvenue chez un adulte jeunedoitfairerechercherunesyphilisquiinduit
souvent une artérite. Les séries autopsiques montrent un taux relativement
élevédelésionsischémiques,souvent multiples et depetite taille. Deslésions
des capillaires et petites artérioles sont observées, avec parfois un
épaississement massif de leur paroi occluant leur lumière (fig 4)
[55]
.De
micro-infarctus hémorragiques sont parfois rencontrés (fig 5). Enfin, des
infiltrats inflammatoires lymphocytaires sont très fréquents. On notera la
possibilité d’une prolifération lymphoïde TCD8
+
multiviscérale qui peut
toucher le système nerveux, central et périphérique.
Enconclusion,destroublesdesfonctionssupérieuressonttrès fréquents chez
les patients VIH, mais plus souvent liés à une infection opportuniste ou à un
lymphome ; le diagnostic d’encéphalite VIH ne devra être porté qu’après
éliminationd’uneautre cause. Son traitement étant le traitement de la maladie
générale, au mieux par la trithérapie, on espère la voir diminuer de fréquence
ou l’améliorer. La seule restriction à l’optimisme actuel est le mauvais
passage de la majorité de ces drogues au travers de la barrière
hématonévraxique.
Infections opportunistes
Parasites
Toxoplasmose
Ce parasite, dont l’hôte habituel est le chat domestique, est responsable, en
France, de l’infection opportuniste la plus fréquente du système nerveux
central chez les patients porteurs du VIH. Le toxoplasme est transmis à
l’homme par l’ingestion de viande peu cuite. L’incidence de l’encéphalite
toxoplasmique est proportionnelle à la prévalence des anticorps
antitoxoplasmiques. Compte tenu des habitudes culinaires, la prévalence de
la toxoplasmose est très élevée en France et en Amérique du Sud (autour de
85 %), moyenne en Europe du Sud (20-50 %) et faible aux États-Unis et en
Europe du Nord (<25 %). Il en résulte que l’incidence de l’encéphalite
toxoplasmique est beaucoup plus élevée en France qu’aux États-Unis, avec
respectivement un risque de 50 % contre environ 25 % des patients
séropositifs. L’encéphalite toxoplasmique se développe chez des patients
ayant une sérologie positive pour le toxoplasme (97 %). Le développement
de l’encéphalite toxoplasmique se fait chez des patients très
immunodéprimés, 75 % ayant moins de 50 CD4/mL
[65]
. Chez l’enfant, elle
ne s’observe qu’à partir de 8-10 ans. Si une encéphalite toxoplasmique doit
être suspectée chez un patient atteint de sida qui présente un déficit
neurologique central, elle est actuellement un mode fréquent de découverte
delamaladieVIHchezdespatientsdontlestatutvirologiquen’estpasconnu.
Les premières séries autopsiques montraient un taux élevé d’encéphalites
toxoplasmiques, 40 % pour les premières séries françaises
[33]
; la mise en
route de traitements préventifs, quasiment systématiques chez les patients
ayantuntauxdeCD4inférieurà100/mL,a fait considérablement diminuer la
mortalité liée à la toxoplasmose. Les signes neurologiques sont variables,
alliant des signes déficitaires focaux d’aggravation rapide et/ou des signes
encéphalitiques diffus. La fièvre est présente dans la moitié des cas. Les
manifestations cliniques associent un déficit sensitivomoteur, des crises
comitiales, focales ou généralisées, des troubles cérébelleux, des céphalées,
desmouvementanormaux et des troubles cognitifs et psychiatriques, pouvant
aller jusqu’au coma. Une paraparésie d’installation subaiguë peut être
secondaire à une toxoplasmose médullaire. De tels troubles neurologiques
chez un patient VIH imposent de pratiquer très rapidement une imagerie,
TDM et/ou IRM. Les lésions sont souvent multifocales, sous la forme de
lésions hypodenses, arrondies, prenant le contraste, souvent associées à un
œdème périphérique (fig 6). Ces lésions sont souvent situées dans les noyaux
gris centraux ou à la jonction cortico-sous-corticale. L’IRM avec gadolinium
montre parfois des lésions de plus petite taille, non visibles au scanner
[48]
.
Mais l’imagerie peut être moins spécifique en cas d’encéphalite diffuse, avec
deshypodensitésdiffusesdelasubstanceblanche,voirenormale.Aucunedes
images n’est toutefois spécifique et le diagnostic différentiel avec un
lymphome primitif est souvent posé. La biologie est de peu d’apport
diagnostique en France dans la mesure où la majorité des adultes sont
séropositifs pour la toxoplasmose. L’étude du LCR est peu contributive et
souvent contre-indiquée en raison du processus expansif intracrânien. En
pratique, chez un patient VIH positif, toute lésion intracérébrale doit être
considérée, par argument de fréquence, comme une toxoplasmose et
rapidement traitée comme telle. Le traitement antitoxoplasmique d’épreuve
est le plus souvent très efficace et, s’il est institué précocement, une guérison
est possible. On applique un traitement d’attaque durant un minimum de
3 semaines. Ce traitement associe le plus souvent, par voie orale,
pyriméthamine et sulfadiazine avec de l’acide folique. Diverses études
montrent que 70 à 90 % des patients répondent à cette bithérapie
[50]
. Les
corticoïdes ne sont indiqués qu’en cas d’hypertension intracrânienne. La
toxicité de ces produits est élevée, avec de fréquentes lésions
dermatologiques, hématologiques (leuconeutropénie et thrombopénie),
lésions rénales et coliques et cytolyse hépatique. Une des alternatives
thérapeutiques est l’utilisation, moins efficace, de clindamycine
[40]
. Les
anticonvulsivants ne sont prescrits qu’en présence de crises comitiales ; la
Dépakinetest utilisée préférentiellement. La surveillance est clinique et
neuroradiologique : une réponse clinique est souvent objective au bout de
15 jours. Une imagerie de contrôle doit être faite après2à4semaines de
traitement. En l’absence d’amélioration clinique au bout de 3 semaines de
traitement supposé efficace, d’aggravation ou d’augmentation des lésions en
imagerie,une biopsiestéréotaxique peut êtreproposée dansl’hypothèse d’un
lymphome ou d’une autre infection opportuniste curable
[12]
. Si le traitement
d’attaque a été couronné de succès, un traitement d’entretien doit être
poursuivi à vie. Une bithérapie, pyriméthamine-sulfadiazine, à doses plus
faibles, reste le traitement de choix, dans la mesure des effets secondaires
[62]
.
Les études autopsiques récentes montrent une nette régression des lésions
aiguës d’encéphalite toxoplasmique (moins de 8 % dans la série de
100 autopsies de Bicêtre), mais des séquelles d’abcès toxoplasmiques sont
fréquentes, associées à d’autres lésions, encéphalite VIH, autres infections
opportunistesoulymphome. Les lésions aiguës,retrouvées parfoislors d’une
biopsiestéréotaxique, sont des abcès nécrotiquescontenantdesmacrophages,
des polynucléaires altérés et, souvent, des hémorragies. Des kystes et des
trophozoïtes libres sont présents en périphérie des zones de nécrose (fig 7).
4Lésionsischémiqueschezunpatientatteintparlevirusdel’immunodéficiencehumaine.
Microangiopathieavecaspectfeuilletédescapillairesdubulbe(flèches).Coupeenparaffine
(hématéine-éosine, ×300).
5Microhématomes multi-
plesdanslecorpscalleuxetla
capsule interne.
MANIFESTATIONS NEUROLOGIQUES DU VIHNeurologie 17-051-B-10
page 3

La fréquence des hémorragies rend souvent périlleuses les biopsies
stéréotaxiques. Des lésions abcédées subaiguës sont rencontrées chez des
patients traités pendant quelques semaines ; les parasites sont alors moins
nombreux, et une étude immunohistochimique peut alors être utile pour les
détecter
[57]
. Des lésions anciennes, chroniques, ou des lésions cicatricielles
ne sont pas rares chez des patients traités, parfois plusieurs années plus tôt,
pour une toxoplasmose cérébrale. Des kystes toxoplasmiques isolés, latents,
sont parfois observés.
Un traitement prophylactique de l’encéphalite toxoplasmique est
actuellement proposé aux patients ayant un taux de CD4 inférieur à 200/mL
et aux patients séropositifs pour la toxoplasmose ayant des CD supérieurs à
200 :l’association triméthoprime-sulphaméthoxazole est la plusintéressante,
car elle préviendrait également la très fréquente pneumocystose
pulmonaire
[11]
.
Enconclusion,lesencéphalitestoxoplasmiques,grâceàunepréventionquasi
systématique chez les patients immunodéprimés, sont beaucoup moins
fréquentes qu’au début de l’infection VIH. Quoi qu’il en soit, toute lésion
expansive chez un patient VIH doit être considérée empiriquement comme
une toxoplasmose et traitée comme telle, l’efficacité des traitements
permettant la guérison d’une grande majorité des patients. Les autres causes,
dont le diagnostic ne peut être établi par des moyens simples (biologie
sanguine et étude du LCR), ne seront envisagées qu’après échec de ce
traitement.
Autres parasitoses du système nerveux central
Elles sont exceptionnelles en France. Elles doivent être évoquées chez des
patients originaires des pays tropicaux ou y ayant voyagé.
Virus
Les infections du système nerveux central par le CMV et le virus JC viennent
au second plan des infections opportunistes, après la toxoplasmose. Si une
possibilité thérapeutique théorique existe pour le CMV, le traitement de
l’infection par le virus JC est encore virtuel.
Cytomégalovirus
Il est actuellement l’infection virale la plus fréquente chez les patients
VIH
[39]
. Une encéphalite liée au CMV a été retrouvée chez 18 % des patients
de notre série autopsique. Elle survient chez des patients fortement
immunodéprimés,adultes et enfants,avecuntauxdeCD4inférieurà 100/mL.
La majorité de ces patients ont eu une rétinite ou une infection pulmonaire à
CMV durant les mois précédents. Des signes d’atteinte encéphalique
apparaissenten quelquesjours, avec unedésorientation, uneconfusion, voire
un début de coma, associés à des déficits sensitivomoteurs et des signes
d’atteinte du tronc cérébral. Ces signes neurologiques, peu spécifiques, sont
souvent accompagnés de fièvre. Malgré un traitement spécifique, l’évolution
est en général défavorable en3à4semaines. La mise en route très précoce
d’un traitement adapté pourrait enrayer une évolution fatale. Les myélites
liées au CMV sont fréquentes, associées à une atteinte pluriradiculaire. Leur
évolution se fait rapidement vers une paraplégie flasque avec troubles
sphinctériens majeurs
[53]
. Les lésions induites par le CMV étant très
nécrosantes, leur évolution se fait en quelques jours ; elles sont souvent
multifocales,touchantles hémisphères cérébraux,avec uneprédilectionpour
larégionpériventriculaire,le tronc cérébral etla moelle.L’imagerie restetrès
pauvre et, malgré des signes encéphalitiques patents, ne retrouve parfois que
peu de signes. La TDM reste souvent normale. L’IRM peut visualiser un
élargissement des ventricules associé à une prise de contraste (fig 8)
[39]
.
L’imagerie est plutôt un examen utile pour le diagnostic différentiel avec
d’autres infections opportunistes ou un lymphome. L’étude du LCR peut
retrouver une hyperprotéinorachie et une pléiocytose avec polynucléaires,
mais il peut être normal. La détection d’acide désoxyribonucléique (ADN)
du CMV par PCR (polymerase chain reaction) serait utile au diagnostic,
particulièrement dans le cas des myéloradiculites. Le diagnostic formel ne
pourrait être porté que par la pathologie
[37]
. Compte tenu de la diffusion des
lésions et de leur localisation, les biopsies stéréotaxiques ne sont pas
indiquées. Devant une forte présomption face à des signes d’encéphalite
diffus ou de myéloradiculite évoluant rapidement chez un patient ayant des
antécédents d’infection par le CMV, un traitement spécifique devra être très
rapidementmis en route.Les produits utiliséssont le ganciclovir, le foscarnet
et le cidofovir en perfusion, parfois en association
[54, 58]
. La mise en route très
précoce d’un traitement spécifique, avant l’apparition de lésions nécrosantes
irréversibles, pourrait permettre d’enrayer la progression du virus. En
pratique,siune réelle améliorationthérapeutiqueest envisageable dans lecas
d’atteintes périphériques, les lésions centrales liées au CMV sont toujours
fatales à court terme.Aussi, un traitement préventif à vie par voie orale, chez
les patients ayant eu une rétinite ou une atteinte viscérale, est-il actuellement
leseul utile
[72]
.La pathologie est encore laseulepreuvediagnostique.L’étude
macroscopique peut montrer un aspect nécrotique des parois ventriculaires,
plus rarement cortico-sous-corticales, mais reste souvent sans anomalie
significative. L’étude microscopique montre, dans la majorité des cas, des
lésions de ventriculite diffuses, avec abrasion de la paroi des ventricules et
présence de cellules contenant des inclusions cytomégaliques nucléaires et
cytoplasmiques (fig 9)
[76]
. Plus rarement, on observe des lésions de nécrose
corticale et de la substance blanche. De rares nodules microgliaux contenant
des cellules cytomégaliques sont parfois présents. Dans la moelle, les lésions
de nécrose touchent la substance blanche et la substance grise ; des cellules
cytomégaliquespeuventêtre retrouvées dans lesméninges voisineset surtout
dans les racines. Les cellules infectées sont des cellules épendymaires, des
cellules gliales, des neurones et, très rarement, des cellules endothéliales
[56]
.
6Toxoplasmose cérébrale. Tomodensitométrie.
A. Lésion arrondie du noyau caudé droit, prenant le contraste et entourée d’un
important œdème.
B. Régression spectaculaire de la lésion après 6 mois de traitement antitoxo-
plasmique.
AB
7Toxoplasmose cérébrale. Biopsie stéréotaxique d’une lésion aiguë : nécrose, inflam-
mation périvasculaire et kyste toxoplasmique (flèche). Coupe en paraffine (hématéine-
éosine, ×1 000).
8Ventriculite liée au Cytomégalovirus. Imagerie par résonance magnétique cérébrale :
lésion hyperintense de la région périventriculaire (flèche).
MANIFESTATIONS NEUROLOGIQUES DU VIH Neurologie17-051-B-10
page 4

Virus JC Papova
Il appartient à la famille des Polyomavirus et est responsable de la
leucoencéphalite multifocale progressive (LEMP). Cette encéphalite
démyélinisante subaiguë touche4à7%despatients atteints de sida. La
LEMP vient au deuxième rang des infections opportunistes virales chez le
patient VIH, responsable de1à8%desdécès, 13 % de notre série
autopsique
[65]
. Le virus, infectant les oligodendrocytes, est responsable de
lésions de la substance blanche. Cette infection peut être un mode de
découverte de l’infection VIH, la majorité des patients ayant un taux de CD4
inférieur à 50/mL. Quelques cas ont été rapportés chez l’enfant. Les
manifestations neurologiques associent de manière rapidement progressive
undéficitmoteur,uneaphasie,unehémianopsieetuneataxie
[65]
.Destroubles
visuels, liés à des lésions des voies optiques, sont très fréquents. Une
évolution fatale sur quelques semaines ou mois est usuelle. L’IRM est
l’examendechoixpourconfirmerlediagnostic,laTDMmontrantdesimages
moins spectaculaires. L’IRM montre en T1 des images hypo-intenses
irrégulières de la substance blanche ; en T2, les lésions deviennent très
hyperintenses, souvent hétérogènes
[74]
. Si la biologie usuelle, sang et LCR,
estnormale, la recherchepar PCRduvirus JC dansleLCR serait trèsutile car
spécifique, mais sa négativité n’exclut pas le diagnostic
[73]
. À ce jour, aucun
traitement spécifique n’est efficace sur le virus JC, mais les traitements par
trithérapie utilisés contre le VIH sembleraient ralentir l’évolution des LEMP.
Les patients ayant un taux élevé de CD4 (>200/mL) au début des troubles
présentent une évolution plus longue, parfois supérieureà1an
[45]
.La
pathologie confirme le diagnostic : macroscopiquement, on observe des
lésions de démyélinisation asymétriques, touchant préférentiellement la
substance blanche occipitale, mais parfois localisées dans les autres
hémisphères, le cervelet et le tronc cérébral (fig 10)
[66]
. Des lésions
nécrotiques sont présentes dans quelques cas. La microscopie montre, dans
les oligodendrocytes situés en périphérie des lésions, des inclusions
nucléaires rouges, amphophiles, des « astrocytes bizarres » et une
démyélinisation (fig 11). Des infiltrats inflammatoires périvasculaires sont
parfoisvisibles.L’immunohistochimieconfirmelaprésenceduvirusJC dans
lesoligodendrocytes(fig 12).UneassociationavecuneencéphaliteVIH a été
observée dans plusieurs cas, les cellules infectées étant différentes,
oligodendrocytes pour le virus JC et macrophages pour le VIH
[75]
.
La LEMP reste une des infections opportunistes du système nerveux central
la plus grave et qui n’a pas de traitement spécifique.
Autres virus du type herpès
Ils sont très rarement impliqués dans des lésions encéphalitiques chez les
patients VIH. Quelques encéphalites liées au virus varicelle-zona (VZV) ont
été rapportées
[14]
.
Rougeole
Chez les enfants VIH et éventuellement chez l’adulte jeune, une encéphalite
nécrosante liée à la rougeole peut survenir. Une telle encéphalopathie,
d’évolution fatale rapide, a pu être reliée au virus sauvage chez une enfant de
6 ans qui avait été vaccinée quelques mois auparavant
[42]
.
Champignons
Cryptocoque
Il est de plus en plus souvent responsable de méningites et de
méningoencéphalite chez les patients immunodéprimés. Ces infections
semblent plus fréquentes dans les séries nord- et sud-américaines que
françaises, mais, depuis quelques années, elles ne sont pas exceptionnelles
ici. Les méningites isolées ont une symptomatologie fruste, sans fièvre ; la
mise en évidence du cryptocoque dans le LCR, par un examen systématique
à l’encre de Chine, devrait conduire à un traitement spécifique efficace. Mais
dans certains cas, malgré une bithérapie par l’amphotéricine B et la
flucytosine, la pénétration des antibiotiques est mauvaise dans le système
nerveux central et des abcès cérébraux surviennent. L’évolution en est
subaiguë, souvent sur plusieurs mois, avec apparition progressive de signes
focaux et de signes cognitifs, voire, à terme, d’un coma
[29]
. Les études
autopsiques ont montré l’infiltration des espaces de Virchow-Robin par les
9EncéphaliteliéeauCytomégalovirus.Cellulescytomégaliquescontenantdesinclusions
nucléaires et cytoplasmiques multiples. Coupe en paraffine (Nissl, ×1 400).
10 Leucoencéphalite multifocale progressive. Lésions démyélinisantes hétérogènes de
la substance blanche (astérisques) ; le cortex est d’aspect normal (C). Coupe en paraffine
(hématéine-éosine, ×70).
11 Leucoencéphalite multifocale progressive.
A. Inclusions nucléaires dans le noyau des oligodendrocytes (flèches).
B.Astrocytes « bizarres » (flèche). Coupes en paraffine (hématéine-éosine, ×530).
AB
12 Leucoencéphalite multifocale progressive. Marquage des oligodendrocytes infectés
par le virus JC dans la substance blanche. Coupe en paraffine (DAB, ×50).
MANIFESTATIONS NEUROLOGIQUES DU VIHNeurologie 17-051-B-10
page 5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
1
/
11
100%