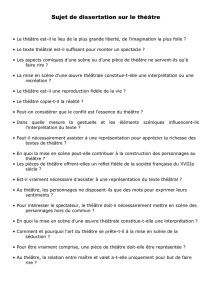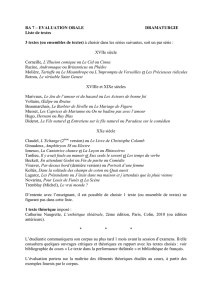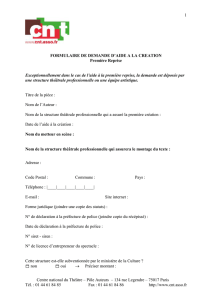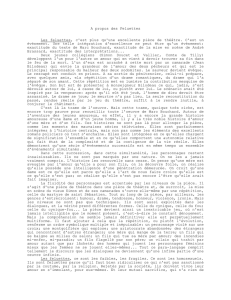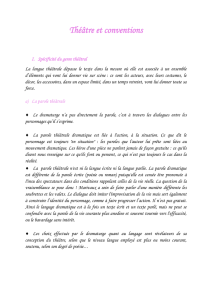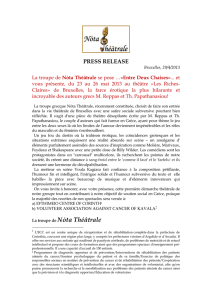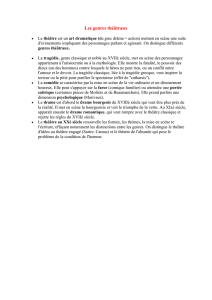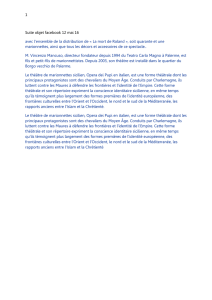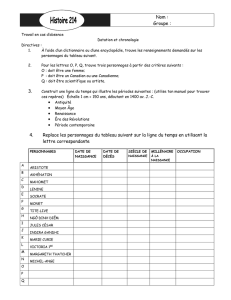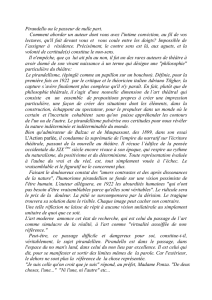Travailler sur scène / 14 février 2008

Travailler sur scène / 14 février 2008
Journée d’étude organisée par le Groupe Théâtre(s) politique(s)
1
Travailler sur scène : enjeux théoriques et historiques (repérages)
Armelle Talbot
Revenons d’abord rapidement sur ce qui a motivé le choix de cet axe de réflexion,
« travailler sur scène ». Prenant acte de la complexité de la notion de travail et de la
multiplicité de ses acceptions en fonction des usages et des époques, faisant simultanément
l’hypothèse que les extraits de pièces et de spectacles qui représentent des personnages en
train de travailler sont à la fois relativement rares et commodément identifiables, il nous a
semblé que le privilège donné au verbe, c’est-à-dire au procès et au « travail du temps » qu’il
implique, pouvait aider à historiciser notre réflexion en l’articulant à l’analyse d’exemples
précis et en questionnant, à travers eux, l’éventuelle « obscénité » du travail et les résistances
spécifiques qu’il oppose à la représentation théâtrale. Cet intérêt historique se conjugue par
ailleurs à une préoccupation typologique : le caractère circonscrit des exemples trouvés
devrait en effet permettre de distinguer entre différents modes d’apparition et de figuration du
travail et de nouer la question des formes et celle des enjeux, s’agissant peut-être aussi de
préciser en quoi et en quel sens ces enjeux peuvent être dits politiques dès lors que l’on n’est
plus confronté à un corpus exclusivement et explicitement militant. Voici donc notre double
horizon de recherche, sachant que, du point de vue historique comme du point de vue
typologique, tout reste à faire et à construire et qu’il s’agit surtout ici de soumettre exemples,
pistes et problèmes à la réflexion collective.
Initialement, l’infinitif « travailler » était donc censé avoir une fonction discriminatrice
– fonction dont nous avons bientôt constaté qu’elle était encore plus problématique que ce que
nous pouvions imaginer, tant l’enjeu définitionnel ne cessait de faire retour1. Toujours est-il
qu’intuitivement, l’occurrence « travailler » semble moins fréquente que celle du « travail »
ou du « travailleur » . Si le métier fait partie de l’état civil d’un grand nombre de personnages
de farces ou de comédies et que les ridicules associés à telle ou telle profession peuvent
donner lieu à de véritables types, on ne les voit guère à l’ouvrage. De même des valets,
1 Sur ces questions définitionnelles, cf. Joël Jung, Le Travail, Paris, Flammarion, coll. « Corpus », 2000.
Rassemblant des textes philosophiques sur le travail, Jung insiste dans son introduction sur la difficulté de toute
définition compte tenu de multiplicité des acceptions et des usages : « Le mot travail peut ainsi désigner 1) toute
activité demandant une attention ou un effort, physique ou intellectuel, prolongés ; 2) les seules activités
rétribuées ou effectuées en vue d’un gain […] ; 3) les activités, soutenues ou non, rétribuées ou non, par
lesquelles on produit matériellement les objets de consommation et d’usage » (p. 11). Il rapporte ensuite cette
pluralité de sens à l’ambivalence d’une notion qui renvoie tantôt à une donnée anthropologique présente dans
toutes les sociétés et à toutes les époques (comme condition générale des interactions entre l’homme et la
nature), tantôt à une réalité historiquement variable (comme pratique sociale déterminée par des rapports de
production spécifiques). Enfin, il évoque « le caractère historique du concept même de travail » (p. 13) : comme
catégorie centrale pour penser l’activité humaine, le travail apparaît au XVIIIe siècle avec la constitution de
l’économie politique, cette notion générale ne pouvant naître que dans le cadre d’une société capitaliste qui
généralise de facto l’activité laborieuse, c’est-à-dire qui fait effectivement abstraction des particularités qui
différencient les pratiques productives. Sur l’historicité du concept de travail, cf. Karl Marx, Introduction
générale à la critique de l’économie politique (1857), trad. fr. M. Rubel et L. Evrard, in K. Marx, Philosophie,
Paris, Gallimard, coll. « Folio/Essais », 1994, p. 475-476 : « L’indifférence à l’égard du travail particulier
correspond à une forme de société dans laquelle les individus passent avec facilité d’un travail à un autre, et dans
laquelle le genre déterminé du travail leur paraît fortuit et par conséquent indifférent. Le travail est alors devenu,
non seulement en tant que catégorie, mais dans la réalité même, un moyen de produire la richesse en général, et
il a cessé de se confondre avec l’individu en tant que destination particulière de celui-ci. […] Ainsi l’abstraction
la plus simple que l’économie moderne place au premier rang et qui exprime un phénomène ancestral, valable
pour toutes les formes de société n’apparaît pourtant comme pratiquement vrai, dans cette abstraction, qu’en tant
que catégorie de la société la plus moderne. […] Cet exemple du travail montre d’une façon frappante que les
catégories les plus abstraites elles-mêmes, malgré leur validité – justement en raison de leur abstraction – pour
toutes les époques, n’en sont pas moins, dans cette détermination abstraite même, tout autant le produit de
conditions historiques et n’ont leur pleine validité que pour elles et dans leur limite ».

Travailler sur scène / 14 février 2008
Journée d’étude organisée par le Groupe Théâtre(s) politique(s)
2
domestiques, nourrices et autres paysans qui, certes, s’inscrivent dans une hiérarchie sociale
contraignante qui détermine les rapports des personnages entre eux mais dont l’action reste
étroitement tributaire du déroulement de la fable, qu’ils occupent la fonction marginale
d’utilité, la fonction secondaire de confident ou la fonction principale de machiniste, à moins
qu’ils ne permettent quelques intermèdes comiques lorsqu’ils commentent ou parodient les
intrigues dans lesquelles sont engagés leurs maîtres. Aussi Yannick Mancel n’hésite-t-il pas à
faire du travail un « tabou » du théâtre occidental presque aussi puissant que ne l’ont été le
sexe et la mort :
« Parmi les tabous auxquels l’Occident a, depuis ses origines, soumis la représentation théâtrale, aux
côtés du sexe et de la mort en direct, figurent aussi, pour une moindre part, le travail et la figure de ceux
qui l’incarnent. Longtemps relégués dans le substrat obscur de la farce et du grotesque, ils
n’apparaissent durant de nombreux siècles qu’à travers la silhouette dérisoire, tout à la fois maligne,
lâche et fourbe, des ouvriers, artisans et commerçants d’Aristophane, et ne sont guère arrivés jusqu’à
nous que par la filiation vivante de la tradition théâtrale : Ménandre, Plaute, Térence, la farce médiévale
et les canevas anonymes de la commedia dell’arte.
Dans le contexte précapitaliste du XVIIe siècle français, où la bourgeoisie commence à affirmer son
identité sociale […], les grands maîtres de la dramaturgie classique demeurent bien allusifs lorsqu’il
s’agit de montrer les processus qui produisent de la richesse, comme si l’obscénité du négoce […]
devait symboliquement justifier, au chapitre des convenances et des bienséances, le devoir d’oisiveté
aristocratique que le pouvoir monarchique et la société nobiliaire continuaient d’imposer sans
dérogation possible à leur classe dominante. […] Chez Molière, on ne sait presque rien, ou pas grand-
chose, de l’origine de la fortune de ces bourgeois enrichis et parvenus qui croient pouvoir tout acheter
avec leur argent […]. Il faudra attendre l’audace historienne et critique de Roger Planchon, dans les
années 1960, pour que la mise en scène (l‘écriture scénique), à partir d’une lecture aiguë du moindre
détail textuel, nous révèle enfin l’impensé économique, historique et politique de l’œuvre de Molière, au
point qu’il soit devenu aujourd’hui impossible d’ignorer l’empire agricole de Dandin, les pratiques
usurières d’Harpagon, ni les florissantes activités maritimes et commerciales d’Argante et de Géronte
dans les Fourberies de Scapin.
L’aventure encyclopédique et la philosophie des Lumières, animées par la pensée bourgeoise, tentèrent
bien par la voix de Diderot de faire exploser ce tabou en préconisant notamment la peinture des
conditions. […] La Brouette du vinaigrier de Louis-Sébastien Mercier s’est imposée avec le temps
comme l’exemple le plus pertinent de cette petite révolution dramaturgique »2.
Sans doute faudra-t-il apprendre à nuancer ce qu’il peut y avoir de péremptoire dans
l’affirmation d’un tel tabou : d’une part, parce que la relégation du travail dans le registre
farcesque et comique n’est pas nécessairement synonyme de dénégation3 (preuve en est la
régularité avec laquelle cette tradition se voit réinvestie – par Dario Fo, le Théâtre du Soleil
ou le Théâtre de l’Aquarium – pour représenter le travail et les travailleurs d’aujourd’hui) ;
d’autre part et surtout, parce qu’il convient d’être très prudent quant à l’utilisation
transhistorique du mot « travail » dont le sens actuel, comme activité humaine organisée à
l’intérieur du groupe social, ne s’impose véritablement qu’au XIXe siècle, impliquant un
processus d’abstraction et d’homogénéisation à la fois tributaire de l’histoire des
représentations et de celle du système économique. En somme, pour pouvoir proclamer
l’obscénité du travail, il faut encore être sûr que ce que le travail désigne à un moment donné
– il y a là une recherche tout aussi vaste que nécessaire à mener pour fonder la légitimité de
2 Yannick Mancel, « Travailler ou ne pas… telle est la question », in Michel Azama (dir.), De Godot à Zucco :
anthologie des auteurs dramatiques de langue française, 1950-2000, vol. 3 Le Bruit du monde, Paris, Editions
Théâtrales / SCÉREN-CNDP, 2004.
3 Du moins faudrait-il inscrire cette dénégation dans la question bien plus large de la représentation de la réalité
et prendre acte du fait qu’il a fallu peu ou prou attendre le XVIIIe siècle pour que la prose du monde fasse son
entrée sur les scènes – et dans les discours – sous une forme réaliste. Sur ce point, voir notamment Erich
Auerbach, Mimésis. La représentation de la réalité dans la littérature occidentale (1946), Paris, Gallimard, coll.
« Tel », 1968, chap. XV, p. 365-394 ; Michel Foucault, « La vie des hommes infâmes » (1977), in Dits et écrits
1954-1988, t. 3, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des sciences humaines », 1994, p. 251 et suivantes.

Travailler sur scène / 14 février 2008
Journée d’étude organisée par le Groupe Théâtre(s) politique(s)
3
notre périodisation, à savoir les XIXe, XXe et XXIe siècles, mais aussi celle des outils
théoriques que nous serons susceptibles de solliciter.
Dans ce cadre, le XVIIIe siècle nous intéresse néanmoins à titre de prolégomènes.
S’agissant de La Brouette du vinaigrier, pièce qui fait effectivement office de manifeste, on
observe que l’activité laborieuse de Dominique produisant et vendant vinaigre et moutardes
reste cantonnée dans le hors-scène. Nous voyons un artisan dont la brouette et les habits
permettent immédiatement d’identifier la condition, leur apparition étant clairement mise en
valeur, dans le texte, comme une transgression des convenances sociales et dramatiques en
vigueur4 : « Qu’est-ce que cela veut dire ? on n’a jamais vu pareille chose ; et certainement
vous êtes fou » (III, 1), « Qu’est-ce donc, mon père ? Qu’avez-vous donc ? Comme vous
venez ici ! Eh mon Dieu ! que voulez-vous avec tout ce train ci ? […] Vous choisissez bien
votre temps, et encore mieux le lieu. […] Quoi ! cet habit de travail, ce Baril, cette Brouette
dans une Salle frottée ! […] Vous avez résolu de m’éprouver, mon père ; mais j’ai peur que
vous ne manquiez aux convenances reçues dans le monde… » (III, 2). Nous voyons le fruit de
son travail, à savoir le baril qui contient toutes ses économies et qui occupe une place
importante dans l’intrigue puisque c’est grâce à lui qu’il pourra marier son fils à une jeune
fille de plus haute naissance. Enfin, nous entendons beaucoup deviser du travail, l’humble
« gagne-pain » de Dominique se distinguant de l’oisiveté des « têtes légères », « hardis
fripons » et « intrigants adroits » qui courent les dots comme Jullefort, mais aussi des dangers
et des incertitudes qui caractérisent le négoce auquel se consacre Delomer (il s’agit non
seulement de souligner que le rang d’honnête homme est indépendant du titre et de la fortune,
mais aussi de promouvoir ce qui se donne comme une véritable éthique économique – aux
espèces sonnantes et trébuchantes qu’a amassées Dominique à force d’épargne et de frugalité,
s’opposent en effet les placements périlleux de Delomer, ceux-ci dépendant de la bonne
moralité de ses associés de Hambourg et entraînant des effets en chaîne sur tous ses créditeurs
et débiteurs, angle sous lequel la question du capitalisme immatériel évoquée dans notre
présentation générale pourrait trouver quelques points d’accroche surprenants dans la
représentation théâtrale du négoce des XVIIIe et XIXe siècles). Toujours est-il que le travail,
présent en tant qu’état et que valeur, n’apparaît pas ici en tant que processus en acte.
Un tel constat est-il généralisable ? Certes, le contexte économique, social et
idéologique du XVIIIe siècle cesse de subordonner la question professionnelle au registre de
la satire et de la caricature et le combat mené par la bourgeoisie contre l’éthique aristocratique
fait du travail un objet régulier de débat, qu’il s’agisse de valoriser telle ou telle condition ou,
plus généralement, le fait d’avoir à travailler pour vivre5. Pour autant, arrive-t-il que l’on voie
les personnages en train de travailler ? Sans doute faut-il prendre en compte des résistances
proprement dramaturgiques. De fait, l’empire de la fable ne tolère guère l’intrusion d’une
activité dont le déroulement reste profondément hétérogène à celui de l’action dramatique. Si
tant est que le drame ait en propre d’imiter « des gens qui agissent et font quelque chose »6,
4 Notons que Mercier, dans la préface, s’en prend clairement à la distinction de la noblesse et de la bassesse,
hiérarchie ségrégative qui fonde l’ordre théâtral et l’ordre social en les articulant étroitement l’un à l’autre
puisque ces critères s’appliquent tout à la fois aux conditions, aux mœurs, aux sujets, aux genres et aux styles.
5 Sur ce point, voir notamment la réhabilitation du négoce que propose Le Fils naturel de Diderot :
« CLAIRVILLE. Je commercerai. / DORVAL. Avec le nom que vous portez, auriez-vous ce courage ? /
CLAIRVILLE. Qu’appelez-vous courage ? Je n’en trouve point à cela. Avec une âme fière, un caractère inflexible,
il est trop incertain que j’obtienne de la faveur la fortune dont j’ai besoin. Celle qu’on fait par l’intrigue est
prompte, mais vile ; par les armes, glorieuse, mais lente ; par les talents, toujours difficile et médiocre. Il est
d’autres états qui mènent rapidement à la richesse ; mais le commerce est presque le seul où les grandes fortunes
soient proportionnées au travail, à l’industrie, aux dangers qui les rendent honnêtes » (III, 5).
6 Aristote, Poétique, chap. III, 1448a, trad. fr. M. Magnien, Paris, Le Livre de poche, 1990, p. 88.

Travailler sur scène / 14 février 2008
Journée d’étude organisée par le Groupe Théâtre(s) politique(s)
4
force est de reconnaître que cette praxis qui résulte d’un choix délibéré se distingue
radicalement de la poïesis dont relève l’activité laborieuse, activité assujettie au besoin et dont
la régularité quotidienne s’oppose au déploiement linéaire d’une intrigue dont on a longtemps
exigé qu’elle ait un début, un milieu et une fin et que chacune de ses étapes soit fermement
soudée l’une à l’autre.
Reste que, sous ce prisme, le drame du XVIIIe siècle contribue également à faire céder
certaines résistances. Il faut en effet noter que les exigences réalistes qui émergent à cette
période permettent de renouveler profondément la représentation et ouvrent sur « une
esthétique du tableau » (l’expression est de Pierre Frantz) dont on peut considérer qu’elle est
une condition de possibilité de la figuration théâtrale du travail comme procès :
« Placé en général au début d’un drame, ou au début d’un acte, le tableau-stase permet la mise en place
d’une atmosphère générale, d’un cadre pour l’action. Souvent totalement pantomime, il propose la
découverte des personnages dans un état d’avant la parole et d’avant l’action. […]
En général, lorsque le rideau se lève, on découvre les personnages s’adonnant à leur activité coutumière
ou professionnelle. […] La Laure de Jean Hennuyer [Mercier – I, 1] range du linge dans une armoire.
M. Dabelle, Chef de bureau, est assis et fait du courrier [Mercier, Jenneval – I, 1]. M. de Leurye, le
juge, en robe de chambre et en bonnet de nuit, est assis devant un bureau et “courbé sur des papiers
qu’il lit avec une profonde attention ; deux bougies presque entièrement consumées sont à gauche. Il a
un coude appuyé sur la table, et il couvre son front de sa main” [Mercier, Le Juge – I, 1]. L’orphelin
anglais, menuisier, est à son établi et travaille [Longueil, L’Orphelin anglais – I, 1]. […] Activités sages
et ordinaires, extérieures et antérieures à l’action dramatique qui vient les perturber, ou qui vient au
moins faire contraste avec elles. Elles inscrivent cette action par avance dans la représentation d’une
“réalité” sociale. […]
Certes, au moment où se lève la toile d’une tragédie ou d’une comédie classiques, l’exposition évoque
un avant et un autour, un hier et un appartement pour Titus et Bérénice. Mais c’est de l’action
commençante qu’ils se désignent. Et cette action, parce qu’elle est théâtrale, ne renvoie pas à un univers
ordinaire qui authentifierait la fiction de son effet de réel. Racine n’a nul besoin de nous montrer Titus
dans son “métier” de roi “ordinaire” ; l’ordinaire n’existe pas dans l’univers des tragiques. Dans le
drame bourgeois, dans le tragique domestique, dans la comédie sérieuse, dans la tragédie
“néoclassique”, en un mot dans tous les genres nouveaux du XVIIIe siècle, l’extraordinaire de l’action
doit se lier à l’ordinaire du réel pour obtenir un effet de vérité. D’où l’exhibition du travail
domestique »7.
Si « l’ordinaire du réel » constitue essentiellement une toile de fond susceptible de favoriser
l’illusion et de mettre en valeur l’irruption de l’action qui s’en détache, si, par ailleurs, le
cadre tout à la fois domestique et bourgeois que privilégient ces pièces maintient logiquement
un certain nombre d’activités professionnelles à la marge de la représentation, du moins la
temporalité spécifique de ces activités fait-elle ses premières incursions sur scène. Cela ne va
d’ailleurs pas sans provoquer de nombreuses réticences de la part des comédiens. Ainsi de la
scène 1 de l’acte II du Père de famille de Diderot, « scène composée » qui entrelace le
dialogue du Père et de son intendant avec le jeu, en partie muet, des personnages féminins,
une marchande de toilettes accompagnée d’une de ses ouvrières déployant toutes sortes de
tissus devant Cécile. Or cette pantomime a été supprimée lors de la création de la pièce à la
Comédie-Française, tant la chose paraissait nouvelle et faisait craindre les réactions de
spectateurs peu enclins à suivre plusieurs actions à la fois et à accepter que « quelque chose se
passe sur scène en dehors de ce qui se dit entre deux personnages »8. De même, on pense aux
« jeux d’entracte » que ménage Beaumarchais dans Eugénie (1767) et qui montrent
précisément les domestiques en train de travailler :
7 Pierre Frantz, L’Esthétique du tableau dans le théâtre du XVIIIe siècle, Paris, PUF, coll. « Perspectives
littéraires », 1998, p. 157-160.
8 Ibid., p. 162.

Travailler sur scène / 14 février 2008
Journée d’étude organisée par le Groupe Théâtre(s) politique(s)
5
« Un domestique entre. Après avoir rangé les sièges qui sont autour de la table à thé, il en emporte le
cabaret et vient remettre la table à sa place auprès du mur de côté. Il enlève des paquets dont quelques
fauteuils sont chargés, et sort en regardant si tout est bien en ordre.
(L’action théâtrale ne reposant jamais, j’ai pensé qu’on pourrait essayer de lier un acte à celui qui le suit
par une action pantomime qui soutiendrait, sans la fatiguer, l’attention des spectateurs, et indiquerait ce
qui se passe derrière la scène pendant l’entr’acte. Je l’ai désignée entre chaque acte. Tout ce qui tend à
donner de la vérité est précieux dans un drame sérieux, et l’illusion tient plus aux petites choses qu’aux
grandes. Les Comédiens Français, qui n’ont rien négligé pour que cette pièce fît plaisir, ont craint que
l’œil sévère du public ne désapprouvât tant de nouveautés à la fois ; ils n’ont pas osé hasardé les
entr’actes…) »
Dans le cadre de cette histoire forcément hâtive (dont les interventions d’Odile
Krakovitch et de Marjorie Gaudemer permettront heureusement de combler certaines
lacunes), le moment naturaliste est fondamental : non seulement il ouvre définitivement le
spectre social en s’intéressant aux couches populaires et donc à des métiers encore peu
représentés, mais l’importance désormais accordée au milieu et la révolution scénique qui
permet de l’incarner impliquent un souci d’exactitude inédit dans la représentation du réel.
Ainsi, Zola rêve d’en finir avec les « ouvriers pleurnichards » des mélodrames et les « décors
bâclés » des féeries pour placer la scène « dans le carré des Halles centrales », dans
« l’intérieur d’une usine » ou « l’intérieur d’une mine » : « Puisque tout le monde se lamente
sur la mort du drame, nos auteurs dramatiques devraient bien tenter ce genre du drame
populaire et contemporain. Ils pourraient y satisfaire à la fois les besoins de spectacle
qu’éprouve le public et les nécessités d’études exactes qui s’imposent chaque jour
davantage »9. S’il est moins question ici de l’activité laborieuse en tant que telle que du
peuple, de ses métiers, de ses habits et de ses lieux de vie, on comprend néanmoins que la
représentation du travail sur scène est tributaire de l’évolution des techniques scéniques, mais
aussi des fonctions que l’on assigne au théâtre, sachant que « les besoins de spectacle » ne
font pas forcément bon ménage avec « les nécessités d’études exactes », les uns et les autres
offrant deux pôles distinctifs dont on pourra éventuellement tester la pertinence sur les
différents exemples que nous rencontrerons au fil de nos recherches. Du reste, l’utopie
zolienne mériterait fort d’être mise à l’épreuve de ses réalisations et des résistances qu’elles
attestent. L’adaptation théâtrale des romans de Zola montre bien qu’il n’est pas si aisé de faire
entrer sur scène des corps au travail, au regard des bienséances comme des règles de l’action
dramatique, et l’étude qu’Anne-Françoise Benhamou a consacrée à la genèse dramatique de
L’Assommoir souligne avec précision les tensions qui ne cessent d’opposer le document et le
mélodrame, la « représentation d’une vérité » et la « recherche du spectaculaire »10.
Voilà donc l’amorce d’une réflexion historique qui incite à articuler l’évolution des
représentations sociales et idéologiques du travail, celle des conventions théâtrales
(bienséances et règles de composition dramaturgique), celle, enfin, des techniques scéniques.
Amorce qui exige de continuer le travail de repérage commencé et qui gagnerait à s’ouvrir sur
l’étranger. Cela est d’autant plus nécessaire que cette histoire, pour le moment, articule la
9 Emile Zola, « Le costume », in Le Naturalisme au théâtre, Paris, Editions Complexe, coll. « Le Théâtre en
question », 2003, p. 114.
10 Cf. Anne-Françoise Benhamou, « Du hasard à la nécessité : L’Assommoir au théâtre », in Jean-Pierre Sarrazac
(dir.), Mise en crise de la forme dramatique 1880-1910, Etudes théâtrales, n° 15-16, 1999, p. 19-29. Cette étude
revient notamment sur la scène du lavoir, tableau conçu par William Busnach pour des raisons strictement
fonctionnelles (légitimer le retournement de fortune de Gervaise et Copeau en remplaçant le hasard de la chute
par la nécessité d’une vengeance dont la fameuse fessée constitue désormais le moment déclencheur) et qui,
paradoxalement, se trouve être « le seul moment du spectacle à porter sur la scène ce que Zola s’était attardé si
longtemps et si poétiquement à décrire dans son roman : le monde du travail, absent de tous les autres tableaux »
(p. 24). Ainsi, Alphonse Daudet, décrivant l’animation des femmes maniant leurs battoirs au milieu des baquets
fumants affirmera que « l’intérieur d’un temple de Bouddha n’aurait pas paru plus étrange et plus neuf ».
 6
6
 7
7
1
/
7
100%