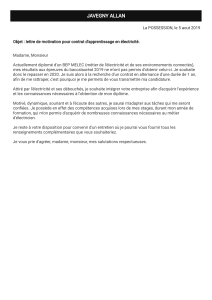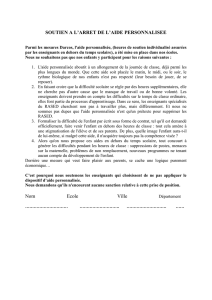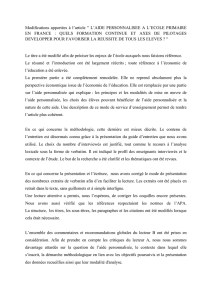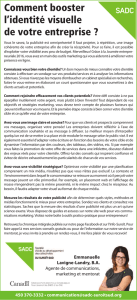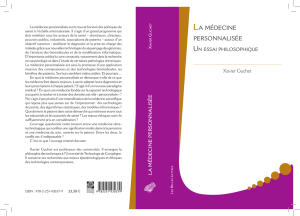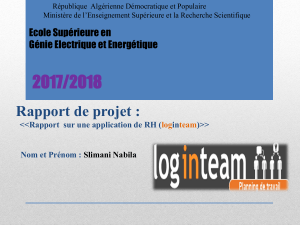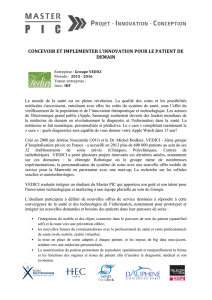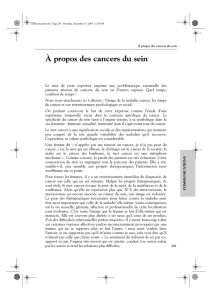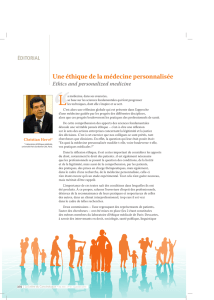“ L Médecine personnalisée, un modèle de partage d’information

“
374 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XXII - n° 10 - novembre 2013
AVANT-PROPOS
Médecine personnalisée,
un modèle departage d’information
pour unmeilleur consentement
Personalized medicine sharing information
forabetter consent
F. Scotté 1,2,3,
P.Leroy 2, 3,
M.F.Mamzer 3, 4,
C.Hervé 3
1 Service d’oncologie médicale,
hôpital européen Georges-Pompidou,
Paris.
2 Unité fonctionnelle de soins
oncologiques de support,
hôpital européen Georges-Pompidou,
Paris.
3 Laboratoire d’éthique médicale,
université Paris Sorbonne Cité, Paris.
4 Service de néphrologie adultes,
hôpital Necker-Enfants malades, Paris.
La médecine personnalisée a été défi nie, par le directeur américain duconseil
pourles sciences et les technologies (President’s Council of Advisors
onScience and Technology), comme “l’adaptation des traitements médicaux
auxcaractéristiques individuelles de chaque patient; le but est de classer les personnes
dans des sous-populations en fonction de leur susceptibilité à certaines maladies
oude leur réponse à certains traitements. Ainsi, la prévention et les traitements seront
proposés à ceux dont on sait qu’ils pourront en bénéfi cier et ainsi limiter les dépenses
etles eff ets secondaires…”(1).
Introduction à la problématique
Les progrès permanents de la médecine, tant d’un point de vue technologique
etthérapeutique qu’organisationnel, repoussent les limites de l’incurabilité, de la vie.
C’est ainsi que, dans le cadre d’une maladie cancéreuse, les données épidémiologiques
européennes montrent que plus d’un patient sur deux vit avec sa maladie (étude
EUROCARE4)[2]. En France, par exemple, près de 360 000nouveaux cas ont été
diagnostiqués en 2010, et l’on comptait près de 150 000décès dans lemême temps
(données de l’Institut de veille sanitaire et de l’Institut national du cancer)[3].
Denombreuses explications peuvent être avancées, dont l’amélioration
destechniques de diagnostic et de dépistage, mais également l’amélioration
de la qualité des soins, complémentaire d’immenses progrès dans le domaine
destraitements anticancéreux. Parmi ceux-ci, les thérapeutiques ciblées représentent
le principal eff ort de recherche. La notion de médecine personnalisée a ainsi été
défi nie et correspond, dans sa défi nition américaine, aux “formes de médecine
quiutilisent des informations sur le génome, les protéines et l’environnement
delapersonne dans le but de prévenir, diagnostiquer et traiter la maladie”(4,5).
Cette défi nition, en cancérologie, inclut la compréhension du mode d’action
et de l’effi cacité des traitements ainsi que la possibilité de poser un pronostic.
Unsynonyme fait également partie de cette défi nition émise par l’Institut national
ducancer américain : médecine de précision.
Diff érentes problématiques doivent alors être posées : la médecine personnalisée
correspond-elle exclusivement à une médecine moléculaire ? comment intégrer
cesdonnées moléculaires à la notion d’environnement tumoral ? faut-il prendre
encompte la notion de personne au sens large, à savoir l’environnement
génomique mais également le contexte de vie, les habitus, les comorbidités,
lesspécifi cités dechacun ? l’histoire de la maladie, le vécu de celle-ci, le choix
dupatient etdesesproches doivent-ils avoir un poids dans la décision ? au regard
decesrésultats moléculaires et des données d’études, comment annoncer, informer
ou encore s’assurer que l’information autour de cette personnalisation est bien
comprise et intégrée par chaque acteur du parcours du malade afi n de lui laisser
la possibilité d’un choix éclairé? quelle attitude tenir face à l’effi cacité, comme
àl’ineffi cacité, des traitements ciblés? quelle attitude avoir lorsqu’il s’agit d’expliquer

La Lettre du Cancérologue • Vol. XXII - n° 10 - novembre 2013 | 375
AVANT-PROPOS
cemécanisme moléculaire, mais également en cas d’absence de cible,
et que faire alors ? quel est l’impact pour la recherche?
Cette prise en compte de la personne transcende l’aspect moléculaire
et pourrait faire partie intégrante de la démarche développée dans le contexte
de la recherche, etnotamment au sein des centres de lutte contre le cancer (4).
CARPEM, développé par des équipes de l’université Paris Sorbonne Cité,
a pour mission de répondre à un programme de recherche afi n detrouver
lesmeilleures thérapeutiques et indications pour les nouveaux traitements ciblés.
Il inclut parmi ses équipes le département médecine éthique et vulnérabilité,
dans lebut, notamment, de réfl échir à l’articulation des diff érents pôles
derecherche, depuis lesplateformes biologiques jusqu’aux plateformes cliniques,
enintégrant lesentrepôts de données, et de défi nir le parcours de l’information
et du patient entre ces équipes.
L’information
Annoncer une nouvelle, qu’elle soit bonne ou mauvaise, tient d’abord aufait
demaîtriser les données à transmettre. Les chemins de l’information reçue
etdélivrée doivent être, pour cela, fl uides. Que l’on annonce une maladie,
unerémission ou un arrêt des traitements, que l’on explique un essai thérapeutique,
la notion deconsentement éclairé implique une connaissance précise des diff érentes
données dans le but de pouvoir les expliciter.
La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système
desanté consacre une place essentielle au consentement et à l’information
despatients et introduit la notion de personne de confi ance dans la relation
médecin-malade (6). Cette information du patient était déjà une obligation
déontologique pour les médecins prévue par l’article35 du code de déontologie
médicale (7). Il faut cependant garder à l’esprit, dans l’évaluation de nos pratiques,
le trop fréquent fossé qui existe entre ce que le praticien pense avoir donné comme
information et ce que le patient a entendu(8).
Dans le cadre de la médecine personnalisée, le médecin doit intégrer et faire
comprendre des notions aussi complexes que les voies de signalisation intracellulaire,
les propriétés et modes d’action des nouvelles thérapies, leur intérêt en termes
detaux de réponse, de survie sans récidive ou de survie globale, puis il doit expliquer
l’intérêt d’intégrer des programmes de recherche.
La médecine personnalisée au temps de la recherche
L’enjeu de la médecine personnalisée, pour le milieu cancérologique, reste avant
tout de développer de nouvelles thérapeutiques et de permettre une sélection
des patients en fonction de critères de choix moléculaires afi n de leur proposer
les traitements les plus adaptés (9). L’équipe du programme SIRIC du Gustave-
Roussy Cancer Campus (GRCC) a présenté à l’oral, lors du congrès de l’association
américaine de cancérologie clinique à Chicago, au printemps dernier, les résultats
deson étude multicentrique prospective menée dans le cadre du cancer du sein(10).
Il a été rappelé que l’objectif de la médecine personnalisée est d’identifi er une cible
pour traiter la maladie cancéreuse, le processus consistant à défi nir le type tumoral
d’une patiente, puis son profi l moléculaire, afi n d’en déterminer les altérations
accessibles au développement d’une thérapeutique spécifi que. La question posée
par l’essai SAFIR01 était celle de l’application de ce concept aux patientes atteintes
d’un cancer du sein métastatique. Le processus de cette étude menée auprès

376 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XXII - n° 10 - novembre 2013
AVANT-PROPOS
de404patientes a consisté en une première phase de biopsies tumorales de malades
en phase de stabilisation ou de réponse tumorale. Par la suite, une analyse génomique
avec séquençage de zones spécifi ques était réalisée, suivie del’identifi cation
d’altérations génomiques pouvant servir de cible à unethérapeutique existante.
Cette identifi cation était menée de manière multicentrique et multidisciplinaire.
Untraitement ciblé était alors administré lors de la progression tumorale,
etlesrésultats en termes de réponse tumorale recueillis. Au cours de ce processus,
l’ensemble des données étaient analysées grâce à l’intervention de bio-informaticiens
en lien avec un entrepôt de données (nouveau temps spécifi que et indispensable
pour lagestion des informations récupérées, et enjeu majeur de l’éthique en termes
detraitement et de gestion de l’information) [11].
Chaque temps de l’analyse a été détaillé lors de cette présentation, en mettant
enavant des résultats importants à chacune de ces phases, et en rappelant
quel’objectif principal était d’évaluer la faisabilité d’une telle recherche dans le cadre
ducancer du sein métastatique. Des biopsies ont été réalisées chez 404patientes,
dont 287 (71%) ont pu avoir un séquençage génomique complet.
En eff et, 29 %desbiopsies étaient ininterprétables ou comportaient un matériel
tumoral non éligible pour l’étude. Les métastases hépatiques et ganglionnaires ont
été ici défi nies comme ayant les meilleures chances d’obtenir un test génomique
de qualité. Ce résultat met en avant un nouveau niveau de sélection des patients
en fonction de leurs sites métastatiques. Parmi ces patientes, 194 (67 %) ont eu
l’identifi cation d’une altération génomique accessible à un traitement ciblé.
Lesprincipales altérations ont ainsi été présentées. Il a été mis en évidence que
legroupe des altérations les plus rares était en fréquence supérieur aux altérations
individuelles les plus couramment retrouvées.
Sur ces 194patientes, 48 (25 %) ont réellement bénéfi cié d’un traitement ciblé
(soit 12 % des patientes initialement biopsiées). Le taux de réponse globale
obtenu a été de 9 % sur ces 48patientes, et 19 % avaient une maladie stabilisée
à plus de16semaines. Au total 12patientes sur les 404biopsiées (3 %) ontpu
bénéfi cier decette procédure. Les discussions ont concerné l’amélioration
delaqualité des biopsies et de la détection des altérations génomiques, ainsi que
la nécessité d’améliorer l’algorithme de recherche de la sensibilité desaltérations
auxthérapeutiques ciblées, d’où l’importance d’une collaboration étroite,
d’unepart, avec les bio-informaticiens et les entrepôts de données (pour déterminer
lessensibilités) et, d’autre part, avec les industriels (pour améliorer l’accès
auxthérapeutiques). F.André a terminé sa présentation autour delanécessité
d’évaluer l’utilisation médicale (en pratique clinique) de cetteapproche
etd’augmenter le recrutement des patients dans des essais thérapeutiques.
Onenrevient donc à l’importance del’information pour mobiliser les malades
vers un eff ort de recherche.
Développement du programme CARPEM
Le projet CARPEM recherche le même objectif que celui du GRCC,
àsavoir élaborer une recherche translationnelle, fondamentale et clinique,
afi ndedécouvrir et développer des thérapeutiques ciblées effi caces et d’optimiser
ainsi le traitement des patients atteints de cancer. Les buts fi xés dans le cadre
deceprogramme sont:
➤améliorer la compréhension des mécanismes de la cancérogenèse et du micro-
environnement tumoral;
➤identifi er des biomarqueurs pronostiques et théranostiques;
➤développer de nouvelles thérapeutiques.

”
378 | La Lettre du Cancérologue • Vol. XXII - n° 10 - novembre 2013
AVANT-PROPOS
Ce numéro est routé avec le supplément 1 “Controverses dans le traitement chirurgical des métastases hépatiques
et nouveautés dans le traitement médical des tumeurs neuroendocrines digestives (TNED)” (12 pages).
Crédits photos : © Mikey_Man et © Sylwia Nowik
Les articles publiés dans
La Lettre duCancérologue
le sont sous la seule responsabilité de leurs auteurs.
Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.
© mai 1992 - EDIMARK SAS - Dépôt légal : à parution - Imprimé en France - Point 44 - 94500 Champigny-sur-Marne
Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
Afi n de permettre un meilleur accompagnement de ces patients,
dansuneapproche globale de la personne malade dans son environnement, il a
semblé indispensable d’associer au programme CARPEM un temps de réfl exion
éthique. L’objectif de ce temps est d’aider au lien entre les diff érentes plateformes
intervenant dans le parcours de recherche et de prise en charge du malade. Il est
apparu incontournable de placer l’information au cœur de cette réfl exion, afi n :
➤d’améliorer la compréhension de chacun de ces intervenants par un juste partage
des savoirs;
➤d’anticiper l’information et le consentement autour de la présence ou de l’absence
d’une cible thérapeutique, voire de la perte d’effi cacité du traitement sur cette cible;
➤d’harmoniser les relais de l’information pour une cohérence et une adhésion de tous
les acteurs décisionnels.
Le développement de cette recherche éthique s’est appuyé sur 4temps
particuliers. Le premier est une analyse du niveau d’information et du lien entre
leséquipes avec, notamment, une évaluation du circuit de la recherche et duniveau
d’information des diff érents acteurs. Le deuxième s’appuie sur l’élaboration
d’undocument d’information et de recueil du consentement, travaillé en lien
étroit avec des équipes de linguistes et de psychologues. Le troisième devra
consister en une diff usion de cette information, et aboutir à un quatrième temps
de mise en pratique, avec proposition de création d’une réunion de concertation
pluridisciplinaire ou d’une unité fonctionnelle d’aide à la prise de décision.
La réalisation de ce travail de recherche au sein du CARPEM s’appuie
sur2comités. Un premier comité, “d’interface”, a pour objectif d’off rir un partage
del’information et des problématiques posées au sein de chacune des plateformes
de recherche. Un second comité, “patients”, a pour rôle d’analyser et de valider
leséléments d’information développés par les équipes de recherche.
De manière institutionnelle, un comité d’éthique clinique a été développé
surlesite, et s’enrichira à terme des travaux du groupe CARPEM, avec appropriation
desprocessus d’information.
Les regards, problématiques théoriques et pratiques, seront partagés
àtravers ce programme, qui réunit, dans le cadre du groupe éthique, chercheurs
fondamentalistes et cliniciens, acteurs des diff érentes plateformes d’examens,
praticiens cliniciens médicaux et non médicaux, et patients, afi n de défi nir au mieux
les contours de la personnalisation et l’aide au développement de la recherche
encedomaine.
Il s’agit là d’un véritable eff ort de création et de mobilisation d’une réfl exion
éthique dans le cadre de la recherche sur la médecine personnalisée optimisée
grâce au juste partage de l’information pour un consentement éclairé de qualité
au profi t du malade.
Références
bibliographiques
1. President’s Council of Advi-
sors on Science and Techno-
logy. Priorities for personalized
medicine. www.whitehouse.gov/
fi les/documents/ostp/PCAST/
pcast_report_v2.pdf
2. Istituto Superiore di Sanità.
http://www.eurocare.it
3. Institut de veille sanitaire.
www.invs.sante.fr
4. National Cancer Institute.
www.cancer.gov/dictionary?
CdrlD=561717
5. Doz F, Marvanne P, Fagot-
Largeault A. The person in perso-
nalised medicine. Eur J Cancer
2013;49(5):1159-60.
6. Loi n° 2002-303 du 4 mars
2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du
système de santé.
7. Code de déontologie médicale.
8. Ghrea M, Dumontier C,
Sautet A, Hervé C. Quality
of information transfer for
informed consent: an experi-
mental study in 21 patients. Rev
Chir Orthop Reparatrice Appar
Mot 2006;92(1):7-18.
9. André F, Ciccolini J, Spano JP
et al. Personalized medicine in
oncology: where have we come
from and where are we going?
Pharmacogenomics 2013;14(8):
931-9.
10. André F, Bachelot TD,
Campone M et al. Array CGH
and DNA sequencing to perso-
nalize targeted treatment of
metastatic breast cancer (MBC)
patients (pts): A prospective
multicentric trial (SAFIR01).
ASCO® 2013: abstr. 511.
11. Ferté C, Trister AD, Huang E
et al. Impact of bioinformatic
procedures in the develop-
ment and translation of high-
throughput molecular classifi ers
in Oncology. Clin Cancer Res
2013;19(16):4315-25.
1
/
4
100%