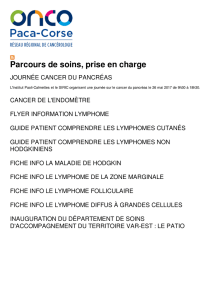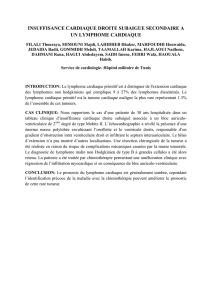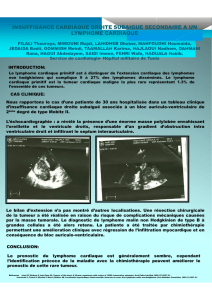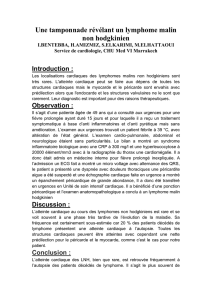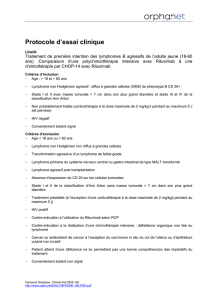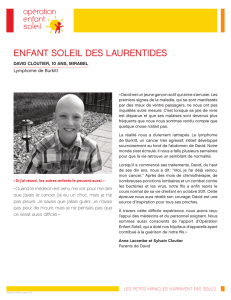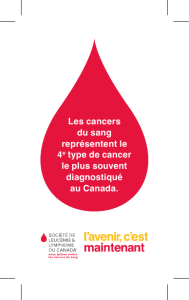Perceptions et pratiques des médecins français pour initier le diagnostic

Correspondances en Onco-hématologie - Vol. V - n° 1 - janvier-février-mars 2010
42
42
mise au point
Perceptions et pratiques
des médecins français
pour initier le diagnostic
du lymphome en 2009 :
première enquête
nationale IDiL
Perceptions and practices of French physicians to introduce
lymphoma diagnosis in 2009: 1st national enquiry IDiL
P. Feugier1, R. Delarue2, E. de Kerviler3, J.L. Gallais4,
F. Raineri5, G. Dieudonné6, A. Fonteneau7
1 Service d’hématologie
et de médecine interne, hôpital
de Brabois adultes, Nancy.
2 Service d’hématologie,
hôpital Necker-Enfants malades, Paris.
3 Service de radiologie,
hôpital Saint-Louis, Paris.
4 Directeur du Conseil scientifi que
de la Société française
de médecine générale (SFMG).
5 Responsable de la formation
à la SFMG.
6 Vice-président de l’association
France Lymphome Espoir.
7 Membre du bureau de l’association
France Lymphome Espoir.
R
ÉSUMÉ
♦
Destinée à mieux connaître les pratiques
d’initiation du diagnostic du lymphome en France,
l’association de patients France Lymphome Espoir
a pris l’initiative de réaliser l’enquête
Initiation
du diagnostic du lymphome
(IDiL). Cette première
enquête nationale a été menée auprès d’une
population de 1 007 médecins généralistes, 100 ORL
et 100 radiologues. Devant la description d’une
symptomatologie évocatrice, le lymphome a été la
première pathologie spontanément évoquée par les
généralistes (30 % de citations) et les radiologues
(69 % de citations) et la deuxième pathologie citée
par les ORL (15 % de citations), derrière les cancers
de la sphère ORL (52 % de citations). La découverte
du dernier cas de lymphome auquel le médecin s’est
trouvé confronté a été fortuite dans la moitié des
cas, quelle que soit la cible interrogée. En moyenne,
le délai entre la première consultation et le jour du
diagnostic a été estimé à 1 mois par les généralistes
et à 3 semaines par les ORL.
Selon leur spécialité, deux tiers à trois quarts des
médecins rencontrent des diffi cultés pour établir
ce diagnostic. La symptomatologie polymorphe,
principale raison avancée pour expliquer le
retard diagnostique, conduit les patients vers des
parcours variés plutôt qu’un “parcours idéal”.
Le besoin d’information exprimé par les médecins
interrogés représente un des leviers d’action qui
pourrait contribuer à harmoniser les pratiques
et à réduire le délai du diagnostic.
Mots-clés : Lymphome non hodgkinien – Lymphome
hodgkinien – Diagnostic – Médecin généraliste (MG) –
ORL – Radiologue.
Summary. To have thorough knowledge of the
practices of lymphoma diagnosis initiation in
France the France Lymphome Espoir patients’ group
took the initiative to realize the IDiL (Initiation of
Lymphoma Diagnosis) enquiry, this fi rst national
enquiry was conducted by phone on a population
of 1,007 general practitioners (GPs), 100 ENT
specialists and 100 radiologists. When faced by a
suggested symptomatology description, lymphoma
was the 1st pathology spontaneously evoked by
GPs (30% of quotations) and radiologists (69% of
quotations) and the 2nd pathology quoted by ENT
specialists (15% of quotations) after ENT cancers
(52% of quotations). The last case of lymphoma
to which the physician was confronted, was a
fortuitous discovery in half of the cases, regardless
of the questioned target. The average delay between
the 1st consultation and the established diagnosis
was estimated to be 1 month for GPs and 3 weeks
for ENT specialists. Depending on their speciality,
two thirds to three quarters of the physicians
were faced with diffi culties in establishing this
diagnosis. Polymorphic symptomatology, main
reason advanced to explain the delayed diagnosis,
leads patients to varied medical courses more than
to an “ideal course”. The need for information
expressed by the physicians questioned, represents
one of the leverages which could contribute
to harmonize the practices and to reduce the
diagnosis delay.
Keywords: Non-Hodgkin lymphoma – Hodgkin’s
disease – Diagnosis – General Practitioner – ENT
specialist – Radiologist.

43
43
Correspondances en Onco-hématologie - Vol. V - n° 1 - janvier-février-mars 2010
Initiation du diagnostic du lymphome :première enquête nationale
CONTEXTE
Avec 12 651 nouveaux cas estimés en France et
4 912 décès, les lymphomes malins non hodgki-
niens (LMNH) se situaient en 2006 au sixième rang
des cancers en termes d’incidence chez l’adulte et
au huitième rang des décès par cancer, loin devant
le lymphome de Hodgkin (au vingtième rang chez
l’homme et au vingt et unième rang chez la femme
en 2005) [5, 6]. Si l’incidence et la mortalité du
lymphome de Hodgkin sont en constante diminu-
tion depuis de nombreuses années, l’incidence
des LMNH présente une forte progression dans
les deux sexes : près de 5 % par an entre 1980 et
2005 (6). Leur fréquence ainsi que l’augmenta-
tion de l’incidence des LMNH ne semblent pas
avoir rendu pour autant ce cancer plus familier
en dehors des milieux hématologiques. Malgré
une démarche diagnostique établie (1, 2), les
témoignages des patients rapportent des par-
cours complexes et un certain retard avant que le
diagnostic de lymphome ne soit posé par l’héma-
tologue (3). Face à cette situation, l’association
France Lymphome Espoir (FLE) a pris l’initiative
de réaliser une première enquête nationale des-
tinée à mieux appréhender les pratiques d’initia-
tion du Diagnostic du Lymphome en France (4).
Cette enquête, qui porte le nom d’Initiation du
diagnostic du lymphome (IDiL), a été réalisée par
l’institut BVA, avec le soutien institutionnel du
laboratoire pharmaceutique Roche sous l’égide
d’un comité de pilotage constitué de 2 hémato-
logues, de 1 radiologue, de 2 généralistes et de
2 représentants de l’association FLE.
MÉTHODOLOGIE
Enquête rétrospective et déclarative, IDiL a été
menée auprès de médecins principalement impli-
qués dans le processus d’initiation du diagnostic
du lymphome. Les entretiens ont été réalisés par
téléphone du 16 février au 6 mars 2009 auprès
de 1 207 médecins exerçant sur le territoire fran-
çais et répartis en 3 échantillons en fonction de
leur spécialité (1 007 généralistes, 100 ORL et
100 radiologues). La représentativité de chacun
des échantillons a été assurée par la méthode
des quotas appliquée aux variables suivantes :
sexe, mode d’exercice (cabinet individuel, cabi-
net de groupe, hôpital pour les radiologues) et
répartition géographique (tableau). Le question-
naire avait pour objectif de contribuer à un état
des lieux des perceptions et des habitudes des
médecins en matière d’initiation du diagnostic
de lymphome : connaissances, stratégies diag-
nostiques, diffi cultés rencontrées, attentes en
matière d’informations. Les entretiens télépho-
niques ont duré 12 minutes en moyenne. Le ques-
tionnaire comprenait 11 à 16 questions fermées
Tableau. Structure des échantillons de médecins interrogés en fonction de leur spécialité.
Généralistes
(n = 1 007) ORL
(n = 100) Radiologues
(n = 100)
Sexe
• Homme (%)
• Femme (%)
73
27
87
13
73
27
Âge
• < 40 ans (%)
• 40 à 49 ans (%)
• ≥ 50 ans (%)
17
25
58
5
25
70
23
23
54
Ancienneté de l’exercice au sein du cabinet
• < 10 ans (%)
• 10 à 19 ans (%)
• ≥ 20 ans (%)
29
21
50
22
28
50
9
51
40
Mode d’exercice
• Individuel (%)
• Cabinet de groupe (%)
• Hôpital (%)
45
55
–
22
28
–
42
27
31
Type d’activité
• Libérale exclusive (%)
• Hospitalière exclusive (%)
• Mixte, libérale et hospitalière (%)
• Mixte, libérale et salariée autre
qu’hospitalière (%)
80
–
11
9
52
–
46
2
47
40
12
1
Lieu de l’activité hospitalière
• Centre hospitalier universitaire ou
centre hospitalier régional (%)
• Centre hospitalier (%)
• Autre établissement (%)
–
–
–
–
–
–
62
31
7
Nombre moyen d’actes par semaine
• < 100 (%)
• Entre 100 et 120 (%)
• > 120 (%)
• NSP/refus (%)
31
38
29
2
55
32
11
2
–
–
–
–
Agglomération d’exercice
• Parisienne (%)
• > 100 000 habitants (%)
• De 20 000 à 100 000 habitants (%)
• De 2 000 à 20 000 habitants (%)
• < 2 000 habitants (%)
• NSP/refus (%)
10
25
18
33
13
1
18
34
33
14
–
1
19
42
28
11
–
–
NSP : ne se prononce pas.

Correspondances en Onco-hématologie - Vol. V - n° 1 - janvier-février-mars 2010
44
44
mise au point
dont certaines permettaient le recueil de com-
mentaires. Les réponses aux questions ont été
analysées de façon quantitative et exprimées
sous forme de pourcentage.
RÉSULTATS
✔
Attitude du médecin face à une symptoma-
tologie évocatrice de lymphome
Il a été demandé aux médecins de citer les 3 pre-
miers diagnostics évoqués devant la description
d’un patient adulte consultant pour la première
fois et présentant une adéno pathie unique ou
des adénopathies multiples persistantes depuis
plus de 1 mois, avec ou sans signes généraux
(perte de poids, fi èvre, sueurs nocturnes, fati-
gue, malaises, démangeaisons, douleurs abdo-
minales, etc.) [fi gure 1]. Face à la description de
symptômes compatibles avec un diagnostic de
lymphome, les généralistes comme les ORL ont
déclaré demander des examens complémentaires.
Les généralistes ont prescrit surtout des examens
biologiques (92 % de citations) et moins d’exa-
mens d’imagerie (30 % de citations). Les ORL ont
déclaré prescrire autant d’examens biologiques
que d’imagerie (65 % et 69 % de citations). En pré-
sence d’adénopathies cervicales, les généralistes
ont déclaré adresser le patient à un ORL dans 61 %
des cas et à un hématologue/oncologue dans
21 % des cas. Enfi n, pour faire pratiquer l’analyse
anatomopathologique d’un ganglion, 60 % des
généralistes ont répondu adresser le patient à un
chirurgien et 25 % à un hématologue tandis que
81 % des ORL ont privilégié le chirurgien.
✔Suspicion de lymphome
et parcours du patient
Quatre-vingt-huit pour cent des généralistes ont
déclaré avoir déjà suspecté un lymphome chez un
de leurs patients ; le diagnostic a été confi rmé par
la suite pour 68 % d’entre eux. Les spécialistes se
sont trouvés plus fréquemment confrontés à un
lymphome confi rmé (88 % des ORL et 98 % des
radiologues). Pour le dernier cas de lymphome
auquel le médecin s’est trouvé confronté, la
découverte du lymphome a été fortuite dans
1 cas sur 2 quelle que soit la cible interrogée. Le
patient chez qui un lymphome était suspecté a
été orienté vers différents spécialistes en fonction
de la spécialité du médecin initialement consulté
(fi gure 2, p. 46).
Soixante-quatorze pour cent des ORL et 55 %
des radiologues ont déclaré que le patient leur
Lymphome
Médecins généralistes (n = 1 007)
Total des citations (%)
30 %
16 %
16 % 22 %
25 %
24 %
Maladie infectieuse
(sans précision)
Leucémie ou autre
hémopathie maligne
Cancer
de la sphère ORL
ORL (n = 100)
Total des citations (%)
52 %
15 %
16 % 22 %
36 %
16 %
Lymphome
Maladie infectieuse
(sans précision)
Lymphome
Radiologues (n = 100)
Total des citations (%)
69 %
9 %
8 % 9 %
37 %
13 %
Maladie infectieuse
(sans précision)
Leucémie ou autre
hémopathie maligne
Cité en premier Cité en deuxième ou en troisième
Figure 1. Trois premiers diagnostics évoqués spontanément par les médecins devant une
symptomatologie évocatrice (question : “À quelle pathologie penseriez-vous immédiatement
en premier, en deuxième, en troisième ?”).
Autres pathologies citées :
• Généralistes (nombre de citations*) : toxoplasmose (18 %), autres maladies infectieuses
virales dont mononucléose et VIH (42 %), autres maladies infectieuses bactériennes dont
tuberculose (11 %), autres cancers dont nez, gorge, oreilles (27 %).
• ORL (nombre de citations*) : leucémie ou autre hémopathie maligne (26 %), toxoplasmose
(6 %), autres maladies infectieuses virales dont mononucléose et VIH (18 %), autres maladies
infectieuses bactériennes dont tuberculose (12 %), autres cancers dont digestif (10 %).
• Radiologues (nombre de citations*) : maladies infectieuses parasitaires dont toxoplasmose
(7 %), autres maladies infectieuses virales dont mononucléose et VIH (24 %), autres maladies
infectieuses bactériennes dont tuberculose (15 %), autres cancers dont sphère ORL (28 %).
* Total supérieur à 100 % car 3 réponses possibles. Seules les pathologies correspondant à
plus de 1 % des citations sont mentionnées.
>>>

Correspondances en Onco-hématologie - Vol. V - n° 1 - janvier-février-mars 2010
46
46
mise au point
avait été adressé par un généraliste. Selon eux,
le généraliste ne suspectait pas d’hémopathie
maligne lorsqu’il leur a adressé le patient dans
79 % des cas pour l’ORL (n = 65) et dans 70 %
des cas pour le radiologue (n = 98). Lorsque le
patient était adressé au radiologue par un spé-
cialiste, la suspicion de lymphome était alors la
cause des examens complémentaires demandés
dans 73 % des cas.
✔
Diffi cultés rencontrées et retard diagnostique
Parmi les praticiens ayant suspecté un cas de
lymphome confi rmé par la suite, 32 % des géné-
ralistes, 25 % des ORL et 30 % des radiologues
ont déclaré n’avoir rencontré aucune diffi culté
pour établir le diagnostic ; les autres ont cité le
polymorphisme clinique de la maladie (39 % des
généralistes, 37 % des ORL et 41 % des radio-
logues) comme principale diffi culté. Ont éga-
lement été répertoriées des diffi cultés liées au
circuit de soins (24 % des généralistes, 13 % des
ORL et 13 % des radiologues), à un manque de
connaissance de la maladie (22 % des généra-
listes, 38 % des ORL et 17 % des radiologues) ou
au comportement du patient (17 % des généra-
listes, 18 % des ORL et 6 % des radiologues). En
moyenne, le délai entre la première consultation
et le jour du diagnostic a été estimé à 1 mois par
les généralistes et à 3 semaines par les ORL.
Parmi les raisons invoquées pour expliquer le
retard diagnostique (fi gure 3), le faible niveau
d’information des médecins sur le lymphome a été
cité surtout par les généralistes les plus jeunes
(49 %) et par ceux qui n’ont jamais été confrontés
au lymphome (42 %).
✔
Attentes en matière d’information sur le
lymphome
Si près de 80 % des spécialistes ont prétendu
se sentir bien ou très bien informés sur le lym-
phome, cette proportion était de 63 % chez les
généralistes. Les généralistes se disant les mieux
informés étaient représentés à 66 % par les plus de
50 ans, tandis que les moins de 40 ans représen-
taient 46 % des généralistes les moins informés.
Soixante-seize pour cent des généralistes, 73 %
des ORL et 64 % des radiologues ont exprimé le
souhait de disposer d’informations complémen-
taires par l’intermédiaire d’un site Internet pro-
fessionnel, de la formation médicale continue,
d’une brochure envoyée au cabinet médical, ou
encore de la presse spécialisée.
DISCUSSION
L’enquête nationale IDiL est le premier travail
ayant pour objectif de mieux connaître les pra-
tiques et les diffi cultés perçues par les médecins
en matière de diagnostic du lymphome. Ses résul-
tats doivent cependant être nuancés à cause de
son caractère déclaratif. Seule une étude pros-
pective relative aux cas de lymphomes en cours
– diffi cile à mettre en place compte tenu de la
rareté de la maladie dans le cadre de l’exercice
de la médecine générale – pourrait apporter des
Médecins généralistes (n = 683)ORL (n = 88)
56 %
56 %
12 %
7 %
6 %
5 %
2 %
7 %
14 %
30 %
3 %
1 %
Hématologue/oncologue
ORL
Chirurgien
Autre spécialiste
Aucun
Ne se prononce pas
Interniste
Radiologue
Gastro-entérologue
Figure 2. Correspondant spécialiste vers lequel a été orienté le patient en fonction du
médecin consulté (généraliste ou ORL ayant suspecté un cas de lymphome qui a ensuite
été confi rmé).
Question posée aux généralistes : “Initialement, vers quel médecin spécialiste avez-vous
orienté ce patient ?” Question posée aux ORL : “Suite à votre examen, l’avez-vous orienté
vers un autre médecin spécialiste ?”
Pour les généralistes, “Autre spécialiste” correspond au pneumologue (1 %), aux urgences
(1 %), à l’infectiologue (1 %), au dermatologue (1 %), au cardiologue (1 %) ou au pédiatre (1 %).

47
47
Correspondances en Onco-hématologie - Vol. V - n° 1 - janvier-février-mars 2010
Initiation du diagnostic du lymphome :première enquête nationale
certitudes. Les diffi cultés diagnostiques concer-
nent une proportion importante de médecins
(de deux tiers à trois quarts). Elles sont le plus
souvent attribuées à la symptomatologie poly-
morphe, et parfois trompeuse, de la maladie, puis
à la rareté de la maladie dans le cadre de l’exercice
d’un médecin. Ces diffi cultés aboutissent à l’inter-
vention de plusieurs professionnels de santé dans
le processus diagnostique et semblent à l’origine
tant de la diversité des parcours de soins que du
“retard” diagnostique. Le délai moyen estimé entre
la première consultation et l’établissement du
diagnostic de lymphome, allant de 3 semaines
(ORL) à 1 mois (généralistes), peut être jugé rela-
tivement court et en contradiction avec certains
témoignages de patients. Il est important, avant
de porter une appréciation sur ce délai, de se
souvenir des limites classiques d’une enquête
déclarative. Par ailleurs, si le temps nécessaire
au diagnostic débute pour les médecins lors de
la première consultation et se termine lorsque le
diagnostic est posé, les patients peuvent y ajouter
le délai nécessaire à l’obtention du premier rendez-
vous, et le temps écoulé entre l’établissement du
diagnostic et son annonce. En outre, l’enquête
a mis en exergue un défi cit d’information qui a
pu participer à l’hétérogénéité des pratiques et
qui s’est révélé être l’un des principaux freins à
l’initiation du diagnostic de lymphome (c’est la
troisième raison la plus souvent citée pour expli-
quer le retard diagnostique).
Les résultats de l’enquête doivent aussi être
analysés à l’aide de 3 variables déterminantes.
•La fréquence de la maladie dans le cadre de
l’exercice du médecin : l’évocation du lymphome
doit être rapportée au nombre de cas d’hémo-
pathies malignes rencontré. Si les radiologues
ont largement évoqué le lymphome face à une
symptomatologie évocatrice (82 % des citations),
ils sont plus nombreux à avoir déjà été confrontés
à une hémopathie maligne dans leur pratique
(98 %) que les généralistes (88 %).
•L’âge du médecin : les généralistes de moins
de 40 ans sont plus nombreux à souligner un
manque d’information sur le lymphome alors
qu’ils affi chent une meilleure connaissance de
la pathologie et du parcours de soins à suivre
que les médecins plus âgés, probablement grâce
à une formation hospitalière plus récente et plus
actualisée. Mais la probabilité d’avoir été effecti-
vement confronté à un lymphome augmente avec
l’ancienneté de l’exercice des médecins.
•
Le lieu d’exercice et la taille de l’agglomé-
ration : le spécialiste hématologue/oncologue,
Nombre de citations (%)*
ORL (n = 100) Radiologues
(n = 100)
Médecins
généralistes
(n = 1 007)
87 %
56 %
23 %
28 %
31 %
7 %
4 % 5 %
95 %
76 %
47 %
21 %
27 %
1 % 2 %
87 %
65 %
34 %
27 %
18 %
8 %
2 % 3 %
Symptomatologie polymorphe et parfois trompeuse
Rareté de la maladie dans le cadre de l'exercice d'un médecin
Peu d'informations des médecins sur cette maladie
Autre raison
Ne se prononce pas
Délais de rendez-vous avec les médecins spécialistes
Difficulté du médecin à évoquer une maladie grave auprès du patient
Consultation tardive des patients
Figure 3. Raisons invoquées par les médecins pour expliquer le retard diagnostique.
La question posée était : “Il semblerait qu’il existe un certain retard dans le diagnostic de
lymphome. Selon vous, à quoi est principalement lié ce retard ? En premier ? En deuxième ?
En troisième ?”
* Total des citations supérieur à 100 % car plusieurs réponses possibles.
 6
6
1
/
6
100%