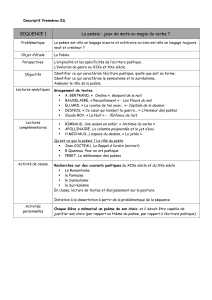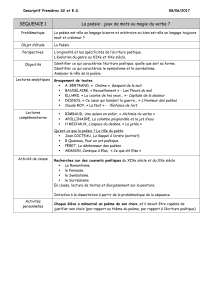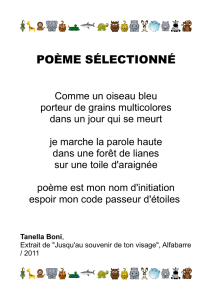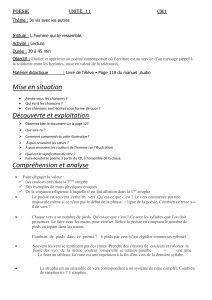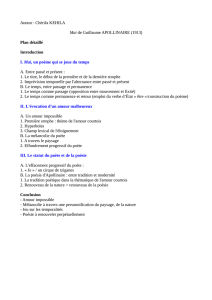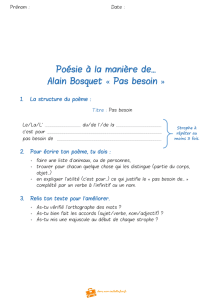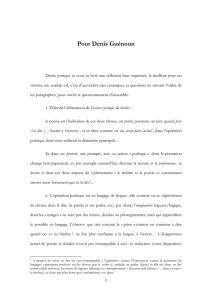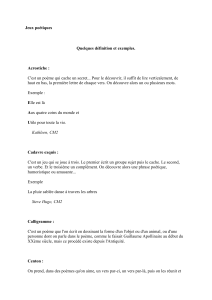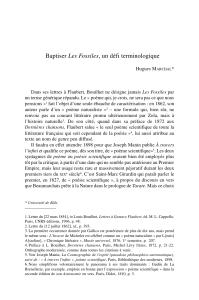1 Henri M « Problèmes de la poésie française contemporaine »

1
Henri MESCHONNIC
« Problèmes de la poésie française contemporaine »
Conférence du 29 mars 2002 à l’École normale supérieure (rue d’Ulm)
J’ai, sur la demande de certains de vos camarades (c’était lors d’une conférence
précédente, pas loin d’ici, je ne sais plus quand, il y a quelques semaines), accepté avec plaisir de
parler des « problèmes de la poésie française contemporaine ». J’insiste sur le mot « problème ».
Et je dirais presque au sens où Benveniste a cherché à donner un sens fort au mot « problème »,
dans le titre de ses deux livres, qui sont des recueils d’articles, Problèmes de linguistique générale.
« Problème », ça signifie, pour moi, essayer de poser des questions que des réponses
empêchent de poser. Parce que, dans beaucoup de domaines, quand on réfléchit sur le langage,
sur le rapport entre la poésie et le langage, la littérature et la langue, sur toutes ces questions qui
jouent sur plusieurs plans, on a affaire souvent à des réponses, et ces réponses empêchent de
poser les questions. Ce n’est pas la même chose, question et problème. Problème, ça veut dire
aussi difficulté, ça veut dire qu’on n’est sûr de rien quand on parle du langage. Et, de ce point de
vue, je n’ai pas une position dogmatique. Je parle un langage d’expérience, je veux dire de mon
expérience.
C’est une expérience d’une trentaine d’années, où je ne dissocie absolument pas trois
types d’activité : une activité qui consiste à écrire des poèmes. Quand je dis trois, ça en fait sans
doute plus, parce qu’il y a écrire des poèmes, et il y a aussi lire des poèmes. Et il y a un rapport
très fort entre les deux, entre lire des poèmes et écrire des poèmes. Il y a, du coup, une réflexion
sur le langage, parce que les poèmes sont des actes de langage.
Deuxième activité, schématiquement : je suis traducteur. Ça fait aussi une bonne trentaine
d’années que j’ai commencé à traduire des textes bibliques : c’était Les cinq Rouleaux, chez
Gallimard, Les cinq Rouleaux, c’est-à-dire, dans l’appellation traditionnelle, le Cantique des
cantiques, que j’ai appelé le « Chant des chants », « Ruth », « Comme ou les Lamentations »,
« Esther » et L’Ecclésiaste, que j’avais appelé « Paroles du sage » ; et puis, en 1981, il y a eu Jona et
le signifiant errant ; et, l’an dernier, la traduction des Psaumes sous le titre Gloires ; et je suis en train
de finir la traduction de la Genèse. Traduire, ça suppose aussi réfléchir, évidemment, sur ce que
c’est que traduire, donc sur l’histoire, la pratique et la théorie de la traduction.
Et puis, ma troisième activité, c’est d’être linguiste, professionnellement d’ailleurs, et je
n’ai jamais séparé ces trois activités. Ce qui me fait, comment dire ? considérer la représentation
commune du langage comme une schizophrénie. C’est un paradoxe, parce que la représentation
commune du langage, c’est-à-dire de la forme et du contenu, du son et du sens, ou, dans les
termes des linguistes, des signifiants et des signifiés – « signifiant » au sens de Saussure – c’est une
représentation qui a pour elle la science, et même l’histoire de la pensée linguistique, depuis à peu
près deux mille cinq cents ans. Et puis, c’est une représentation qui a pour elle l’expérience
commune, donc elle est à la fois familière et renforcée, confortée par le savoir, ou les savoirs.
Je considère qu’on ne se rend pas compte que c’est une schizophrénie pure et simple.
Mais on ne le voit pas, justement parce qu’on y est habitué.
Le problème est donc d’avoir à la fois les concepts et les moyens pour sortir d’une
représentation commune. Avec la poésie, c’est la même chose, avec la littérature en général, avec
l’art en général. Et, quand je dis « schizophrénie », je dis bien une scission complète de la
personnalité – ce n’est qu’une métaphore, bien sûr – concernant le langage.
Mais ça importe de manière vitale à la poésie, c’est-à-dire à l’acte de lire un poème et à
l’acte d’écrire un poème.
Ça m’a amené à réfléchir, je dirais non pas de manière essentialiste, mais de manière
radicalement historique, sur le langage, sur les langues, sur les discours, sur la poésie, sur l’art, sur

2
la notion de sujet, ça m’a amené à prendre acte du fait que nous vivons, depuis au moins les
Lumières, c’est-à-dire la rationalité du XVIIIe siècle, dans une hétérogénéité des catégories de la
raison. Ça a l’air d’être un langage philosophique, mais je ne suis pas philosophe. C’est une
hétérogénéité des catégories de la raison, qui part de l’invention même de la notion de sujet
philosophique. Et je crois que ce qu’on peut rappeler facilement, c’est que ce qu’on appelle le
sujet philosophique, c’est le sujet conscient, unitaire et volontaire, celui qui a des intentions, qui
sait ce qu’il fait. S’il sait ce qu’il fait, il fait ce qu’il sait.
Ça m’a amené à réfléchir sur ce qu’une expression convenue d’aujourd’hui appelle la
« question du sujet ». C’est une expression d’un comique profond. Et, de plus en plus,
effectivement, en réfléchissant sur le langage, sur les problèmes de la poésie, je me dis qu’il y a un
comique de la pensée, et le comique appelle à être partagé.
« On peut rire de tout, disait Desproges, mais pas avec n’importe qui. » Mais il s’agit de
faire partager le comique de la pensée. C’est quoi, le comique de la pensée ? C’est de montrer des
choses que personne ne voit. Pourquoi est-ce que, éventuellement, personne ne les voit ? Mais
c’est parce que nous vivons dans des consensus. Nous prenons le consensus pour la vérité. Il y a
eu une époque où tout le monde pensait que la Terre était plate, c’était un consensus. Ça ne
voulait pas dire qu’elle était plate. On s’aperçoit qu’à toute époque de la pensée, ce sont toujours
les experts qui se trompent. Les autres ne se trompent pas, puisqu’il font confiance aux experts.
Je ne prendrai qu’un exemple, celui de la circulation du sang. Harvey, au XVIIe siècle,
découvre que le sang circule. Je crois qu’il a fallu à peu près soixante-dix ans pour convaincre
toutes les autorités médicales que le sang circule. Les autorités médicales, justement les autorités,
étaient persuadées que le sang se diffuse. Ce qui donne tout son sens à une petite remarque de
Spinoza, qui définit la vie humaine pas par la circulation du sang. Quand Spinoza définit, je ne sais
plus où, la vie humaine, en disant : ce n’est pas la circulation du sang qui définit une vie humaine,
c’est la pensée et c’est l’histoire, c’était un exemple tout à fait d’actualité. On ne sait pas à quel
point il est aussi de nos jours d’actualité, si on considère la parenté qu’il peut y avoir entre le
cognitivisme d’aujourd’hui et l’organicisme du XIXe siècle. C’est-à-dire une biologisation de la
pensée du langage.
On me disait, je ne sais plus qui, il y a très peu de temps, que certains se demandaient où,
dans le cerveau, se trouve la localisation de la langue maternelle. À un colloque international, je
disais il y a un an ou deux ans : « Il n’y a pas de neurone dans un poème, et il n’y a pas de poème
dans le cerveau ». Et, comme c’était un colloque international, on m’a rapporté que deux
Américains s’étaient rapprochés l’un de l’autre et disaient : « Ah… il y a quand même des
neurones dans un poème ».
Alors, la question du sujet ? Non. Moi, je dirais la question des sujets. Et ça touche
directement aux problèmes du poème. Autrement dit, réfléchir sur la poésie est déjà dans une
situation scabreuse. J’ai intitulé ça, ça me semblait inévitable, « problèmes de la philosophie
française contemporaine ». Dans la mesure où je lis beaucoup de choses sur la poésie en même
temps que je lis beaucoup de poèmes, je me suis rendu compte d’une chose, qui est une banalité :
c’est le péché mignon très français de s’universaliser. Ça aussi, d’ailleurs, ça remonte à Rivarol.
Nous ne nous sommes pas dérivarolisés.
Le poète français a aussi tendance, comme celui qui réfléchit sur la langue, à
s’universaliser. Et beaucoup de propos qu’on peut lire de poètes ou de philosophes sur la poésie
française se présentent éventuellement comme des propos sur la poésie.
Alors la poésie, eh bien, ça nous plonge immédiatement en plein réalisme médiéval. Il est
quand même très intéressant de réactualiser cette notion, qui a l’air de faire partie du musée
Grévin de la pensée du langage, comme si ça ne concernait qu’Abélard, le Moyen Âge. Non. Et
comme disait Bergson, les « données immédiates » : réalisme et nominalisme sont des données
immédiates du langage. C’est-à-dire que ce sont des universaux du langage, on ne s’en
débarrassera jamais. Et les problèmes de la poésie sont directement concernés par la réflexion sur

3
le réalisme et le nominalisme. Mais comme ces choses paraissent tellement poussiéreuses et
réservées à des spécialistes ou à des historiens de la philosophie, je me suis même amusé à
remarquer que souvent on intervertissait les deux, et on appelait l’un de la réalité qui couvre
l’autre, etc.
Je rappelle très brièvement : le réalisme, ça consiste à prendre les mots pour des réalités.
Vous comprenez bien qu’au Moyen Âge l’exemple de Dieu était brûlant. Brûlant, au sens où il
conduisait au bûcher. Parce qu’on ne pouvait pas être nominaliste. Le nominalisme désignant le
point de vue selon lequel les mots ne sont que des mots, ça ne pouvait pas s’appliquer à Dieu,
c’est évident.
Mais il y a un exemple qui est beaucoup moins dangereux, et qui est tout à fait intéressant,
c’était aussi un exemple qui roulait beaucoup dans les discussions : c’est l’humanité. Du point de
vue réaliste, l’humanité existe, les individus sont des fragments de l’humanité. Du point de vue
nominaliste, il n’y a que les individus qui existent, « individus » dans tous les sens du mot, au sens
logique comme au sens social. Il n’y a que les individus qui existent. À ce moment-là, qu’est-ce
que c’est que l’humanité ? C’est l’ensemble des individus.
Eh bien, vous voyez qu’à partir de ce moment-là, réalisme et nominalisme ne sont que
des points de vue, et ces deux points de vue sont inévitables, ils sont partie consubstantielle des
questions du langage, et donc des questions de la poésie.
Ça touche immédiatement la notion de genre littéraire. Vous entrez dans une librairie,
vous ne pouvez pas demander à acheter « la poésie ». Non, de même que vous ne pouvez pas
dire : « Je voudrais le roman ». Non, vous trouverez La Chartreuse de Parme ou La Princesse de Clèves,
mais vous ne trouverez pas « le roman ». Vous ne trouverez pas non plus « la poésie ». Alors quel
est le mode d’existence de la poésie, et de même du roman, d’ailleurs ?
C’est un chemin qui mène inévitablement à remettre en question un certain nombre
d’idées reçues. Je disais, « la question du sujet ». La question du sujet et, éventuellement, les
confusions qu’il peut y avoir sur cette question, font partie des problèmes de la poésie
contemporaine, et pour l’instant je m’abstiens de dire « française ».
Pourquoi ça en fait partie ? Eh bien, parce qu’on ne peut plus dire « la question du sujet ».
Ce qui suppose non seulement d’abord qu’il n’y en a qu’un, en réalité il y en a déjà deux. C’est le
sujet philosophique, et, immédiatement, dans l’idée reçue régnant aujourd’hui, qu’est-ce qui
conteste le sujet philosophique ? C’est le sujet freudien.
Alors on utilise beaucoup la psychanalyse, plutôt son application à la littérature comme
une herméneutique, ou pseudo-herméneutique, ou enfin moyen d’interpréter les textes littéraires,
on utilise beaucoup des concepts de la psychanalyse.
Qu’est-ce qu’on fait quand on étudie un texte littéraire avec les concepts de la
psychanalyse ? On emprunte à la psychanalyse, dont je ne dis rien sur le plan clinique, je n’ai
aucune critique à faire sur le plan clinique, ce n’est pas de la clinique que je parle, je parle de
l’emprunt fait par les littéraires à certains concepts de la psychanalyse. Alors je dirais, ces
emprunts sont tout à fait comparables à ce que peut faire un grammairien.
Que peut faire un grammairien devant un poème ? Vous lui présenterez le plus beau
poème, ou éventuellement un mauvais poème, ça revient strictement au même, la seule chose que
le grammairien a le droit de faire, c’est de dire : « Il y a un sujet, un verbe et un complément ». Il
ne peut rien faire d’autre. S’il dit autre chose, c’est que, comme le personnage de Molière qui
disait : « Pour être dévot, on n’en est pas moins homme », pour être grammairien, on n’en est pas
moins homme, ou femme ; pour être un littéraire empruntant à la psychanalyse, on n’en est pas
moins quelqu’un qui a des sentiments, etc.
Autrement dit, tout le reste n’est que de l’ordre de l’opinion, et c’est donc un placage de
concepts venus d’ailleurs qui ne sont pas plus pertinents pour dire quoi que ce soit d’un poème
que les concepts grammaticaux ne sont pertinents pour dire quoi que ce soit d’un poème. Un
concept grammatical ne dit rien d’un poème. Un concept linguistique ne dit rien d’un poème. Un
concept psychanalytique non plus.

4
Alors comment parler des poèmes ? Je suis donc obligé de reconnaître la limite de la
notion de sujet philosophique.
À ce moment-là, je me mets à chercher, j’en trouve une douzaine, pour ma part. Je les
énumère comme ça, sans être du tout sûr, d’ailleurs, d’avoir une liste complète. Mais il est certain
qu’après le sujet philosophique, on peut se représenter qu’il y a un sujet psychologique. Qu’est-ce
que c’est qu’un sujet psychologique ? C’est le sujet qui a des désirs, des émotions, des sentiments.
Ça ne peut pas être lui qui fait le poème, et ce n’est pas lui non plus qui lit le poème, bien qu’en
même temps tous ces sujets soient des fonctions des individus que nous sommes, nous les avons
tous en nous. Ils sont plus ou moins mobilisables ou mobilisés selon les circonstances.
Mais ce n’est pas le sujet psychologique qui fait le poème, parce que si c’était le sujet
psychologique qui faisait le poème, le poème serait seulement l’énoncé d’une émotion. Et tout le
monde sait qu’un poème ne peut pas être simplement l’énoncé d’une émotion, ou d’un désir, etc.
De ce point de vue, la phrase qui me semble résumer le problème, je dis ça entre
parenthèses avant de reprendre mon petit rouleau de la liste des sujets, c’est une phrase que j’ai
citée je ne sais pas combien de fois dans Célébration de la poésie. C’est une phrase de Mallarmé dans
sa réponse à l’Enquête littéraire de Jules Huret en 1891, où il oppose « nommer » et « suggérer ».
Je sais que certains contemporains notoires ont estimé que cette opposition entre
nommer et suggérer était une vieillerie symbolarde.
Ce n’est pas du tout ce que je crois. Je crois que ça, c’est ce que les philologues appellent
une lectio facilior, c’est-à-dire une lecture facile, la lecture la plus facile, celle qui s’impose peut-être,
qui est une facilité, effectivement, mais qui contient un péché comme le ver dans le fruit, c’est
l’historicisme, c’est-à-dire la réduction du sens aux conditions de production du sens, comme si
cette phrase de Mallarmé, qui opposait nommer et suggérer, n’était une vérité bonne que pour
1891 et que pour Mallarmé.
Je crois que la lectio difficilior – c’est ce qui s’oppose pour les philologues à la lectio facilior –
la lectio difficilior, c’est-à-dire l’hypothèse plus intéressante, plus féconde, mais plus difficile, c’est
qu’on a affaire, là, peut-être, à un universel de la poésie. Un universel, c’est quelque chose qui
fonctionne toujours et partout, même si on ne sait pas qu’il fonctionne.
Alors ça se ramène à ça. Le sujet psychologique, tout ce qu’il peut produire, c’est du
nommer. C’est-à-dire du décrire. Donc du journal intime. Alors c’est le problème des confusions
avec le poème, ce qui va supposer évidemment qu’on propose à un moment quelconque une
définition du poème, pour savoir de quoi on parle.
Bon, le sujet psychologique ne peut pas être l’auteur du poème, le sujet philosophique
non plus, je l’ai déjà dit tout à l’heure. Qu’est-ce qu’on peut énumérer, ensuite ?
Il y a deux couples, il y a le sujet de la connaissance des choses, c’est le sujet de la science,
et le sujet de la domination des choses, disons que c’est le sujet de la technique. Ils sont nommés
là pour mémoire, ce n’est ni l’un ni l’autre qui fait le poème, ni qui lit le poème.
Et puis il y a un autre couple. Là il s’agissait des choses, maintenant il s’agit des personnes,
des êtres humains : le sujet de la connaissance des êtres, c’est le sujet qui invente l’ethnologie ou
l’anthropologie, pur sujet de la connaissance, à distinguer du sujet de la domination des autres.
Heidegger a pour caractéristique de faire un amalgame de tous ces sujets, c’est pour ça que je
critique la pensée de Heidegger, parce que c’est une pensée de l’amalgame, parce que ce qui
domine chez lui, c’est la phobie de sa jeunesse, tout à fait légitime d’ailleurs, c’est de se
débarrasser du psychologisme des années 1890.
Seulement, en se débarrassant du psychologisme, il s’est débarrassé de plein d’autres
choses. Il s’est débarrassé, entre autres, du poète, par exemple. Et il s’est débarrassé de la
poétique, il s’est débarrassé de tout ce qui était les sciences humaines, etc.
Alors je reviens maintenant à mes sujets. Après ces deux couples, il y a le sujet de
l’histoire. On sait que pour les marxistes, il n’y avait que les masses qui étaient sujets de l’histoire,
il n’y avait pas d’individus. Il y a un très bel article de Mandelstam, au titre déjà étrange, « L’État

5
et le rythme », article de 1920 que j’ai cité dans Critique du rythme, en 1982. Et c’est très
intéressant que cet article ait été écrit par un poète. Et il disait, en 1920 : « Il faut faire attention à
l’individu, sinon nous allons avoir le collectivisme sans collectivité ». Et on sait comment il a fini,
Mandelstam. Ce n’est pas aussi pour rien que j’ai cité une autre phrase de lui en épigraphe à
Critique du rythme : « Dans la poésie, c’est toujours la guerre ». On va y revenir.
C’était le sujet de l’histoire. Il y a le sujet du bonheur. Si on n’oublie pas de lire la préface
de l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert, on s’aperçoit que, pour Diderot, la seule chose qui
compte, c’est la recherche du bonheur. D’où un nouveau coup de pied dans les chevilles de
Heidegger, parce que, pour Heidegger, la seule chose qui compte, c’est la domination. Il n’a pas
lu, ou enfin je suppose, et en tout cas on dirait, qu’il n’a pas lu la préface de Diderot à
l’Encyclopédie.
Le sujet du bonheur, ce n’est pas du tout le sujet de la domination des autres. Qu’est-ce
qu’il y a encore comme sujet ? Il y a un autre couple de sujets, c’est le sujet de la langue, c’est le
locuteur de la langue, c’est le sujet disons saussurien. Et le sujet du discours, au sens de
Benveniste. Et ce qui est remarquable avec le sujet de la langue, c’est qu’on n’a pas besoin de
savoir comment fonctionne sa langue pour parler sa langue. Un enfant de trois ans parle sa
langue, il ne sait pas comment ça fonctionne. Tous les adultes normaux, c’est-à-dire ceux qui ne
sont pas linguistes, ne sont pas tellement différents de l’enfant de trois ans. Il suffit de voir la
difficulté qu’on a si tout d’un coup on veut expliquer à un ami étranger une petite particularité
grammaticale ou phraséologique de sa propre langue. On a beaucoup de difficulté avec le langage,
ça c’est un des paradoxes de notre rapport au langage. Nous sommes des êtres de langage, et il est
extrêmement difficile de parler du langage. C’est parce que nous n’avons pas de rapport direct
avec le langage, ce qui est aussi un paradoxe.
Pourquoi est-ce que nous n’avons pas de rapport direct avec le langage ? C’est parce que
nous n’avons, avec le langage, que des rapports historiques, culturels, situés, ceux des
représentations. Et la critique majeure que je fais à ce par quoi j’ai commencé, c’est-à-dire la
représentation du signe, celle du discontinu – forme, contenu – c’est qu’elle ne se donne pas pour
une représentation, elle se donne pour la nature du langage.
Donc, en se donnant pour la nature du langage, elle efface le continu qu’il y a aussi dans le
langage, et c’est seulement une pensée du discontinu. C’est ça que j’appelais une schizophrénie.
Et dans le langage, il y a les deux, il y a du discontinu et du continu. Et c’est ça, le comique de la
pensée. C’est de prendre conscience que le savoir n’est pas du tout quelque chose qui s’oppose à
de l’ignorance. Bien sûr, ça serait trop simple : il y a des gens qui ne savent pas, et puis il y a des
gens qui savent. Ce qui est très intéressant, et moi c’est surtout en travaillant sur des traductions
de textes bibliques et sur l'histoire de la pensée du langage, que j’ai appris ce genre de choses
malicieuses, c’est que plus certains savoirs sont des savoirs, c’est-à-dire sont dogmatiques et
arrogants, plus ils cachent, comme un jeu de cases vides et de cases pleines, ils cachent leur
propre ignorance.
Autrement dit, chaque savoir engendre sa propre ignorance, et par définition empêche de
la reconnaître. Donc un savoir est en même temps éventuellement l’effacement de ce qu’il
empêche de savoir, et immédiatement cet effacement se redouble, parce que c’est l’effacement de
l’effacement. Auquel cas, c’est tout à fait comparable à ce qui se passe dans une traduction : les
traductions courantes sont des traductions qui effacent tout ce qui est du continu dans le langage,
tout ce qui est de l’ordre du rythme, du poème, ne retiennent que le sens des mots. Et en même
temps, le traducteur adore se faire passer pour un passeur, en quoi il confond saint Jérôme et
Charon... saint Jérôme est le patron des traducteurs, mais Charon aussi est un passeur, c’est lui
qui passe les âmes sur le Styx. Et, si on ne traduit que le sens des mots, eh bien, on est
exactement dans la séparation de la forme et du contenu, de l’âme et du corps, autrement dit : ce
qu’on a fait passer de l’autre côté, ce que les spécialistes de traduction appellent la langue d’arrivée
par rapport à la langue de départ, c’est du cadavre. C’est le cadavre d’un poème, éventuellement.
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%