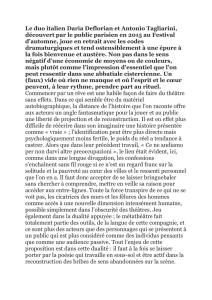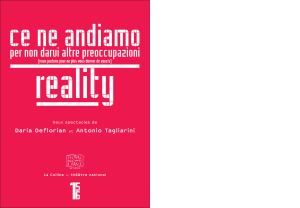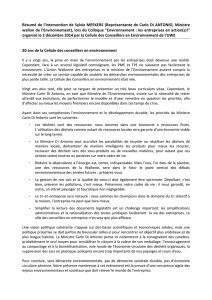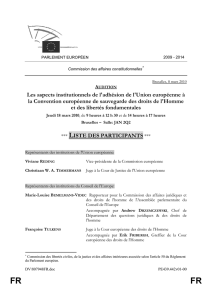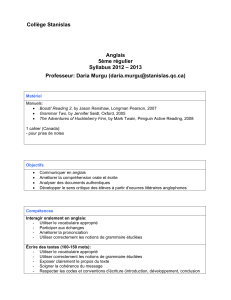Dossier D’accompagnement ce ne anDiamo per non DarVi aLtre preoccUpaZioni

1
DOSSIER D’ACCOMPAGNEMENT
CE NE ANDIAMO PER NON DARVI
ALTRE PREOCCUPAZIONI
Nous partons pour ne plus vous donner de soucis
IL CIELO NON E UN FONDALE
Le ciel n’est pas une toile de fond
deux spectacles de Daria Deflorian et Antonio Tagliarini
en italien, surtitré
29 novembre – 18 décembre 2016
Berthier 17e
HORAIRES
du mardi au samedi à 20h
le dimanche à 15h
Ateliers Berthier
1 rue André Suarès (angle du bd Berthier)
Paris 17e
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS
PUBLIC DE L’ENSEIGNEMENT
Clémence Bordier / 01 44 85 40 39
clemence.bordier@theatre-odeon.fr
Coralba Marrocco / 01 44 85 41 18
coralba.marrocco@theatre-odeon.fr
© Élisabeth Carecchio
Théâtre de l’Europe

2
SOMMAIRE
Générique des spectacles (ci-contre)
1re PARTIE
CE NE ANDIAMO PER NON DARVI ALTRE PREOCCUPAZIONI
A. Le pouvoir de dire non
B. Extrait : Le Justicier d’Athènes
C. Nous restons pour vous donner des soucis
2e PARTIE
IL CIELO NON È UN FONDALE
A. La ville comme gure
B. Les coutures de l’intimité
C. Points de départ
– La voie sacrée du périphérique
– Enquêter sur le réel
3e PARTIE
UN THÉÂTRE À MAINS NUES
A. Daria et son double, Antonio
B. Promenade dans le théâtre de Daria Deorian et Antonio Tagliarini
C. Aux origines des pièces du duo romain
D. « Un espace de rencontres »
QUELQUES REPÈRES
SUR DARIA DEFLORIAN ET ANTONIO TAGLIARINI

3
CE NE ANDIAMO PER NON
DARVI ALTRE PREOCCUPAZIONI
Nous partons pour ne plus vous donner de soucis
de Daria Deflorian et Antonio Tagliarini
en italien, surtitré
IL CIELO NON È UN FONDALE
Le ciel n’est pas une toile de fond
de Daria Deflorian et Antonio Tagliarini
en italien, surtitré
29 novembre – 7 décembre
Berthier 17e
9 – 18 décembre
Berthier 17e
avec le Festival
d’Automne à Paris
avec le Festival
d’Automne à Paris
collaboration au projet
Monica Piseddu
Valentino Villa
lumière
Gianni Staropoli
décor
Marina Haas
surtitrage
Anna Damiani
Francesca Corona
traduction des surtitrages
Caroline Michel
direction technique
Giulia Pastore
accompagnement
et diffusion international
Francesca Corona
organisation
Anna Damiani
et l’équipe technique de
l’Odéon-Théâtre de l’Europe
durée
1 heure
créé le
7 novembre 2013
au Teatro Palladium lors
du Romaeuropa Festival 2013
production
A. D.
coproduction
369gradi, Romaeuropa
Festival 2013, Teatro di Roma
inspiré par une image du roman
Le Justicier d’Athènes de
Pétros Márkaris
avec
Anna Amadori
DariaDeflorian
AntonioTagliarini
ValentinoVilla
collaboration au projet
Francesco Alberici
Monica Demuru
texte sur Jack London
Attilio Scarpellini
lumière
Gianni Staropoli
costumes
Metella Raboni
assistant à la mise en scène
Davide Grillo
surtitrage
Francesca Corona
traduction des surtitrages
Federica Martucci
direction technique
Giulia Pastore
construction du décor
Atelier du Théâtre de Vidy
accompagnement
et diffusion international
Francesca Corona
organisation
Anna Damiani
et l’équipe technique de
l’Odéon-Théâtre de l’Europe
durée
1h30
créé le
16 novembre 2016
au Théâtre de Vidy – Lausanne
production
Sardegna Teatro, Fondazione Teatro
Metastasio di Prato,
Emilia Romagna Teatro Fondazione
coproduction
A. D., Odéon-Théâtre de l’Europe,
Festival d’Automne à Paris,
Romaeuropa Festival, Théâtre de
Vidy – Lausanne, Sao Luiz – Teatro
Municipal de Lisboa, Festival Terres
de Paroles, Théâtre Garonne, scène
européenne – Toulouse
avec le soutien du
Teatro di Roma
en collaboration avec
Laboratori Permanenti/ Residenza
Sansepolcro, Carrozzerie NOT/
Residenza Produttiva Roma, Fivizzano
27/ nuova script ass.cult. Roma
avec
Francesco Alberici
Daria Deflorian
Monica Demuru
Antonio Tagliarini

4
1re PARTIE
CE NE ANDIAMO PER NON
DARVI ALTRE PREOCCUPAZIONI
Nous partons pour ne plus vous donner de soucis
A. Le pouvoir de dire non
« Parce que s’il y a bien quelque chose qu’on a compris ces derniers
temps, c’est l’importance de dire non. On peut dire non. Il y a une
puissance dans la négation, dans le non. Tout ce contentement…
On nous y habitue : « allez, même si tu ne le sens pas, fais le quand
même, peut-être qu’après... » Mais en fait non. Non. On n’a pas
envie de s’en contenter. »
Extrait de Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni
Ce ne andiamo per non darvi altre preoccupazioni est un spectacle
court, une heure à peine. Mais comme le remarque Tagliarini, ce « temps
bref » peut aussi devenir une arme d’intensité massive, et la voix de la
condence est souvent celle qui porte le plus loin. Le peu de temps, la
discrétion des paroles – l’économie, en somme – sont ici au cœur du
propos, lui donnent sa rigueur et son humanité. Les quatre comédiens
conquièrent de haute lutte leur droit d’entrer en scène et d’y rester. An
(ajoute l’un d’entre eux, non sans malice) « de vous donner d’autres
soucis. ». Le peu de temps, c’est celui qui reste à quatre retraitées
grecques avant d’en nir. Deorian et Tagliarini ont découvert leur destin
dans les premières pages du Justicier d’Athènes, une ction policière
signée Pétros Márkaris. Le romancier cite leurs noms, leurs dates de
naissance, lisibles sur leurs cartes d’identité posées bien à plat sur
une table modeste, à côté d’une bouteille de vodka à moitié vide, d’un
acon de somnifères et d’un message écrit avec soin. Elles y expliquent
pourquoi elles mettent n à leurs jours. N’ayant plus de quoi vivre, elles
ont cru comprendre qu’elles étaient « un poids pour l’État [...] et toute la
société ». Deorian et Tagliarini n’ont pas scénarisé cette histoire. Leur
projet ne consiste pas à nous raconter la crise grecque, ni à la transposer
en Italie. Ils entrent les mains nues sur une scène vide, noyée d’ombre,
et s’interrogent devant nous, nous interpellent sur leurs scrupules dans
l’approche sensible d’un tel matériau. « Ensemble, » disent les artistes,
« nous nous présentons au public avec une déclaration de profonde
impuissance, une impuissance cruciale à représenter : notre « non »
commence tout de suite, dès la première scène. » Daria Deorian
l’afrme : face au pouvoir, il est toujours possible de dire non. Ce « non »
des retraitées, il faut le faire entendre, car on ne peut, comme on dit, « en
rester là ». Mais il ne suft pas non plus de répéter ce « non ». De la part
d’un(e) artiste, quelle serait l’action juste – ni leçon, ni récupération – qui
permettrait d’aborder un tel acte de désespoir sans se complaire dans
le spectaculaire ou le compassionnel ? Ces questions qui se posent
aux interprètes s’adressent aussi à leurs spectateurs. Elles ne sont pas
seulement esthétiques, mais aussi et d’abord civiques. La quête se
conduit comme à tâtons entre le plateau et la salle. Sous nos yeux, les
quatre comédiens exposent leurs difcultés. Avec une délicatesse qui

5
parfois n’est pas dénuée d’humour, ils cherchent la bonne façon de
répliquer au geste « incompréhensible, gratuit et puissant » des retraitées
et « trouver une réponse constructive à la débâcle – avant tout morale
– qui nous entoure. Incapables, impuissants. Mais conscients de cela. »
Cette réponse, ils la trouvent par les moyens du théâtre, donnant corps
avec dignité à toutes les disparitions.
Présentation de Daniel Loayza pour l’Odéon-Théâtre de l’Europe
www.theatre-odeon.eu/fr/2016-2017/spectacles/ce-ne-andiamo-non-darvi-altre-preoccupazioni
B. Extrait : Le Justicier d’Athènes
Nous sommes quatre retraitées, sans familles. Nous n’avons ni enfants, ni
chiens. D’abord, on nous a réduit nos retraites, notre unique revenu. Puis
nous avons cherché un médecin qui nous prescrive nos médicaments,
mais les médecins étaient en grève. Quand ils les ont enn prescrits, on
nous a dit à la pharmacie que nos mutuelles n’ont plus d’argent et que
nous devons payer de notre poche. Nous avons compris que nous étions
un poids pour l’État, les médecins, les pharmacies et toute la société.
Nous partons pour vous éviter cette charge. Quatre retraitées en moins,
cela vous aidera à mieux vivre.» L’écriture du message est soignée, en
lettres rondes. Elles ont laissé à côté leurs cartes d’identité. Ekaterini
Sektaridi, née le 23.4.1941 ; Angeliki Stathopoulou, née le 5.2.1945 ;
Loukia Haritonidou, née le 12.6.1943 ; Vassiliki Patsi, née le 18.12.1948.
Pétros Márkaris, Le Justicier d’Athènes, trad. M. Volkovitch, Éditions Points, 2014,
p. 10 et 144-145, 3 juin 2015 pour le Théâtre national de la Colline
C. Nous restons pour vous donner des soucis
Katia Ippaso, journaliste et auteure italienne, s’entretient avec Daria
Deflorian et Antonio Tagliarini. Dans ce dialogue à trois, Daria et
Antonio nous racontent comment, à travers leur dernier spectacle,
Nous partons pour ne plus vous donner des soucis, ils ont cherché à
s’enraciner au cœur d’un discours douloureux, celui de la crise.
Katia Ippaso : Nous partons pour ne plus vous donner de soucis part de
l’image des quatre femmes de Pétros Márkaris, vous tournez autour
de leurs vies tout en refusant de les incarner. Vous vous questionnez,
vous dépeignez l’atmosphère. Vous imaginez la mercerie où l’une
d’entre elles est allée acheter une nouvelle paire de collants parce
qu’elle ne voulait pas mourir les collants déchirés. Vous imaginez
les gens perdus dans les rues d’Athènes. Vous disposez leurs corps
dans la maison. Comme si la police criminelle ne devait pas tarder à
arriver afin d’établir les causes et les modalités de la mort.
Dans le cas des quatre retraitées de Márkaris, la contradiction inhérente
à cette image littéraire nous a attirés. Elle se déplaçait continuellement
sous nos yeux, et nous avec elle. Il ne s’agit pas de personnes réelles,
nous ne connaissons pas leurs mésaventures, mais ce qui nous a frappé
c’est leur geste collectif, leur capacité à dire non... À un certain moment
de notre travail, j’ai voulu les sauver et j’ai dit aux autres : je ne veux pas
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
1
/
19
100%