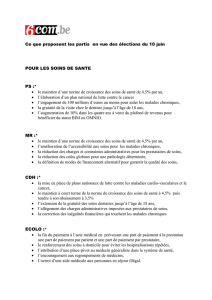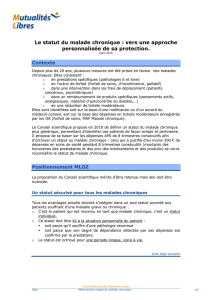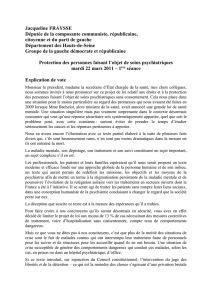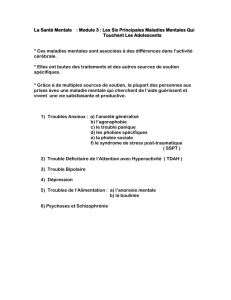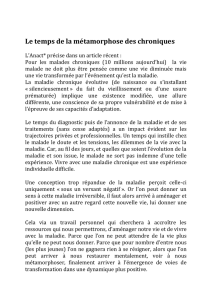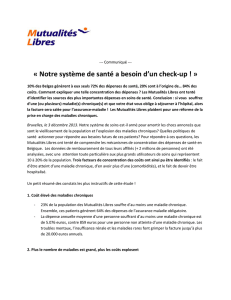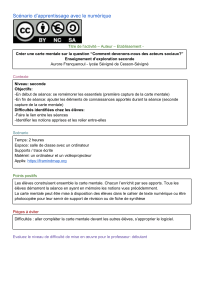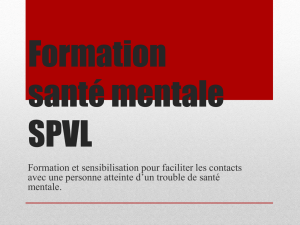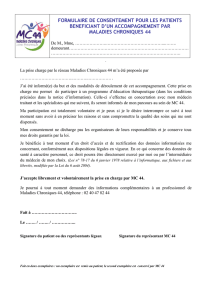MC-Informations Analyses et points de vue 249

MC-Informations
Analyses et points de vue
Périodique trimestriel de l’Alliance nationale des Mutualités chrétiennes 249
La
solidarité,
c’est bon pour la santé.
MUTUALITE
CHRETIENNE
Evolution 2000-2011 des dépenses INAMI pour le secteur MRPA-MRS-CSJ en millions € et aux prix de 2011 -
Dépenses observées et théoriques
Vlaanderen
Wallonie
Brussel
LCM
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Soins chroniques
La MC veut continuer à
inscrire à l’agenda les
souhaits et les besoins
des personnes nécessi-
tant des soins lourds et de
longue durée.
Santé mentale
Au vu des enjeux actuels autour de la santé mentale et suite à la réforme des soins en santé
mentale (Psy107), les Mutualités chrétiennes francophones et germanophone ont entamé,
à l’instar des Mutualités chrétiennes fl amandes (VCM), une démarche active en la matière,
conscientes des nécessités en termes d’information, de formation, d’accessibilité aux soins et
de renfort des compétences en première ligne et de la liaison avec l’hôpital.
septembre 2012
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Dépenses observées
Dépenses théoriques
Flandre
Wallonie
Bruxelles
A.N.M.C.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Evolution du nombre moyen de DMG par généraliste pour les
af liés ANMC entre 2002 et 2011.
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Werkelijke uitgaven
Theoretische uitgaven

2
La sécurité sociale est une grande réalisation et avancée
sociale moderne. Depuis la seconde guerre mondiale, elle
s’est étendue progressivement à toutes les catégories de la
population, couvrant les risques liés aux maladies ou à la perte
de revenus du travail ou compensant les charges familiales :
assurance soins de santé, allocations de chômage, indemnités
d’incapacité de travail, pensions, indemnités en cas de
maladies professionnelles ou d’accidents du travail, allocations
familiales… L’ensemble de ces prestations représentaient, en
2011, plus de 80 milliards d’euros. Notre système de sécurité
sociale a permis de réduire l’impact sur le pouvoir d’achat des
situations de crise économique et de chômage, et d’éviter à
nombre de personnes fragilisées de tomber sous le seuil de
pauvreté. Cette efficacité est atteinte parce que notre système
de sécurité sociale est construit sur des principes fondateurs
essentiels : la solidarité, la concertation sociale, la cogestion,
la démocratie participative.
Au sortir de la seconde guerre mondiale, les responsables
politiques et les partenaires sociaux ont jeté ces fondations
de notre système de sécurité sociale. Ils ont décidé de le
financer sur la base de cotisations sociales proportionnelles
aux salaires, à charge en partie des travailleurs, en partie des
employeurs. Parallèlement, l’Etat a organisé un système de
couverture pour les personnes qui ne peuvent ouvrir le droit
à la sécurité sociale par leur travail. Ainsi, la solidarité entre
les hauts et les bas revenus, entre les jeunes et les personnes
âgées, entre les gens en bonne santé et les malades s’est
concrétisée. C’est un premier fondement. Le second principe
fondateur est celui de la concertation sociale. Les syndicats,
les organisations patronales, les mutualités et les représentants
du gouvernement sont réunis au sein d’organes de gestion
paritaire. Ils assurent la gestion globale, la transparence des
décisions et sont responsabilisés financièrement. Le troisième
principe fondateur est celui de la cogestion. En effet, l’exécution
du système a été confiée aux employeurs pour les allocations
familiales, aux syndicats pour les allocations de chômage,
aux mutualités pour les soins de santé et indemnités, aux
assureurs privés pour les accidents du travail, aux secrétariats
sociaux pour la perception des cotisations sociales, et pour
les indépendants aux caisses d’assurances sociales pour la
perception des cotisations et leurs allocations familiales.
Ces administrations efficaces assument le bon déroulement
du système et ce, même lorsque le gouvernement est en
affaires courantes ! Elles sont strictement contrôlées et leur
organisation se base sur une démocratie participative.
Les matières transférées aux Communautés et Régions
concernent les secteurs de l’emploi (4,3 milliards d’euros),
les allocations familiales (5,9 milliards d’euros), les soins de
santé (3,7 milliards d’euros) et l’aide aux personnes âgées (500
millions d’euros). Ce n’est donc qu’une petite partie (+/- 15%)
de la sécurité sociale qui est transférée mais elle touche de
nombreuses personnes. Aujourd’hui, ces matières sont gérées
et assumées sur la base des principes fondateurs de la sécurité
sociale, qu’en sera-t-il demain ? La réponse n’est pas évidente
et est déterminante pour l’avenir. Elle demande un vrai débat
politique.
Les mêmes principes fondateurs guideront-ils encore la gestion
future ? Quel sera le rôle des partenaires sociaux ? Seront-
ils consultés pour la forme ? Co-gestionnaires ? Opérateurs
comme aujourd’hui ? Ou optera-t-on pour un modèle étatique ?
Si tel est le cas, comment assurer la continuité et la cohérence
avec le système de sécurité sociale fédéral ? Comment assurer
la transparence des décisions ? Où va-t-on trouver l’expertise ?
Va-t-on répartir les compétences d’une manière morcelée vers
des administrations éparses et nouvelles ? Comment assurer
une gouvernance globale des matières transférées permettant
des politiques ambitieuses ? Comment assurer la solidarité s’il
y a plus de scission ?
A nos yeux, les principes fondateurs de la sécurité sociale
doivent rester à la base de la future gestion des compétences
qui seront transférées aux Communautés et aux Régions. La
solidarité, la concertation sociale, la cogestion et la démocratie
participative en sont l’essence. Et le maintien de ces principes
n’empêche pas Communautés et Régions d’avoir leurs propres
spécificités et objectifs dans la mise en œuvre de leur politique
sociale. C’est un débat politique essentiel, nous sommes tous
concernés !
Marc Justaert Jean Hermesse
Président Secrétaire général
Editorial
N’oublions pas les principes fondateurs de la sécurité sociale!
MC-Informations 249 • septembre 2012
2

1. Notre modèle de sécurité sociale:
un peu d’histoire…
Le vingtième siècle a vu la plupart des pays européens étendre
progressivement la couverture des risques sociaux à tous leurs
citoyens. La Belgique, au même titre que la France et les Pays-
Bas, a construit son système de protection sociale sur base
du modèle bismarckien, d’influence allemande, qui diffère du
modèle beveridgien d’influence britannique.
Quels sont les grands principes qui distinguent les deux
systèmes? Les systèmes d’influence bismarckienne organisent
traditionnellement une solidarité entre les actifs fondée sur le
travail. Les allocations octroyées (chômage, invalidité, etc.) sont
proportionnelles à la rémunération perdue. Le financement se
fait largement par des cotisations sociales (des employeurs et
des travailleurs) proportionnelles au salaire. En conséquence, le
système de protection sociale est co-géré par les employeurs et
les salariés eux-mêmes (gestion paritaire).
Les systèmes d’influence beveridgienne sont quant à eux
universels et se donnent pour mission d’assurer une même
protection minimale à tous les citoyens. Ils prévoient des
allocations forfaitaires identiques pour tous. Le financement se
fait par l’impôt, et le système est principalement géré par l’Etat.
Dans tous les pays qui ont adopté le modèle bismarckien, la
protection s’est peu à peu généralisée par l’extension à des
catégories de population initialement non protégées (étudiants,
travailleurs indépendants, etc.). Par exemple, la Belgique a
progressivement rendu accessible son système de soins de santé
à tous les résidents belges. Ainsi, depuis le 1er janvier 2008, les
indépendants et les salariés bénéficient des mêmes prestations
de soins (la couverture des petits risques a été intégrée au sein
de l’assurance maladie obligatoire pour les indépendants).
2. Les partenaires sociaux au cœur de la politique
de santé
La gestion du système d’assurance maladie obligatoire repose
principalement sur le modèle de la concertation sociale. Ce sont
les partenaires sociaux – prestataires et organismes assureurs
dans un premier temps, auxquels sont associés les représentants
Transfert de compétences
Les forces du système de santé en Belgique
Olivier Gillis, Département Recherche et Développement.
L’accord institutionnel pour la sixième réforme de l’Etat prévoit
le transfert d’un pan important de la sécurité sociale vers les
entités fédérées. Pour le secteur de la santé, ce n’est pas moins
de 16 % du budget de l’assurance maladie (soit 24 milliards
d’euros en 2011) qui sera communautarisé. S’il ne s’agit que de
quelques pages dans l’accord institutionnel, les changements
seront néanmoins considérables.
C’est l’occasion de mettre en évidence les mécanismes et les
principes qui font de notre système de santé belge l’un des plus
performant au monde ; mécanismes qu’il conviendra dès lors
de préserver au niveau des entités fédérées. C’est également
l’occasion de se tourner vers l’avenir, et de réfléchir aux enjeux,
comme le vieillissement de la population qui impliquera une
nécessaire coopération entre tous les acteurs concernés,
mais également aux risques tels que la privatisation et la
marchandisation des soins.
Quelles compétences en matière de santé seront
transférées vers les entités fédérées ?(Hannes, 2012)
- l’accueil résidentiel en maisons de repos, en
hôpital gériatrique isolé ou spécialisé en soins de
longue durée isolé;
- les travaux de construction, de rénovation et de
gros entretien des infrastructures hospitalières;
- certaines conventions passées avec des
établissements de revalidation;
- les aides à la mobilité (e.a. voiturettes);
- l’allocation d’aide aux personnes âgées (APA);
- les maisons de soins psychiatriques et les
habitations protégées;
- la politique de prévention et de dépistage des
maladies;
- les éléments importants d’organisation des soins
de première ligne.
N’oublions pas les principes fondateurs de la sécurité sociale!
MC-Informations 249 • septembre 2012 3

patronaux et syndicats dans un second temps – qui identifient les
besoins à couvrir et décident des moyens à mettre en œuvre.
Le secteur est ainsi directement associé, dans un modèle de
cogestion, tant au niveau des initiatives à prendre qu’au niveau
décisionnel, à la politique menée.
Les avantages d’un tel système sont les suivants:
• les acteurs de terrain (organismes assureurs, prestataires de
soins, etc.) définissent la politique de santé, ce qui permet à
celle-ci de coller au plus près des besoins des patients. La
concertation sociale est ainsi un gage de cohésion sociale et
de démocratie participative;
• le paysage politique et gouvernemental change au gré des
élections contrairement aux partenaires sociaux qui sont un
gage de stabilité. Ceux-ci permettent ainsi une réelle continuité
et cohérence dans la politique de santé à mener à court et long
terme;
• de par la démocratie participative et la stabilité qu’elle garantit,
la concertation sociale permet ainsi plus de souplesse dans
l’évolution du système, la nécessaire adaptation aux besoins
et la maîtrise des coûts.
Dans les modèles d’inspitation beveridgienne, l’Etat (Parlement
et Gouvernement) fixe la politique globale et le ministre, aidé
par son administration, intervient tant en terme d’initiative que
de décision pour définir les besoins et les moyens. Le secteur
peut éventuellement être associé à la décision au travers d’un
organe d’avis (fonction consultative), dont la composition peut
varier selon le degré d’implication souhaité par l’exécutif. L’avis
du secteur est généralement non contraignant.
Les inconvénients liés à un tel système sont les suivants:
• la représentation du secteur est aléatoire et dépend de la
volonté du politique. De plus, son avis est non-contraignant;
• par conséquent, il y a un risque plus important que la politique
menée ne répondent pas aux besoins des bénéficiaires, mais
également que celle-ci ne soit pas suffisamment axée sur le
long terme;
• la faible implication des partenaires sociaux implique en outre
un risque de dualisation plus élevé, avec d’un côté un système
étatique accessible et de qualité relative et de l’autre le marché
offrant des prestations inaccessibles à une grande partie de la
population;
• un tel système peut être également révélateur d’une plus
grande instabilité des recettes. Celles-ci provenant de l’impôt,
elles peuvent être modifiées chaque année à l’occasion
de l’exercice de confection d’un budget gouvernemental, à
l’inverse des cotisations sociales dont la modification demande
un accord social entre patrons et syndicats.
3. Une organisation centralisée tenant compte des
besoins spécifiques
L’organisation actuelle de notre système de santé permet de
mener une politique de santé optimale, flexible et cohérente.
Le trait principal de cette organisation est que les décisions
relatives aux différents secteurs de la santé (honoraires
médicaux, hôpitaux, maisons de repos, soins infirmiers, etc.)
sont centralisées au niveau de l’INAMI (où sont représentées
les mutualités) et du SPF Santé publique. Cette centralisation
permet de pouvoir adapter l’offre de soins aux besoins qui sont
en constante évolution.
De par l’augmentation des besoins en soins chroniques, beaucoup
de lits hospitaliers ont ainsi par le passé été reconvertis en lits en
maison de repos et de soins (MRS). Il en a été de même pour
certains lits en hôpitaux psychiatriques qui ont été reconvertis
en lits en maison de soins psychiatriques (MSP). Pour l’avenir,
un chantier important est la diminution du nombre de lits aigus
à l’hôpital (la Belgique est un des pays européens ayant le plus
grand nombre de lits par 1000 habitants, soit 4,3 lits en 2008) au
profit de services de revalidation et de convalescence, et du
développement des soins infirmiers à domicile. Ceci permettra
un meilleur suivi via des soins plus appropriés, moins de
réadmissions et plus de proximité. Cette évolution doit aller de
paire avec la révision du mode de financement des hôpitaux ainsi
qu’une meilleure couverture des coûts à charge du patient en
dehors de l’hôpital.
Un autre chantier important est la structuration de la première
ligne. Ces dernières années, toute une série de mesures ont été
prises pour revaloriser la médecine générale, mais également
encourager les prestataires à s’installer dans les zones en
pénurie : soutien administratif, aides à l’installation (Fonds
Impulseo), financement des postes de garde, subsidiation du
réseau informatisé sécurisé, etc. Pour aller plus loin dans le
développement et la meilleure répartition de l’offre de soins,
les conditions à la subsidiation accompagnant ces mesures
doivent être renforcées; ceci devant permettre de davantage
structurer la première ligne à l’instar de la seconde ligne. On doit
par exemple veiller à ce que les postes de garde médicale soient
coordonnés avec les services d’urgence des hôpitaux.
Ces différents enjeux et défis ne seront possibles que si
l’organisation future des compétences transférées se fait dans
un lieu unique d’expertise et de décision, qui travaille de manière
concertée avec le niveau fédéral.
MC-Informations 249 • septembre 2012
4

4. Des moyens garantis et nancés de manière
solidaire
Le mode de financement de notre modèle d’assurance sociale
garantit une solidarité horizontale (entre bien-portants et
malades) et verticale (entre riches et pauvres).
Le financement se fait à plus de 60 % par des cotisations sociales
qui sont proportionnelles au revenu. Ainsi, les assurés cotisent
non pas en fonction du risque qu’ils encourent, qui est inégalement
réparti, mais en fonction du revenu dont ils disposent.
S’il est vrai que les modèles de type beveridgien permettent
également une certaine forme de solidarité (financement par
l’impôt qui est proportionnel au revenu), il n’est pas certain que
celle-ci soit garantie, en particulier en période de crise et au
gré de la couleur politique des partis au pouvoir. En effet, les
moyens sont alloués indirectement via l’impôt à la protection
sociale contrairement à notre modèle de sécurité sociale qui
est directement financé par les cotisations sociales. On a pu
voir dans l’actualité récente que la Grande-Bretagne a fait des
coupes importantes dans les budgets alloués au système national
de santé (NHS), et qu’un pan important de celui-ci a été privatisé.
Ainsi, dans la future gestion des compétences de sécurité sociale
qui vont être transférées aux entités fédérées, il est dès lors
essentiel de maintenir un financement qui soit réellement solidaire,
afin d’éviter toute forme de dérives telles que nous pouvons
l’observer au Royaume-Uni, et plus récemment au Canada.
5. Une solidarité forte entre branches de la sécurité
sociale
Les recettes de sécurité sociale sont gérées globalement. Cette
gestion globale se fait au niveau de l’Ofce national de Sécurité
sociale (ONSS) sous la supervision du Comité de Gestion de la
Sécurité sociale (constitué de représentants des partenaires
sociaux, des pouvoirs publics et du Collège inter-mutualiste). La
gestion globale implique que les différentes branches de la sécurité
sociale ne sont pas financées selon leurs rentrées financières
propres mais bien selon leurs besoins, permettant ainsi des
transferts entre les branches en boni et les branches déficitaires1.
Par exemple, les boni au sein de l’assurance maladie depuis 2005
ont permis des transferts importants de moyens vers les autres
branches de la sécurité sociale: 350 millions en 2010 et 1,093
milliard en 2011 (sachant qu’en 2012, les boni ont été récupérés
pour combler le déficit de l’Etat).
Si la gestion globale garantit une réelle solidarité entres les
différentes branches de la sécurité sociale, elle permet également
de pouvoir mener une politique globale et transversale. C’est
également le cas plus particulièrement pour le secteur des soins
de santé où, chaque année, la confection du budget permet de
mener des arbitrages entre les différents secteurs et de mener
ainsi une politique cohérente (par exemple concernant l’accueil
des personnes âgées qui implique différents types de structures
de logement et de soins).
6. Les risques de privatisation et de
marchandisation
L’accord institutionnel et le transfert de compétences
qui l’accompagne présentent un risque de renforcer les
phénomènes de privatisation et de marchandisation. Pour
illustrer ce double phénomène, nous prenons l’exemple des
maisons de repos, secteur le plus important parmi les matières
transférées en santé.
Nous définissons ici la privatisation dans le secteur de la santé
comme le glissement du financement des soins par des moyens
publics vers un financement par des moyens individuels. Cela
peut se faire directement via des (majorations de) paiements
propres ou l’exclusion de prestations assurées, ou indirectement
via des (augmentations de) primes d’assurance complémentaire
où seule la solidarité des risques joue un rôle et non plus la
solidarité des revenus (Derieuw, 2007).
Par rapport à la croissance budgétaire actuelle du secteur
des maisons de repos, le financement prévu par l’accord
institutionnel risque d’être insuffisant, et dès lors d’impliquer
un glissement inéluctable vers le financement privé. En effet,
les compétences transférées en matière de santé ne seront à
termes plus nancées par la norme de croissance de 4,5 %. Les
moyens fédéraux actuels, répartis entre les entités fédérées
selon deux clés population différentes (sur base de la répartition
des plus de 80 ans entre les entités pour les matières santé
concernant les personnes âgées, et sur base de la répartition
de la population totale pour les autres matières santé), seront
majorés chaque année en fonction de la croissance du Produit
intérieur brut (PIB), de l’inflation (évolution des prix) et de la
population (afférant à la clé concernée). Pour les maisons de
repos comme pour beaucoup d’autres secteurs, ces moyens
risquent d’être insuffisants.
L’encadrement en MRPA-MRS-CDJ (maisons de repos pour
personnes âgées, maisons de repos et de soins, centres de
jour) représente, en 2011, 2,4 milliards d’euros. Si, en 2000, on
avait appliqué le taux de croissance tel que prévu par l’accord
institutionnel, les budgets n’auraient cru en moyenne que de
4,7 % par an (hors ination), contre 7,3 % effectivement. Ceci
implique que, pour l’année 2011, il aurait manqué plus de 500
millions d’euros pour répondre aux besoins et ce, alors que le
vieillissement de la population va s’accentuer (voir Figure 1).
1 https://www.socialsecurity.be/
MC-Informations 249 • septembre 2012 5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
1
/
24
100%