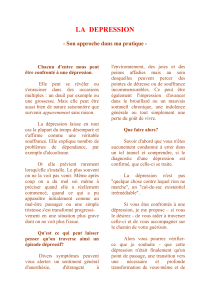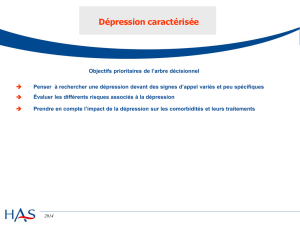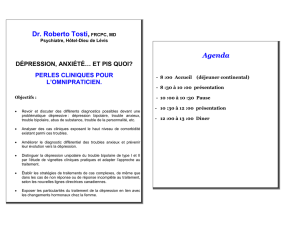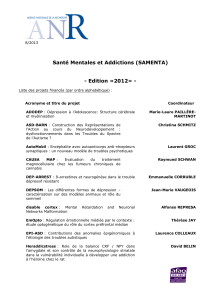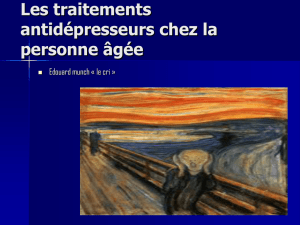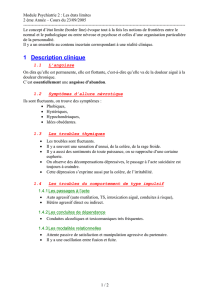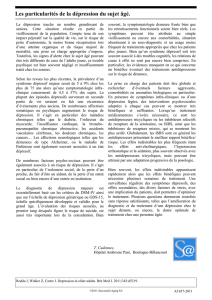MC-Informations Analyses et points de vue 257 Coûts moyens

Le budget de frais d’administra-
tion versé aux 5 OA représente
actuellement un peu plus d’1 mil-
liard d’euros. D’aucuns durant la
campagne électorale ont mis en
avant qu’il y avait là une source
importante d’économies pos-
sibles. Il n’est pas inutile de faire
le point sur ce budget de frais
d’administration, d’examiner son
évolution et, surtout, de le rap-
porter à la masse des prestations
de soins de santé et d’indemnités
versées, ainsi qu’à l’évolution du
PIB.
Illustration Atlas AIM des contacts avec les médecins généralistes
Simulation – remplacement de toutes les statines par leur
variante la moins chère (la simvastatine) à volume égal en
2013 et calcul de l’économie pour l’AMI
MC-Informations
Analyses et points de vue
Périodique trimestriel de l’Alliance nationale des Mutualités chrétiennes 257
septembre 2014
La
solidarité,
c’est bon pour la santé.
MUTUALITE
CHRETIENNE
La dépression est une maladie mal connue
et les tabous qui l’entourent ont la vie dure.
Grâce à vingt entretiens approfondis de per-
sonnes ayant vécu une dépression, nous
avons pu mieux comprendre la relation entre
celle-ci et l’(in)capacité de travail.
SIMVASTATINE PRAVASTATINE SIMVASTATINE FLUVASTTATINE ROSUVASTATINE TOTAL
Dépenses AMI réelles 2013 (national) 31.054.423 9.829.285 1.035.343 44.825.962 73.426.552 160.171.566
Dépenses AMI simulées 2013 (national) 31.054.423 6.032.004 832.760 24.565.911 20.552.867 83.037.964
Economie sur les dépenses AMI 2013 (national) 0 3.797.281 202.583 20.260.051 52.873.686 77.133.601
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
160.000.000
180.000.000 Economie totale en
2013 : 77 millions €
Dépenses AMI en euros (national)
Coûts moyens
mensuels à charge
de l’AMI, 2010.
Profi l de
dépendance
Coûts à
charge AMI
Forfait A 209 €
Forfait B 724 €
Forfait C 1150 €

2
Éditorial
Les données chiffrées et les études sont une source d’infor-
mation précieuse pour permettre aux décideurs politiques
de développer des soins de santé accessibles et de qualité.
Les différents articles de ce numéro peuvent donc se lire dans
cette optique.
Dans certains cas, ce sont des données de population qui sont
requises pour se faire une idée correcte de la réalité à laquelle
les citoyens sont confrontés dans les différentes régions du
pays. Pour répondre à cette nécessité, l’Agence intermutualiste
(AIM) a développé un nouvel outil très puissant: l’Atlas AIM
permet aux personnes intéressées d’accéder aux différents
indicateurs et statistiques dérivés des bases de données des
mutuelles. Elles y trouveront des données sur les soins de
santé remboursés, les médicaments et les indicateurs socio-
économiques. Actuellement, ces bases de données renferment
déjà des informations sur le diabète, la médecine générale,
le dossier médical global, l’attestation malades chroniques
et la consommation d’antibiotiques en ambulatoire. Ces
données sont également disponibles sous la forme de cartes
au niveau de la Belgique, des régions, des provinces, des
arrondissements, des communes et même, sur demande, par
secteurs statistiques. Dans le présent MC Info vous en saurez
également plus sur les modalités d’inscription à cet Atlas.
La seconde étude de ce numéro recoupe elle aussi les
données des mutualités et est dédiée aux frais d’administration
des mutualités. Le tout - à nouveau - dans la plus grande
transparence. Cette analyse révèle que ces dépenses ne sont
pas aussi élevées que certains le prétendent. Elles représentent
3,3% des dépenses en soins de santé et sont passées de 4,1%
en 2003 à 3,3% en 2013. Et ce, malgré une législation de plus
en plus exigeante (MAF, forfaits de soins, OMNIO, …) ainsi
que l’augmentation du nombre de malades chroniques (liée
notamment au vieillissement) qui complexie le système. Cette
complexité se reète non seulement dans les applications
informatiques, mais également dans la nécessité de contacter
plus fréquemment les membres personnellement, an de mettre
leur dossier à jour. Autre constat: les frais d’administration en
Belgique sont inférieurs à ceux de nombreux pays limitrophes
et bien inférieurs aux dépenses des assureurs commerciaux
privés.
Les dépenses du secteur des médicaments représentent
une part non négligeable du budget de l’assurance maladie.
Et bien que de nombreuses économies aient déjà été consen-
ties, une rationalisation permettrait d’économiser davantage
sans pour autant porter atteinte à la qualité. C’est notamment
le cas des anticholestérolémiants que nous passerons sous la
loupe dans le troisième article du présent numéro. Si les mé-
decins ne prescrivaient que la simvastatine la moins chère, il
en découlerait une économie de 77 millions d’euros pour l’as-
surance maladie et de 11 millions pour les patients. Une autre
option consisterait à abaisser le prix des molécules plus oné-
reuses par un système d’adjudication et par le jeu de la concur-
rence.
Il ne faut pas nécessairement beaucoup de chiffres pour générer
des données de qualité, mais lorsqu’il s’agit d’un groupe limité,
il est préférable de l’interroger de façon approfondie. L’étude
sur la dépression et l’(in)capacité de travail va dans ce sens.
La dépression est un ‘processus’ difcile dans la vie d’un
individu. La faculté d’une personne en incapacité de travail
éventuelle à demander de l’aide au bon moment peut varier
d’une personne à l’autre. L’étude révèle que ce sont en
l’occurrence les contacts sociaux avec les proches et les
collègues de travail qui seront alors déterminants. L’approche
du médecin-conseil et du chef de service, en cas de reprise du
travail, jouent aussi un rôle important. Une reprise progressive
de ses activités par un travail à temps partiel ou éventuellement
temporairement adapté sont également des points d’attention.
Une dernière étude porte sur l’opportunité d’introduire une
assurance couvrant les risques liés à la dépendance en
Wallonie et à Bruxelles. Une précédente étude MC sur les ma-
lades chroniques (2008) a montré qu’en Flandre l’intervention
de l’assurance ‘dépendance’ (130 euros par mois) dans les frais
non-médicaux représentait une grande différence et permettait
d’alléger considérablement la facture pour le patient. L’article
recommande de considérer la dépendance comme un risque
social qu’il serait opportun d’assurer, comme c’est le cas par
exemple au Grand Duché du Luxembourg où il s’agit d’une
branche à part entière de la sécurité sociale. Il est important
qu’une telle assurance soit assortie d’instruments appropriés
pour évaluer la dépendance. Ce qui permettrait de donner une
vision adéquate du temps nécessaire pour renforcer les soins
et l’aide. Cela pourrait également servir de critère de nance-
ment. L’instauration d’une telle assurance ‘dépendance’ est une
compétence régionale. Mais à cet échelon aussi les mutualités
souhaitent apporter leur expertise et mettre leurs données à
disposition an de mettre en place, ensemble, cette politique.
Dr. Michiel Callens
Directeur R&D
2
MC-Informations 257 • septembre 2014

Atlas AIM
Une source de données unique dans les soins de santé
Birgit Gielen, project manager Atlas AIM pour l’Agence intermutualiste
Résumé
En décembre 2013, l’Agence intermutualiste (AIM) a lancé un nouveau site web, l’Atlas AIM (http://atlas.
ima-aim.be). Son objectif est de répondre au besoin croissant en termes de données chiffrées sur les soins
de santé et l’assurance maladie en mettant à disposition une source de référence permanente.
Aujourd’hui, l’Atlas AIM est accessible au grand public et une simple adresse e-mail permet de se créer un
profil utilisateur en ligne et d’accéder ainsi aux statistiques et indicateurs disponibles. Ceux-ci sont dérivés
des bases de données AIM et peuvent être visualisés au niveau de la Belgique, des régions, des provinces,
des arrondissements et des communes. Il est même possible, sur demande explicite, d’accéder aux secteurs
statistiques.
La prudence est toutefois de mise dans l’interprétation des chiffres. Les indicateurs sont en effet dérivés
des données de facturation des soins remboursés. Nous avons dès lors édicté une série de directives pour
baliser cette interprétation. De même, les chiffres ne sont publiés qu’après avoir été validés par des externes.
Outre des statistiques globales (nombre de bénéficiaires, pourcentage de bénéficiaires de l’intervention
majorée, etc.), l’Atlas AIM renferme actuellement des données sur la prévalence du diabète, le pourcentage
de bénéficiaires en possession d’une attestation malades chroniques, la proportion de bénéficiaires ayant
eu un contact avec le médecin généraliste, la part de bénéficiaires avec un Dossier médical global, des
indicateurs relatifs à la pratique de la médecine générale et une série d’indicateurs liés à la consommation
d’antibiotiques en ambulatoire.
L’offre d’indicateurs disponibles sera progressivement étendue. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez
des suggestions d’indicateurs pertinents.
une source d’information non négligeable, plus particulièrement
pour le suivi et l’amélioration de nos soins de santé.
L’Agence InterMutualiste (AIM1) collecte, traite, analyse et
interprète les données des 7 organismes assureurs belges dans
le cadre de projets de recherche pertinents pour la politique
de gestion du système de santé. L’AIM travaille à cet effet
1. Introduction
1.1. L’Agence InterMutualiste (AIM)
Chaque acte remboursé dans le cadre de l’Assurance Maladie
obligatoire en Belgique est enregistré dans les chiers de
facturation des organismes assureurs à l’aide d’un code de
nomenclature correspondant. Il en va de même pour la date,
les codes d’identication du patient, du prestataire de soins, de
l’hôpital… Même si ces données de facturation ne contiennent
pas directement de données diagnostiques, elles constituent
1 www.ima-aim.be
3
MC-Informations 257 • septembre 2014

en étroite collaboration avec l’Institut national d’Assurance
Maladie - Invalidité (INAMI), le Centre d’Expertise en Soins
de Santé (KCE), le Service Public Fédéral Santé Publique, la
Fondation Registre du Cancer, le Bureau du plan, l’Institut
Scientique de Santé Publique (ISP), et collabore également
fréquemment avec les instances fédérées compétentes.
Fin 2012, l’AIM fêtait ses 10 années d’existence2 (Préal et
Gielen 2013). En effet, l’asbl AIM a été fondée le 3 juillet 2002
à l’initiative commune des organismes assureurs. Les statuts
prévoyaient la représentation de l’INAMI, du KCE et du SPF
Santé Publique dans le conseil d’administration et furent
publiés au Moniteur belge le 31 octobre 2002. L’intégration
ultérieure dans la législation s’est faite via la loi-programme du
24 décembre 2002.
L’AIM a pour objectif de soutenir les organismes assureurs
dans leur rôle de maintien et d’amélioration constante d’un
système de soins de santé belge performant, accessible,
de haute qualité et efcace, fondé sur une base nancière
durable. D’autre part, le strict respect de la législation sur la
vie privée est une priorité. Une stricte gestion de la sécurité,
de la condentialité et de la vie privée a par conséquent été
développée dès le début .
1.2 Les données de l’AIM
Les données de l’AIM sont une source d’information importante
pour de nombreuses études, non seulement de l’AIM elle-même,
mais aussi du KCE, de l’INAMI, de l’ISP, de la Fondation Registre
du cancer, etc. Les objectifs de ces études peuvent mener à la
formulation de recommandations en vue d’améliorer la gestion
de l’Assurance maladie. Même les équipes de recherche
universitaires demandent de plus en plus de données à l’AIM
qui sont donc devenues une référence dans le système de
santé belge.
L’échantillon permanent
L’échantillon permanent a ouvert la voie à une mise à disposition
permanente et structurelle des données AIM comme source
d’information accessible aux différents acteurs et institutions
opérant dans le secteur des soins de santé. Cet échantillon
est constitué d’une cohorte d’assurés pour lesquels toutes
les dépenses de santé remboursées et les données socio-
économiques sont suivies d’année en année.
Cette cohorte a été sélectionnée par échantillonnage d’une
personne sur 40 afliées à un organisme assureur ; plus un
échantillon supplémentaire tiré au hasard de 1 personne
sur 20 parmi les afliés de 65 ans et plus. L’échantillon total
renferme donc les données de près de 305.000 personnes :
260.000 dans l’échantillon de base de 1 personne sur 40 et
45.000 dans l’échantillon supplémentaire des plus de 65 ans.
La surreprésentation des plus de 65 ans vise à augmenter la
précision pour ce groupe, qui a relativement plus de dépenses
de santé, et dans lequel les catégories d’âges les plus élevées
seraient autrement trop peu représentées3.
Plus de détails peuvent être trouvés sur le site web4 ou dans
une publication antérieure (Mertens et Preal 2009).
Les bases de données structurelles
L’AIM gère trois grandes bases de données structurelles :
une base de données «Population » reprenant des données
démographiques et socio-économiques sur les membres des
sept organismes assureurs belges ; une base de données
« Pharmanet » contenant les données relatives à tous les
médicaments remboursés, pour autant qu’ils n’aient pas été
délivrés par une ofcine hospitalière; et une base de données
«Soins de santé» reprenant le détail de toutes les prestations
remboursées dans le cadre de l’assurance-maladie obligatoire.
Des informations supplémentaires peuvent être trouvées sur le
site web5.
La base de données structurelle des soins de santé existe
depuis 2014. Pendant la période 2002-2013, l’AIM n’a recueilli
auprès des organismes assureurs que les dépenses en soins
de santé nécessaires à la réalisation de projets de recherche
spéciques. À la n du projet, ces données étaient alors
détruites. L’augmentation du nombre de projets et du volume
de données a entraîné une charge de travail insoutenable
et une certaine inefcacité. Les organismes assureurs ont
par conséquent décidé de développer une base de données
permanente (reprenant des données remontant à 2006). Cette
décision a également été soutenue par l’AIM qui a prouvé son
efcacité au cours des 11 premières années et qui a su mettre
en place de solides procédures internes de sécurité dans le
respect absolu des lois sur la vie privée. Depuis janvier 2014,
les organismes assureurs livrent chaque trimestre les données
individuelles codées de leurs membres à l’AIM.
2 http://www.ima-aim.be/nl/imaweb/archives#anc_N1011A
3 ?
4 http://www.ima-aim.be/nl/imaweb/DT/content/imaweb/datas/eps/eps_introduction.html
5 http://www.ima-aim.be/nl/imaweb/DT/content/imaweb/datas/general
4
MC-Informations 257 • septembre 2014

2. Atlas AIM
2.1. Origine (Matrice) de l’Atlas AIM
L’AIM collabore à des projets ou prend elle-même l’initiative
d’effectuer certaines études liées aux soins de santé.
Pareilles études requièrent habituellement la livraison unique
d’informations ou de chiffres. Mais ces chiffres sont très vite
dépassés, et il s’ensuit inévitablement la demande de données
mises à jour d’études déjà publiées. Si actualiser chaque année
(tous les deux ans) un rapport complet dans un domaine donné
s’avère réalisable, ces demandes conduisent rapidement au
dépassement des limites des ressources humaines disponibles.
Actualiser uniquement les principaux résultats d’un rapport
d’étude est bien moins chronophage, surtout si des procédures
standardisées sont mises en place. De même, la mise à jour
annuelle des chiffres ou des indicateurs clés de tous les projets
achevés permettrait un suivi efcace de certains domaines de
recherche.
Il existait donc depuis longtemps le besoin d’une source
de référence accessible qui contienne des informations
pertinentes pour la gestion du système de soins de santé, mais
qui démontre aussi le potentiel des données de l’AIM. Cette
source de référence devait pouvoir être utilisée par une variété
d’utilisateurs externes, mais aussi par les utilisateurs internes
comme point de départ pour des analyses spéciques à un
projet donné.
C’est ainsi qu’un nouveau projet a été approuvé en mars 2011
qui poursuivait ce double objectif: mettre les chiffres validés
issus des données de l’AIM et pertinents pour la politique de
soins de santé à la disposition du public cible, et illustrer ce
faisant la plus-value des données de l’AIM. Les décideurs
politiques, les chercheurs, les collaborateurs des organismes
assureurs ou de l’AIM, et les prestataires de soins de santé
constituent les principaux groupes cible. Pour le grand public,
les chiffres ou évolutions pertinents sont diffusés par la presse.
2.2. Réalisation de l’Atlas AIM
La «maturation» du projet a pris deux ans pendant lesquels
nous avons étudié divers sites web d’indicateurs nationaux
et européens. Nous avons également afné les objectifs
opérationnels, parachevé les procédures de contrôle de la
qualité et de l’efcacité et cherché le logiciel approprié pour
la publication en ligne. Le choix s’est porté sur le logiciel de
visualisation statistique Swing® d’ABF Research6.
Nous avons opté pour un départ modeste avec un nombre
limité d’indicateurs que nous allons compléter en fonction des
intéractions avec le groupe cible et de ses réactions. Ainsi, le
site http://atlas.ima-aim.be a été ouvert au public en décembre
2013 avec des indicateurs liés à trois thèmes: les statistiques de
référence de la population de bénéciaires (ex. le pourcentage
de bénéciaire de l’intervention majorée), la prévalence du
diabète et des indicateurs sur la médecine générale.
2.3 Les particularités de l’Atlas AIM
Dénition de l’Atlas AIM
L’Atlas AIM met des statistiques, de préférence de véritables
«indicateurs», en ligne à la disposition du grand public. Il ne
s’agit donc pas d’études scientiques distinctes ou de rapports
détaillés. L’Atlas AIM fournit des chiffres globaux pour la gestion
du système de santé et une référence pour tous les acteurs
impliqués; il met à disposition des chercheurs des données
qu’ils peuvent coupler avec les leurs ; peut envoyer des
invitations à entreprendre des actions ou à étudier certaines
données plus en détail … car «mesurer, c’est savoir» (Gielen
et Preal 2014).
Les indicateurs et statistiques sont regroupés selon 6thèmes:
la démographie et le socio-économique, la prévention, l’état
de santé, la consommation de soins de santé, l’accessibilité et
l’organisation des soins de santé. Cette première phase présente
un nombre limité d’indicateurs, provenant principalement des
études déjà réalisées.
En juin 2014, l’Atlas AIM comprenait - outre des statistiques
globales - des données sur la prévalence du diabète, le
pourcentage de bénéciaires en possession d’une attestation
malades chroniques, la proportion de bénéciaires ayant eu un
contact avec un médecin généraliste, la part de bénéciaires
avec un Dossier médical global (DMG), des indicateurs relatifs
à la pratique de la médecine générale et une série d’indicateurs
liés à la consommation d’antibiotiques en ambulatoire.
L’extension des données disponibles se fait progressivement
et dépend principalement des hommes-jours disponibles. Le
Tableau 1 présente un résumé des thèmes pour lesquels des
indicateurs sont disponibles ou en cours d’élaboration.
6 http://www.abfresearch.nl/
5
MC-Informations 257 • septembre 2014
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
1
/
48
100%