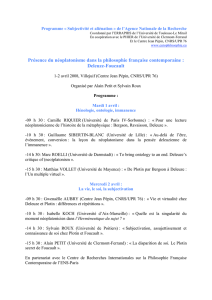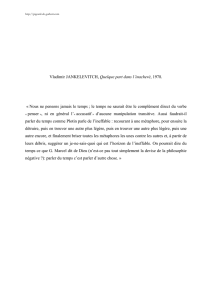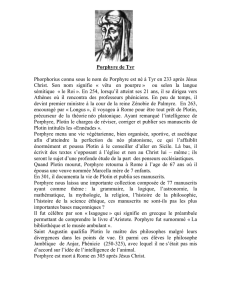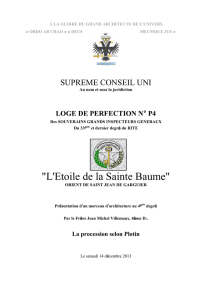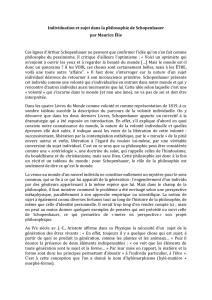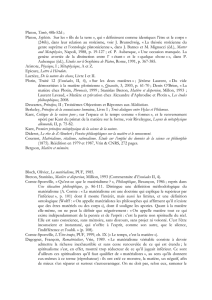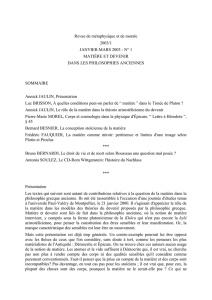Plotin aujourd`hui

CHAPITRE PREMIER
22e et 23e traités, selon l'ordre chronologique, ou ennéade VI, traités 4 et 5,
selon le classement de Porphyre
L'optimisme de Plotin, opposé à la philosophie moderne, consiste à affirmer l'ubiquité de
l'être, se fonde chez Parménide et Platon, et est en accord avec la physique actuelle.
La philosophie de Plotin (205-270 après J.C.) peut se résumer ainsi : « Le monde est beau, la
vie est belle, mais l'humanité fait son propre malheur. » Ce message s'oppose diamétralement à la
vision du monde qui est celle de l'époque moderne et qu'on peut énoncer ainsi : «Dieu, s'il existe, a
mal fait le monde. La situation de l'homme est intenable. Il peut seulement user de sa liberté qui le
place au-dessus de tout le reste de la création.» C'est dire que Plotin a beaucoup à apprendre à
l'homme d'aujourd'hui, si toutefois sa philosophie, qui n'est connue actuellement que par les
spécialistes, est autre chose qu'une fiction poétique. Il faut donc confronter Plotin à la physique la
plus récente, d'une part, et montrer que celle-ci lui donne raison désormais, après une période où elle
semblait lui donner tort. D'autre part, montrer que Plotin s'enracine dans la philosophie grecque, dont
il est l'apogée, celle de Parménide, puis de Platon notamment, qu'il continue en la reprenant au point
où celui-ci l'avait laissée. L'œuvre de Plotin comporte cinquante-quatre traités, édités par son disciple
Porphyre et répartis en six Ennéades (du grec : neuf) de neuf traités chacune. Etant donné que
chaque traité et même, peut-on dire, chaque phrase forme un tout difficile à démembrer et qui
explique la totalité du système d'un certain point de vue, on étudiera chaque traité en lui-même, sans
référence à d'autres, puis on envisagera la même philosophie plotinienne du point de vue d'un autre
traité, qui nous en apprendra davantage, etc. Porphyre nous a transmis l'ordre chronologique dans
lequel les cinquante-quatre traités ont été écrits et il les a regroupés artificiellement en six ennéades.
On commencera par les 22e et 23e traités, dans l'ordre chronologique, qui sont en fait un seul et même
texte, le plus fondamental, classés par Porphyre dans l'ennéade VI, aux numéros quatre et cinq, et
notés VI, 4 et 5. Ce texte est intitulé : «Ce qui est un et identique peut être en même temps
partout.» Il affirme donc l'ubiquité de l'être, aussi bien au sens de la méditation de Parménide, puis
de Platon sur l'Un ou Etre dans son dialogue Parménide, que, d'une manière prémonitoire, au sens de
la non-séparabilité de la mécanique quantique, exposée en France notamment par Bernard
d'Espagnat. On étudiera donc cette source parménidienne et platonicienne, et cette confirmation
moderne de la philosophie indépassable et méconnue de Plotin, afin d'expliquer le détail des
arguments des 22e et 23e traités, puis de tous les autres.
Parménide affirme que l'être est et que le non-être n'est pas, en aucune façon.
Commençons donc par le fondateur de la métaphysique occidentale, Parménide. Il s'exprime
dans un langage poétique, et relate l'initiation que lui auraient conférée des entités divines. «Les
Filles du Soleil, - Ayant laissé derrière elles les demeures de la Nuit, - Vers la lumière hâtaient notre
course (fragment I).» Il part de cette affirmation d'une logique imparable et d'une santé intellectuelle
exubérante : l'être est, le non-être n'est pas, en aucune façon. D'une manière apparemment obscure,
mais qui exprime une idée finalement assez simple, il distingue l'étant de l'être, c'est-à-dire ce que
l'on voit, les événements, les individus qui naissent et périssent, ce que Platon appellera les
phénomènes, et leur substrat, l'être qui est invisible et immuable. En effet, les étants ne peuvent,
malgré les apparences, ni sortir du néant, ni y retourner, puisque celui-ci n'a aucune espèce
d'existence. «Il est nécessaire de dire et penser de l'étant l'être : en effet, il est être (fr. VI).» La
langue grecque joue sur la différence entre le participe : étant, qui participe, comme le sujet auquel il
se rapporte, au temps et à l'espace, et l'infinitif : être, qui en est indépendant. L'intelligence est requise
d'apercevoir, derrière l'apparence kaléidoscopique des étants qui s'assemblent et se dispersent, la
permanence de l'être, qui ne peut pas ne pas être : «L'être absent, contemple-le néanmoins comme
être présent en certitude à l'intelligence ; - Car elle ne coupera pas l'étant de sa contiguïté à l'étant,
1

- Ni par dispersion universelle selon l'ordre du monde - Ni par assemblage (fr.IV).» Ce dernier mot
- signifie : placer debout avec (ou) en même temps, d'où : réunir en un tout par
l'assemblage des parties, d'où : faire naître, produire, « créer ». L'idée de création, c'est-à-dire de
passage du néant à l'être, est expressément rejetée par Parménide : «Jamais il n'arrivera que des non-
étants soient contraints d'être (fr. VII).» «Etant inengendré, impérissable l'être est aussi - Intact en
tous ses membres, sans émoi et sans fin ; - Jamais il ne fut ni ne sera, - Puisqu'il est maintenant tout
entier égal à lui-même, - Un, continu : quelle génération rechercher pour lui, - Quelle sorte
d'accroissement à partir d'où ? […] - Quelle nécessité aurait donc fait éclore - Ou plus tard ou plus
tôt ce qui aurait dans le rien son principe ? - Ainsi faut-il qu'il soit tout à fait ou pas du tout (fr.
VIII).»
Parménide manifeste une confiance sans faille en la plénitude de l'être, une absence de doute
concernant l'éventualité du néant, une solidité à toute épreuve au sujet de la raison et de son rapport à
l'être au-delà des apparences : «Ainsi faut-il que l'être soit tout à fait ou pas du tout. - Et de ce qui
est, jamais la foi inébranlable n'admettra - Qu'il provienne quelque chose en sus de lui ; pour ce
Justice n'a permis - En desserrant ses liens, à ce qui est, de naître et de périr, - Mais elle le
maintient ; touchant cela il y a pour le jugement alternative [ : crise, choix nécessaire] : - Il
est ou il n'est pas. […] Comment l'étant viendrait-il à l'être par la suite ? Comment serait-il venu à
être ? S'il est venu à être, il n'est pas, et non plus s'il doit un jour venir à être.- Ainsi la génération
s'éteint et on ne peut plus parler de destruction. - Il n'est pas non plus divisible, puisqu'il est tout
entier égal à soi-même ; - Gagner en quelque point, ce qui lui enlèverait le demeurer, - Ni perdre il
ne saurait, tout entier rempli qu'il est par l'étant. - Ainsi, il est tout entier continu, car l'étant est
conjoint à l'étant. - Davantage, immobile entre les limites de forts liens, - Il est sans commencement
et sans fin, puisque le naître et le périr - Furent absolument écartés de lui, repoussés au loin par la
foi véridique. - Le même dans le même il demeure et en lui-même repose, - Et reste ainsi fixé dans
l'immuable ici ; car la souveraine Nécessité - Le tient dans les liens d'une limite qui tout autour
l'enclôt. - C'est pourquoi la Justice est que l'étant ne soit pas inachevé. - Il est en effet sans manque,
alors que n'étant pas il manquerait de tout (fr. VIII).» Cette confiance dans l'être engendre une
défiance envers ceux qui, comme des girouettes, ne savent où s'orienter, ni que penser : «Les mortels
qui ne savent rien - Se forgent leurs illusions, les doubles têtes : car c'est le manque de
ressources - Qui dans leur cœur incline une intelligence errante ; ils sont entraînés, - A la fois
sourds et aveugles, hébétés, gent indécise - Par qui l'être et le non-être sont réputés le même - Et pas
le même : leur sentier à tous est labyrinthe [- : qui revient sur ses pas, qui se tourne en
sens contraire] (fr. VI).»
Objections de Platon : 1. Si la pensée est être, elle n'est pas la pensée DE l'être. 2.
Comment la multiplicité des étants ou phénomènes peut-elle résulter de l'unicité de l'être ?
Cette thèse logique, absolue, totalitaire, intégriste pour ainsi dire, entraîne au moins deux
difficultés qui seront relevées par Platon et traitées, semble-t-il, par Plotin. D'abord, étant donné que
tout ce qui serait distinct de l'être n'existerait en aucune façon, serait du néant, on ne saurait penser le
néant, on ne peut penser que l'être. De plus, la pensée ne peut être distincte de l'être, car ce serait la
réduire au néant. Il est donc nécessaire de poser l'équation : pensée = être. «Penser et être, c'est la
même chose (fr. III).» «Le non-étant, tu ne saurais le connaître (cela ne se peut) ni l'énoncer (fr. II).»
«Il n'est ni énonçable ni pensable que l'être puisse n'être pas (fr. VIII).» D'où cette confusion : «C'est
le même penser et ce à cause de quoi il y a pensée. - Car jamais sans l'étant, dans lequel il est
manifesté par la parole, - Tu ne trouveras le penser (fr. VIII).» L'objection générale de Platon est la
suivante : si la pensée est l'être, elle n'est pas la pensée de l'être, à moins que l'être ne se pense lui-
même et encore il aurait une distinction de soi à soi, ou bien encore tout serait seulement une grande
pensée. Platon examine donc dans la « première hypothèse » de son dialogue Parménide le statut de
l'Etre-Un parménidien et quels peuvent être ses rapports à la pensée. Une deuxième difficulté
2

consiste à savoir comment la multiplicité des étants peut être distincte, si peu que ce soit, de l'Etre en
dehors duquel il n'y a rien. Elle sera examinée dans la « deuxième hypothèse » du Parménide de
Platon.
Réponses. 1. La « première hypothèse » du Parménide de Platon conduit à affirmer que
l'Etre, ou Un, ou Dieu est distinct d'un être déterminé, n'a pas d'identité et est impensable.
Montrons d'abord que si l'Etre ou «Un qui est tout entier partout en même temps» est séparé,
n'appartient à aucun être en particulier, en ce sens, il n'existe pas. (En grec, le mot être, comme le mot
un est toujours écrit avec une minuscule, que ce soit chez Parménide, chez Platon ou chez Plotin, ou
même dans la traduction de Bréhier.) C'est la notion de Dieu ou Un selon la « première hypothèse »
du Parménide de Platon (137c à 142b). On prend le mot Un absolument, sans relation à autre chose,
et l'on demande : «Si l'Un est Un» et rien d'autre, quelles conséquences en découlent ? D'abord, l'Un
n'a point de parties, sinon il serait plusieurs. N'ayant point de parties, il n'a ni commencement, ni fin,
ni limite. Il est sans figure. L'Un n'est nulle part, ni en soi ni en autre que soi, car alors il se
dédoublerait en un Deuxième. Il est donc étranger au mouvement et au repos, comme à l'altération et
au devenir, car sinon il deviendrait autre que l'Un. L'Un n'a pas non plus de différence ou d'identité.
L'identité, en effet, suppose que l'on rentre dans une catégorie, il faut être id, cela, par opposition à
autre chose. L'Un qui est Un ne supporte aucune affection, attribution ou participation, car il n'est ni
semblable ni dissemblable à quoi que ce soit. L'Un n'est ni égal, ni inégal, ni plus vieux, ni plus jeune
que soi ou qu'autre que soi. Il est étranger au temps (éternel). Etant étranger au temps, il n'a même
pas d'être (déterminé, ou existence). «L'Un [ou Etre] ne participe donc d'aucune façon à l'être»
individuel. «L'Un n'est donc en aucune façon.» «Il n'a donc même pas assez d'être pour être un
[quelque chose].» L'Un est une pure essence, un néant d'être (déterminé). L'Un n'est pas un, il en est
séparé et l'Un n'est pas. A ce qui n'est pas, rien n'appartient : à l'Un n'appartient aucun nom (qui est
une détermination), on ne peut former de lui aucune phrase. C'est donc par abus de terme et faute de
mieux qu'on l'appelle Dieu, ou l'Etre, parce qu'il a tout de même quelque rapport avec l'être
individuel, ou plus exactement celui-ci a quelque rapport avec celui-là, comme on le verra dans la
seconde hypothèse. De l'Un, il n'y a ni définition, ni science, ni sensation, ni opinion. Il n'est donc
personne qui le nomme, qui l'exprime, qui le conjecture ou le connaisse.
Cette hypothèse, refusée par Platon, est admise par Plotin, qui en fait le fondement de
toute la philosophie.
L'explication de ces paradoxes, c'est que la source de l'être (individuel) n'est pas elle-même un
être individuel. Le principe n'est rien de ce dont il est le principe et l'essence n'est pas l'existence.
Tout nom est une détermination, une relation, et désigne un être identifié. Il est normal que si l'on
prend Un dans un sens absolu, indéterminé, non relatif, on arrive à la contradiction : Un n'est pas un
(quelque chose). La faculté de connaissance, la raison, seule employée ici, reconnaît elle-même sa
limite. L'Un est impensable, mais ce serait réduire l'homme à la raison, ou plutôt la totalité du réel à
ce que nous en percevons, que de s'en désintéresser pour autant. Platon critique donc (au sens de :
pratiquer un tri) Parménide, lequel, voulant affirmer qu'il n'y a rien en dehors de l'être, posait
l'équation pensée = être. Plus exactement, Platon distingue plusieurs hypothèses concernant les
rapports de la pensée et de l'être, en un exercice propédeutique. En attendant, sa conclusion, pour la
première hypothèse : si l'Un est Un, consistant à affirmer l'Etre Un de Parménide, est la suivante : il
est impossible qu'il en soit ainsi de l'Un, c'est-à-dire qu'il n'ait pas d'être et que l'on ne puisse rien
penser ni affirmer de lui. Il va donc examiner une deuxième hypothèse : si l'Un est. Mais Plotin, au
contraire, prend au pied de la lettre cette première méditation de Platon sur l'Un et en fait la base de
toute sa philosophie : l'Un ou Etre subsiste séparément de tout être individuel (c'est l'ab-solu, au sens
étymologique de : ce qui présente une solution de continuité par rapport au relatif). Mais aucun être
individuel n'est séparé de l'Un, qu'il accueille dans son intégralité, ainsi que va le montrer la seconde
hypothèse.
3

2e réponse. La « seconde hypothèse » du Parménide n'explique pas mais admet l'ubiquité
de l'Etre, présent en tout être. Cette solution est également rejetée ici par Platon et acceptée par
Plotin.
Soit la seconde hypothèse : si l'Un est (Platon, Parménide 142b - 144d). - Alors, «l'être sera
être de l'Un sans être identique à l'Un ; autrement l'être ne serait pas être de l'Un et lui, l'Un, ne
serait pas participant de l'être. Les deux formules : l'Un est, l'Un est Un seraient identiques. Or,
l'hypothèse présente n'est point : si l'Un est un, qu'en doit-il résulter ? Mais bien : si l'Un est.» L'Un
participe donc à l'être (individuel) sans s'identifier à lui. L'Un qui est, forme un tout, et l'Un ne
manque pas à la partie qu'est l'être, et l'être ne manque pas à la partie qu'est l'Un. «Ces deux parties, à
leur tour, possèdent chacune l'Un et l'être ; la partie en vient à se constituer d'au moins deux
parties ; et la même raison se répétant indéfiniment, tout ce qui vient se constituer partie est gros à
chaque fois de cette dualité de parties ; car l'Un est toujours gros de l'être, et l'être, gros de l'Un.»
«L'Un qui est sera donc ainsi pluralité infinie.» «A toute la réalité donc, en sa multiplicité, l'être a
été donné en partage» et «à toute partie singulière de l'être s'attache l'Un». Mais alors une
conclusion paradoxale s'impose : «L'Un serait tout entier à la fois en plusieurs lieux présent.» Platon
la refuse, du moins dans le Parménide, mais non dans le Sophiste, où elle constitue le fameux
parricide à l'égard de Parménide, et Plotin l'accepte. Aussi laissera-t-on Platon poursuivre seul cette
discussion et l'on abordera les 22e et 23e traités (dans l'ordre chronologique), où est justifié ce
fondement de la philosophie de Plotin : comment l'Un ou Etre peut-il être tout entier en chaque être ?
ou encore : quels sont les rapports de Dieu et du monde, particulièrement avec l'homme ?
Cette solution reprend la description des trois sortes de réalités de l'allégorie de la caverne,
mais en l'inversant, c'est-à-dire que le Bien ou Un n'a pas d'existence en soi, mais seulement dans
les phénomènes, qui sont ainsi réévalués.
Avant d'aborder le texte même des 22e et 23e traités, il faut remarquer que la méditation de
Plotin suit directement celle de Platon dans la célèbre allégorie de la caverne (République, livre VII).
Dans celle-ci, on rencontre trois sortes de réalités : le Bien ou Un ou Dieu, symbolisé par le Soleil,
source de l'être et du connaître ; des Idées, symbolisées par de véritables objets ; et des phénomènes,
symbolisés par le reflet, c'est-à-dire l'image portée sur la paroi d'une caverne par les véritables objets
éclairés par le Soleil. A cela s'ajoutent des prisonniers, enchaînés face au mur de la caverne,
symbolisant les êtres humains qui, depuis leur naissance, n'aperçoivent des réalités que les
phénomènes. Ils prennent les phénomènes pour les Idées. Phénomène vient du grec et
signifie : ce que l'on perçoit avec l'un des cinq sens, par exemple une table en bois, perçue par les
yeux du corps. Idée vient du grec et signifie : structure, forme. Pour prendre un exemple qui
n'est pas chez Platon mais en découle directement, l'Idée de la Table, perçue par les yeux de l'esprit,
si l'on peut dire, c'est le plan géométrique commun à toutes les tables. Platon prétend que l'Idée de la
Table est plus parfaite, plus réelle que n'importe quelle table phénoménale, en bois, en fer, etc., que le
langage courant qualifie de réelle, et qui n'est qu'une copie imparfaite, une approximation de l'Idée de
la Table. De même, la ligne droite du géomètre, immatérielle, éternelle, est plus ligne droite que
n'importe quel fil à plomb, arête de mur, cordeau d'arpenteur, etc. Cela dit, l'un des prisonniers de la
caverne parvient à se détacher de ses liens (qui symbolisent les sens et leurs illusions) et à se
retourner vers les véritables réalités, les Idées. C'est le philo-sophe, du grec - : amoureux
du savoir (l'acception amoureux de la sagesse est une acception seconde, dérivée, la sagesse étant
une conséquence du savoir véritable).
Cette doctrine a souvent été mal comprise, elle est pourtant évidente pour celui qui la
considère comme il faut, et difficilement contestable, du moins en ce qui concerne l'affirmation des
Idées, sinon leur supériorité sur les phénomènes. En effet, nous vivons dans un monde étonnant, qui
n'est pas un chaos, où il y a de l'ordre, des êtres, caractérisés par une structure dans une matière. De
4

plus, tous les chevaux ont une organisation commune qui les distingue de tous les chiens, etc. De
même, une table (à dessin, à écrire, à manger, à langer… et même de logarithmes, qui n'est pas en
bois !) se distingue d'une chaise. Un chat est un chat. Il y a donc une Idée du Cheval ou de la Table,
c'est-à-dire un certain plan nécessaire à une catégorie d'objets et répondant à une définition, par
exemple, pour la table : une surface sur laquelle sont rassemblés des éléments en vue d'un certain
travail. Même si toutes les tables en bois venaient à disparaître, la nécessité de leur plan subsisterait,
c'est ce que Platon veut dire quand il affirme que les Idées ont plus de réalité que les phénomènes.
Quant à cette unité, cette cohérence qui caractérise chaque être et dont Plotin parlera abondamment,
elle ne peut venir que d'une source mystérieuse que Platon appelle, faute de mieux, le Bien, source
d'ordre cosmique. De plus, JE ne peux nier la notion d'être, puisque moi-même j'en suis un. Enfin, il
faut remarquer ici ce qui caractérise la philosophie grecque toute entière : l'allégorie de la caverne
propose un théocentrisme, un réalisme dans lequel l'homme est le plus éloigné possible de la source
de l'être. Par opposition, la philosophie moderne est un anthropocentrisme, un humanisme, un
subjectivisme qui affirme les « droits de l'homme » et débute toute méditation par un « cogito ».
Enfin, Platon méprise ces sous-êtres trompeurs que sont les « phénomènes », séparés, privés de la
réalité suprême du Bien, perceptible par le philosophe. Plotin au contraire magnifie le phénomène en
sa beauté, puisque l'Un ou Dieu est tout entier en chacun (panthéisme), et que le Bien, à proprement
parler, n'existe pas en soi, mais seulement dans les phénomènes.
Cette thèse de Plotin, selon laquelle l'Etre est tout entier partout en même temps, …
Historiquement, la thèse de Plotin sur l'indivisibilité et l'ubiquité de l'Etre, source des Idées,
ou Formes, répond donc à l'objection que Platon lui-même se pose dans son dialogue Parménide,
objection devant laquelle celui-ci semble reculer et qui aurait incité Aristote à renoncer à la théorie
des Formes : comment une même Forme peut-elle être toute entière à la fois dans chaque être qu'elle
informe ? comment la « participation » est-elle possible ? Voyons maintenant l'énoncé de la thèse de
Plotin selon laquelle « ce qui est un et identique peut être en même temps partout », et comment
cette affirmation qui paraissait incompatible avec la physique du début du XXe siècle est maintenant
en accord avec la physique la plus récente. Il ne s'agit pas, en effet, ici, d'étudier Plotin à la manière
universitaire, comme une pièce de musée, mais de voir s'il est plus qu'une fiction poétique et s'il peut
éclairer notre vie d'aujourd'hui. Voici ce qu'il écrit dans le 22e traité, chapitre 3 : «Il ne faut pas
s'étonner que l'Etre soit présent en tout ce qui est dans un lieu, sans être lui-même dans un
lieu ; c'est le contraire qui serait étonnant, et même impossible : s'il avait un lieu propre,
comment serait-il présent aux objets qui seraient en un autre lieu, ou, du moins, intégralement
présent, comme nous le disons maintenant ? C'est parce qu'il n'a point de lieu, la raison nous le
dit, qu'il peut être présent tout entier dans les choses où il est, et qu'il est présent tout entier en
toutes aussi bien qu'en chacune. Sinon, chacune de ses parties serait en un endroit différent, il
serait un corps.» Or, «chaque corps est ce qu'il est grâce à sa forme ou Idée ; or, cette forme
n'a point une étendue déterminée, ni même une étendue quelconque.» L'Etre n'est pas non plus
l'ensemble des parties, prises comme un Tout, car « si l'ensemble des parties était l'Etre, aucune
partie, à elle toute seule, ne serait l'Etre.»
… est illustrée par l'exemple de la lumière qui, abstraction faite du corps lumineux, est
indivisible, n'a pas d'origine et est partout en même temps.
Plotin développe cette thèse par un exemple. Déjà Platon posait, dans la première partie du
Parménide, l'alternative suivante : la forme est-elle présente toute entière à la fois en des choses
multiples et discontinues à la manière d'un voile qui recouvre plusieurs individus, ou bien à la
manière du jour qui, un et identique, est en beaucoup de choses présent sans être pour cela séparé de
lui-même ? Plotin élabore cette image d'une manière ingénieuse et compliquée, en VI, 4, ch. 7 et 8 : «
Prenons comme centre une petite masse lumineuse ; plaçons autour d'elle un corps sphérique
et transparent, de telle manière que la lumière se propage du centre à toute la sphère, sans que
5
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
 11
11
 12
12
 13
13
 14
14
 15
15
 16
16
 17
17
 18
18
 19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24
 25
25
 26
26
 27
27
 28
28
 29
29
 30
30
 31
31
 32
32
 33
33
 34
34
 35
35
 36
36
 37
37
 38
38
 39
39
 40
40
 41
41
 42
42
 43
43
 44
44
 45
45
 46
46
 47
47
 48
48
 49
49
 50
50
 51
51
 52
52
 53
53
 54
54
 55
55
 56
56
 57
57
 58
58
 59
59
 60
60
 61
61
 62
62
 63
63
 64
64
 65
65
 66
66
 67
67
 68
68
 69
69
 70
70
 71
71
 72
72
 73
73
 74
74
 75
75
 76
76
 77
77
 78
78
 79
79
 80
80
 81
81
 82
82
 83
83
 84
84
 85
85
 86
86
 87
87
 88
88
 89
89
 90
90
 91
91
 92
92
 93
93
 94
94
 95
95
 96
96
 97
97
 98
98
 99
99
 100
100
 101
101
 102
102
 103
103
 104
104
 105
105
 106
106
 107
107
 108
108
 109
109
 110
110
 111
111
 112
112
 113
113
 114
114
 115
115
 116
116
 117
117
 118
118
 119
119
 120
120
 121
121
 122
122
 123
123
 124
124
 125
125
 126
126
 127
127
 128
128
 129
129
 130
130
 131
131
 132
132
 133
133
 134
134
 135
135
 136
136
 137
137
 138
138
 139
139
 140
140
 141
141
 142
142
 143
143
 144
144
 145
145
 146
146
1
/
146
100%