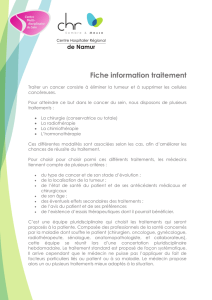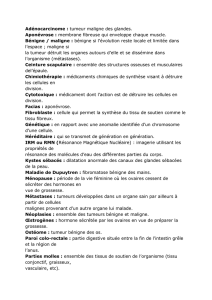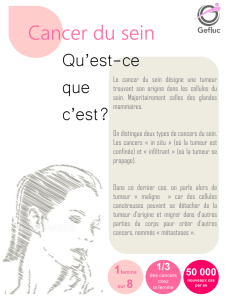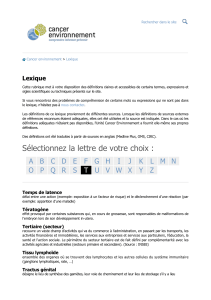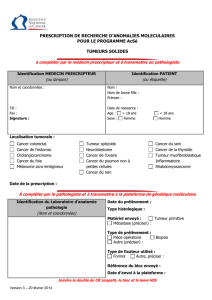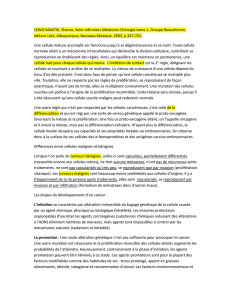25/11/13 PLESSY Alexandre L2 BTIME E. CHARAFE

BTIME – Éléments de nomenclature des processus pathologiques : tumeurs bénignes – cellules cancéreuses
25/11/13
PLESSY Alexandre L2
BTIME
E. CHARAFE JAUFFRET‐
7 pages – Correcteur N°1
Éléments de nomenclature des processus pathologiques : tumeurs bénignes – cellules cancéreuses
1. Généralités
Dans l’être humain, il y a un très grand nombre de cellules : 1014 cellules organisées en tissus, en organes et en
systèmes avec des spécialisations différentes.
De façon globale, le développement et la croissance sont conditionnés par des processus complexes qui
permettent la régulation des différentes étapes de la vie d’une cellule : la prolifération, la différenciation, la
sénescence (accompagnée de nombreux phénomènes moléculaires pouvant engendrer un processus cancéreux)
et la mort cellulaire programmée (l’apoptose).
Cas des cellules souches : dans les organes, il y a des cellules que l’on appelle « cellules mémoires », qui
permettent, dans certains cas, la régénération. Ce sont les cellules souches qui ont des caractéristiques
particulières par rapport à la prolifération, la différenciation, la sénescence et l’apoptose. En effet, elles ont une
durée de vie longue et vont proliférer en cas de stimulus (lésions, hormones…). Ces cellules peuvent proliférer
de deux façons différentes : soit en donnant deux cellules souches (division symétrique) ; soit en donnant par
leur division une cellule souche et une cellule qui va s’engager en différenciation pour assurer la reformation de
l’organe.
Exemple du sein : lors de la grossesse la glande mammaire va être soumise à un grand stimulus hormonal qui
fait que l’ensemble des cellules vont proliférer et se préparer à la lactation. A l’accouchement, la libération
d’ocytocine va engendrer la production du lait et à l’inverse, lors du sevrage il va y avoir apoptose massive des
cellules de la glande. La glande va se reconstituer à l’identique grâce aux cellules souches. Ce serait les
cellules souches qui engendrent les cancers.
Ces phénomènes sont également mis en jeu au cours du renouvellement des cellules à durée de vie limitée, de
la régénération des cellules parenchymateuses détruites et de la cicatrisation des plaies et lésions
inflammatoires. La bonne régulation de ces processus de prolifération, de différenciation, de sénescence et
d’apoptose est à l’origine de l’homéostasie tissulaire.
Les anomalies de l’ensemble de cette régulation peuvent aboutir à la formation d’une tumeur.
1/7
Plan
1. Généralités
2. Définition d'une tumeur
3. Composition d'une tumeur
4. Caractéristiques d'une tumeur
5. Type histologique d'une tumeur
6. Différenciation tumorale
7. Critères permettant de différencier les tumeurs bénignes et malignes
8. Les limites de la classification entre tumeurs maligne et bénigne
9. Nomenclature des tumeurs : (catalogue, mais à connaître par cœur)
10. Marqueurs typiques des tumeurs
11. Anomalies morphologiques

BTIME – Éléments de nomenclature des processus pathologiques : tumeurs bénignes – cellules cancéreuses
2. Définition d'une tumeur
Le terme tumeur (du latin tumere, enfler) désigne, en médecine, une augmentation de volume d’un tissu,
clairement délimitée, sans précision de cause. C’est une néoformation de tissus corporels (néoplasie), qui a lieu
à la suite d’un dérèglement de la croissance cellulaire de type bénin ou malin.
N’importe quel tissu peut être le siège d’une néoplasie. Les conséquences d’une néoplasie peuvent être très
différentes en fonction de la localisation de la tumeur et de la fonction du tissu affecté. En effet, une tumeur,
selon ses paramètres et selon sa taille peut conduire à un dysfonctionnement des organes et nuire à l’ensemble
de l’organisme, voir causer la mort. Les tumeurs surviennent chez tous les êtres vivants, y compris les plantes.
Les tumeurs bénignes sont des tumeurs souvent sans gravité, c'est-à-dire ne pouvant donner lieu à des
« tumeurs filles » ou métastases. C’est le cas des verrues ou des naevi (grains de beauté). Les tumeurs bénignes
affectant la peau sont néanmoins souvent perçues comme inesthétiques et peuvent donner lieu à une ablation.
Cependant une tumeur bénigne peut entraîner des complications graves (compression, inflammation…) par
son action mécanique. C'est le cas du méningiome qui peut entraîner des convulsions, voir un engagement
cérébral (le cerveau est trop comprimé et descend par le trou occipital, ce qui entraîne le décès).
Les tumeurs malignes sont souvent désignées sous le terme de cancer. Ce sont des tumeurs agressives : en plus
d’attaquer les tissus environnants, elles produisent des métastases qui se propagent à travers le sang ou la
lymphe. C'est l'envahissement des ganglions et des autres organes qui va conditionner le pronostic vital et ce
que l'on nomme le TNM.
Le TNM est une classification des cancers reconnue de façon internationale , c'est à dire par l'OMS :
–T = taille tumorale
–N = statut ganglionnaire
–M = statut métastatique
Plus la taille de la tumeur augmente, plus le T augmente. Le statut ganglionnaire peut être N0, N1 voir N2 selon
le nombre de ganglions envahis. M0 correspond à aucunes métastases et M1 à des métastases.
Il existe aussi ce que l'on appelle le pTNM (= pathological TNM) c'est une classification plus fiable étant
donné qu'elle se fait après analyse de la tumeur par un anatomopathologiste.
3. Composition d'une tumeur
Le tissu tumoral est composé de :
•cellules tumorales
•stroma tumoral (tissu de soutien) qui sous-tend la croissance de la tumeur : il est principalement
composé de vaisseaux et cellules sécrétant des facteurs de croissances... Ce stroma est une des cibles en
thérapie anti-cancéreuse, le but étant d’empêcher l'angiogenèse et donc la vascularisation tumorale. On
trouve aussi dans le stroma tumoral des éléments du système immunitaire : l’immunité du cancer est très
étudiée ; l’idée est de moduler l’immunité tumorale, il faudrait « booster » les NK pour tuer les cellules
cancéreuses.
4. Caractéristiques d'une tumeur
Une tumeur est une prolifération cellulaire liée à la multiplication d'une ou plusieurs cellules anormales
(notion de clonalité).
C'est donc une masse tissulaire ressemblant plus ou moins à du tissu normal : notion de différenciation
tumorale ; par exemple, dans le foie, une tumeur bien différenciée sera un hépatocarcinome (prolifération
d'hépatocytes) ou un cholangiocarcinome (prolifération des cellules formant les canaux biliaires).
2/7

BTIME – Éléments de nomenclature des processus pathologiques : tumeurs bénignes – cellules cancéreuses
Une tumeur a une certaine autonomie biologique : la prolifération persiste après arrêt du « stimulus » qui lui a
donné naissance. C'est une notion assez discutée : on parle plutôt d'autonomie relative, les cellules tumorales et
le stroma dialoguent de façon très proche.
Au cours du processus tumoral, il y peut y avoir une succession d’événements génétiques : proto-oncogènes et
gènes suppresseurs de tumeurs qui s’activent, défaillance des gènes contrôlant l’intégrité de l’ADN... Ainsi, la
tumeur devient :
o capable de générer ses propres signaux mitogènes
o résistante aux signaux extérieurs d’inhibition de la croissance
o immortelle
o capable d'infiltrer des tissus adjacents
o capable de néoangiogenèse
5. Type histologique d’une tumeur
Le type histologique est définit sur l'analyse anatomopathologique : il permet de définir un pronostic et de
guider le traitement. On qualifie un type histologique grâce à des critères histologiques communs définis par
l’OMS.
Ainsi, le type histologique d'une tumeur va être défini en fonction de l'organe mais aussi de la cellule dont
elle semble dériver. Au sein d'un même organe, des tumeurs de différents types histologiques sont possibles.
Cas particulier : les tumeurs vasculaires sont dites ubiquitaires, on peut en retrouver dans la totalité des organes.
Il existe cependant des métastases de primitif inconnu : la tumeur est tellement peu différenciée qu'il devient
très difficile de connaître son origine.
6. Différenciation tumorale
C'est la tendance de la tumeur à ressembler au tissu dont elle est censée dériver. Ce paramètre permet de classer
la tumeur en fonction de sa différenciation :
•bien différenciée : si elle ressemble trait pour trait au tissu normal dont elle est issue
•moyennement différenciée : si elle lui ressemble de façon lointaine
•indifférenciée : si elle lui ressemble très peu sur le plan histologique (on parle alors d'anaplasie)
Les tumeurs bénignes sont en général très bien différenciées. C'est assez logique : une tumeur bien différenciée
est une tumeur dont les cellules se divisent peu alors qu'une tumeur indifférenciée va être agressive étant donné
que ses cellules sont en permanence en division.
Cette notion de différenciation permet ainsi de guider le pronostic.
7. Critères permettant de différencier les tumeurs bénignes et malignes
Généralement, la distinction entre une tumeur bénigne et une tumeur maligne est ce qu'on peut appeler une
distinction évolutive : une tumeur bénigne sera une tumeur qui habituellement n’entraîne pas la mort alors
qu'une tumeur maligne peut entraîner la mort.
Il existe aussi des critères macroscopiques et histologiques permettant de faire cette différenciation.
3/7

BTIME – Éléments de nomenclature des processus pathologiques : tumeurs bénignes – cellules cancéreuses
Tumeur bénigne Tumeur maligne
bien limitée mal limitée
encapsulée non encapsulée
histologiquement semblable au tissu d'origine plus ou moins semblable au tissu d'origine
(dédifférenciation, différenciation aberrante)
cellules régulières cellules irrégulières (cellules cancéreuses)
croissance lente croissance rapide
refoulement sans destruction des tissus voisins envahissement des tissus voisins
pas de récidive locale après exérèse complète récidive possible après exérèse supposée totale
pas de métastases métastases
Exemple de tumeur bénigne : léiomyome du col
utérin (la tumeur est bien limité)
Cette tumeur va engendrer des saignements.
8. Les limites de la classification entre tumeurs maligne et bénigne
Il peut y avoir continuum biologique entre une tumeur bénigne et maligne. C'est à dire qu'une tumeur
initialement bénigne peut dégénérer et devenir maligne.
Un cas bien connu : tumeur du colon (polype du colon) initialement bénigne mais qui peut évoluer vers
l'adénocarcinome.
Il existe aussi des tumeurs qu'il faut retirer car, même si elles ne donnent pas de métastases, sont très agressives
localement (tumeurs phyllodes du sein et carcinome basocellulaire de la peau).
9. Nomenclature des tumeurs : (catalogue, mais à connaître par cœur)
L’examen anatomopathologique d’une tumeur a pour objectif d’établir le type histologique de la tumeur, son
grade, son stade (extension) et enfin d'évaluer le pronostic pour aider à déterminer le traitement.
La traduction de cet examen est le nom de la tumeur :
•racine faisant référence à la différenciation tissulaire : rhabdo /léïomyo /adéno
•suffixe : permet de savoir si c'est bénin/malin/embryonnaire, unique/multiple et enfin si c'est
épithélial/conjonctif
◦ome : bénin (sauf lymphome et mélanome)
◦matose : tumeurs multiples ou diffuses (leïomyomatose, adénomatose)
4/7

BTIME – Éléments de nomenclature des processus pathologiques : tumeurs bénignes – cellules cancéreuses
◦carcinome : tumeur maligne épithéliale (adénocarcinome)
◦sarcome : tumeur maligne conjonctive (rhabdomyosarcome)
◦blastome : tumeur embryonnaire (neuroblastome)
TISSU D’ORIGINE BENIGNE MALIGNE
Tissu épithelial
Malpighien
Transitionnel (urothèlium)
Glandulaire
Papillome, condylome
Papillome
Adénome
Carcinome épidermoïde
Carcinome basocellulaire
Carcinome transitionnel
Adénocarcinome
Tissu conjonctif commun
Fibrocytaire
Histiocytaire
Fibrome
Histiocytofibrome
Fibro-sarcome
Histiocytome malin fibreux
Tissu conjonctif spécialisé
Adipeux
Musculaire lisse
Musculaire strié
Synovial
Vasculaire
Cartilagineux
Osseux
Lipome
Leiomyome
Rhabdomyome
Angiome
Chondrome
Ostéome
Liposarcome
Leiomyosarcome
Rhabdomyosarcome
Synovialosarcome
Angiosarcome
Chondrosarcome
Ostéosarcome
Tissu hématopoiétique
Lymphoïde
Myéloide
Syndrome lymphoprolifératifs
Lymphomes, maladie de hodgkin
Syndromes myéloprolifératifs
Tissu nerveux
Meninge
Nerf périphérique
Tissu soutien du SNC
Méningiome
Schwannome (neurinome)
Neurofibrome
Astrocytome, gliome
Schwannome malin
Glioblastome (extrêmement grave)
Tissu mésothélial Mésothéliome bénin Mésothélium malin
Tissu mélanique Neavus naevocellulaire Mélanome
Tissu embryonnaire
Complexe, pluritissulaire Tératome amture ou bénin Tératome immature ou malin
À noter : les tumeurs embryonnaires sont très exceptionnelles.
5/7
 6
6
 7
7
1
/
7
100%