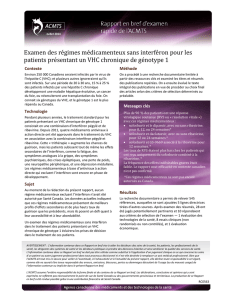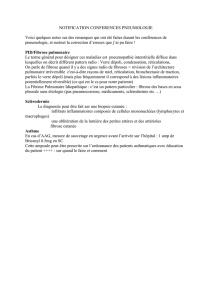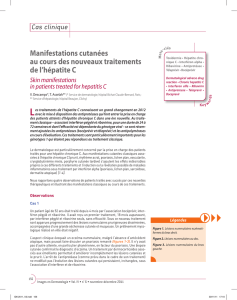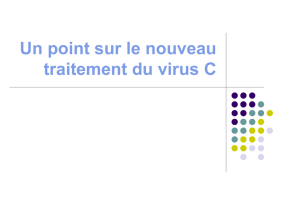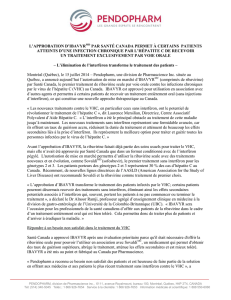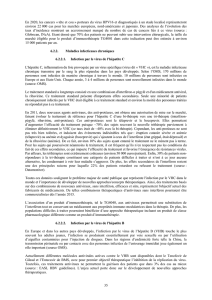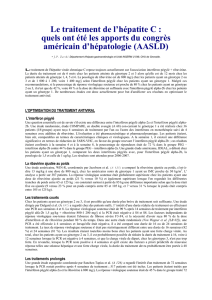Lire l`article complet

* Service d’hépato-gastroentérologie, CHU Nancy-Brabois.
Hépatite C et non-réponse : des solutions
●H. Barraud*
D
es progrès majeurs ont été réalisés durant ces quinze
dernières années dans le diagnostic, l’histoire natu-
relle et le traitement des patients atteints d’hépatite
chronique C. Le traitement de référence associe l’interféron
pégylé à la ribavirine. Une réponse virologique prolongée, définie
par l’absence d’ARN viral 6 mois après la fin du traitement et
presque synonyme de guérison, est obtenue chez plus de la moitié
des patients. Malgré ces avancées thérapeutiques, près de 50 % des
patients, principalement des porteurs du virus C de génotype 1, sont
considérés comme non répondeurs virologiques ou rechuteurs à
une bithérapie bien conduite (1-3).
EXISTE-T-IL DES NON-RÉPONDEURS ?
D’après la communication de V. de Ledinghen
(hôpital Haut-Lévêque, Bordeaux)
L’étude des cinétiques précoces de la réplication virale chez des
patients traités par bithérapie montre que 64 % sont des “répondeurs
rapides”, c’est-à-dire présentant une diminution marquée de leur
charge virale dès les premières semaines du traitement, alors que
24 % ont une réponse réelle mais lente au cours des 24 premières
semaines de traitement. Seuls 8 % des patients n’ont pas de varia-
tion de leur charge virale au cours des 6 premiers mois de traite-
ment, et correspondent ainsi à de “vrais non-répondeurs”, tandis
que 4 % présentent une réponse partielle avec une diminution
modeste de la charge virale, d’environ 0,5 log
10
(diapositive 1) (4).
Les patients jugés “non répondeurs” pourraient donc ne pas être
si nombreux, et certains le sont probablement plus du fait d’une
insuffisance thérapeutique, liée à une dose, à une durée et/ou à
une adhésion au traitement inadaptées, que du fait d’une résistance
virale.
L’issue virologique du traitement antiviral peut être estimée par
l’existence d’une réponse virologique à la douzième semaine de
traitement, définie par une diminution d’au moins 2 log
10
de la
charge virale préthérapeutique ou par un ARN viral indétectable
dans le sérum. Elle est observée chez 86 % des malades traités
(tous génotypes confondus). Chez ces patients, la probabilité d’une
réponse virologique prolongée est de 65 %. À l’inverse, la proba-
bilité de réponse virologique prolongée chez les patients non répon-
deurs à la douzième semaine de traitement est quasi nulle, voisine
de 3 % (diapositive 2) (1). Ces données indiquent qu’une priorité
doit être accordée aux trois premiers mois, tout devant être mis
en œuvre pour optimiser le traitement durant cette période, aussi
bien en termes de dose d’interféron et de ribavirine qu’en termes
de gestion des effets indésirables.
Chute de 2 log10
ou ARN-
Oui 65 %
86 %
S12
35 %
RVP
NR
Non
3 %
14 % 97 %
RVP
NR
Fried MW et al. NEJM 2002;347:975-82.
Diapositive 2. Priorité aux 3 premiers mois.
Pas de réponse (≈ 8 %)
Réponse partielle (4 %)
Réponse lente (≈ 24 %)
Zeusem S et al. J Hepatol 2005;43:250-7.
Réponse
rapide (≈ 64 %)
1
> 2,0
> 0,5
0
Mois
270 malades naïfs
Pegasys® 180 µg + Copegus® 1 000/1 200 mg/j
VL decrease (log copies/ml)
ETR
6
Diapositive 1. Cinétiques virales précoces sous traitement par PEG-IFNα-
2a + ribavirine.
ÉCHOS DE SYMPOSIUM
La lettre de l’hépato-gastroentérologue - n° 1 - vol. IX - janvier-février 2006
52

Comment diminuer le nombre de malades
non répondeurs ?
Commencer un traitement antiviral n’est jamais une urgence.
L’annonce du diagnostic a déjà été un stress, le diagnostic de non-
réponse en est certainement un autre. Il faut savoir tenir compte
de la vie familiale (naissance, divorce, maladie de l’entourage,
etc.) mais aussi professionnelle du patient (promotion, licencie-
ment, déménagement, etc.), afin de déterminer le moment le plus
opportun pour débuter le traitement, sans pour autant attendre la
progression de la fibrose… Il est important de rechercher d’éven-
tuels facteurs de mauvais pronostic, tels que l’âge avancé, le sexe
masculin, un indice de masse corporelle élevé, une infection par
un virus de génotype 1 ou 4, une forte charge virale, l’existence
d’une stéatose et/ou d’une fibrose sévère. Parmi ces facteurs, cer-
tains sont liés à une insulinorésistance et doivent être pris en
charge avant le début du traitement (5). La biopsie hépatique peut
alors être utile, pour différencier les lésions liées au virus et une
stéatose hépatique non alcoolique. Un régime hypocalorique asso-
cié à la pratique quotidienne d’exercice physique en cas de sur-
poids ainsi que l’interruption d’une éventuelle consommation
excessive d’alcool sont aussi importants à considérer avant l’ini-
tiation du traitement que la prise en charge d’un diabète et/ou d’une
dyslipidémie.
Une fois le traitement débuté, il s’agira de tout mettre en œuvre
pour ne pas avoir à l’interrompre ou même à diminuer les doses,
et permettre ainsi au patient de conserver le maximum de chances
de réponse virologique prolongée. L’objectif est de maintenir le
traitement à plus de 80 % de la dose de départ, pour l’interféron
pégylé comme pour la ribavirine (6). Il a en effet été clairement
montré que plus la posologie de la ribavirine était faible, plus les
chances d’éradication virale prolongée étaient faibles (7) (diapo-
sitives 3 et 4).
L’adhésion au traitement doit être impérativement favorisée, d’où
l’importance de bien évaluer au préalable les comorbidités et les
éventuelles contre-indications (8). Il faut savoir aborder le problème
de l’abstinence alcoolique, favoriser les rencontres mensuelles,
s’aider de la famille, des infirmières, enfin gérer au mieux chaque
effet lié à l’administration du traitement antiviral. Parmi eux, l’ané-
mie représente la première cause d’interruption du traitement anti-
viral, et induit la réduction de la posologie de la ribavirine (hémo-
globine < 10 g/l) dans 15 à 22 % des cas (1, 3, 9). La prescription
d’érythropoïétine peut permettre de maintenir la posologie de la
ribavirine à plus de 80 % de la dose nécessaire, et ainsi d’accroître
les chances de réponse virologique prolongée chez les patients
traités (10). Une étude rétrospective effectuée chez 201 patients
de génotype 1 a en effet montré un taux de réponse virologique
prolongée de 71 % versus 43 % chez les patients ne bénéficiant pas
d’injections d’érythropoïétine; en outre, une amélioration de la
qualité de vie a été mise en évidence chez les patients traités par
érythropoïétine (11) (diapositives 5 et 6). Le rapport coût/effica-
Mc Hutchinson JG et al. Gastroenterology 2002;123:1061-9.
Interféron retard + ribavirine :
80 % de la dose
Réponse virologique prolongée
p = 0,04
Génotypes 1 : si 80 % de la durée du traitement,
réponse virologique prolongée : 51 % versus 34 % (p = 0,01)
63
> 80 %
0
10
20
30
40
50
60
70
52
< 80 %
Diapositive 3. Essayer de maintenir les doses > 80 %.
Reddy KR et al. EASL 2005.
p = 0,01
Réponse virologique prolongée en fonction de la dose de ribavirine
reçue durant les 12 premières semaines de traitement.
0
10
20
30
40
50
60
70 66
> 97 %
57
80-97 %
45
60-80 %
0
< 60 %
Diapositive 4. Ribavirine : les 12 premières semaines sont essentielles !
Afdhal NH et al. Gastroenterology 2004:126:1302-11.
• N = 185
• Interféron + ribavirine
• EPO ou placebo
si Hb < 12 g/dl
• Amélioration de la qualité
de la vie (SF36) p < 0,001 0
20
40
60
80
100 88
EPO
p < 0,001
Maintien de la dose de ribavirine
60
Placebo
Diapositive 5. Effet de l’EPO sur la dose de ribavirine.
Zubair S et al. DDW 2005.
• N = 201
• Génotype 1
• Étude rétrospective
Coût/efficacité ? 0
20
40
60
80
100
71
EPO
p = 0,01
Réponse virologique prolongée
43
Abstention
Diapositive 6. Érythropoïétine et réponse virologique prolongée.
ÉCHOS DE SYMPOSIUM
La lettre de l’hépato-gastroentérologue - n° 1 - vol. IX - janvier-février 2006 53

cité reste encore à évaluer. Un essai multicentrique randomisé
(PEGEPO) comparant l’utilisation ou non de l’epoetin ß chez des
patients atteints d’hépatite chronique virale C et traités par bithéra-
pie est actuellement en cours, coordonné par F. Lunel.
Une neutropénie peut également être induite par le traitement anti-
viral ; une seule étude rétrospective a évalué l’efficacité du G-CSF
chez 9 patients de génotype 1 ; le taux de réponse virologique pro-
longée n’était pas significativement différent chez les patients rece-
vant du G-CSF et chez ceux n’en bénéficiant pas (11). À ce jour,
il n’y a donc pas de recommandation pour sa prescription lors du
traitement d’une hépatite chronique C. La place d’un agoniste des
récepteurs de la thrombopoïétine dans le traitement des thrombo-
pénies induites par le traitement antiviral mérite également d’être
précisée ; c’est l’objet d’une étude de phase II, dont le promoteur
est GlaxoSmithKline.
Les troubles de l’humeur et la dépression sont fréquents au cours
du traitement antiviral ; leur incidence varie de 20 à 39 % ; ils sur-
viennent principalement pendant les 12 premières semaines de
traitement (87 %) (1, 2, 12-14). Leur dépistage (et leur traitement)
est essentiel avant de débuter la bithérapie, dans la mesure où ils
risquent de se majorer et d’induire une mauvaise adhésion au trai-
tement. Une étude portant sur 14 malades traités par paroxétine
(20 mg/j) en cas de dépression a montré que 79 % des patients étaient
parvenus au terme du traitement antiviral ; les différents scores
psychiatriques s’étaient en outre améliorés (15). Il a également été
observé qu’un traitement préventif par citalopram (20 mg/j) admi-
nistré chez 14 malades ayant des antécédents psychiatriques per-
mettait de diminuer significativement la fréquence de la dépression
(14 %, contre 64 % dans le groupe non traité) (16). Une étude
multicentrique randomisée, ParoPEG (ANRS), réalisée en double
aveugle et coordonnée par J.P. Bronowicki (Nancy), débute actuel-
lement ; son objectif est d’évaluer l’efficacité de la paroxétine dans
la prévention du syndrome dépressif chez des patients traités pour
une hépatite chronique C.
Faut-il modifier la manière de prescrire
l’interféron retard ?
Un gain d’efficacité du PEG-IFNα-2a associé à la ribavirine (1 à
1,2 g/j) est observé dans l’étude HALT C, portant sur 604 malades
non répondeurs à un traitement antérieur par interféron standard
avec ou sans ribavirine : la réponse virologique prolongée après
48 semaines de traitement était de 28 % en cas de traitement par
interféron seul au préalable, contre 12 % en cas de bithérapie (17).
L’interféron pégylé en association avec la ribavirine est indiscu-
tablement le traitement de référence. Le changement d’interféron
pégylé est possible ; un essai non contrôlé portant sur 31 malades
non répondeurs au PEG-IFNα-2b associé à la ribavirine (800 mg/j)
a montré un bénéfice du retraitement par PEG-IFNα-2a associé
à la ribavirine (1 à 1,2 g/j), avec obtention d’un taux de réponse
virologique prolongée (18).
La durée du traitement antiviral pourrait être majorée à 72 semaines
au lieu de 48 semaines pour les génotypes 1, bien que le bénéfice
ne soit pas clairement démontré. L’étude TeraVic-4, effectuée chez
326 malades jugés non répondeurs après quatre semaines de traite-
ment, qui ont ensuite bénéficié d’un traitement par PEG-IFNα-2a
(180 µg/sem.) et ribavirine (800 mg/j) durant 48 ou 72 semaines,
a cependant montré une augmentation significative du taux de
réponse virologique prolongée chez les patients traités durant
72 semaines (32 % contre 45 %) (19) (diapositive 7). L’allonge-
ment de la durée de traitement pourrait être nécessaire chez cer-
tains malades “répondeurs lents” ; la posologie de la ribavirine
dans cette étude était toutefois inférieure à celle habituellement
administrée.
Sanchez Tapias JM et al. AASLD 2004.
• TeraVic-4
• 326 malades
non répondeurs à S4
• PEG-IFNα-2a 180 µg/sem.
• Ribavirine 800 mg/j
• 48 sem. versus 72 sem.
0
10
20
30
40
50
32
48 sem.
p = 0,01
Réponse virologique prolongée
45
72 sem.
Diapositive 7. Faut-il traiter plus longtemps ?
L’augmentation du rythme des injections d’interféron pégylé
(2/sem.) pourrait être une option thérapeutique intéressante. Une
étude, réalisée chez 26 malades naïfs traités par PEG-IFNα-2b et
ribavirine (10,6 mg/kg/j) pendant 24 ou 48 semaines (selon le
génotype), a ainsi montré une augmentation significative du taux
de réponse virologique prolongée chez les patients traités par deux
injections par semaine comparativement à ceux traités par une
injection unique d’interféron pégylé (72 % contre 25 %) (20). Le
pourcentage anormalement faible de réponse virologique obser-
vée dans cette étude chez les patients traités par une seule injection
ne permet pas, cependant, de recommander cette pratique.
L’augmentation de la dose d’interféron pégylé pourrait être une
autre piste ; Diago et al. ont en effet montré une augmentation du
taux de réponse virologique prolongée (37,5 %) chez des patients
de génotype 1 non répondeurs à une bithérapie et traités alors par
des doubles doses de PEG-IFNα-2a (360 µg/sem.) (21). Ces résul-
tats encourageants doivent être confirmés par l’étude REPEAT,
où quatre groupes de patients non répondeurs au PEG-IFNα-2b
associé à la ribavirine sont comparés ; deux d’entre eux reçoivent
en association à la ribavirine un traitement d’induction (12 semaines)
par des doubles doses de PEG-IFNα-2a (360 µg), suivi d’un traite-
ment à la posologie habituelle (180 µg), pendant une durée totale
de 48 ou de 72 semaines (diapositive 8).
Le dosage plasmatique de la ribavirine pourrait également être utile
pour améliorer l’efficacité du traitement antiviral, en raison de
l’existence d’un seuil d’efficacité de la molécule (voisin de 3 mg/l)
au-delà duquel les chances de réponse virologique pourraient être
accrues (22).
ÉCHOS DE SYMPOSIUM
La lettre de l’hépato-gastroentérologue - n° 1 - vol. IX - janvier-février 2006
54

TRAITEMENT SUSPENSIF
État des lieux dans la “vraie vie”
D’après la communication de C. Trépo
(hôpital Hôtel-Dieu, Lyon)
NOREVIC 1 est une étude transversale française, réalisée dans
27 centres d’hépatologie, dont l’objectif était de décrire les moda-
lités de prise en charge des patients atteints d’hépatite chronique C
“non répondeurs à au moins un traitement antiviral”. Les données
étaient recueillies à l’aide d’un questionnaire médical au cours de
la consultation. Entre mai 2002 et octobre 2003, 389 patients étaient
inclus : 48 % des patients n’étaient pas traités, bien que 27 % aient
un score Métavir F4 à la dernière biopsie, et 22 % un score F3.
Les motifs de non-traitement étaient dans 67 % des cas liés à une
décision médicale, et dans 14 % des cas au refus du patient. Parmi
les patients sous traitement, 54 % étaient inclus dans des protocoles
thérapeutiques ; les autres bénéficiaient d’une monothérapie dans
28 % des cas, d’une bithérapie dans 29 % des cas et d’une trithéra-
pie dans 28 % des cas. La monothérapie correspondait à l’adminis-
tration de ribavirine (24 % des cas), d’interféron standard (19 % des
cas) ou pégylé (52 % des cas), ou encore de silymarine (5 % des
cas). La bithérapie était une association interféron pégylé et riba-
virine (86 % des cas), pentoxifylline et vitamine E (7 % des cas)
ou ribavirine et amantadine (7 % des cas). Enfin, la trithérapie corres-
pondait toujours à une association interféron pégylé, ribavirine et
amantadine (diapositives 9, 10, 11).
NOREVIC 2 est une enquête nationale réalisée auprès des méde-
cins, libéraux ou non, issus de centres hospitaliers universitaires
(CHU), généraux (CHG) ou régionaux ; elle concerne la place
d’un traitement antiviral d’entretien chez les patients considérés
comme “non répondeurs” à un ou plusieurs traitements anté-
rieurs. Des questionnaires permettaient l’évaluation de la défini-
tion : des patients “non répondeurs” ; des critères optimaux de l’in-
dication et des objectifs du traitement d’entretien ; du choix des
molécules et de leurs posologies ; de la durée optimale du traite-
ment. Une excellente participation a été notée, puisque 222 méde-
cins spécialistes ont complété les questionnaires de l’enquête ;
16 % étaient issus de CHU, 37,4 % de CHG, 24,2 % étaient libé-
360 µg
A180 µg
Follow-up
Pegasys®
360 µg
B180 µg
Follow-up
48 72
Pegasys®
C180 µg
Follow-up
Pegasys®
360 µg
D180 µg
Follow-up
Malades non répondeurs à l’interféron retard α-2b + ribavirine
Pegasys®
Diapositive 8. Quelle dose et quelle durée de PEG-IFNα-2a : REPEAT.
Pourcentage
Score de fibrose
(Métavir) à la dernière
biopsie (n = 379)
0 0,5
1 21,1
2 29,8
3 21,9
4 26,6
ALAT
• Patients traités
≤ N 43,5
N - 1,5 N 15,7
> 1,5 N 40,9
• Patients non traités
≤ N 22,7
N - 1,5 N 23,9
> 1,5 N 53,3
À l’inclusion
• 48 % des patients
ne sont pas traités
• 27 % ont une cirrhose
Refus du patient
14 % Autre
19 %
Décision médicale
67 %
Motifs de non-traitement
Diapositive 9. 389 patients ont été inclus entre mai 2002 et octobre 2003.
Parmi les patients
débutant un traitement
à l’inclusion, 54 % sont
inclus dans un protocole
thérapeutique
Autre 15 %
Trithérapie
28 %
Monothérapie
28 %
Bithérapie 29 %
Monothérapie
PEG-IFN (61 %)
Bithérapie
PEG-IFN
+ ribavirine (83 %)
Trithérapie
PEG-IFN + ribavirine
+ amantadine (77 %)
Diapositive 10. Patients sous traitement.
51 % sont traités
40 %
14 % 29 %17 %
Monothérapie Bithérapie Trithérapie Autre
Trithérapie
PEG-IFN + ribavirine
+ amantadine
100 %
Monothérapie
Autre traitement Pentoxifylline + vit. E (70 %)
Ribavirine
24 %
IFN
19 %
Silymarine
5 %
PEG-IFN 52 %
Bithérapie
Pentoxifylline
+ vit. E
7 %
Ribavirine +
amantadine
7 %
PEG-IFN + ribavirine
86 %
Diapositive 11. Modalités de traitement chez les patients non répondeurs
avec cirrhose.
ÉCHOS DE SYMPOSIUM
La lettre de l’hépato-gastroentérologue - n° 1 - vol. IX - janvier-février 2006 55

raux et 22,4 % avaient une activité mixte. Les critères optimaux
pour l’initiation d’un traitement d’entretien étaient un stade Méta-
vir supérieur à F3, l’existence d’une réponse biochimique, une tolé-
rance satisfaisante du traitement antiviral, et la volonté du patient
(diapositive 12). Le choix des molécules était fonction des essais
au cours de cette période ; aussi, la monothérapie par interféron
pégylé était préférée à la bithérapie (ou à la ribavirine seule) si
celle-ci était mal tolérée, et la ribavirine en monothérapie était pré-
férée en cas de contre-indication à l’interféron (diapositive 13).
Les réticences à l’indication d’un traitement d’entretien incluaient
la mauvaise tolérance du traitement, les craintes du patient, l’ab-
sence de recommandation et le manque de preuves, mais surtout
les difficultés d’évaluation de ce traitement. Il est probable que
l’utilisation plus fréquente des marqueurs non invasifs de fibrose
permettra à l’avenir de suivre plus aisément ces patients, et donc
de les traiter. Quoi qu’il en soit, le pourcentage de patients bénéfi-
ciant d’un traitement d’entretien était respectivement de 7 %, 36 %
et 34 % en cas de score Métavir inférieur à F3, égal à F3, et en
cas de cirrhose compensée (diapositive 14). Ces derniers chiffres
sont décevants ; il est évident qu’il faudrait traiter davantage ces
patients, connus pour une maladie fibrosante avancée et pour les-
quels un bénéfice peut être réellement attendu. Réduire l’activité
nécrotico-inflammatoire de la maladie, c’est-à-dire normaliser les
transaminases, peut en effet permettre de freiner le développement
de la fibrose hépatique. L’objectif du traitement d’entretien est éga-
lement de prévenir les complications de la maladie en attendant
l’arrivée de nouvelles molécules antivirales ; et les renforts sont
probablement proches…
NOREVIC 3 est lancée ; il s’agit d’un observatoire des pratiques
thérapeutiques et de surveillance d’un suivi de cohorte de patients
non répondeurs traités et non traités. Un recueil des événements
cliniques et biologiques pertinents sera effectué par le patient lui-
même ; les marqueurs indirects de fibrose pourront être utilisés. Un
site internet (www. non-répondeur.com) a par ailleurs été créé pour
une réponse aux différents items “on line” ; une mise à disposition
d’algorithmes décisionnels est également proposée.
Les arguments “pour et contre”
le traitement suspensif
■
■
Traitement suspensif : les arguments “pour”
D’après la communication de D. Guyader
(CHU Pontchaillou, Rennes)
Le traitement suspensif correspond à un traitement par interféron
pégylé et/ou ribavirine, prolongé et en association avec la correc-
tion des cofacteurs de la fibrose (consommation régulière d’alcool,
surpoids, etc.). Ses objectifs sont le ralentissement de la progres-
sion de la fibrose et la prévention des complications de la cirrhose
chez des malades n’ayant pas répondu à un traitement antiviral bien
conduit. Poynard et al. ont montré chez plus de 3 000 malades sous
traitement antiviral, quel qu’il soit, que peu de patients aggravaient
leur fibrose hépatique ; certains l’amélioraient et la plupart la stabi-
lisaient (diapositive 15) (23). Les facteurs associés à la régression
de la fibrose étaient des scores initiaux de fibrose et d’activité
faibles, une charge virale faible (inférieure à 1,3 M/ml), le jeune
âge (< 40 ans), un indice de masse corporelle inférieur à 27 kg/m2,
et l’obtention d’une réponse virologique prolongée. Un bénéfice
était observé, même quand la maladie était d’emblée sévère. La
réversion de la cirrhose n’est pas un événement si exceptionnel
(diapositive 16) ; une réelle amélioration histologique peut être
observée chez ces patients, même en l’absence de réponse virolo-
gique prolongée. Le jeune âge et un meilleur contrôle de l’activité
histologique apparaissent associés à la régression de la fibrose.
L’efficacité du traitement suspensif a ainsi été mise en évidence
dans beaucoup d’études, dont le schéma était cependant mal adapté
à cette évaluation. En effet, les biopsies hépatiques sont souvent
120%
80
40
0
95,9
Stade
Métavir > F3
69,4
Réponse
biochimique
25,6
Nombre de
traitements
antérieurs
80,8
Tolérance du
traitement
93,2
Volonté
du patient
Diapositive 12. Critères optimaux pour l’initiation d’un traitement d’en-
tretien.
%
60
80
40
20
0
85,4
PEG-IFN
monothérapie
31,5
Bithérapie
35,2
Ribavirine
monothérapie
26,5
La meilleure
combinaison
Diapositive 13. Choix des molécules.
7 %
Patients
avec score Métavir < F3 Patients
avec score Métavir = F3
Patients
avec cirrhose compensée
93 % 64 %
66 % Patients non traités
Patients bénéficiant
d’un traitement d’entretien
36 %
34 %
Diapositive 14. Pourcentage des patients ARN VHC+ bénéficiant d’un trai-
tement d’entretien.
ÉCHOS DE SYMPOSIUM
La lettre de l’hépato-gastroentérologue - n° 1 - vol. IX - janvier-février 2006
56
 6
6
 7
7
 8
8
 9
9
 10
10
1
/
10
100%